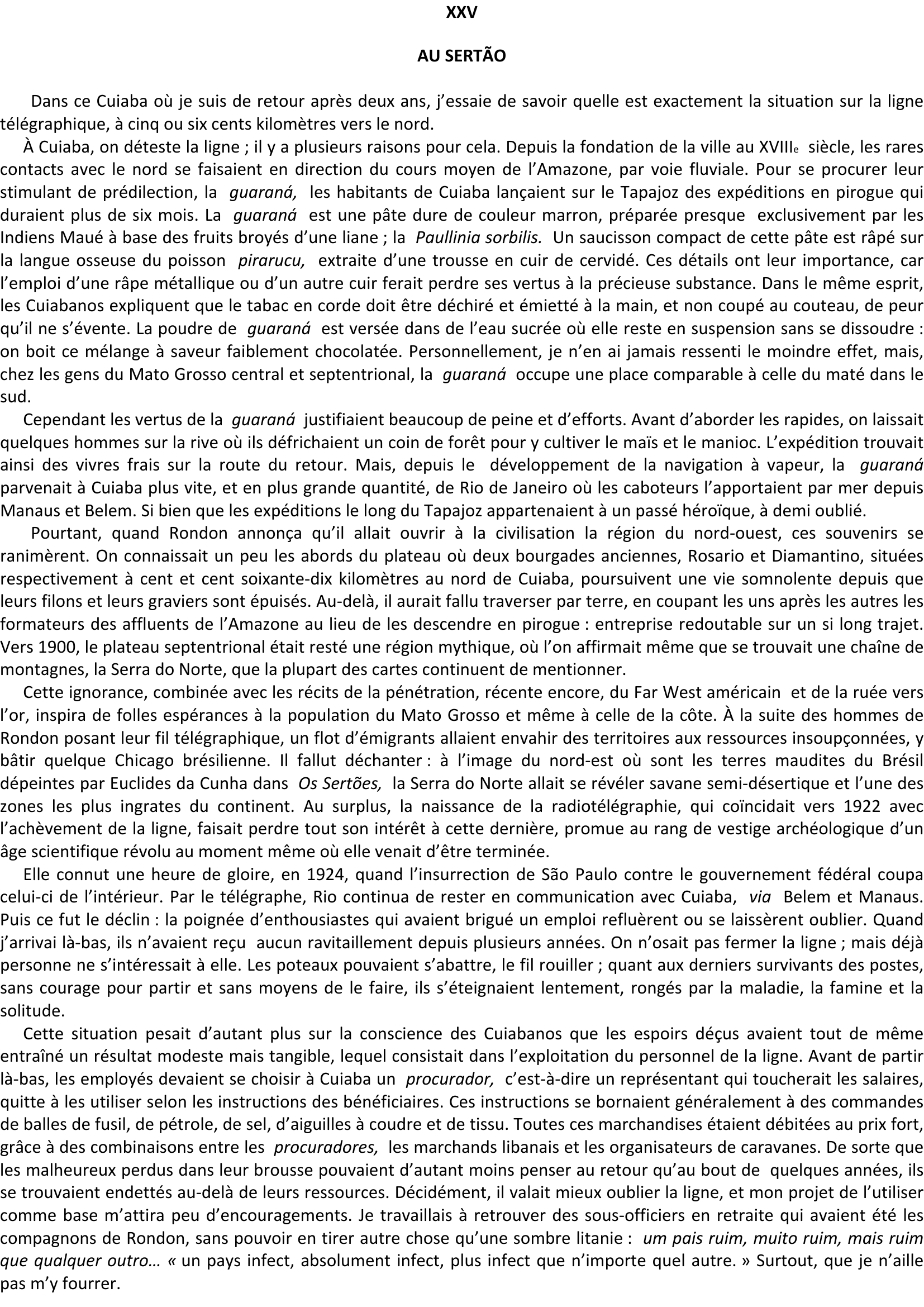Fig.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
XXV
AU SERTÃO
Dans ceCuiaba oùjesuis deretour aprèsdeuxans,j’essaie desavoir quelle estexactement lasituation surlaligne
télégraphique, àcinq ousix cents kilomètres verslenord.
À Cuiaba, ondéteste laligne ; ilya plusieurs raisonspourcela.Depuis lafondation delaville auXVIII esiècle, lesrares
contacts aveclenord sefaisaient endirection ducours moyen del’Amazone, parvoie fluviale.
Pourseprocurer leur
stimulant deprédilection, la guaraná, les
habitants deCuiaba lançaient surleTapajoz desexpéditions enpirogue qui
duraient plusdesix mois.
La guaraná est
une pâte dure decouleur marron, préparée presqueexclusivement parles
Indiens Mauéàbase desfruits broyés d’uneliane ; la Paullinia
sorbilis.
Un
saucisson compactdecette pâteestrâpé sur
la langue osseuse dupoisson pirarucu, extraite
d’unetrousse encuir decervidé.
Cesdétails ontleur importance, car
l’emploi d’unerâpemétallique oud’un autre cuirferait perdre sesvertus àla précieuse substance.
Danslemême esprit,
les Cuiabanos expliquent queletabac encorde doitêtre déchiré etémietté àla main, etnon coupé aucouteau, depeur
qu’il nes’évente.
Lapoudre de guaraná est
versée dansdel’eau sucrée oùelle reste ensuspension sanssedissoudre :
on boit cemélange àsaveur faiblement chocolatée.
Personnellement, jen’en aijamais ressenti lemoindre effet,mais,
chez lesgens duMato Grosso central etseptentrional, la guaraná occupe
uneplace comparable àcelle dumaté dansle
sud.
Cependant lesvertus dela guaraná justifiaient
beaucoupdepeine etd’efforts.
Avantd’aborder lesrapides, onlaissait
quelques hommessurlarive oùilsdéfrichaient uncoin deforêt pourycultiver lemaïs etlemanioc.
L’expédition trouvait
ainsi desvivres fraissurlaroute duretour.
Mais,depuis ledéveloppement delanavigation àvapeur, la guaraná
parvenait
àCuiaba plusvite, eten plus grande quantité, deRio deJaneiro oùles caboteurs l’apportaient parmer depuis
Manaus etBelem.
Sibien quelesexpéditions lelong duTapajoz appartenaient àun passé héroïque, àdemi oublié.
Pourtant, quandRondon annonça qu’ilallait ouvrir àla civilisation larégion dunord-ouest, cessouvenirs se
ranimèrent.
Onconnaissait unpeu lesabords duplateau oùdeux bourgades anciennes, RosarioetDiamantino, situées
respectivement àcent etcent soixante-dix kilomètresaunord deCuiaba, poursuivent uneviesomnolente depuisque
leurs filons etleurs graviers sontépuisés.
Au-delà, ilaurait fallutraverser parterre, encoupant lesuns après lesautres les
formateurs desaffluents del’Amazone aulieu deles descendre enpirogue : entreprise redoutable surunsilong trajet.
Vers 1900, leplateau septentrional étaitresté unerégion mythique, oùl’on affirmait mêmequesetrouvait unechane de
montagnes, laSerra doNorte, quelaplupart descartes continuent dementionner.
Cette ignorance, combinéeaveclesrécits delapénétration, récenteencore,duFar West américain etde laruée vers
l’or, inspira defolles espérances àla population duMato Grosso etmême àcelle delacôte.
Àla suite deshommes de
Rondon posantleurfiltélégraphique, unflot d’émigrants allaientenvahir desterritoires auxressources insoupçonnées, y
bâtir quelque Chicagobrésilienne.
Ilfallut déchanter : àl’image dunord-est oùsont lesterres maudites duBrésil
dépeintes parEuclides daCunha dans Os
Sertões, la
Serra doNorte allaitserévéler savanesemi-désertique etl’une des
zones lesplus ingrates ducontinent.
Ausurplus, lanaissance delaradiotélégraphie, quicoïncidait vers1922 avec
l’achèvement delaligne, faisait perdre toutsonintérêt àcette dernière, promueaurang devestige archéologique d’un
âge scientifique révoluaumoment mêmeoùelle venait d’êtreterminée.
Elle connut uneheure degloire, en1924, quand l’insurrection deSão Paulo contre legouvernement fédéralcoupa
celui-ci del’intérieur.
Parletélégraphe, Riocontinua derester encommunication avecCuiaba, via Belem
etManaus.
Puis cefut ledéclin : lapoignée d’enthousiastes quiavaient briguéunemploi refluèrent ouselaissèrent oublier.Quand
j’arrivai là-bas,ilsn’avaient reçuaucun ravitaillement depuisplusieurs années.Onn’osait pasfermer laligne ; maisdéjà
personne nes’intéressait àelle.
Lespoteaux pouvaient s’abattre,lefil rouiller ; quantauxderniers survivants despostes,
sans courage pourpartir etsans moyens delefaire, ilss’éteignaient lentement,rongésparlamaladie, lafamine etla
solitude.
Cette situation pesaitd’autant plussurlaconscience desCuiabanos quelesespoirs déçusavaient toutdemême
entrané unrésultat modeste maistangible, lequelconsistait dansl’exploitation dupersonnel delaligne.
Avant departir
là-bas, lesemployés devaientsechoisir àCuiaba un procurador, c’est-à-dire
unreprésentant quitoucherait lessalaires,
quitte àles utiliser selonlesinstructions desbénéficiaires.
Cesinstructions sebornaient généralement àdes commandes
de balles defusil, depétrole, desel, d’aiguilles àcoudre etde tissu.
Toutes cesmarchandises étaientdébitées auprix fort,
grâce àdes combinaisons entreles procuradores, les
marchands libanaisetles organisateurs decaravanes.
Desorte que
les malheureux perdusdansleurbrousse pouvaient d’autantmoinspenser auretour qu’auboutdequelques années,ils
se trouvaient endettésau-delàdeleurs ressources.
Décidément, ilvalait mieux oublier laligne, etmon projet del’utiliser
comme basem’attira peud’encouragements.
Jetravaillais àretrouver dessous-officiers enretraite quiavaient étéles
compagnons deRondon, sanspouvoir entirer autre chose qu’une sombre litanie : um
pais ruim, muito ruim,maisruim
que qualquer outro…« un
pays infect, absolument infect,plusinfect quen’importe quelautre. » Surtout, quejen’aille
pas m’y fourrer..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fig. 36 Le nain Séneb, sa femme et ses enfants. Groupe
- Fig. 32-33. - À gauche : Chavin, nord du Pérou (d'après
- Fig. 30 Pépi Ier et Mérenrê debout. Cuivre (détail : Pépi
- Fig. 135 Élévation du temple funéraire de Ramsès III. Fig. 136 Reconstitution-perspective du
- Fig. 3 Principaux sites paléolithiques d'Égypte. 1985, 40-41) montrent qu'il s'accommode d'étapes