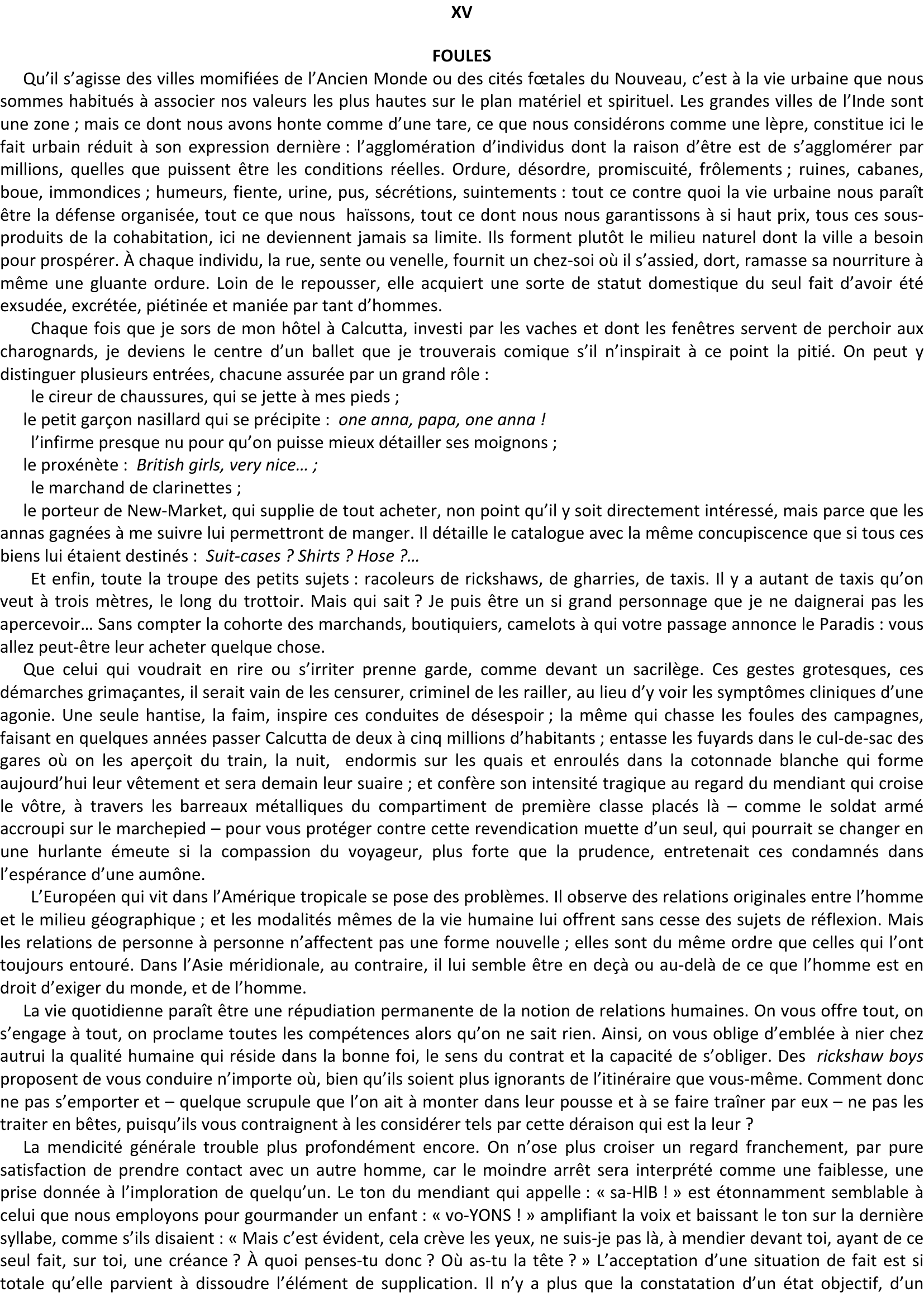la terre contre le bleu-vert limpide du ciel.
Publié le 06/01/2014

Extrait du document
«
XV
FOULES Qu’il
s’agisse desvilles momifiées del’Ancien Mondeoudes cités fœtales duNouveau, c’estàla vie urbaine quenous
sommes habitués àassocier nosvaleurs lesplus hautes surleplan matériel etspirituel.
Lesgrandes villesdel’Inde sont
une zone ; maiscedont nous avons honte comme d’unetare,ceque nous considérons commeunelèpre, constitue icile
fait urbain réduitàson expression dernière :l’agglomération d’individusdontlaraison d’êtreestdes’agglomérer par
millions, quellesquepuissent êtrelesconditions réelles.Ordure, désordre, promiscuité, frôlements ;ruines,cabanes,
boue, immondices ; humeurs,fiente,urine,pus,sécrétions, suintements : toutcecontre quoilavie urbaine nousparaît
être ladéfense organisée, toutceque nous haïssons, toutcedont nous nousgarantissons àsi haut prix,touscessous-
produits delacohabitation, icine deviennent jamaissalimite.
Ilsforment plutôtlemilieu naturel dontlaville abesoin
pour prospérer.
Àchaque individu, larue, sente ouvenelle, fournitunchez-soi oùils’assied, dort,ramasse sanourriture à
même unegluante ordure.Loindelerepousser, elleacquiert unesorte destatut domestique duseul faitd’avoir été
exsudée, excrétée, piétinéeetmaniée partant d’hommes.
Chaque foisque jesors demon hôtel àCalcutta, investiparlesvaches etdont lesfenêtres serventdeperchoir aux
charognards, jedeviens lecentre d’unballet quejetrouverais comiques’iln’inspirait àce point lapitié.
Onpeut y
distinguer plusieursentrées,chacune assuréeparungrand rôle :
le cireur dechaussures, quisejette àmes pieds ;
le petit garçon nasillard quiseprécipite : one
anna, papa, oneanna !l’infirme
presquenupour qu’on puisse mieuxdétailler sesmoignons ;
le proxénète : British
girls,verynice… ;le
marchand declarinettes ;
le porteur deNew-Market, quisupplie detout acheter, nonpoint qu’ilysoit directement intéressé,maisparce queles
annas gagnées àme suivre luipermettront demanger.
Ildétaille lecatalogue aveclamême concupiscence quesitous ces
biens luiétaient destinés : Suit-cases ?
Shirts ?Hose ?…Et
enfin, toutelatroupe despetits sujets : racoleurs derickshaws, degharries, detaxis.
Ilya autant detaxis qu’on
veut àtrois mètres, lelong dutrottoir.
Maisquisait ? Jepuis être unsigrand personnage quejene daignerai pasles
apercevoir… Sanscompter lacohorte desmarchands, boutiquiers, camelotsàqui votre passage annonce leParadis : vous
allez peut-être leuracheter quelque chose.
Que celui quivoudrait enrire ous’irriter prennegarde,comme devantunsacrilège.
Cesgestes grotesques, ces
démarches grimaçantes, ilserait vaindeles censurer, crimineldeles railler, aulieu d’yvoir lessymptômes cliniquesd’une
agonie.
Uneseule hantise, lafaim, inspire cesconduites dedésespoir ; lamême quichasse lesfoules descampagnes,
faisant enquelques annéespasserCalcutta dedeux àcinq millions d’habitants ; entasselesfuyards danslecul-de-sac des
gares oùon les aperçoit dutrain, lanuit, endormis surlesquais etenroulés danslacotonnade blanchequiforme
aujourd’hui leurvêtement etsera demain leursuaire ; etconfère sonintensité tragiqueauregard dumendiant quicroise
le vôtre, àtravers lesbarreaux métalliques ducompartiment depremière classeplacés là–comme lesoldat armé
accroupi surlemarchepied –pour vousprotéger contrecetterevendication muetted’unseul, quipourrait sechanger en
une hurlante émeutesila compassion duvoyageur, plusforte quelaprudence, entretenait cescondamnés dans
l’espérance d’uneaumône.
L’Européen quivitdans l’Amérique tropicalesepose desproblèmes.
Ilobserve desrelations originales entrel’homme
et lemilieu géographique ; etles modalités mêmesdelavie humaine luioffrent sanscesse dessujets deréflexion.
Mais
les relations depersonne àpersonne n’affectent pasune forme nouvelle ; ellessontdumême ordrequecelles quil’ont
toujours entouré.
Dansl’Asie méridionale, aucontraire, illui semble êtreendeçà ouau-delà deceque l’homme esten
droit d’exiger dumonde, etde l’homme.
La vie quotidienne paraîtêtreunerépudiation permanente delanotion derelations humaines.
Onvous offre tout,on
s’engage àtout, onproclame touteslescompétences alorsqu’on nesait rien.
Ainsi, onvous oblige d’emblée ànier chez
autrui laqualité humaine quiréside danslabonne foi,lesens ducontrat etlacapacité des’obliger.
Des rickshaw
boys
proposent
devous conduire n’importe où,bien qu’ils soient plusignorants del’itinéraire quevous-même.
Commentdonc
ne pas s’emporter et–quelque scrupule quel’onaitàmonter dansleurpousse etàse faire traner pareux –ne pas les
traiter enbêtes, puisqu’ils vouscontraignent àles considérer telsparcette déraison quiestlaleur ?
La mendicité généraletroubleplusprofondément encore.Onn’ose pluscroiser unregard franchement, parpure
satisfaction deprendre contactavecunautre homme, carlemoindre arrêtserainterprété commeunefaiblesse, une
prise donnée àl’imploration dequelqu’un.
Leton dumendiant quiappelle : « sa-HlB ! » estétonnamment semblableà
celui quenous employons pourgourmander unenfant : « vo-YONS ! » amplifiantlavoix etbaissant leton surladernière
syllabe, commes’ilsdisaient : « Maisc’estévident, celacrève lesyeux, nesuis-je paslà,àmendier devanttoi,ayant dece
seul fait,surtoi, une créance ? Àquoi penses-tu donc ?Oùas-tu latête ? » L’acceptation d’unesituation defait estsi
totale qu’elle parvient àdissoudre l’élémentdesupplication.
Iln’y aplus quelaconstatation d’unétatobjectif, d’un.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CIEL ET LA TERRE (Le) (résumé & analyse)
- BLEU DU CIEL (Le). Georges Bataille (résumé)
- BLEU DU CIEL (le) de Georges Bataille
- BLEU DU CIEL (Le) Georges Bataille - résumé de l'œuvre
- ENTRE CIEL ET TERRE d’Otto Ludwig (résumé)