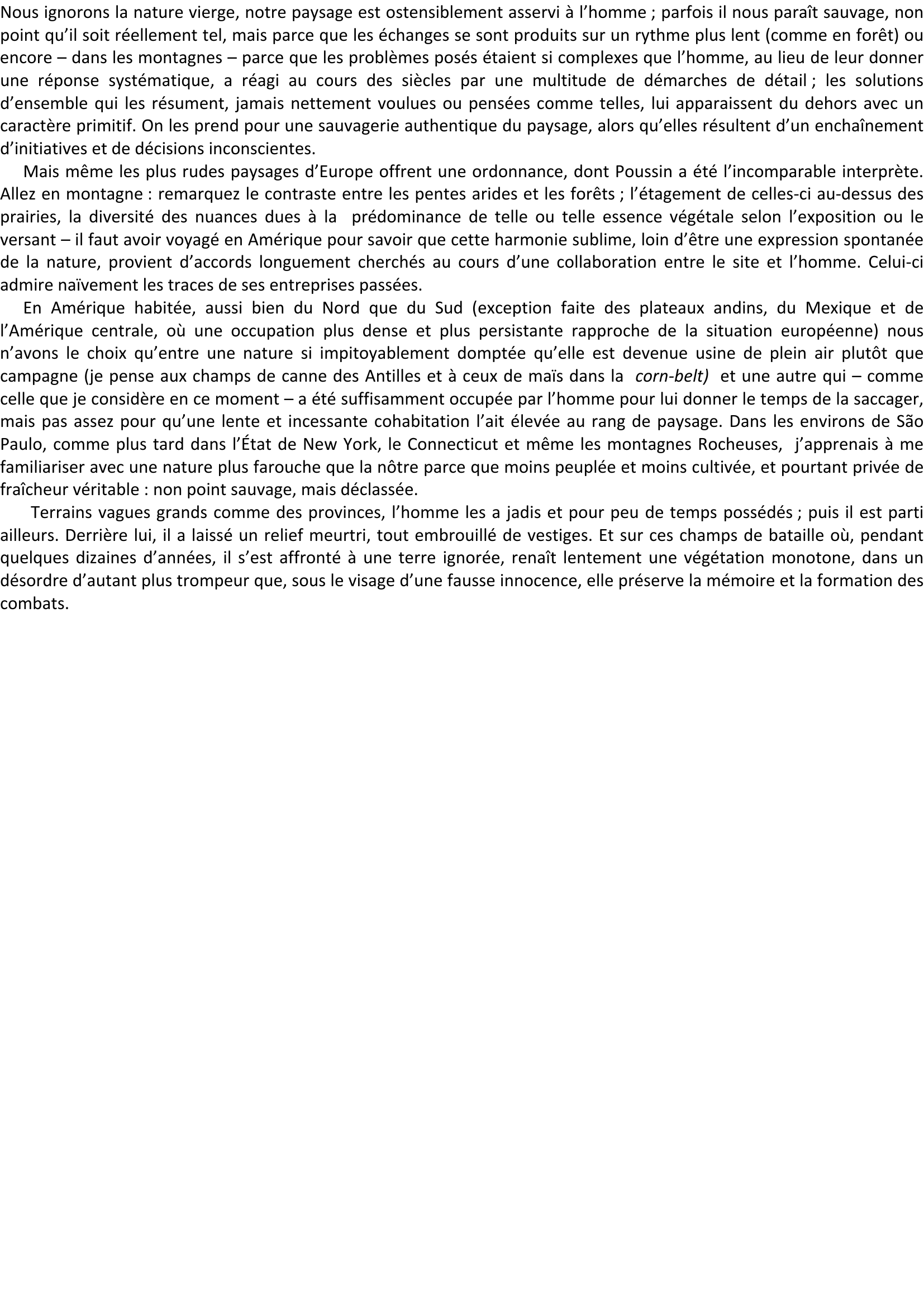retrouver sa pareille, il faudrait aller à plusieurs milliers de kilomètres vers le nord, près du bassin amazonien. Pendant que l'auto gémit dans les virages qu'on ne peut même plus qualifier de « têtes d'épingle » tant ils sont en spirale, à travers un brouillard qui feint la haute montagne sous d'autres climats, j'ai loisir d'inspecter les arbres et les plantes étagés devant mon regard comme des spécimens de musée. Cette forêt diffère de la nôtre par le contraste entre le feuillage et les troncs. Celui-ci est plus sombre, ses nuances de vert évoquent le minéral plutôt que le végétal et, dans le premier règne, le jade et la tourmaline davantage encore que l'émeraude et le péridot. Au contraire, les troncs, blancs ou grisâtres, se silhouettent comme des ossements sur le fond obscur du feuillage. Trop près de la paroi pour considérer l'ensemble, j'examinais surtout les détails. Des plantes plus copieuses que celles d'Europe dressent des tiges et des feuilles qui semblent découpées dans le métal, tant leur port est assuré et tant leur forme pleine de sens paraît à l'abri des épreuves du temps. Vue de dehors, cette nature est d'un autre ordre que la nôtre ; elle manifeste un degré supérieur de présence et de permanence. Comme dans les paysages exotiques d'Henri Rousseau, ses êtres atteignent à la dignité d'objets. Une fois déjà, j'ai ressenti une impression analogue. C'était à l'occasion de premières vacances en Provence, après des années vouées à la Normandie et à la Bretagne. À une végétation restée pour moi confuse et sans intérêt, en succédait une autre où chaque espèce m'offrait une signification particulière. C'était un peu comme si j'étais transporté d'un village banal dans un site archéologique où chaque pierre ne serait plus un élément de maison, mais un témoin. Je parcourais, exalté, la rocaille, me répétant que chaque brindille ici s'appelait thym, origan, romarin, basilic, ciste, laurier, lavande, arbousier, câprier, lentisque, qu'elle possédait ses lettres de noblesse et qu'elle avait reçu sa charge privilégiée. Et la lourde senteur résineuse m'était à la fois preuve et raison d'un univers végétal plus notable. Ce que la flore provençale m'apportait alors par son arôme, celle du tropique me le suggérait maintenant par sa forme. Non plus monde d'odeurs et d'usages, herbier de recettes et de superstitions, mais troupe végétale pareille à un corps de grandes danseuses dont chacune aurait arrêté son geste dans la position la plus sensible, comme pour rendre manifeste un dessein mieux apparent s'il n'avait plus rien à craindre de la vie ; ballet immobile, troublé seulement par l'agitation minérale des sources. Quand on atteint le sommet, encore une fois tout change ; finie la moite chaleur des tropiques et les héroïques enchevêtrements de lianes et de rochers. Au lieu de l'immense panorama miroitant, qu'on surplombe pour la dernière fois jusqu'à la mer depuis le belvédère de la serra, on aperçoit dans la direction opposée un plateau inégal et dépouillé, déroulant crêtes et ravines sous un ciel quinteux. Il tombe là-dessus une bruine bretonne. Car nous sommes à près de 1 000 mètres d'altitude, bien que la mer soit encore proche. Au sommet de cette paroi commencent les hautes terres, succession de gradins dont la chaîne côtière forme la première et la plus dure marche. Ces terres s'abaissent insensiblement en direction du nord. Jusqu'au bassin de l'Amazone dans lequel elles s'effondrent par de grandes failles à 3 000 kilomètres d'ici, leur déclin ne sera interrompu qu'à deux reprises, par des alignements de falaises : Serra de Botucatu, à 500 kilomètres environ de la côte, et Chapada de Mato Grosso à 1 500. Je les franchirai l'une et l'autre avant de retrouver, autour des grands fleuves amazoniens, une forêt semblable à celle qui s'accroche au rempart côtier ; la plus grande partie du Brésil, circonscrite entre l'Atlantique, l'Amazone et le Paraguay, figure une table en pente redressée du côté de la mer : tremplin crépu de brousse encerclé par un humide anneau de jungle et de marais. Autour de moi, l'érosion a ravagé les terres au relief inachevé, mais l'homme surtout est responsable de l'aspect chaotique du paysage. On a d'abord défriché pour cultiver ; mais au bout de quelques années, le sol épuisé et lavé par les pluies s'est dérobé aux caféiers. Et les plantations se sont transportées plus loin, là où la terre était encore vierge et fertile. Entre l'homme et le sol, jamais ne s'est instaurée cette réciprocité attentive qui, dans l'Ancien Monde, fonde l'intimité millénaire au cours de laquelle ils se sont mutuellement façonnés. Ici, le sol a été violé et détruit. Une agriculture de rapine s'est saisie d'une richesse gisante et puis s'en est allée ailleurs, après avoir arraché quelques profits. C'est justement qu'on décrit l'aire d'activité des pionniers comme une frange. Car, dévastant le sol aussi vite, presque, qu'ils le défrichent, ils semblent condamnés à n'occuper jamais qu'une bande mouvante, mordant d'un côté sur le sol vierge et abandonnant de l'autre des jachères exténuées. Comme un feu de brousse fuyant en avant l'épuisement de sa substance, en cent ans la flambée agricole a traversé l'État de São Paulo. Allumée au milieu du XIXe siècle par les mineiros délaissant leurs filons taris, elle s'est déplacée d'est en ouest, et j'allais bientôt la rattraper de l'autre côté du leuve Parana, s'ouvrant un passage à travers une foule confuse de troncs abattus et de familles déracinées. Le territoire traversé par la route de Santos à São Paulo est l'un des plus anciennement exploités du pays ; aussi emble-t-il un site archéologique dédié à une agriculture défunte. Des coteaux, des talus autrefois boisés laissent apercevoir leur ossature sous un mince manteau d'herbe rêche. On devine par endroits le pointillé des buttes qui marquaient l'emplacement des pieds de caféiers ; elles saillent sous les flancs herbus, pareilles à des mamelles atrophiées. Dans les vallées, la végétation a repris possession du sol ; mais ce n'est plus la noble architecture de la forêt primitive : la capoeira, c'est-à-dire la forêt secondaire, renaît comme un fourré continu d'arbres grêles. De temps à autre, on remarque la cabane d'un émigrant japonais qui s'emploie, selon des méthodes archaïques, à régénérer un coin e sol pour y installer des cultures maraîchères. Le voyageur européen est déconcerté par ce paysage qui ne rentre dans aucune de ses catégories traditionnelles. Nous ignorons la nature vierge, notre paysage est ostensiblement asservi à l'homme ; parfois il nous paraît sauvage, non point qu'il soit réellement tel, mais parce que les échanges se sont produits sur un rythme plus lent (comme en forêt) ou ncore - dans les montagnes - parce que les problèmes posés étaient si complexes que l'homme, au lieu de leur donner une réponse systématique, a réagi au cours des siècles par une multitude de démarches de détail ; les solutions d'ensemble qui les résument, jamais nettement voulues ou pensées comme telles, lui apparaissent du dehors avec un caractère primitif. On les prend pour une sauvagerie authentique du paysage, alors qu'elles résultent d'un enchaînement d'initiatives et de décisions inconscientes. Mais même les plus rudes paysages d'Europe offrent une ordonnance, dont Poussin a été l'incomparable interprète. Allez en montagne : remarquez le contraste entre les pentes arides et les forêts ; l'étagement de celles-ci au-dessus des prairies, la diversité des nuances dues à la prédominance de telle ou telle essence végétale selon l'exposition ou le versant - il faut avoir voyagé en Amérique pour savoir que cette harmonie sublime, loin d'être une expression spontanée de la nature, provient d'accords longuement cherchés au cours d'une collaboration entre le site et l'homme. Celui-ci admire naïvement les traces de ses entreprises passées. En Amérique habitée, aussi bien du Nord que du Sud (exception faite des plateaux andins, du Mexique et de l'Amérique centrale, où une occupation plus dense et plus persistante rapproche de la situation européenne) nous 'avons le choix qu'entre une nature si impitoyablement domptée qu'elle est devenue usine de plein air plutôt que campagne (je pense aux champs de canne des Antilles et à ceux de maïs dans la corn-belt) et une autre qui - comme celle que je considère en ce moment - a été suffisamment occupée par l'homme pour lui donner le temps de la saccager, mais pas assez pour qu'une lente et incessante cohabitation l'ait élevée au rang de paysage. Dans les environs de São Paulo, comme plus tard dans l'État de New York, le Connecticut et même les montagnes Rocheuses, j'apprenais à me familiariser avec une nature plus farouche que la nôtre parce que moins peuplée et moins cultivée, et pourtant privée de fraîcheur véritable : non point sauvage, mais déclassée. Terrains vagues grands comme des provinces, l'homme les a jadis et pour peu de temps possédés ; puis il est parti ailleurs. Derrière lui, il a laissé un relief meurtri, tout embrouillé de vestiges. Et sur ces champs de bataille où, pendant quelques dizaines d'années, il s'est affronté à une terre ignorée, renaît lentement une végétation monotone, dans un désordre d'autant plus trompeur que, sous le visage d'une fausse innocence, elle préserve la mémoire et la formation des combats. XI SÃO POLO Un esprit malicieux a défini l'Amérique comme un pays qui a passé de la barbarie à la décadence sans connaître la civilisation. On pourrait, avec plus de justesse, appliquer la formule aux villes du Nouveau Monde : elles vont de la fraîcheur à la décrépitude sans s'arrêter à l'ancienneté. Une étudiante brésilienne m'est revenue en larmes après son premier voyage en France : Paris lui avait paru sale, avec ses bâtiments noircis. La blancheur et la propreté étaient les seuls critères à sa disposition pour estimer une ville. Mais ces vacances hors du temps à quoi convie le genre monumental, cette vie sans âge qui caractérise les plus belles cités, devenues objet de contemplation et de réflexion, et non plus simples instruments de la fonction urbaine - les villes américaines n'y accèdent jamais. Dans les villes du Nouveau Monde, que ce soit New York, Chicago ou São Paulo qu'on lui a souvent comparée, ce n'est pas le manque de vestiges qui me frappe : cette absence est un élément de leur signification. À l'inverse de ces touristes européens qui boudent parce qu'ils ne peuvent ajouter à leur tableau de chasse une autre cathédrale du XIIIe, je me réjouis de m'adapter à un système sans dimension temporelle, pour interpréter une forme différente de civilisation. Mais c'est dans l'erreur opposée que je tombe : puisque ces villes sont neuves et tirent de cette nouveauté leur être et leur justification, je leur pardonne mal de ne pas le rester. Pour les villes européennes, le passage des siècles constitue une promotion ; pour les américaines, celui des années est une déchéance. Car elles ne sont pas seulement fraîchement construites : elles sont construites pour se renouveler avec la même rapidité qu'elles furent bâties, c'est-à-dire mal. Au moment où les nouveaux quartiers se dressent, ce sont à peine des éléments urbains : ils sont trop brillants, trop neufs, trop joyeux pour cela. Plutôt on croirait une foire, une exposition internationale édifiée pour quelques mois. Après ce délai, la fête se termine et ces grands bibelots dépérissent : les façades s'écaillent, la pluie et la suie y tracent des sillons, le style se démode, l'ordonnance primitive disparaît sous les démolitions qu'exige, à côté, une nouvelle impatience. Ce ne sont pas des villes neuves contrastant avec des villes anciennes ; mais des villes à cycle d'évolution très court, comparées à des villes à cycle lent. Certaines cités d'Europe s'endorment doucement dans la mort ; celles du Nouveau Monde vivent fiévreusement dans une maladie chronique ; perpétuellement jeunes, elles ne sont pourtant jamais saines. En visitant New York ou Chicago en 1941, en arrivant à São Paulo en 1935, ce n'est donc pas la nouveauté qui m'a d'abord étonné, mais la précocité des ravages du temps. Je n'ai pas été surpris qu'il manquât à ces villes dix siècles, j'ai été saisi de constater que tant de leurs quartiers eussent déjà cinquante ans ; de ce que, sans honte, ils fissent montre de telles flétrissures puisque, aussi bien, la seule parure à quoi ils pourraient prétendre serait celle d'une jeunesse fugitive pour eux comme pour des vivants. Ferrailles, tramways rouges comme des voitures de pompiers, bars d'acajou à balustrade de laiton poli ; entrepôts de briques dans des ruelles solitaires où le vent seul balaye les ordures ; paroisses rustiques au pied des bureaux et des bourses au style de cathédrale ; labyrinthes d'immeubles verdis surplombant des gouffres entrecroisés de tranchées, de ponts tournants et de passerelles, ville sans cesse accrue en hauteur par l'accumulation de ses propres décombres supportant les constructions neuves : Chicago, image des Amériques, il n'est pas surprenant qu'en toi le Nouveau Monde chérisse la mémoire des années 1880 ; car la seule antiquité à quoi il puisse prétendre dans sa soif de renouvellement, c'est cet écart modeste d'un demi-siècle, trop bref pour servir au jugement de nos sociétés millénaires, mais qui lui donne, à lui qui ne pense pas le temps, une chance menue de s'attendrir sur sa jeunesse transitoire. En 1935, les Paulistes se vantaient qu'on construisît dans leur ville, en moyenne, une maison par heure. Il s'agissait alors de villas ; on m'assure que le rythme est resté le même, mais pour les immeubles. La ville se développe à une telle vitesse qu'il est impossible de s'en procurer le plan : chaque semaine demanderait une nouvelle édition. Il paraît même qu'en se rendant en taxi à un rendez-vous fixé quelques semaines auparavant, on risque d'être en avance d'un jour sur le quartier. Dans ces conditions, l'évocation de souvenirs vieux de presque vingt ans ressemble à la contemplation d'une photographie fanée. Au moins peut-elle offrir un intérêt documentaire ; je verse les fonds de tiroir de ma mémoire aux archives municipales. On dépeignait alors São Paulo comme une ville laide. Sans doute, les immeubles du centre étaient pompeux et démodés ; la prétentieuse indigence de leur ornementation se trouvait encore aggravée par la pauvreté du gros oeuvre : statues et guirlandes n'étaient pas en pierre, mais en plâtre barbouillé de jaune pour feindre une patine. D'une façon générale, la ville offrait ces tons soutenus et arbitraires qui caractérisent les mauvaises constructions dont l'architecte a dû recourir au badigeon, autant pour protéger que pour dissimuler le substrat. Dans les constructions de pierre, les extravagances du style 1890 sont partiellement excusées par la pesanteur et la densité du matériau : elles se situent à leur plan d'accessoire. Tandis que là, ces boursouflures laborieuses évoquent seulement les improvisations dermiques de la lèpre. Sous les couleurs fausses, les ombres sortent plus noires ; des rues étroites ne permettent pas à une couche d'air trop mince de « faire atmosphère » et il en résulte un sentiment d'irréalité, comme si tout cela n'était pas une ville, mais un faux-semblant de constructions hâtivement édifiées pour les besoins d'une prise de vue cinématographique ou d'une représentation théâtrale. Et pourtant, São Paulo ne m'a jamais paru laide : c'était une ville sauvage, comme le sont toutes les villes américaines