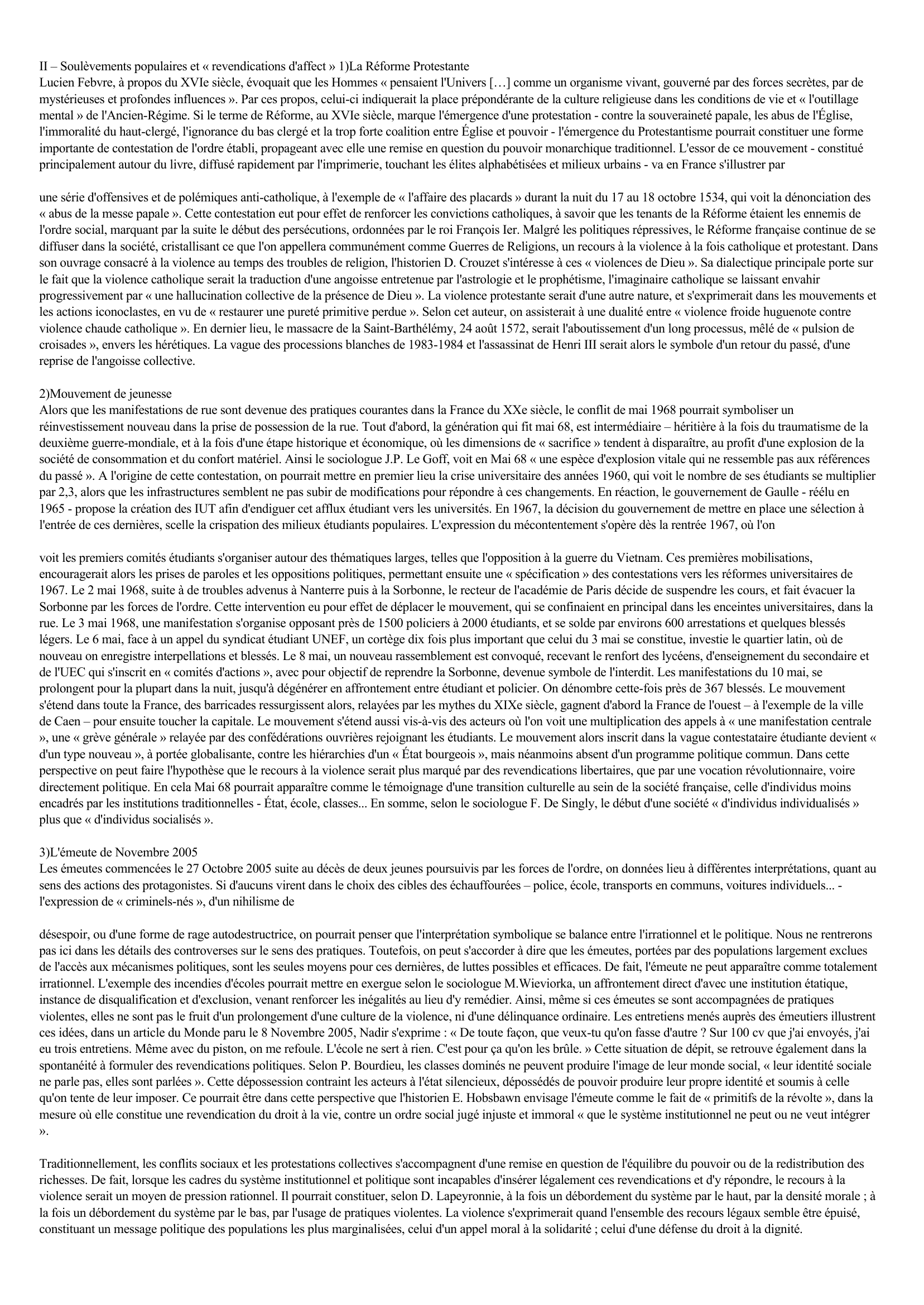Le rapport à la violence en France du XVIe à nos jours
Publié le 17/08/2012
Extrait du document
De fait, l'émeute ne peut apparaître comme totalement irrationnel. L'exemple des incendies d'écoles pourrait mettre en exergue selon le sociologue M.Wieviorka, un affrontement direct d'avec une institution étatique, instance de disqualification et d'exclusion, venant renforcer les inégalités au lieu d'y remédier. Ainsi, même si ces émeutes se sont accompagnées de pratiques violentes, elles ne sont pas le fruit d'un prolongement d'une culture de la violence, ni d'une délinquance ordinaire. Les entretiens menés auprès des émeutiers illustrent ces idées, dans un article du Monde paru le 8 Novembre 2005, Nadir s'exprime : « De toute façon, que veux-tu qu’on fasse d’autre ? Sur 100 cv que j’ai envoyés, j’ai eu trois entretiens. Même avec du piston, on me refoule. L’école ne sert à rien. C’est pour ça qu’on les brûle. « Cette situation de dépit, se retrouve également dans la spontanéité à formuler des revendications politiques. Selon P. Bourdieu, les classes dominés ne peuvent produire l'image de leur monde social, « leur identité sociale ne parle pas, elles sont parlées «. Cette dépossession contraint les acteurs à l'état silencieux, dépossédés de pouvoir produire leur propre identité et soumis à celle qu'on tente de leur imposer. Ce pourrait être dans cette perspective que l'historien E. Hobsbawn envisage l'émeute comme le fait de « primitifs de la révolte «, dans la mesure où elle constitue une revendication du droit à la vie, contre un ordre social jugé injuste et immoral « que le système institutionnel ne peut ou ne veut intégrer «.
«
II – Soulèvements populaires et « revendications d'affect » 1)La Réforme ProtestanteLucien Febvre, à propos du XVIe siècle, évoquait que les Hommes « pensaient l'Univers […] comme un organisme vivant, gouverné par des forces secrètes, par demystérieuses et profondes influences ».
Par ces propos, celui-ci indiquerait la place prépondérante de la culture religieuse dans les conditions de vie et « l'outillagemental » de l'Ancien-Régime.
Si le terme de Réforme, au XVIe siècle, marque l'émergence d'une protestation - contre la souveraineté papale, les abus de l'Église,l'immoralité du haut-clergé, l'ignorance du bas clergé et la trop forte coalition entre Église et pouvoir - l'émergence du Protestantisme pourrait constituer une formeimportante de contestation de l'ordre établi, propageant avec elle une remise en question du pouvoir monarchique traditionnel.
L'essor de ce mouvement - constituéprincipalement autour du livre, diffusé rapidement par l'imprimerie, touchant les élites alphabétisées et milieux urbains - va en France s'illustrer par
une série d'offensives et de polémiques anti-catholique, à l'exemple de « l'affaire des placards » durant la nuit du 17 au 18 octobre 1534, qui voit la dénonciation des« abus de la messe papale ».
Cette contestation eut pour effet de renforcer les convictions catholiques, à savoir que les tenants de la Réforme étaient les ennemis del'ordre social, marquant par la suite le début des persécutions, ordonnées par le roi François Ier.
Malgré les politiques répressives, le Réforme française continue de sediffuser dans la société, cristallisant ce que l'on appellera communément comme Guerres de Religions, un recours à la violence à la fois catholique et protestant.
Dansson ouvrage consacré à la violence au temps des troubles de religion, l'historien D.
Crouzet s'intéresse à ces « violences de Dieu ».
Sa dialectique principale porte surle fait que la violence catholique serait la traduction d'une angoisse entretenue par l'astrologie et le prophétisme, l'imaginaire catholique se laissant envahirprogressivement par « une hallucination collective de la présence de Dieu ».
La violence protestante serait d'une autre nature, et s'exprimerait dans les mouvements etles actions iconoclastes, en vu de « restaurer une pureté primitive perdue ».
Selon cet auteur, on assisterait à une dualité entre « violence froide huguenote contreviolence chaude catholique ».
En dernier lieu, le massacre de la Saint-Barthélémy, 24 août 1572, serait l'aboutissement d'un long processus, mêlé de « pulsion decroisades », envers les hérétiques.
La vague des processions blanches de 1983-1984 et l'assassinat de Henri III serait alors le symbole d'un retour du passé, d'unereprise de l'angoisse collective.
2)Mouvement de jeunesseAlors que les manifestations de rue sont devenue des pratiques courantes dans la France du XXe siècle, le conflit de mai 1968 pourrait symboliser unréinvestissement nouveau dans la prise de possession de la rue.
Tout d'abord, la génération qui fit mai 68, est intermédiaire – héritière à la fois du traumatisme de ladeuxième guerre-mondiale, et à la fois d'une étape historique et économique, où les dimensions de « sacrifice » tendent à disparaître, au profit d'une explosion de lasociété de consommation et du confort matériel.
Ainsi le sociologue J.P.
Le Goff, voit en Mai 68 « une espèce d'explosion vitale qui ne ressemble pas aux référencesdu passé ».
A l'origine de cette contestation, on pourrait mettre en premier lieu la crise universitaire des années 1960, qui voit le nombre de ses étudiants se multiplierpar 2,3, alors que les infrastructures semblent ne pas subir de modifications pour répondre à ces changements.
En réaction, le gouvernement de Gaulle - réélu en1965 - propose la création des IUT afin d'endiguer cet afflux étudiant vers les universités.
En 1967, la décision du gouvernement de mettre en place une sélection àl'entrée de ces dernières, scelle la crispation des milieux étudiants populaires.
L'expression du mécontentement s'opère dès la rentrée 1967, où l'on
voit les premiers comités étudiants s'organiser autour des thématiques larges, telles que l'opposition à la guerre du Vietnam.
Ces premières mobilisations,encouragerait alors les prises de paroles et les oppositions politiques, permettant ensuite une « spécification » des contestations vers les réformes universitaires de1967.
Le 2 mai 1968, suite à de troubles advenus à Nanterre puis à la Sorbonne, le recteur de l'académie de Paris décide de suspendre les cours, et fait évacuer laSorbonne par les forces de l'ordre.
Cette intervention eu pour effet de déplacer le mouvement, qui se confinaient en principal dans les enceintes universitaires, dans larue.
Le 3 mai 1968, une manifestation s'organise opposant près de 1500 policiers à 2000 étudiants, et se solde par environs 600 arrestations et quelques blesséslégers.
Le 6 mai, face à un appel du syndicat étudiant UNEF, un cortège dix fois plus important que celui du 3 mai se constitue, investie le quartier latin, où denouveau on enregistre interpellations et blessés.
Le 8 mai, un nouveau rassemblement est convoqué, recevant le renfort des lycéens, d'enseignement du secondaire etde l'UEC qui s'inscrit en « comités d'actions », avec pour objectif de reprendre la Sorbonne, devenue symbole de l'interdit.
Les manifestations du 10 mai, seprolongent pour la plupart dans la nuit, jusqu'à dégénérer en affrontement entre étudiant et policier.
On dénombre cette-fois près de 367 blessés.
Le mouvements'étend dans toute la France, des barricades ressurgissent alors, relayées par les mythes du XIXe siècle, gagnent d'abord la France de l'ouest – à l'exemple de la villede Caen – pour ensuite toucher la capitale.
Le mouvement s'étend aussi vis-à-vis des acteurs où l'on voit une multiplication des appels à « une manifestation centrale», une « grève générale » relayée par des confédérations ouvrières rejoignant les étudiants.
Le mouvement alors inscrit dans la vague contestataire étudiante devient «d'un type nouveau », à portée globalisante, contre les hiérarchies d'un « État bourgeois », mais néanmoins absent d'un programme politique commun.
Dans cetteperspective on peut faire l'hypothèse que le recours à la violence serait plus marqué par des revendications libertaires, que par une vocation révolutionnaire, voiredirectement politique.
En cela Mai 68 pourrait apparaître comme le témoignage d'une transition culturelle au sein de la société française, celle d'individus moinsencadrés par les institutions traditionnelles - État, école, classes...
En somme, selon le sociologue F.
De Singly, le début d'une société « d'individus individualisés »plus que « d'individus socialisés ».
3)L'émeute de Novembre 2005Les émeutes commencées le 27 Octobre 2005 suite au décès de deux jeunes poursuivis par les forces de l'ordre, on données lieu à différentes interprétations, quant ausens des actions des protagonistes.
Si d'aucuns virent dans le choix des cibles des échauffourées – police, école, transports en communs, voitures individuels...
-l'expression de « criminels-nés », d'un nihilisme de
désespoir, ou d'une forme de rage autodestructrice, on pourrait penser que l'interprétation symbolique se balance entre l'irrationnel et le politique.
Nous ne rentreronspas ici dans les détails des controverses sur le sens des pratiques.
Toutefois, on peut s'accorder à dire que les émeutes, portées par des populations largement excluesde l'accès aux mécanismes politiques, sont les seules moyens pour ces dernières, de luttes possibles et efficaces.
De fait, l'émeute ne peut apparaître comme totalementirrationnel.
L'exemple des incendies d'écoles pourrait mettre en exergue selon le sociologue M.Wieviorka, un affrontement direct d'avec une institution étatique,instance de disqualification et d'exclusion, venant renforcer les inégalités au lieu d'y remédier.
Ainsi, même si ces émeutes se sont accompagnées de pratiquesviolentes, elles ne sont pas le fruit d'un prolongement d'une culture de la violence, ni d'une délinquance ordinaire.
Les entretiens menés auprès des émeutiers illustrentces idées, dans un article du Monde paru le 8 Novembre 2005, Nadir s'exprime : « De toute façon, que veux-tu qu'on fasse d'autre ? Sur 100 cv que j'ai envoyés, j'aieu trois entretiens.
Même avec du piston, on me refoule.
L'école ne sert à rien.
C'est pour ça qu'on les brûle.
» Cette situation de dépit, se retrouve également dans laspontanéité à formuler des revendications politiques.
Selon P.
Bourdieu, les classes dominés ne peuvent produire l'image de leur monde social, « leur identité socialene parle pas, elles sont parlées ».
Cette dépossession contraint les acteurs à l'état silencieux, dépossédés de pouvoir produire leur propre identité et soumis à cellequ'on tente de leur imposer.
Ce pourrait être dans cette perspective que l'historien E.
Hobsbawn envisage l'émeute comme le fait de « primitifs de la révolte », dans lamesure où elle constitue une revendication du droit à la vie, contre un ordre social jugé injuste et immoral « que le système institutionnel ne peut ou ne veut intégrer».
Traditionnellement, les conflits sociaux et les protestations collectives s'accompagnent d'une remise en question de l'équilibre du pouvoir ou de la redistribution desrichesses.
De fait, lorsque les cadres du système institutionnel et politique sont incapables d'insérer légalement ces revendications et d'y répondre, le recours à laviolence serait un moyen de pression rationnel.
Il pourrait constituer, selon D.
Lapeyronnie, à la fois un débordement du système par le haut, par la densité morale ; àla fois un débordement du système par le bas, par l'usage de pratiques violentes.
La violence s'exprimerait quand l'ensemble des recours légaux semble être épuisé,constituant un message politique des populations les plus marginalisées, celui d'un appel moral à la solidarité ; celui d'une défense du droit à la dignité..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Place des femmes dans la famille en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle
- Thème 1: Le rapport des sociétés à leur passé Chapitre 2 : L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France.
- HISTOIRE LITTÉRAIRE DU SENTIMENT RELIGIEUX EN FRANCE DEPUIS LA FIN DES GUERRES DE RELIGION JUSQU’A NOS JOURS.
- RAPPORT SUR LES CHOSES DE LA FRANCE de Machiavel
- Michel de l'Hospital par Michel François S'il est une figure qui mérite d'avoir sa place parmi les hommes d'État qui se sont imposés comme tels, non pas seulement dans la France du XVIe siècle mais dans l'Europe des temps modernes, c'est bien celle de Michel de L'Hospital.