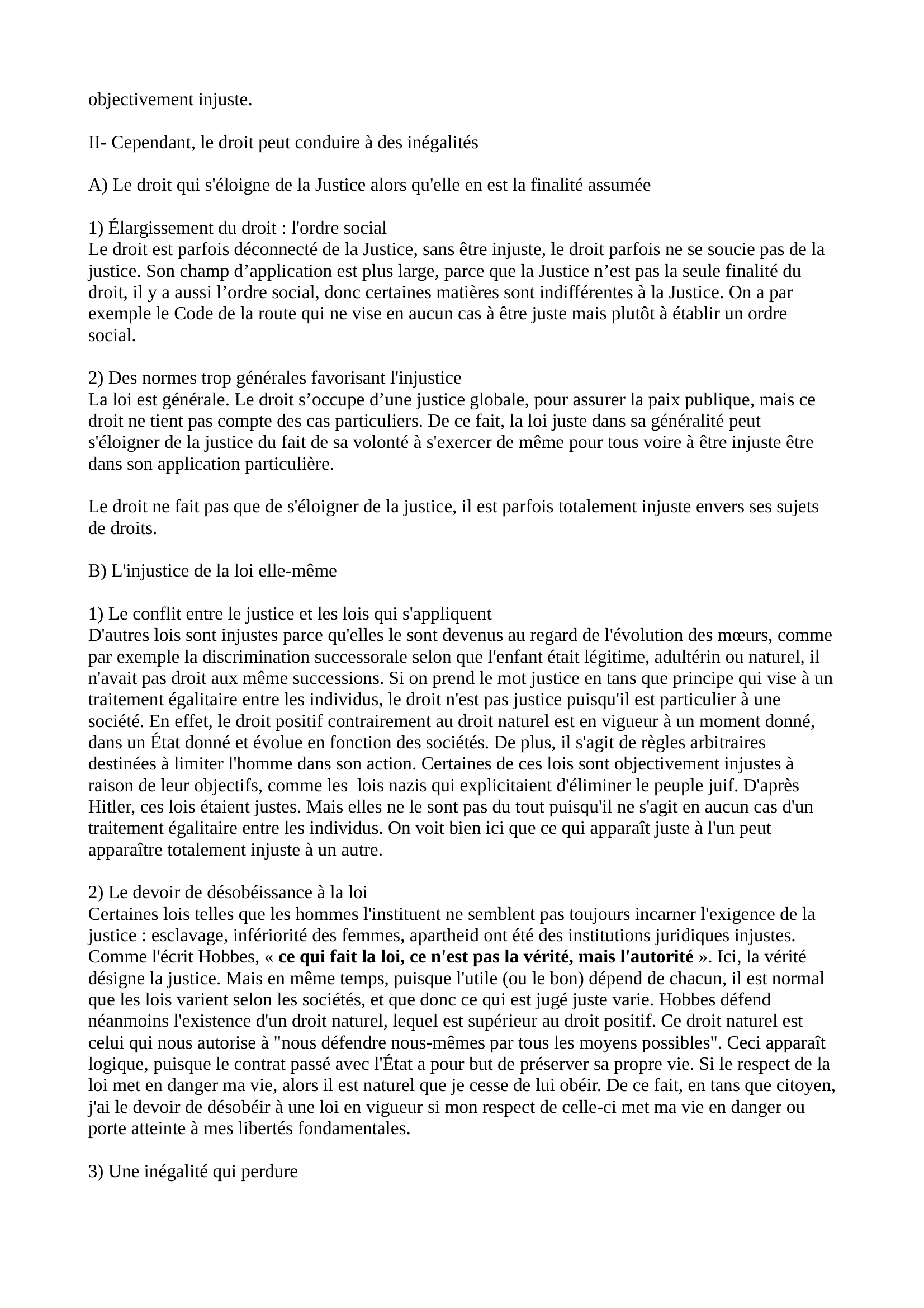dissertation le droit est-il juste ?
Publié le 01/12/2015

Extrait du document


«
objectivement injuste.
II- Cependant, le droit peut conduire à des inégalités
A) Le droit qui s'éloigne de la Justice alors qu'elle en est la finalité assumée
1) Élargissement du droit : l'ordre social
Le droit est parfois déconnecté de la Justice, sans être injuste, le droit parfois ne se soucie pas de la
justice.
Son champ d’application est plus large, parce que la Justice n’est pas la seule finalité du
droit, il y a aussi l’ordre social, donc certaines matières sont indifférentes à la Justice.
On a par
exemple le Code de la route qui ne vise en aucun cas à être juste mais plutôt à établir un ordre
social.
2) Des normes trop générales favorisant l'injustice
La loi est générale.
Le droit s’occupe d’une justice globale, pour assurer la paix publique, mais ce
droit ne tient pas compte des cas particuliers.
De ce fait, la loi juste dans sa généralité peut
s'éloigner de la justice du fait de sa volonté à s'exercer de même pour tous voire à être injuste être
dans son application particulière.
Le droit ne fait pas que de s'éloigner de la justice, il est parfois totalement injuste envers ses sujets
de droits.
B) L'injustice de la loi elle-même
1) Le conflit entre le justice et les lois qui s'appliquent
D'autres lois sont injustes parce qu'elles le sont devenus au regard de l'évolution des mœurs, comme
par exemple la discrimination successorale selon que l'enfant était légitime, adultérin ou naturel, il
n'avait pas droit aux même successions.
Si on prend le mot justice en tans que principe qui vise à un
traitement égalitaire entre les individus, le droit n'est pas justice puisqu'il est particulier à une
société.
En effet, le droit positif contrairement au droit naturel est en vigueur à un moment donné,
dans un État donné et évolue en fonction des sociétés.
De plus, il s'agit de règles arbitraires
destinées à limiter l'homme dans son action.
Certaines de ces lois sont objectivement injustes à
raison de leur objectifs, comme les lois nazis qui explicitaient d'éliminer le peuple juif.
D'après
Hitler, ces lois étaient justes.
Mais elles ne le sont pas du tout puisqu'il ne s'agit en aucun cas d'un
traitement égalitaire entre les individus.
On voit bien ici que ce qui apparaît juste à l'un peut
apparaître totalement injuste à un autre.
2) Le devoir de désobéissance à la loi
Certaines lois telles que les hommes l'instituent ne semblent pas toujours incarner l'exigence de la
justice : esclavage, infériorité des femmes, apartheid ont été des institutions juridiques injustes.
Comme l'écrit Hobbes, « ce qui fait la loi, ce n'est pas la vérité, mais l'autorité ».
Ici, la vérité
désigne la justice.
Mais en même temps, puisque l'utile (ou le bon) dépend de chacun, il est normal
que les lois varient selon les sociétés, et que donc ce qui est jugé juste varie.
Hobbes défend
néanmoins l'existence d'un droit naturel, lequel est supérieur au droit positif.
Ce droit naturel est
celui qui nous autorise à "nous défendre nous-mêmes par tous les moyens possibles".
Ceci apparaît
logique, puisque le contrat passé avec l'État a pour but de préserver sa propre vie.
Si le respect de la
loi met en danger ma vie, alors il est naturel que je cesse de lui obéir.
De ce fait, en tans que citoyen,
j'ai le devoir de désobéir à une loi en vigueur si mon respect de celle-ci met ma vie en danger ou
porte atteinte à mes libertés fondamentales.
3) Une inégalité qui perdure.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation de droit : La hiérarchie des normes
- Peut-on fonder le droit sur la nature ? (dissertation)
- Dissertation : L’avenir du droit de la famille ? (gratuite)
- DISSERTATION: Le droit peut-il être fondé sur la nature?
- Dissertation droit