Breton, « On me dit que là-bas »
Publié le 28/12/2012

Extrait du document
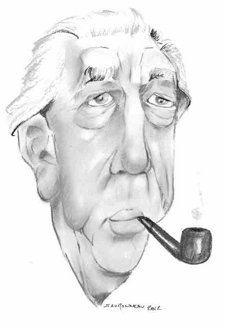
Université Saint Joseph Décembre 2012 TPC Poésie surréaliste Breton, « On me dit que là-bas « Présenté par Mia Debs Le poète marche et cueille, il n'écrit pas, il énumère ce qu'il rencontre ; il n'a pas d'idées, pas d'intentions : il est au monde, il aime, et l'amour lui donne liberté, transparence, rencontres électives. Il ne choisit pas, il associe des mots en liberté sur lesquels sont greffés la sensation présente et tout le souvenir. Et l'image, riche de cette greffe, recèle un sens qui ne défie la logique rectiligne que pour en inventer une autre, celle profonde et tournante de qui préfère connaître que savoir. Tel est le cas d'André Breton, poète surréaliste du XXe siècle, lecteur de Freud, qui décide d'explorer l'abîme ouvert par les recherches psychanalytiques sur l'inconscient, véritable labyrinthe de l'irrationnel qui s'offre désormais à l'investigation littéraire. Le poème à étudier est tiré du recueil intitulé L'air de l'eau publié en 1934 ; recueil de vers libres, qui disloque la syntaxe et fait la part belle à des métaphores qui se présentent « comme ces images de l'opium que l'homme n'a plus à évoquer mais qui s'offrent à lui spontanément « (premier Manifeste du surréalisme). Il s'agit d'un poème où réflexion et automatisme s'unissent dans la glorification amoureuse, où le je, tout entier est absorbé par son regard sur l'autre. La femme aimée est retrouvée partout dans ce poème à travers temps et espace : « ce pays lointain « ; « paradis perdu « ; Breton nous fait remonter à des temps révolus, à ceux de la Genèse où l'amour et la sexualité sont rendus innocents : « de l'inexistence du mal «. La femme est ainsi liée aux quatre éléments : terre : « le pommier « ; air : « fumant « ; eau : « mer « ; feu : « feux «. Elle est présente dans la légende, dans le mythe du paradis perdu, offerte enfin de toute sa splendeur à la fête amoureuse, aux ébats amoureux : « lançant ses derniers feux sombres entre tes jambes «. Breton ne cesse pourtant de s'interroger sur le miracle vertigineux de la rencontre et sur le moyen de recréer la femme indéfiniment, par-delà l'éclat poétique de l'instant, dans le quotidien de la vie vécue, afin d'assurer à la transmutation de l'existence qui est son oeuvre une totale pérennité. Il s'agit dans ce poème de la femme que le poème blasonne. Il est la partie de son corps à laquelle « l'érotisme intense et discret « du poème contient le plus grand nombre d'évocations. Le « là-bas « promis par la femme et qui « tremble bien réel à la pointe de [ses] cils « est un paradis retrouvé dans la puissance d'aimer « toujours pour la première fois «. Voici conjurée cette « obsession poétique «, cette « fausse intuition tyrannique « à laquelle « un ami « reproche au poète d'avoir trop cédé. Le tombeau n'est donc pas pavé de bonnes intentions, mais de « cils «, comme s'il s'agissait de piétiner ces oeillères pour ouvrir véritablement les yeux sur le monde de l'amour réinventé. Le « désir d'aimer et d'être aimé « est lu par Breton par l'expression « frais sorti de la malle entr'ouverte des âges «, cette « malle entr'ouverte « symbolisant le sexe féminin. Tout le poème dit la transition aveuglante, oeuvre au noir et mort à soi, au terme de laquelle le poète renaît véritablement voyant, grâce à la femme médiatrice : « qui semble tirer toute sa lumière de sa vie «. Le poème éveille donc une lumière nouvelle, celle du « second soleil de serins sauvages «. Tout le poème chante la multitude et la fécondité des membres de la femme aimée, serpent aux pattes retrouvées, ayant conjuré la condamnation biblique à ramper sur son ventre. Riche d'évocations sensuelles : « immense pic fumant de neige «, elle désigne surtout l'épiphanie du surréel qui féconde chacun des sauts où elle montre ses deux faces, la face visible et la face invisible scellées à la faveur de l'amour. Pour Breton, c'est le signe que les inhibitions et les frustrations nées d'une éducation religieuse si violemment attaquée pour nous permettre d'aimer, c'est-à-dire « [c]omme le premier homme aima la première femme «. L'Eldorado bretonien situé sur le littoral d'un ilot volcanique : « On me dit que là-bas les plages sont noires De la lave allée à la mer Et se déroulent au pied d'un immense pic fumant de neige Sous un second soleil de serins sauvages «. A l'image de ces derniers oiseaux habituellement astreint au réveil officiel de leur vie encagée, les populations d'animaux soi-disant domestiques sont par élection promises à la libération après une courte période de captivité. C'est le cas des pulsions de l'inconscient brusquement révélées à elles-mêmes par l'intrusion du désir représenté par le « pommier en fleur « qui réfère à cet arbre de la connaissance du Bien et du Mal, au péché originel : d'ailleurs, le vrai « péché « d'Adam et d'Eve, c'est d'avoir découvert le désir. Breton apporte dans ce poème la liberté du désir, le « pouvoir aimer « physiquement. Il ramène la notion de désir à celle d'avant la chute d'Adam et Eve, où ces derniers s'aimaient librement. Il clos alors l'histoire du christianisme en retournant la question de la culpabilité du désir et en rendant la sexualité innocente, en la purifiant par le feu : « de la lave allée à la mer «. L'aboutissement du désir, de la copulation brute à travers le vers : « lançant ses derniers feux sombres entre tes jambes « montre que dans l'acte sexuel, on meurt et on ressuscite ; la mort permet une certaine renaissance (cf. « la petite mort «) : « glace de ténèbres miroir d'amour «. Ainsi, Breton fait chanter [« la clé à la porte de la chambre inconnue «], faisant l'amour à la femme comme si c'était la première fois. Cette marche de l'imaginaire du poète vers plus d'intimité à travers le corps de la femme fait du poème une pyramide de désir élevée à ses plus hauts degrés.
Liens utiles
- Philippe Breton, Histoire de l'informatique (résumé et analyse)
- NADJA – ANDRE BRETON
- VASES COMMUNICANTS (Les), d'André Breton
- Dictionnaire abrégé du surréalisme, d'André Breton et Paul Eluard
- Anthologie de l'humour noir, ouvrage d'André Breton


