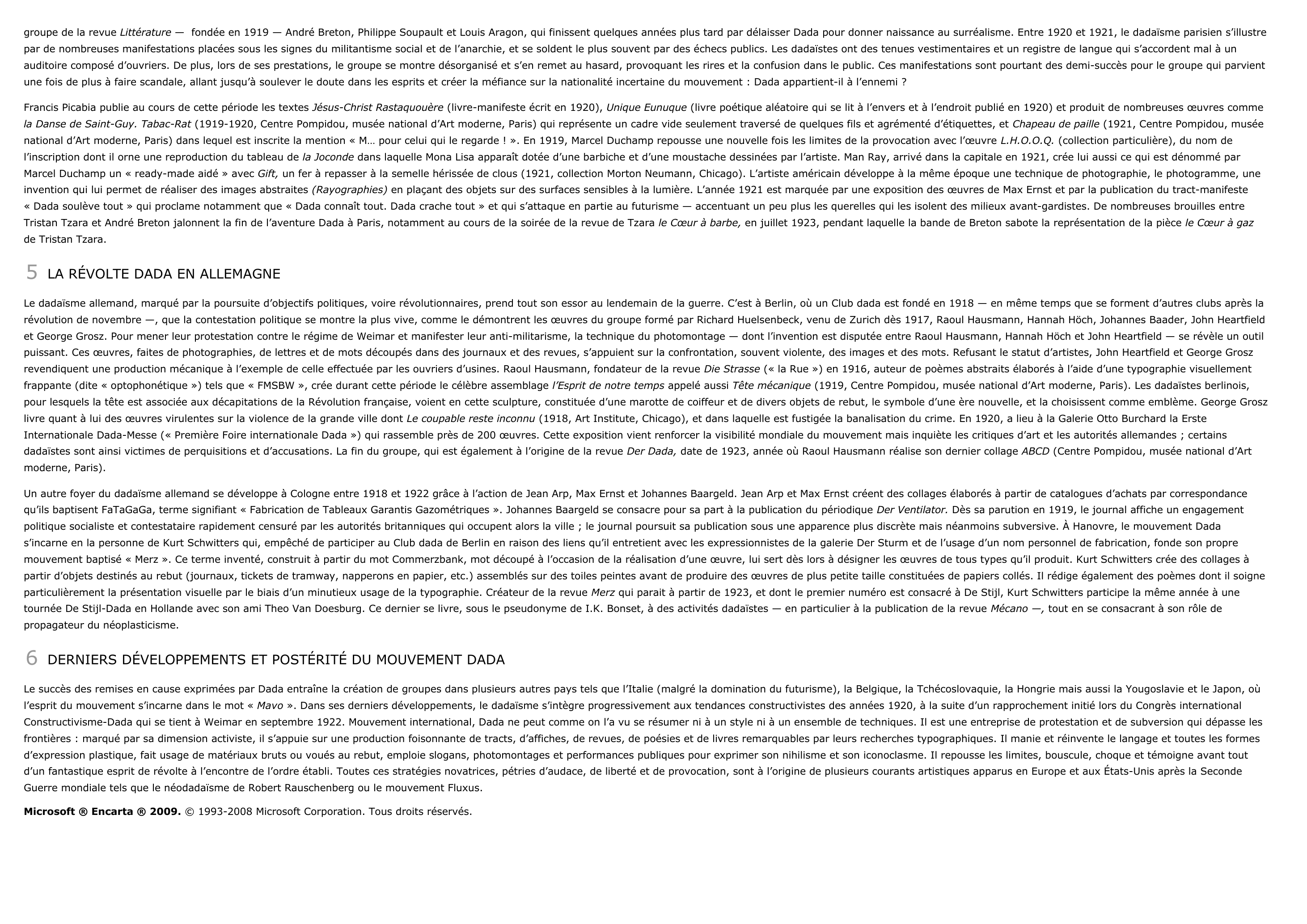Dada - peinture.
Publié le 15/05/2013

Extrait du document
«
groupe de la revue Littérature — fondée en 1919 — André Breton, Philippe Soupault et Louis Aragon, qui finissent quelques années plus tard par délaisser Dada pour donner naissance au surréalisme.
Entre 1920 et 1921, le dadaïsme parisien s’illustre
par de nombreuses manifestations placées sous les signes du militantisme social et de l’anarchie, et se soldent le plus souvent par des échecs publics.
Les dadaïstes ont des tenues vestimentaires et un registre de langue qui s’accordent mal à un
auditoire composé d’ouvriers.
De plus, lors de ses prestations, le groupe se montre désorganisé et s’en remet au hasard, provoquant les rires et la confusion dans le public.
Ces manifestations sont pourtant des demi-succès pour le groupe qui parvient
une fois de plus à faire scandale, allant jusqu’à soulever le doute dans les esprits et créer la méfiance sur la nationalité incertaine du mouvement : Dada appartient-il à l’ennemi ?
Francis Picabia publie au cours de cette période les textes Jésus-Christ Rastaquouère (livre-manifeste écrit en 1920), Unique Eunuque (livre poétique aléatoire qui se lit à l’envers et à l’endroit publié en 1920) et produit de nombreuses œuvres comme
la Danse de Saint-Guy.
Tabac-Rat (1919-1920, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, Paris) qui représente un cadre vide seulement traversé de quelques fils et agrémenté d’étiquettes, et Chapeau de paille (1921, Centre Pompidou, musée
national d’Art moderne, Paris) dans lequel est inscrite la mention « M… pour celui qui le regarde ! ».
En 1919, Marcel Duchamp repousse une nouvelle fois les limites de la provocation avec l’œuvre L.H.O.O.Q. (collection particulière), du nom de
l’inscription dont il orne une reproduction du tableau de la Joconde dans laquelle Mona Lisa apparaît dotée d’une barbiche et d’une moustache dessinées par l’artiste.
Man Ray, arrivé dans la capitale en 1921, crée lui aussi ce qui est dénommé par
Marcel Duchamp un « ready-made aidé » avec Gift, un fer à repasser à la semelle hérissée de clous (1921, collection Morton Neumann, Chicago).
L’artiste américain développe à la même époque une technique de photographie, le photogramme, une
invention qui lui permet de réaliser des images abstraites (Rayographies) en plaçant des objets sur des surfaces sensibles à la lumière.
L’année 1921 est marquée par une exposition des œuvres de Max Ernst et par la publication du tract-manifeste
« Dada soulève tout » qui proclame notamment que « Dada connaît tout.
Dada crache tout » et qui s’attaque en partie au futurisme — accentuant un peu plus les querelles qui les isolent des milieux avant-gardistes.
De nombreuses brouilles entre
Tristan Tzara et André Breton jalonnent la fin de l’aventure Dada à Paris, notamment au cours de la soirée de la revue de Tzara le Cœur à barbe, en juillet 1923, pendant laquelle la bande de Breton sabote la représentation de la pièce le Cœur à gaz
de Tristan Tzara.
5 LA RÉVOLTE DADA EN ALLEMAGNE
Le dadaïsme allemand, marqué par la poursuite d’objectifs politiques, voire révolutionnaires, prend tout son essor au lendemain de la guerre.
C’est à Berlin, où un Club dada est fondé en 1918 — en même temps que se forment d’autres clubs après la
révolution de novembre —, que la contestation politique se montre la plus vive, comme le démontrent les œuvres du groupe formé par Richard Huelsenbeck, venu de Zurich dès 1917, Raoul Hausmann, Hannah Höch, Johannes Baader, John Heartfield
et George Grosz.
Pour mener leur protestation contre le régime de Weimar et manifester leur anti-militarisme, la technique du photomontage — dont l’invention est disputée entre Raoul Hausmann, Hannah Höch et John Heartfield — se révèle un outil
puissant.
Ces œuvres, faites de photographies, de lettres et de mots découpés dans des journaux et des revues, s’appuient sur la confrontation, souvent violente, des images et des mots.
Refusant le statut d’artistes, John Heartfield et George Grosz
revendiquent une production mécanique à l’exemple de celle effectuée par les ouvriers d’usines.
Raoul Hausmann, fondateur de la revue Die Strasse (« la Rue ») en 1916, auteur de poèmes abstraits élaborés à l’aide d’une typographie visuellement
frappante (dite « optophonétique ») tels que « FMSBW », crée durant cette période le célèbre assemblage l’Esprit de notre temps appelé aussi Tête mécanique (1919, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, Paris).
Les dadaïstes berlinois,
pour lesquels la tête est associée aux décapitations de la Révolution française, voient en cette sculpture, constituée d’une marotte de coiffeur et de divers objets de rebut, le symbole d’une ère nouvelle, et la choisissent comme emblème.
George Grosz
livre quant à lui des œuvres virulentes sur la violence de la grande ville dont Le coupable reste inconnu (1918, Art Institute, Chicago), et dans laquelle est fustigée la banalisation du crime.
En 1920, a lieu à la Galerie Otto Burchard la Erste
Internationale Dada-Messe (« Première Foire internationale Dada ») qui rassemble près de 200 œuvres.
Cette exposition vient renforcer la visibilité mondiale du mouvement mais inquiète les critiques d’art et les autorités allemandes ; certains
dadaïstes sont ainsi victimes de perquisitions et d’accusations.
La fin du groupe, qui est également à l’origine de la revue Der Dada, date de 1923, année où Raoul Hausmann réalise son dernier collage ABCD (Centre Pompidou, musée national d’Art
moderne, Paris).
Un autre foyer du dadaïsme allemand se développe à Cologne entre 1918 et 1922 grâce à l’action de Jean Arp, Max Ernst et Johannes Baargeld.
Jean Arp et Max Ernst créent des collages élaborés à partir de catalogues d’achats par correspondance
qu’ils baptisent FaTaGaGa, terme signifiant « Fabrication de Tableaux Garantis Gazométriques ».
Johannes Baargeld se consacre pour sa part à la publication du périodique Der Ventilator. Dès sa parution en 1919, le journal affiche un engagement
politique socialiste et contestataire rapidement censuré par les autorités britanniques qui occupent alors la ville ; le journal poursuit sa publication sous une apparence plus discrète mais néanmoins subversive.
À Hanovre, le mouvement Dada
s’incarne en la personne de Kurt Schwitters qui, empêché de participer au Club dada de Berlin en raison des liens qu’il entretient avec les expressionnistes de la galerie Der Sturm et de l’usage d’un nom personnel de fabrication, fonde son propre
mouvement baptisé « Merz ».
Ce terme inventé, construit à partir du mot Commerzbank, mot découpé à l’occasion de la réalisation d’une œuvre, lui sert dès lors à désigner les œuvres de tous types qu’il produit.
Kurt Schwitters crée des collages à
partir d’objets destinés au rebut (journaux, tickets de tramway, napperons en papier, etc.) assemblés sur des toiles peintes avant de produire des œuvres de plus petite taille constituées de papiers collés.
Il rédige également des poèmes dont il soigne
particulièrement la présentation visuelle par le biais d’un minutieux usage de la typographie.
Créateur de la revue Merz qui parait à partir de 1923, et dont le premier numéro est consacré à De Stijl, Kurt Schwitters participe la même année à une
tournée De Stijl-Dada en Hollande avec son ami Theo Van Doesburg.
Ce dernier se livre, sous le pseudonyme de I.K.
Bonset, à des activités dadaïstes — en particulier à la publication de la revue Mécano —, tout en se consacrant à son rôle de
propagateur du néoplasticisme.
6 DERNIERS DÉVELOPPEMENTS ET POSTÉRITÉ DU MOUVEMENT DADA
Le succès des remises en cause exprimées par Dada entraîne la création de groupes dans plusieurs autres pays tels que l’Italie (malgré la domination du futurisme), la Belgique, la Tchécoslovaquie, la Hongrie mais aussi la Yougoslavie et le Japon, où
l’esprit du mouvement s’incarne dans le mot « Mavo ».
Dans ses derniers développements, le dadaïsme s’intègre progressivement aux tendances constructivistes des années 1920, à la suite d’un rapprochement initié lors du Congrès international
Constructivisme-Dada qui se tient à Weimar en septembre 1922.
Mouvement international, Dada ne peut comme on l’a vu se résumer ni à un style ni à un ensemble de techniques.
Il est une entreprise de protestation et de subversion qui dépasse les
frontières : marqué par sa dimension activiste, il s’appuie sur une production foisonnante de tracts, d’affiches, de revues, de poésies et de livres remarquables par leurs recherches typographiques.
Il manie et réinvente le langage et toutes les formes
d’expression plastique, fait usage de matériaux bruts ou voués au rebut, emploie slogans, photomontages et performances publiques pour exprimer son nihilisme et son iconoclasme.
Il repousse les limites, bouscule, choque et témoigne avant tout
d’un fantastique esprit de révolte à l’encontre de l’ordre établi.
Toutes ces stratégies novatrices, pétries d’audace, de liberté et de provocation, sont à l’origine de plusieurs courants artistiques apparus en Europe et aux États-Unis après la Seconde
Guerre mondiale tels que le néodadaïsme de Robert Rauschenberg ou le mouvement Fluxus.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quelle vanité que la peinture, qui attire l’admiration par la ressemblance des choses dont on n’admire point les originaux ! Pascal
- philo art Pascal: “Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par l’imitation des choses dont on admire point les originaux”
- Comparer deux documents d'époques différentes (1) Découvrir Des peintures rupestres Informations : cette peinture rupestre provient de la grotte de Lascaux (salle de la Rotonde).
- dada
- HISTOIRE DE LA PEINTURE EN ITALIE de Stendhal (résumé)