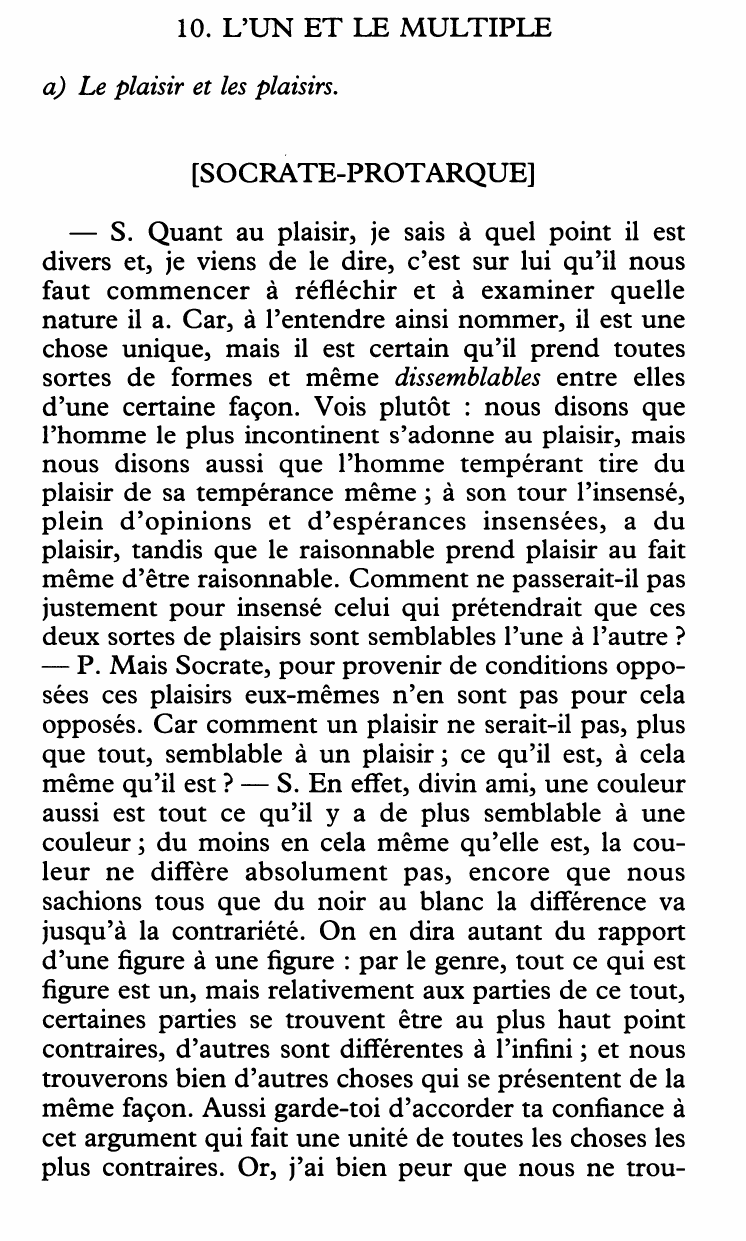d'autres figures, si tu me le demandais, cite-moi d'autres vertus.
Publié le 22/10/2012

Extrait du document
«
138 PLATON PAR LUI-MÊME
10.
L'UN ET LE MULTIPLE
a) Le plaisir et les plaisirs.
[SOCRA TE-PROT ARQUE]
- S.
Quant au plaisir, je sais à quel point il est
divers et,
je viens de le dire, c'est sur lui qu'il nous
faut commencer à réfléchir et à examiner quelle
nature il a.
Car, à l'entendre ainsi nommer, il est une
chose unique, mais il est certain qu'il prend toutes
sortes
de formes et même dissemblables entre elles
d'une certaine façon.
Vois plutôt : nous disons que l'homme le plus incontinent s'adonne au plaisir, mais
nous disons aussi que l'homme tempérant tire du
plaisir de sa tempérance même ; à son tour l'insensé,
plein d'opinions et d'espérances insensées, a du
plaisir, tandis que le raisonnable prend plaisir au fait
même d'être raisonnable.
Comment ne passerait-il pas
justement
pour insensé celui qui prétendrait que ces
deux sortes de plaisirs sont semblables
l'une à l'autre?
-P.
Mais Socrate, pour provenir de conditions oppo
sées ces plaisirs eux-mêmes n'en sont pas pour cela
opposés.
Car comment un plaisir ne serait-il pas, plus
que tout, semblable à un plaisir ; ce qu'il est, à cela
même qu'il est?- S.
En effet, divin ami, une couleur
aussi est
tout ce qu'il y a de plus semblable à une
couleur; du moins en cela même qu'elle est, la cou
leur ne diffère absolument pas, encore que nous
sachions tous que du noir au blanc la différence va
jusqu'à la contrariété.
On en dira autant du rapport
d'une figure à une figure : par le genre, tout ce qui est
figure est un, mais relativement aux parties de ce
tout,
certaines parties se trouvent être au plus haut point
contraires, d'autres sont différentes à l'infini ; et nous
trouverons bien d'autres choses qui se présentent de la
même façon.
Aussi garde-toi d'accorder ta confiance à
cet argument qui fait
une unité de toutes les choses les
plus contraires.
Or, j'ai bien peur que nous ne trou-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- figures de style
- Un critique définit le héros cornélien de cette manière : “Des héros tout d’une pièce, immobiles et raides dans leurs grandes armures, artificieusement mis aux prises avec des événements extraordinaires et déployant des vertus presque surnaturelles ou des vices non moins monstrueux”. Qu’en pensez-vous ?
- Les Figures de Styles
- Géométrie Les figures planes Prends ton porte-documents pages 10, 11, 12 et remplis la case à côté de chaque figure.
- TRAITÉ DES VERTUS, Vladimir Jankélévitch (résumé & analyse)