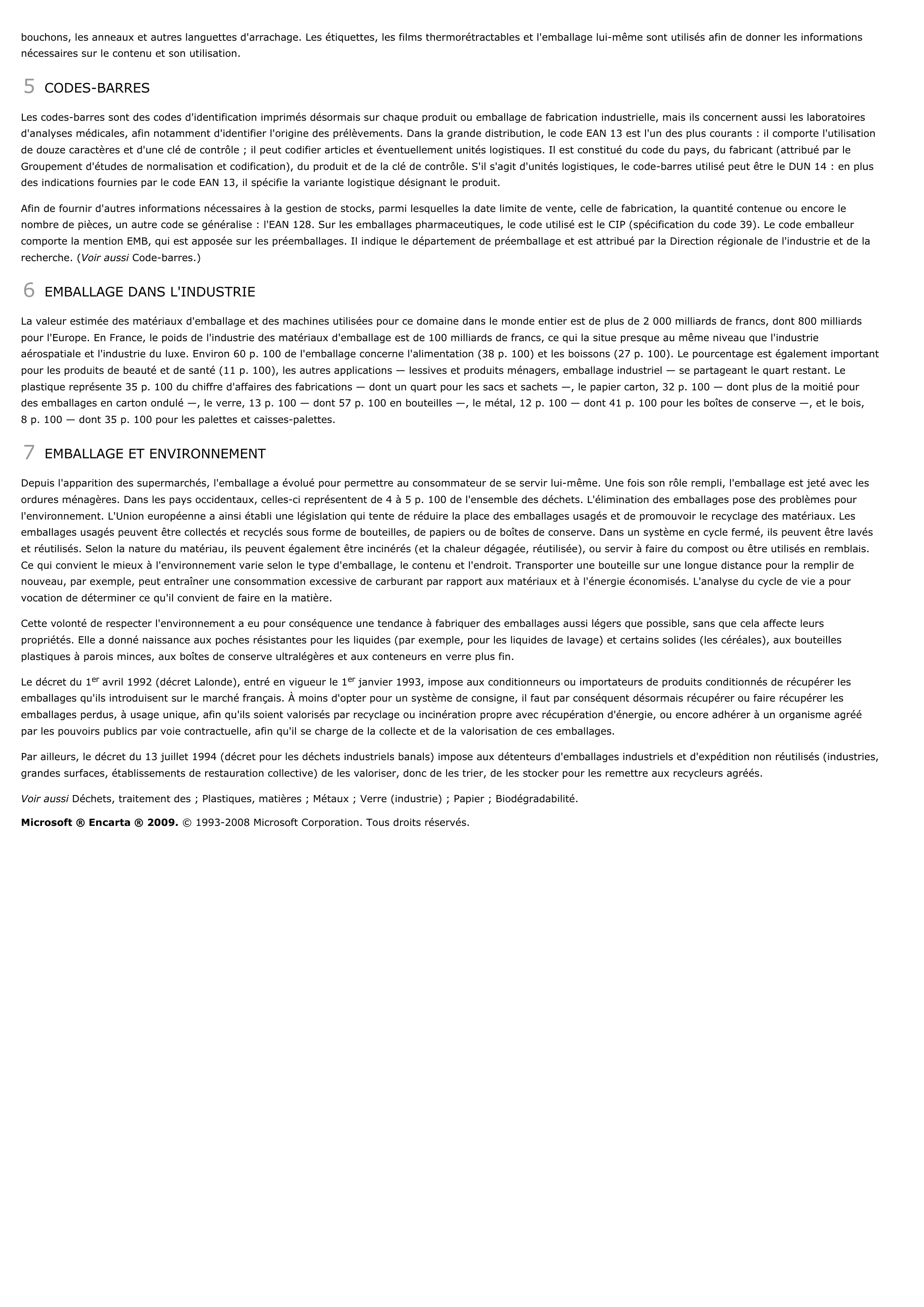emballage - agriculture et agroalimentaire.
Publié le 23/04/2013

Extrait du document


«
bouchons, les anneaux et autres languettes d'arrachage.
Les étiquettes, les films thermorétractables et l'emballage lui-même sont utilisés afin de donner les informationsnécessaires sur le contenu et son utilisation.
5 CODES-BARRES
Les codes-barres sont des codes d'identification imprimés désormais sur chaque produit ou emballage de fabrication industrielle, mais ils concernent aussi les laboratoiresd'analyses médicales, afin notamment d'identifier l'origine des prélèvements.
Dans la grande distribution, le code EAN 13 est l'un des plus courants : il comporte l'utilisationde douze caractères et d'une clé de contrôle ; il peut codifier articles et éventuellement unités logistiques.
Il est constitué du code du pays, du fabricant (attribué par leGroupement d'études de normalisation et codification), du produit et de la clé de contrôle.
S'il s'agit d'unités logistiques, le code-barres utilisé peut être le DUN 14 : en plusdes indications fournies par le code EAN 13, il spécifie la variante logistique désignant le produit.
Afin de fournir d'autres informations nécessaires à la gestion de stocks, parmi lesquelles la date limite de vente, celle de fabrication, la quantité contenue ou encore lenombre de pièces, un autre code se généralise : l'EAN 128.
Sur les emballages pharmaceutiques, le code utilisé est le CIP (spécification du code 39).
Le code emballeurcomporte la mention EMB, qui est apposée sur les préemballages.
Il indique le département de préemballage et est attribué par la Direction régionale de l'industrie et de larecherche.
( Voir aussi Code-barres.)
6 EMBALLAGE DANS L'INDUSTRIE
La valeur estimée des matériaux d'emballage et des machines utilisées pour ce domaine dans le monde entier est de plus de 2 000 milliards de francs, dont 800 milliardspour l'Europe.
En France, le poids de l'industrie des matériaux d'emballage est de 100 milliards de francs, ce qui la situe presque au même niveau que l'industrieaérospatiale et l'industrie du luxe.
Environ 60 p.
100 de l'emballage concerne l'alimentation (38 p.
100) et les boissons (27 p.
100).
Le pourcentage est également importantpour les produits de beauté et de santé (11 p.
100), les autres applications — lessives et produits ménagers, emballage industriel — se partageant le quart restant.
Leplastique représente 35 p.
100 du chiffre d'affaires des fabrications — dont un quart pour les sacs et sachets —, le papier carton, 32 p.
100 — dont plus de la moitié pourdes emballages en carton ondulé —, le verre, 13 p.
100 — dont 57 p.
100 en bouteilles —, le métal, 12 p.
100 — dont 41 p.
100 pour les boîtes de conserve —, et le bois,8 p.
100 — dont 35 p.
100 pour les palettes et caisses-palettes.
7 EMBALLAGE ET ENVIRONNEMENT
Depuis l'apparition des supermarchés, l'emballage a évolué pour permettre au consommateur de se servir lui-même.
Une fois son rôle rempli, l'emballage est jeté avec lesordures ménagères.
Dans les pays occidentaux, celles-ci représentent de 4 à 5 p.
100 de l'ensemble des déchets.
L'élimination des emballages pose des problèmes pourl'environnement.
L'Union européenne a ainsi établi une législation qui tente de réduire la place des emballages usagés et de promouvoir le recyclage des matériaux.
Lesemballages usagés peuvent être collectés et recyclés sous forme de bouteilles, de papiers ou de boîtes de conserve.
Dans un système en cycle fermé, ils peuvent être lavéset réutilisés.
Selon la nature du matériau, ils peuvent également être incinérés (et la chaleur dégagée, réutilisée), ou servir à faire du compost ou être utilisés en remblais.Ce qui convient le mieux à l'environnement varie selon le type d'emballage, le contenu et l'endroit.
Transporter une bouteille sur une longue distance pour la remplir denouveau, par exemple, peut entraîner une consommation excessive de carburant par rapport aux matériaux et à l'énergie économisés.
L'analyse du cycle de vie a pourvocation de déterminer ce qu'il convient de faire en la matière.
Cette volonté de respecter l'environnement a eu pour conséquence une tendance à fabriquer des emballages aussi légers que possible, sans que cela affecte leurspropriétés.
Elle a donné naissance aux poches résistantes pour les liquides (par exemple, pour les liquides de lavage) et certains solides (les céréales), aux bouteillesplastiques à parois minces, aux boîtes de conserve ultralégères et aux conteneurs en verre plus fin.
Le décret du 1 er avril 1992 (décret Lalonde), entré en vigueur le 1 er janvier 1993, impose aux conditionneurs ou importateurs de produits conditionnés de récupérer les emballages qu'ils introduisent sur le marché français.
À moins d'opter pour un système de consigne, il faut par conséquent désormais récupérer ou faire récupérer lesemballages perdus, à usage unique, afin qu'ils soient valorisés par recyclage ou incinération propre avec récupération d'énergie, ou encore adhérer à un organisme agréépar les pouvoirs publics par voie contractuelle, afin qu'il se charge de la collecte et de la valorisation de ces emballages.
Par ailleurs, le décret du 13 juillet 1994 (décret pour les déchets industriels banals) impose aux détenteurs d'emballages industriels et d'expédition non réutilisés (industries,grandes surfaces, établissements de restauration collective) de les valoriser, donc de les trier, de les stocker pour les remettre aux recycleurs agréés.
Voir aussi Déchets, traitement des ; Plastiques, matières ; Métaux ; Verre (industrie) ; Papier ; Biodégradabilité.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- charbon symptomatique du bétail - agriculture et agroalimentaire.
- batterie, élevage en - agriculture et agroalimentaire.
- agricole, équipement - agriculture et agroalimentaire.
- abattoir - agriculture et agroalimentaire.
- zootechnie - agriculture et agroalimentaire.