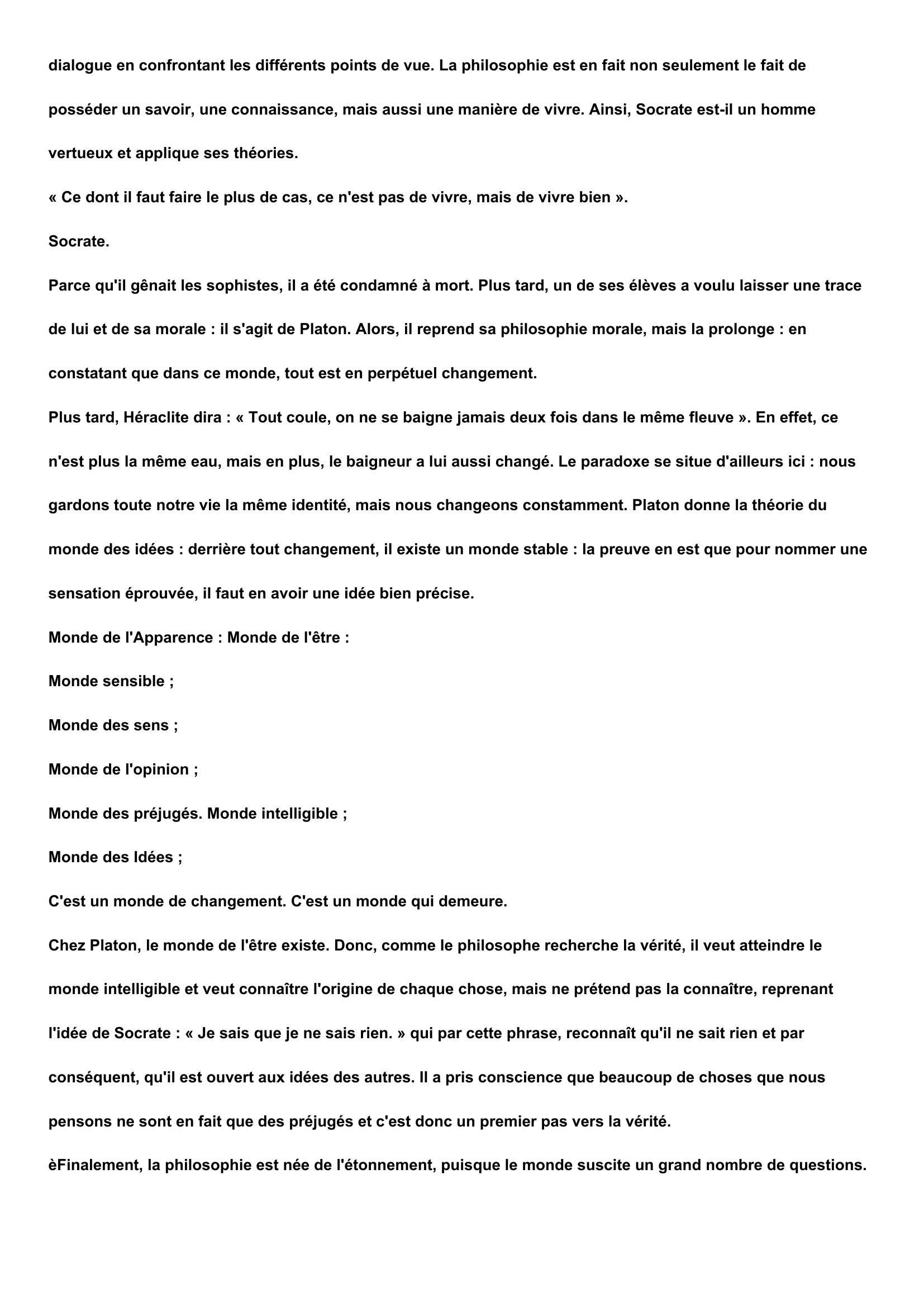Introduction à la philosophie
Publié le 20/01/2013

Extrait du document

PHILOSOPHIE I : Introduction à la philosophie : La Philo vient de Philein = Amour et de Sophia = sagesse. Ainsi, à la base, c’est l’amour de la sagesse. Elle est née au V° siècle avant J.-C., avec un Grec : Socrate. Avant lui, c’était ce qu’on appelle les penseurs pré-socratiques dont trois se signalent : Héraclite, Parménide et Pythagore. Plus physiciens que philosophes, on leur doit l’apparition de nouvelles sciences : les maths, physique, astronomie, puisqu’ils s’intéressent beaucoup à l’homme, à l’univers et à la place de l’homme sur terre. Cette période pré-socratique est ce qu’on appelle la période du miracle grec. Socrate est un grec marginal de par sa pensée et par son physique : autant les Grecs sont beaux, forts et musclés, autant Socrate est laid, bossu, sale et pauvre. Pour la pensée, les Grecs privilégient l’apparence ; lui, ne pouvant pas… D’autre part, ne faisant pas payer ses entretiens, il ne vit que de dons de ses orateurs. De plus, il passe ses journées à déambuler dans Athènes, à observer et à discuter ; en fait, le but de ses déambulations est la recherche de la vérité par la parole. De même, il combat les sophistes tels que Protagoras et Gorgias : parce qu’ils sont soi-disant des sages qui enseignent la sagesse, ils sont populaires et très admirés du peuple grec et Socrate, pdt tte sa vie, a essayé de démontrer qu’ils ne sont pas de vrais philosophes, d’une part parce qu’ils se font payer pour leurs discours, mais surtout parce qu’ils ne veulent pas le moins du monde atteindre la vérité mais visent le Pouvoir. En effet, ils enseignent comment bien parler pour manipuler le peuple et accéder au pouvoir politique : ils enseignent donc la Rhétorique, qui est l’ensemble des techniques visant à persuader un ou plusieurs interlocuteurs par le biais du langage, du gestuel et de la façon de présenter. Pour les Sophistes, la vérité n’existe pas, mais il faut faire croire au peuple et s’en servir. Socrate, en revanche, est tout le contraire : il est sincère et cherche réellement à atteindre la vérité par le dialogue en confrontant les différents points de vue. La philosophie est en fait non seulement le fait de posséder un savoir, une connaissance, mais aussi une manière de vivre. Ainsi, Socrate est-il un homme vertueux et applique ses théories. « Ce dont il faut faire le plus de cas, ce n’est pas de vivre, mais de vivre bien «. Socrate. Parce qu’il gênait les sophistes, il a été condamné à mort. Plus tard, un de ses élèves a voulu laisser une trace de lui et de sa morale : il s’agit de Platon. Alors, il reprend sa philosophie morale, mais la prolonge : en constatant que dans ce monde, tout est en perpétuel changement. Plus tard, Héraclite dira : « Tout coule, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve «. En effet, ce n’est plus la même eau, mais en plus, le baigneur a lui aussi changé. Le paradoxe se situe d’ailleurs ici : nous gardons toute notre vie la même identité, mais nous changeons constamment. Platon donne la théorie du monde des idées : derrière tout changement, il existe un monde stable : la preuve en est que pour nommer une sensation éprouvée, il faut en avoir une idée bien précise. Monde de l’Apparence : Monde de l’être : Monde sensible ; Monde des sens ; Monde de l’opinion ; Monde des préjugés. Monde intelligible ; Monde des Idées ; C’est un monde de changement. C’est un monde qui demeure. Chez Platon, le monde de l’être existe. Donc, comme le philosophe recherche la vérité, il veut atteindre le monde intelligible et veut connaître l’origine de chaque chose, mais ne prétend pas la connaître, reprenant l’idée de Socrate : « Je sais que je ne sais rien. « qui par cette phrase, reconnaît qu’il ne sait rien et par conséquent, qu’il est ouvert aux idées des autres. Il a pris conscience que beaucoup de choses que nous pensons ne sont en fait que des préjugés et c’est donc un premier pas vers la vérité. èFinalement, la philosophie est née de l’étonnement, puisque le monde suscite un grand nombre de questions. Platon dira : « La philosophie est fille de l’étonnement «. Platon : * Écrit des dialogues mettant en scène Socrate ainsi qu’un ou plusieurs sophistes, et en général de jeunes grecs. Le but de ces discussions est de s’élever vers la vérité. * Il fonde une école : l’Académie. * Il aura un disciple, Aristote ; Aristote, lui en revanche, a inventé la métaphysique qui étudie les premières causes de la Nature. Au départ donc, le philosophe est aussi physicien, mathématicien, astronome, géomètre… : c’est une science universelle. En évoluant, la philo est devenue sélective ; de plus, les philosophes font tous des erreurs de raisonnement que les philosophes suivants traquent et rétablissent pour atteindre la vérité, puis poursuivent le raisonnement ; Il y a plusieurs philosophies : * La métaphysique qui étudie la connaissance et le raisonnement * La philosophie pratique qui étudie la Morale. * L’Ésthétique, qui est un questionnement sur le Beau ; * La philosophie politique qui tend à trouver le meilleur état possible. * L’Épistémologie, qui est la réflexion sur le savoir. TEXTE 1 : Qui philosophe ? Platon procède par élimination en disant d’abord ceux qui ne philosophent pas, à savoir les savants, les dieux (ils connaissent la Vérité Universelle), les ignorants (ils pensent tout savoir ; sont inclus les sophistes) ; il suppose que la philosophie, pour l’homme, est un long travail car le savoir n’est pas inné et c’est aussi une continuelle remise en question des idées reçues et donc des préjugés. Alors, qui philosophe ? C’est, toujours d’après Platon, celui qui a pris conscience qu’il ne sait rien, et que, par-là même, la vérité est quelque chose qui ne se possède pas, mais qui se recherche. L’amour, selon Platon est l’un des moyens d’accéder à la vérité : au départ, l’amour est l’amour des beaux corps (donc purement physique), puis devient l’amour des belles âmes (donc amour intellectuel) pour finalement accéder à l’amour du Beau. TEXTE 2 p.389 : Épictète est un stoïcien. Le Stoïcisme est une école de pensée qui prône de vivre en harmonie avec la Raison et la Nature. Leur but est de trouver la paix de l’âme ou ATARAXIE en éloignant de lui tout ce qui pourrait le troubler, à savoir les passions et autres : et c’est donc accepter le destin en se montrant détaché à l’égard des choses, des hommes et de ce qui ne dépend pas de nous, qui aurait une origine surnaturelle. Les hommes ont différentes opinions sur les choses puisqu’une opinion est subjective, ce qui peut engendrer des conflits, mais Épictète pense que, dès que les hommes auront pris conscience de ces conflits, ils vont y mettre un terme et donc déterminer qui a raison et qui a tort en cherchant les origines du conflit et par la suite, on a condamné la simple opinion (qui n’est ni fondée ni prouvée) et pour que l’homme affirme qu’il a raison, il lui faut le prouver. Mais, il a fallu trouver une norme pour déterminer qui est dans le vrai. Chacun pense que ce qu’il croit est l’unique vérité, ce qui est en soi absurde parce que deux opinons contradictoires ne peuvent être vraies toutes deux. L’opinion est subjective et varie d’un individu à un autre et d’une civilisation à une autre. Finalement, dans le domaine de l’opinion, toutes se valent, ce qui fait que l’opinion est différente de la vérité. Or, il affirme qu’il y a quelque chose de supérieur à l’opinion, parce qu’autrement, on ne pourrait dire qu’une telle opinion est plus vraie qu’une autre. Donc, il y a une norme, sinon, on ne pourrait se parler, notre langage n’aurait aucun sens. L18, « nécessaire « :è est nécessaire tout ce qui ne peut ne pas être, c’est donc différent de contingent èLa philosophie cherche la norme, et une fois atteinte, on pourra dire avec certitude que telle affirmation est vraie ou fausse. TEXTE 5-A p.391 : Pour Husserl, la philosophie trouve son origine en Grèce antique puisque c’est là que les hommes ont commencé à se poser des questions en refusant de prendre le monde tel qu’il est, mais en se posant la question : Pourquoi le monde est-il ainsi plutôt qu’autrement ? Et aussi pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Puis, au fur et à mesure du temps, la Philosophie s’est spécialisée en métaphysique ou ontologie (de to on : l’être). donc, selon Husserl, la philosophie en Grèce a donné naissance à la culture occidentale et continue dans le texte 5-B. TEXTE 5-B p.391 : Husserl démontre ici que la Philosophie occidentale est différente des autres et qu’elle est une création des Grecs et non une simple diffusion : elle a donc permis un questionnement infini, qui est encore présent aujourd’hui. La preuve est que cette philosophie s’est spécialisée au cours du temps en différents domaines, eux même se spécialisant tant le champ des connaissances est vaste. Au contraire, la philosophie orientale est restée en vase clos, ce qui fait qu’elle est limitée. TEXTE 6 p.393 : Kant est un philosophe du XVIII°siècle, pour qui le but final de la philo est de répondre à quatre questions essentielles, ce qui fait d’elle une épistémologie. 1. Que puis-je savoir ? on trouvera la réponse dans la Métaphysique. En fait, c’est la question de savoir jusqu’où la raison humaine peut aller dans la connaissance des premières causes de la Nature, donc quelle est sa capacité de questionnement et de réponse ? 2. Que dois-je faire ? La réponse se trouve dans la Morale puisqu’elle s’occupe de distinguer le bien du mal et donc par suite, agir du mieux possible. 3. Que m’est-il permis d’espérer ? La réponse se trouve dans la religion puisqu’elle distingue le Paradis et l’Enfer. Kant, étant réaliste, s’est rendu compte que l’homme, pour vivre dans le bien a besoin d’une récompense. Il est en effet impossible de penser que quelqu’un qui fait le Mal autour de lui peut le faire impunément : il faut donc une justice surnaturelle, divine. Donc, selon Kant, Dieu est une sorte de justicier et joue donc le rôle d’une idée régulatrice. 4. Qu’est-ce que l’Homme ? La réponse est apportée avec l’anthropologie, au sens kantien du terme i.e. qu’il pose la question de la nature de l’homme puisque l’homme est considéré comme un être à part dont la nature est difficile à discerner. Ces quatre questions, toujours d’après Kant, se rapportent toutes à l’Anthropologie puisqu’elles se rapportent à l’homme en général et à sa nature. Le rôle du philosophe est donc de déterminer différentes tâches : d’abord de déterminer la source du savoir humain (i.e. pourquoi l’homme peut-il savoir tout ce qu’il sait), l’étendue de l’usage possible et utile de tout savoir, autrement dit, que peut-on connaître avec certitude ? et enfin les limites de la raison humaine ou, que peut-on ne pas savoir ? PHILOSOPHIE II : LA CONSCIENCE : INTRODUCTION : « avoir conscience de… « = savoir ; « Perdre/ reprendre conscience « = perception plus ou moins claire des phénomènes qui nous entourent et qui nous renseignent sur notre propre conscience ; Étymologiquement, Conscience vient du latin « cum scienta «, ce qui veut dire avec ou accompagné de savoir. Donc, en fait, être conscient signifie penser, agir, sentir, réfléchir tout en le sachant : c’est donc savoir ce que l’on fait quand on le fait. La conscience est alors assimilable à la connaissance, et c’est la caractéristique propre de l’homme et implique donc que l’homme occupe une place particulière dans le monde car la conscience que l’on a de soi-même permet de se penser, de se juger et d’autre part de penser tout ce qui entoure l’être humain, lui permettant de changer et de vouloir changer ce qui est autour de lui. I- La conscience, distance de l’homme au monde et à lui-même : On dit que les animaux et les bébés sont au monde, i.e. qu’ils sont collés au monde, en font partie intégrante et n’ont pas la capacité intellectuelle de s’en détacher. L’homme, lui, au contraire, par le simple fait d’avoir conscience de soi, a aussi conscience que le reste du monde n’est as lui, et donc, il s’en détache. L’homme fait partie du monde mais peut s’en défaire, ce qui lui permet de juger et de comprendre le monde, de questionner, de donner des explications et de transformer le monde en vue d’un objectif précis. Ainsi, l’homme vit dans les soucis puisqu’il se projette dans l’avenir : il anticipe toujours alors que les animaux vivent collés au présent. Donc, l’homme se sépare du monde : il n’appartient pas au monde, c’est le monde qui lui appartient. Au premier abord, on pourrait croire que la Cs de soi est une connaissance de soi, autrement dit que la Cs de soi est immédiate (sans intermédiaire), mais en fait, cette Cs immédiate que nous avons de tous de nous même est superficielle : elle n’apprend pas qui je suis réellement ni le sens profond de soi. Au second abord, cette connaissance n’est que partielle parce que si je faisais des choses en pleine connaissance de causes, je n’éprouverais ni remords ni regrets. Finalement, la conscience de soi, moins qu’un avantage, est plus une obligation d’une tache à accomplir, ou de quelque chose à accomplir. Le « je veux être moi-même « est plus une tache à effectuer dans le temps limité de la vie que la possession d’une réelle identité. On dit que l’homme est perfectible : il a tout au long de sa vie l’occasion de se perfectionner parce qu’il n’a pas de nature bien définie. Si la Cs instaure une distance avec moi-même, l’homme, dans ce sens est double. Il y a donc deux « moi « en chaque personne : quand on se met en cause, il y a un « moi « qui juge, et un autre qui est jugé. En effet, dans la formule « Je me juge «, on a deux choses : le juge est sujet et fait par conséquent partie du monde intelligible ; et le « moi « qui est jugé est objet : il est dans le monde sensible et appartient donc au moi matériel ou encore, c’est un moi immédiat. C’est cette dualité qui est à la base de la philosophie : être soi-même est donc par définition impossible et la Cs de soi est tjs un écart entre « moi « et « moi « : ce qui fait que je ne coïncide jamais avec moi, car l’homme a tjs la possibilité de se perfectionner. Cette distance (du monde à l’homme et de l’homme à l’homme) implique un espace de réflexion donc le retour de la pensée sur soi-même : c’est un acte médiat parce que la réflexion suppose que je me détache de la chose sur laquelle je réfléchis pour y revenir ensuite. Le verbe réfléchir est plus fort que le verbe penser dans sa signification. II- La conscience, capacité de questionnement et de doute : Quand je pense, dans le même temps, j’en prends conscience : la pensée englobe tous les phénomènes de l’esprit et de la réflexion ; la pensée peut accéder à un savoir véritable, par une critique sur les préjugés. Descartes affirme que la Cs et son corréla qui est la pensée deviennent à la fois le fondement et le modèle de toute vérité. Le fondement est ce sur quoi repose un ensemble de connaissance. Il développe ses idées dans deux livres principalement : Discours sur la Méthode et Méditation Métaphysique. Il reprend l’adage socratique « je sais que je ne sais rien « mais le pousse à l’extrême, en instaurant un doute méthodique et hyperbolique qui consiste à se défaire des idées reçues et de toutes les croyances, puisque par définition, elles ne peuvent être vraies. C’est donc un instrument dont le but est de trouver une vérité qui puisse servir de fondement aux autres. Descartes est un anti-aristotélicien : il doute de tout, ce qui instaure une révolution en philo : en effet, si une chose résiste au doute, alors elle est ferme et assurée et donc vraie. Pour ce faire, il a recours à la méditation : méditer consiste à raisonner et à venir à soi pour trouver le fondement de la vérité. Le doute est le début du raisonnement et prouve une certaine liberté. Descartes doute des sens parce qu’ils sont trompeurs, mais ne le sont-ils pas tout le temps ? De même, il doute des sciences puisqu’il y a forcément une ou des erreurs de raisonnement, qu’on appelle paralogismes mais aussi des pensées qui lui viennent quotidiennement à l’esprit. Quelle est alors la seule et unique certitude qui résiste à ce doute méthodique ? Il reste le « moi « comme Cs et comme capacité à penser : il dira donc « Cogito ergo sum «. Toute pensée est consciente car toujours accompagnée du savoir de celui qui pense. Cela implique que la Cs de soi est en même temps connaissance de soi : l’individu est transparent à lui-même parce que non seulement il pense, mais en plus il a Cs de le faire. Le problème est : je sais que je suis, mais je ne sais pas qui je suis : il faut donc savoir « ce que je suis, moi qui suis certain que je suis « On peut remarquer que dans sa citation, Descartes passe du « je « au « moi «. Le « moi « est une identité, une réalité permanente : c’est le fait d’être unique, ce que l’on nomme la substance (ce qui reste en soi sur les apparences) ; mais c’est aussi ce qui unifie les diverses perceptions et pensées de l’homme. Aussi nombreuses soient-elles, « il est de soi si évident que c’est moi qui doute, qui entend et qui désire, qu’il n’est pas ici besoin de rien ajouter pour l’expliquer «. Cette certitude l’amène à faire du sujet une substance pensante, séparée du corps. Son « je suis une chose qui pense « introduit une dualité entre le corps et l’âme. III- Problèmes que posent la transparence et l’immédiateté de la Cs : Affirmer « je suis une chose qui pense « ne me dit pas qui je suis et ne me renseigne pas non plus sur ma réelle identité. Cette identité, loin d’être immédiate et évidente est finalement problématique puisqu’elle est à faire et c’est pour Kant, le fruit d’un véritable travail. Bien sûr, le « je « est nécessaire pour pouvoir penser et s’approprier ses pensées, mais il ne donne aucune connaissance réelle sur soi-même. Être Cs signifie seulement qu’il est possible pour le sujet de prendre ses états de Cs pour objet de Cs, i.e. de réfléchir et de faire un retour sur soi. Il faut donc distinguer la Cs immédiate qui accompagne tous mes actes de la conscience médiate ou réfléchie qui permet au sujet de faire un retour sur soi-même. Donc, il y a deux moments : d’abord celui durant lequel je pense, et un autre durant lequel j’ai conscience d’être conscient. ces deux moments sont corrélatifs car la conscience des actes est en même temps conscience de soi, sinon, on perdrait son identité. Husserl dira « Toute conscience est conscience de quelque chose « et introduit par cela l’intentionnalité. Ce qui caractérise la Cs est qu’elle est toujours en relation à autre chose qu’à elle-même et il y a donc implication d’une distance du sujet à l’objet qu’il vise, qui peut être le monde extérieur ou le sujet lui-même. La Cs vise toujours quelque chose d’extérieur à elle, avec quoi elle ne peut jamais se confondre. Avant toute réflexion, être Cs, c’est être présent dans le monde, donc s’y inscrire et lui donner un sens . Par cela, la Cs donne un sens aux choses extérieures qui n’en ont pas forcément un. Selon Hegel, un animal est un vivant parmi les vivants. Il dit aussi que l’homme est double et qu’il a, tout comme les animaux, une conscience immédiate mais aussi un esprit, puisqu’il pense, et agit en connaissance de cause. Selon Pascal, la pensée est l’essence de l’homme : il a Cs d’être misérable, mais il est malgré cela, il est grand parce qu’il en a conscience, ce qui est différent des animaux. La pensée, c’est l’expression du roseau : l’homme est supérieur à ce qui peut le tuer. L’attache de l’homme est de bien penser en vue de bien agir. Ainsi, il nous incombe de bien utiliser ce pouvoir que nous sommes les seuls à posséder. PHILOSOPHIE III. L’INCONSCIENT : INTRODUCTION : En tant qu’adjectif, il qualifie un être dépourvu de conscience ou, irréfléchi ou encore une personne non consciente des conséquences de ses actes. On a vu que la particularité de l’homme réside dans la conscience qu’il a de lui-même, de ses actes et de tout ce qui l’entoure. Cette Cs de lui-même ne lui donne pas la connaissance profonde de lui-même, qui est apparue comme une tâche qu’il fallait accomplir tout au long de sa vie, mais une connaissance de soi est-elle possible ? De même, on peut se poser la question : le sujet est-il toujours maître et possesseur de lui-même ? La pleine conscience des actes et pensées pose problème ; en effet, il ne va pas de soi que je suis maître de toutes mes pensées : un exemple tout simple est lors d’une dispute, on se prend à dire des choses méchantes et que l’on ne pense pas On trouvera la réponse avec Leibniz, philosophe allemand de la fin du XVII° siècle, parce qu’il soulève le problème des moments graduels de la conscience selon différents paramètres ; il dit aussi qu’on ne peut être conscient de tout, soit par habitude, soit par incapacité. Il faut donc supposer un psychisme de ma partie qui m’est obscur mais qui pourtant fait partie intégrante de moi-même. I- L’inconscient est premier chez l’individu : 1°) chronologiquement : À sa naissance, le bébé n’a aucune conscience ni de lui-même ni du monde qui l’entoure. Cette conscience, il l’acquérira durant ses trois premières années, en apprenant à maîtriser son corps, puis son langage, et enfin à reconnaître les autres et lui-même en tant qu’individu unique. 2°) Principalement ou logiquement : L’inconscient freudien ne se définit pas seulement par le négatif, mais il est une force psychique active dont le fonctionnement obéit à des règles différentes que celles régissant le Cs. Freud propose de comprendre le psychisme (ensemble des phénomènes mentaux d’un individu) comme la coexistence de deux modes de fonctionnement dont chacun forme un système indépendant : il y a donc le système Ics et le système Pcs/ Cs. Le Pcs est situé entre le Cs et l’Ics dans la mesure où ses représentations ne sont pas présentes en permanence dans la Cs, mais ont toujours la possibilité d’y rentrer. Ce qui le sépare de l’Ics, c’est le Surmoi ou, censure qui est une instance inconsciente qui interdit l’accès à la Cs des désirs jugés inacceptables par la morale : tous les contenus Ics doivent alors se transformer pour accéder au Pcs, puis ensuite à la Cs. L’Ics, chez l’homme, est constitué de pulsions. Les pulsions sont des processus dynamiques qui orientent l’organisme vers un but précis et ces pulsions sont anarchiques. Il a sa source dans les excitations corporelles qui impliquent un état de tension. Son but est de supprimer cet état de tension, ce qui implique la rencontre d’un objet qui puisse le satisfaire ; Chez un enfant en bas âge, la pulsion la plus importante est l’autoconservation. L’ensemble des pulsions s’appelle le « ça « et s’organise au fur et à mesure de la vie, notamment par le biais d’une éducation : les parents contrecarrent les pulsions de l’enfant. Le Surmoi est le moi idéal. Il intériorise dans la conscience de l’enfant l’autorité du père et les exigences par rapport aux interdits parentaux qui sont eux-mêmes le reflet des interdits sociaux et moraux de la Société. Il joue en même temps le rôle de juge et est à l’origine de la Cs morale par le biais du refoulement qu’il provoque en exerçant une censure sur les pulsions du « ça «. Le refoulement est une opération qui repousse et maintient hors de la Cs les représentations liées à une pulsion dont la satisfaction n’est pas compatible avec les exigences morales que les parents ont inculquées. Le « moi « appartient en partie au système Pcs/ Cs et appartient aussi pour une grande part au système Ics puisqu’il est le résultat d’une suite d’identification Ics à la mère, d’abord, puis au père et enfin aux autres. Donc, le « moi « est soumis aux exigences du « ça «, aux impératifs du « Surmoi « et aux contraintes de la réalité : il a donc un rôle de médiateur entre les intérêts antagonistes du « ça «, du « Surmoi « et du monde extérieur. Ces éléments, une fois refoulés, sont porteurs d’une énergie pulsionnelle, ce qui les fait continuer à agir sans qu’on le sache et influence notre comportement. L’Ics est dynamique (on est loin de la conception de Leibniz) : il essaie par tous les moyens possibles de faire accéder ces représentations au Pcs et à al Cs, mais en se transformant et en revêtant des images les plus banales. Quels sont les moyens par lesquels l’Ics tente de parvenir à la Cs ? II- Les différentes manifestations de l’Ics (l’Ics, producteur de sens) : Dans notre vie quotidienne se manifestent souvent, sans que l’on ne s’en aperçoive, ces pulsions Ics, mais d’une manière déguisée. Ces manifestations sont appelées par nos brillants savants : « symptômes «. 1. Le rêve : Freud dira que c’est « la voie royale vers l’Ics «. Le rêve résulte d’un travail d’élaboration au terme duquel les désirs refoulés parviennent à s’exprimer, mais en se déguisant pour déjouer la Censure morale et être acceptés par la Cs. Mais lorsque ce déguisement est insuffisant ou sur le point de s’arrêter, la Cs réveille le dormeur. En interprétant ces rêves, on peut retrouver les pulsions refoulées, causes du rêve. 2. Les oublis et les actes manqués :C’est un phénomène normal qui résulte d’un refoulement, donc d’une défense du Surmoi contre des phénomènes désagréables. 3. Les lapsus : c’est une faute d’inattention dans la parole et l’écriture, qui consiste à substituer un mot à la place d’un autre. En général, cela provoque le rire, mais il exprime un désir Ics qui profite pour s’exprimer d’une faiblesse de la Cs. L’Ics produit donc des effets quotidiens, qui sans cette théorie de l’Ics resteraient incompréhensibles et, partant du postulat initial que tout acte psychique a un sens, tous les actes Ics s’expliquent. Freud traite ces symptômes comme des effets de sens, en eux se manifeste une signification qui pourtant est recouverte, cachée par le sujet lui-même. C’est un paradoxe, mais il s’explique par le fait que le « moi « est le jeu de forces opposées, i.e. le « ça « et le « Surmoi «.Bien que les symptômes soient bénins pour la plupart, il existe d’autres manifestations de l’Ics qui sont de réelles maladies psychiques plus ou moins graves : ¨ Les névroses :Maladie psychique aiguë (chronique) qui n’implique ni infection ni lésion physique, ni une désorganisation de la personnalité et s’accompagne donc d’une conscience douloureuse de la maladie. Il y a trois formes essentielles. 1. Névroses obsessionnelles 2. Hystérie : c’est en traitant ces cas que Freud en est venu à en déduire l’existence de l’Ics. État pathologique qui ne semble reposer sur aucune lésion organique ; se manifeste souvent par des crises. 3. Névroses phobiques : peur extrême, incontrôlable. Les phonies proviennent d’un traumatisme refoulé (qui se manifeste par le biais de cette phobie) par les conflits qui opposent le ça et le Surmoi. ¨ Les psychoses : elles impliquent une grave désorganisation de la personnalité ; enferment le malade dans un univers qui ne correspond plus du tout au vrai ; Le psychotique est délirant ou autistique, mais n’a pas Cs de son anomalie. Ces symptômes sont plus ou moins gênants, voire dangereux pour le malade et son entourage, ne se rendant compte de rien. On peut vivre avec ; un analyste peut guérir. Freud, qui a émis l’hypothèse de l’Ics, a trouvé une façon de guérir : la Psychanalyse qui vise à retrouver la pulsion, cause du symptôme, en déchiffrant le discours de son patient qui a toujours une signification Ics. Pour cela différentes techniques sont mises dans la partie : l’interprétation des rêves ou des associations libres. La guérison est définie par un retour dans la Cs de la pulsion. Quel est l’acquis de la psychanalyse ? Commencée par Freud, elle évolue au cas par cas donc, affirmer que nous ne sommes plus maîtres de notre maison n’est pas définitif. La toute puissance de la Cs définie par Freud a été depuis remise en question et on s’aperçoit que l’Ics appartient tout autant à l’homme que la Cs TEXTE 3 : Il met à jour la raison qui fait que nous n’avons pas la même conscience sur tout ce qu’on perçoit. Quand nous sommes occupés à quelque chose, nos sens parviennent à notre esprit sans que nous nous en apercevions ; lorsque cette occupation cesse , nous sommes en mesure de nous en apercevoir. Ces perceptions influencent notre comportement et notre gestuel : nos coutumes sont influencées par elles. Nous n’avons pas Cs de tout : on s’aperçoit de certaines perceptions et d’autres non. TEXTE 4 : Bergson est un français , il est l’un des seuls à reconnaître l’existence de l’Ics, mais il en donne une définition différente de celle de Freud, à savoir que l’Ics est la mémoire de tout ce qui a été oublié, parce qu’on ne se souvient pas de tout ce qu’on vit. Pour Bergson, on se souvient de ce qui nous est utile pour le présent ; pourtant, tous les autres souvenirs subsistent « au-dessous de la scène illuminé par la Cs «. De manière métaphorique, il donne une connotation négative à l’Ics. On n’oublie rien, bien qu’on n’ait pas tjs Cs des souvenirs. L’Ics est qualifié « d’obscures profondeurs «, ce qui est en soi différant des « lumières « de la Cs. Les souvenirs sont des fantômes qui nous hantent ; ils ne remontent jamais, parc que, dit-il : « j’ai autre chose à faire « ; le Pb est qu’il confond Ics et Pcs parce que ces souvenirs qui ne remontent pas ont été censuré. Ils apparaissent quand je dors, parce que le Surmoi dort aussi. TEXTE 6 : Freud rédige une réponse adressée à ceux qui ne croient pas à l’hypothèse de l’Ics psychique. Elle est nécessaire et légitime, i.e. conforme à la raison et à la Morale parce qu’on ne peut pas tout expliquer par des mécanismes Cs : on doit alors chercher les réponses dans le non-Cs, c’est à dire l’Ics et donne des exemples : nos actes manqués, nos rêves (souvent bizarres et incompréhensibles au niveau de la Cs), les hystériques et les névrosés, les phénomènes compulsionnels (actes qu’on ne peut contrôler). Ces actes sont Cs et sont les effets de l’Ics (=symptômes), mais ils deviennent logiques si on les explique par l’Ics, logique qui évidemment échappe totalement à la Cs. PHILOSOPHIE IV : LES PASSIONS. Au sens premier du terme, selon Aristote, avoir une passion signifie en fait le fait de subir une action, passion venant alors du verbe pâtir. Au XVII° siècle, les passions de l’âme sont tous les états où l’âme connaît des modifications (plaisir, peur, colère…). Elles sont bonnes si elles disposent l’âme à vouloir ce qui est bon, mais peuvent être mauvaises si on les suit avec excès. D’un point de vue psychologique, on distingue la Passion d’une simple émotion par sa durée, son intensité et sa capacité à dominer la vie intellectuelle du passionné. La passion peut annihiler toute volonté et, par nature, une passion est aujourd’hui perçue comme quelque chose d’excessif et d’exclusif. La Passion est opposée à trois éléments : la Raison, d’abord (chez Kant, elle relève de notre côté sensible), l’action ensuite et enfin la volonté. Elle est ainsi perçue négativement puisqu’elle semble avoir un contrôle total sur le passionné qui ne peut que subir sans rien pouvoir tenter la passion. Un exemple : la passion amoureuse peut engendrer une jalousie excessive qui peut parfois même conduire à une certaine violence. De plus, notre culture Judéo-chrétienne fait que l’on condamne systématiquement les passions à cause des sept Péchés Capitaux. La question est de savoir pourquoi on les condamne de façon si radicales ? En fait, c’est parce qu’elles révèlent tout ce qu’il y a d’extrême en l’homme et que c’est la victoire du sensible sur la raison ; pourtant, n’est-elle pas la marque de notre dualité ? Et, en fait, plutôt que de l’éradiquer, ne vaudrait-il pas mieux connaître ce qu’il y a de passionnel en nous et en avoir le contrôle pour agir avec ? La sagesse, en ce sens, n’est-elle pas de se connaître soi-même, donc de connaître ses passions, pour en tirer le meilleur parti avec la raison et ainsi, être en harmonie avec soi-même, c’est à dire en fait, arriver à un équilibre entre la raison et les passions ? I- La Passion opposée à la raison. Pourquoi parlait-on avant DES passions, alors qu’on en proclame aujourd’hui une certaine unicité en parlant de la passion au singulier ? Tant qu’on a défini les passions comme étant des phénomènes passifs affectant notre âme et notre vie, elles étaient multiples et s’opposaient à la Raison, qui est unique, elle, et qui est seule capable de les gouverner : en fait, on voulait marquer une certaine opposition entre les multiples déchirements que peut connaître l’âme et la faculté unifiante qui est capable de la sauver. Aujourd’hui, par déplacement de définition, seule UNE Passion peut dominer la vie d’un homme. Les passions qui peuvent nous affecter sont différentes l’une de l’autre. Peut-on les regrouper sous une unique dénomination, ces passions hétérogènes ? Oui, si l’on suit Hegel parce que la passion ne peut se définir par son objet, qui est pour chaque passionné différent, autrement dit, elle ne peut se définir par un contenu particulier. Donc, la passion est une forme. « Cette forme exprime seulement ceci qu’un sujet a placé tout l’intérêt vivant de son esprit, de son talent, de son caractère et de sa jouissance dans un seul contenu « dira Hegel. La passion est donc une tension spirituelle, orientée vers un but, un projet : c’est donc une force de caractère ou force d’âme. Le risque est alors de confondre passion et caractère (forte personnalité i.e. volonté) car elles se ressemblent, avec notamment deux points communs la constance dans les fins et la fixation de la Cs sur un objet, un contenu qui a été posé et valorisé librement. Cependant, la volonté est une activité hautement Cs qui se force de mettre en œuvre les moyens appropriés à l’obtention d’un résultat poursuivi en fonction d’un choix délibéré qui suppose un équilibre relatif de nos tendances : il n’est donc pas démesuré. La passion, au contraire rompt cet équilibre de nos tendances parce qu’elle est un signe de dépendance, qu’on ignore son objet et ses véritables buts, et qu’au fil du temps elle laisse libre à l’imaginaire, ce que Stendhal appelle dans De l’amour la Cristallisation. Ce phénomène fait que le sujet se fixe sur un objet unique, l’idéalise et l’exagère à outrance. Pourtant, le passionné se croit libre de ses choix, de sa passion parce qu’il poursuit une fin et qu’il emploie tous les moyens propres à l’atteindre. Il faut donc supposer que cette fin est illusoire. Illusoire vient du latin illudare qui signifie se moquer de… L’illusion est une tromperie qui se joue de nos sens et de notre esprit. Proche de l’erreur parce qu’elles font intervenir un jugement erroné. La passion est l’opposée de la raison parce qu’elle peut conduire au fanatisme. Le fanatique (du latin fanisticum) qualifie l’individu qui, sortant de l’endroit sacré où il a communiqué avec son dieu, est transporté d’enthousiasme. La dimension originellement religieuse s’est étendue à tous les domaines de croyance : idéologie, politique… Contrairement aux chercheurs scientifiques dans le cadre d’une rationalité rigoureuse qui aiment la vérité, les fanatiques portent à sa vérité un caractère intolérant et irrationnel et le rend capable d’utiliser la violence extrême, violence qui peut être tournée vers l’extérieur mais aussi vers soi. Cette passion des fanatiques est destructrice et fait souffrir l’individu qui en fait profiter les autres. C’est donc pour toutes ces raisons que la Passion est perçue comme étant mauvaise et donc contraire à la raison : elle est dite irrationnelle et déraisonnable. Le rationnel se différenciant du raisonnable par le fait que le rationnel est conforme à la raison théorique et qu’elle appartient au domaine de la connaissance, alors que le raisonnable qualifie « quelqu’un capable de bien juger et de discerner le vrai du faux « (définition de Descartes), et fait partie du domaine de l’action morale pour désigner une conduite sage ou un homme qui agit conformément à la Cs. On a longtemps affirmé que la raison devait réprimer ou tout au moins régler les passions, pourtant, n’est-il pas toujours trop simple ou trop hâtif de juger la passion toujours mauvaise et la raison toujours bonne ou bienveillante ? II- La raison ne s’oppose pas nécessairement à la Passion. Tout d’abord, la raison peut être passionnée : le sage, par exemple, dans sa quête de sagesse et de vertu est un être passionné par le Bien : il en fait le sens profond et le but de sa vie. De même, le savant dans sa recherche de la vérité est un être passionné par le vrai. La raison peut aussi se passionner pour tout ce qui est artistique, parce que l’Art n’est pas seulement le plaisir des sens mais aussi le plaisir de l’esprit. Toutes ces passions ont en commun le fait qu’elles canalisent l’énergie pulsionnelle d’un individu vers des buts idéaux, ce que Freud nommera Sublimation, disant que c’est « la capacité d’échanger le but qui est à l’origine sexuel contre un autre qui n’est plus sexuel, mais qui est psychiquement parent avec le premier «. Ce processus rend compte d’activité correspondant à des buts socialement valorisées, à savoir les activités artistiques ou intellectuelles. Ces buts sont apparemment sans rapport avec la sexualité, mais ils trouvent leur origine dans la pulsion sexuelle qui, sous la pression d’un refoulement change d’orientation et choisit des objets de valeur supérieure. La passion de l’artiste ou du savant leur évite des maladies psychiques : elle ne peut par conséquent pas être condamnée car elle les fait vivre en leur évitant le désespoir car elle leur donne un sens. Cette passion est leur vie. Passion et raison se conjuguent et servent l’une à l’autre : on peut même dire qu’elles sont indissociables et peuvent œuvrer dans le même sans de la vie et de l’histoire. En fait, les hommes agissent et transforment le monde car ils sont passionnés, ce qu’a voulu montrer Hegel lorsqu’il affirme : « rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion «. Moralement parlant, la passion est égoïste parce que l’homme passionné ne recherche que son propre intérêt, mais ce but peut être bon, moral et universel, c’est à dire qu’il y a adéquation entre l’intérêt particulier du passionné et l’intérêt universel : la passion est égoïste , mais il arrive que l’intérêt de ce particulier coïncide avec l’universel et cette adéquation est bien souvent involontaire. Comment alors est-elle possible ? D’après Hegel, c’est possible grâce à la ruse de la raison. En effet, la raison n’est pas seulement une qualité de l’esprit humain, mais elle est tout ce qui anime l’ensemble du réel. Les hommes, sans le savoir, sont les outils de quelque chose qui les dépasse : c’est la raison universelle. Les hommes croyant poursuivre uniquement leur propre intérêt, déterminé par leur propre passion, réalisent une histoire de l’humanité, « elles réalisent l’universel « dira Hegel. Il a montré que l’histoire de l’humanité ne s’effectue pas n’importe comment, mais qu’elle possède un sens voulu par la raison et obéit à une fin, un but. L’homme passionné œuvre de par ses actions dans ce sens et dans tous les domaines qu’ils soient intellectuels, politiques, sexuels… Il transforme ce qui l’entoure à sa manière et toutes ces transformations sont liées entre elles. La passion sert la raison, et donc ne s’y oppose pas. Cependant, opposer ou ne pas opposer passion et raison suppose qu’elles soient du même ordre or, n’appartiennent-elles pas à deux domaines différents ? III- Passion et raison n’ont aucun lien entre elles. Ne s’est-on pas trompé jusqu’à présent en opposant raison et passion et en disant qu’elle avaient un terrain commun qui permettent leur opposition ou non ? C’est le point commun qu’a soulevé Hume dans son Traité de la nature humaine ; Il y réfute l’opposition classique raison/ passion : l’une ne s’oppose pas à l’autre parce qu’elles sont totalement éloignées : Hume, comme le dit Kant, est un éveilleur. Il veut montrer que les idées reçues sont perçues de manière confuse, il faut donc analyser ces idées en les ramenant à ce qu’elles contiennent, but de la philo. Il applique ce principe à la raison et par extension à la passion. La raison n’est qu’une faculté de représentation et de combinaison. La représentation est une image contemplée par notre esprit, parfaitement inerte, qui donc ne possède aucun dynamisme. Ces représentations ne sont pas des moteurs de l’action puisque la raison n’influence pas l’action. Seules les passions sont dynamiques et influent sur l’action. Chez Hume, la raison est purement théorique, ce qui est différent de pratique et a permis à Kant de distinguer la raison pure, théorique et la raison pratique, qui s’applique à l’action. puisque la raison et la passion sont hétérogènes, les préjugés sont anéantis. Ils consistent à affirmer qu’il y a un combat perpétuel entre la passion et la raison, qui tourne à l’avantage de la raison quand elle réussit à empêcher l’action inspirée par la passion et les préjugés accordent à la raison le mérite d’empêcher les actions déraisonnables et accusent la passion de faire agir l’homme de façon déraisonnable. Au contraire, Hume met en évidence qu’il ne peut y avoir de déraison que dans la raison, i.e. qu’il ne peut y avoir d’erreurs que dans le jugement. Ainsi, aucune passion n’est en soi déraisonnable parce qu’elle n’appartient pas à l’ordre des idées et de la représentation, mais consiste dans l’existence vécue des situations. La raison est un pouvoir de contemplation, de prévision, de jugement, i.e. toujours un pouvoir de distanciation par rapport à l’environnement présent. La passion implique que nous sommes insérés dans une situation qui nous presse et qui nous concerne de façon présente. Il est déraisonnable de prétendre transporter de l’eau dans un récipient troué car c’est juger et prévoir faussement que l’eau ne coulera pas. Il n’est pas raisonnable ni déraisonnable de « préférer la destruction du monde entier à une égratignure de mon doigt « (Hume) car mon doigt que je sens m’importe plus que le monde entier que je ne fais que me représenter. On ne peut donc pas qualifier une passion de raisonnable ou non car ils ne relèvent pas du même domaine. Toutes les passions ne sont pas mauvaises, et la raison n’est pas toujours bonne. La raison et la passions sont présentes en chacun de nous et toutes deux peuvent devenir nuisibles, non seulement à l’homme, mais aussi à son entourage s’il les suit de manière excessive. TEXTE 5 : Schopenhauer développe le thème de l’amour, qu’il présente comme un leurre. Il le réduit à l’instinct de reproduction ou de conservation de l’espèce, en faisant un parallèle entre un insecte qui recherche telle ou telle nourriture et l’homme qui recherche l’amour de telle ou telle femme qui est apte à fonder une famille. L’amour relève donc d’un intérêt, qui est la conservation de l’espèce. C’est quelque chose de raisonné, de rationnel, mais ne l’est pas en fait parce que la description n’a plus rien à voir avec notre conception de l’amour : un homme se marie avec une femme qu’il juge parfaite, donc capable de procréer et d’élever ses enfants. La volonté de la nature qui se révèle dans les instincts est supérieure à celle de l’individu et agit, toujours Schopenhauer, à son désavantage. Tout ceci se fait de manière Ics parce que le but de la passion (de procréation) lui échappe totalement. En d’autres termes, la fin, le but de la passion amoureuse est inconnu. C’est donc une sorte de ruse de la nature pour que l’homme perpétue sa race et son espèce et finalement, si l’homme prenait Cs que la seule fin de l’amour est la procréation, il ne poursuivrait pas cet amour de manière acharnée et ferait passer son bien-être personnel avant : il est clair que l’amour implique le sacrifice de soi : « la vérité prend ici la forme de l’illusion, afin d’agir sur sa volonté «. Les hommes croient agir pour leur bien-être alors qu’ils agissent pour la nature. TEXTE 8 : Les passions ne sont pas forcément mauvaises parce qu’elles sont inhérentes à l’homme et le constituent tout autant que la raison. Si dans un premier temps, elles sont nuisibles, elles peuvent se transformer au contact de la raison et se spiritualiser. L’erreur de l’homme a été de croire que les passions sont toutes et toujours mauvaises pour nous-mêmes et pour les autres et c’est pour cette raison qu’on a voulu les faire disparaître à jamais. Cette attitude est inacceptable puisqu’on a voulu tuer ces passions, sans même penser qu’elles peuvent être bénéfiques pour l’homme. Ainsi il condamne Socrate en disant que « le monde est malade depuis Socrate «, de même que l’Église qui a condamné sans réfléchir ces passions : elle a été totalement aveugle. Les passions sont sources de vie et si on détruit les passions, alors on détruit la vie : l’Église détruit la vie. TEXTE 9 : Pascal expose le perpétuel combat entre la raison et la passion : il y a combat parce qu’il n’est ni pure intelligence ni pure sensibilité. L’homme est à la fois sensibilité et intelligence, mais ne peut les faire coexister et doit donc toujours avantager l’un par rapport à l’autre, c’est pourquoi il est toujours divisé, écartelé entre le sensible et l’intelligence. L’âme humaine est toujours déchirée et si l’on veut la paix intérieure, il faut faire un choix et c’est pourquoi les penseurs se sont divisés en deux sectes : les stoïciens qui voulaient anéantir ce qu’il y a de passionnel en eux, mais ce, par la fuite ; et les épicuriens qui à l’origine sont des sages, mais qui pensaient que les passions n’étaient pas mauvaises en soi et recherchaient le bonheur , mais plus un bonheur spirituel que matériel ou corporel Pascal tourne l’Épicurisme à sa source car Des Barreaux est un sage épicurien dégénéré. Ce combat continue parce qu’on ne peut effacer ce qu’il y a de passionnel en nous, ni de même effacer le rationnel. Finalement, si on a les deux capacités, il faut faire avec et ne pas annihiler ni le passionnel ni le rationnel. PHILOSOPHIE V : AUTRUI. INTRODUCTION : Autrui, c’est l’autre en général : « c’est l’autre qui n’est pas moi « sera la définition donnée par J-P. Sartre. Il y a en même temps proximité et éloignement ; proximité parce qu’on ne peut pas vivre seul : la solitude est un état second. Un être humain a besoin des autres car il a besoin de leur aide, mais aussi pour en savoir plus sur lui-même. En effet, nos actes ne prennent sens que par rapport au regard que l’autre peut avoir sur nous : la honte, c’est la honte devant quelqu’un. En outre, la communication avec l’autre est le besoin le plus important et si elle est possible, c’est parce que l’autre est proche de moi et peut donc comprendre. Cependant, on ne comprend pas toujours les réactions des autres parce qu’elles sont différentes, ce qui entraîne des conflits. Donc, nous sommes toujours différents : nous ne réagissons pas de la même manière même si on comprend les pensées : il existe une distance infranchissable. C’est une bonne chose dans la mesure où chacun a son caractère qui lui est propre puisque chacun a sa propre personnalité, sa propre identité, son unicité (tant biologique que morale), mais cette distance amène souvent une volonté de s’isoler des autres, c’est pourquoi autrui est une figure contradictoire en ce sens qu’on ne peut s’en passer, mais, d’un autre côté, l’autre est loin. Autrui est un « Alter ego «, c’est à dire autre moi et autre que moi. Cette distance pose deux Pb principaux : puis-je connaître autrui ? Et cette distance engendre une incompréhension et une volonté de domination. Mon rapport à l’autre n’est-il qu’un rapport de dominé/ dominant ? Ce rapport est-il nécessaire ? Ne puis-je pas voir autrui comme un être supérieur ou inférieur à moi, mais plutôt comme mon égal ? Autrui devient alors un Pb éthique : peut-on dépasser ce stade imposant une hiérarchie entre moi et les autres et voir autrui comme une fin : le respecter en tant qu’alter ego. I- La connaissance d’autrui. Notre devoir d’être humain est de connaître autrui, ce qui peut nous permettre de réduire la distance qui existe entre lui et moi. Les conflits (incompréhensibles) et les quiproquos viendraient en fait de l’ignorance de l’autre. Cette connaissance pose Pb parce que d’abord, elle est empirique (est empirique toute connaissance se basant sur l’expérience) parce que chaque chose est unique : il m’est donc impossible de connaître l’autre en général, mais un autre en particulier. Même si je réduis cette connaissance à un petit nombre d’individus, est-elle pour autant possible ? Non, je ne peux saisir l’autre dans sa totalité, parce que lui ne le peut pas et qu’il a, tout comme moi, un point de vue unique sur le monde et donc, qu’il agit par rapport à ce point de vue particulier. On peut alors tenter de le connaître par analogie avec moi-même, i.e. trouver une identité de rapport, une ressemblance entre moi et lui. Concrètement, je vais essayer de le connaître ou de le comprendre par rapport à la réaction que j’aurai à sa place, par rapport à des attentes personnelles. Là encore, lui n’est pas moi, et vice-versa, et sa façon de réagir peut être radicalement différente de la mienne. Donc, cette connaissance par analogie est superficielle et incertaine parce que là encore empirique. On a ici une vision pessimiste car, ne puis-je pas éprouver ce que ressent autrui par le biais de certains sentiments ? Ces sentiments sont : ¨ La sympathie (du grec sun = avec ; pathos = souffrance) quand j’éprouve de la sympathie pour quelqu’un, il se crée entre lui et moi une communauté de sentiments qui peuvent aller jusqu’à une fusion affective : amitié ou amour. Par exemple, Adam Smith (économiste anglais à qui l’on doit le libéralisme) fait de la sympathie le fondement de la morale dans la mesure où elle pousse les individus à se dévouer les uns pour les autres. ¨ La pitié, sentiment de compassion (= pâtir avec) en présence du malheur d’autrui. Chez Rousseau, elle a un véritable statut philosophique puisqu’il dit que c’est « un sentiment naturel qui modérant, dans chaque individu, l’activité de l’amour de soi-même concoure à la conservation mutuelle de toute l’espèce «. La pitié, à l’état de nature, remplace les lois et la morale et constitue avec l’instinct de conservation le fondement de la vie morale et sociale. L’état de nature est une hypothèse de travail qu’usent les philosophes des lumières qui est l’état dans lequel se trouvaient les hommes avant toute constitution civile. On entend ainsi expliquer pourquoi les hommes se regroupent, pourquoi ils ont fait des lois et pourquoi il y a des injustices. De tels sentiments font ressentir avec autrui, mais ne font pas sentir comme lui. Nous avons chacun notre façon d’éprouver les choses par rapport à notre vécu et aussi et surtout par rapport à notre éducation. De plus, si je ne peux pas connaître autrui, c’est parce que lui-même ne se connaît pas dans son intégralité : il est une énigme pour moi autant qu’il l’est pour lui, et ce pour deux raisons principales : d’une part du fait de ses déterminations Ics, et d’autre part du fait que l’homme est perfectible, i.e. qu’il n’est pas : l’homme devient : on dit alors que l’homme existe (du latin ex = hors de . et de sistere = se tenir èse tenir hors de.) alors que l’animal est. Tout ceci s’applique à moi : à travers autrui, je peux me connaître et donc en savoir plus sur moi-même. Sartre dira « qu’autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même «. Autrui me libère dans la mesure où il remet en cause toutes les certitudes que je crois avoir. La présence d’autrui m’enrichit par sa différence puisqu’il m’ouvre d’autres perspectives que la mienne et me permet de ce fait une connaissance plus profonde de mon existence dans ce monde. Cet enrichissement se fait sur la base d’un langage commun puisqu’il réclame une communication en général. Donc, en gros, l’autre ne m’est pas connaissable de manière totale ; il est cependant un moyen pour moi de me connaître. Mais, là encore, il y a un Pb : serait-ce donc pour un but personnel et uniquement personnel que l’on communique ? En effet, nous nous utilisons mutuellement pour nous connaître nous-mêmes et enrichir nos points de vue. Je suis alors un moyen pour l’autre et vice-versa. Le Pb est de savoir si cette utilisation mutuelle me permet d’être reconnu comme Cs de soi (et inversement ) par l’autre ; Il est évident que quand j’utilise quelque chose, c’est en vue de mon bien-être et non du sien ; l’autre devient alors dans ce cas un simple objet, tout autant que l’inverse est vrai. Mais, existe-t-il, dans ce cas, une reconnaissance mutuelle ? II- La reconnaissance mutuelle. Originellement, l’être humain est un être égocentrique : un enfant, jusqu’environ cinq ans a tendance à tout ramener à lui et n’envisage les choses que par rapport à lui-même. Le reste du monde, y compris les autres, n’existent à ses yeux que pour son bon plaisir. Mais, à l’inverse, reconnaître autrui, c’est admettre que je ne suis pas le seul sujet et qu’il existe une diversité de Cs qui ont autant que moi le droit de profiter de la vie et de ce qui les entoure et sur un plan purement juridique, qui ont autant de droit que moi. Nous savons que les autres existent, mais les reconnaissons-nous pour autant comme des Cs de soi libres, au même titre que nous ? Non, bien sûr. Et il y a des quantités astronomiques d’exemples : l’esclavage, le colonialisme, le racisme et en général l’oppression. Qu’en était-il au début de l’humanité ? Il était d’abord un animal sans Cs : la question est de savoir comment sommes-nous sortis de l’animalité pour entrer dans l’humanité ? Hegel tente de répondre à cette question dans Phénoménologie de l’esprit (1807 donc avant les théories évolutionnistes sur l’homme) en traçant l’histoire de la Cs qui se fait par étapes successives liées entre elles sous forme dialectique. La dialectique, selon Hegel, est la loi de la pensée et du réel qui progressent par négations successives en accédant à une synthèse elle-même partielle et donc appelée à être dépassée. Son livre retrace l’itinéraire subi par l’esprit humain dans sa prise de conscience progressive de la liberté. La fin de l’histoire sera atteinte quand chaque homme prendra Cs que chaque home, en tant qu’être humain, est libre. Ce qui nous intéresse, c’est de savoir comment l’être humain a dépassé son animalité pour arriver à l’humanité et donc passer l’étape de la reconnaissance. Pour ce faire, Hegel va prendre deux hommes, donc deux Cs différentes. Chacune de ces deux Cs croit que la Cs qu’il a de lui-même est immédiate. Or l’immédiateté des Cs n’est pas satisfaisante. Cette certitude le fait presque sortir de l’animalité parce qu’elle s’oppose immédiatement, mais est encore intérieure. Autrement dit, le reste du monde, y compris les autres hommes n’est rien à ses yeux et donc le moi se pose comme une absoluité : chacune de ces Cs a Cs d’elle-même, mais pour ce qui est des autres Cs, elle les met dans le même sac : elle ne reconnaît pas les autres Cs comme Cs. Elle est encore, pour l’autre, figure indépendante, i.e. qu’elle ne se retrouve pas dans l’autre. elle voit l’autre comme un être vivant englué dans la matière : l’autre fait partie du décor. La Cs de soi reste alors au stade de la certitude individuelle, parce que la véritable Cs de soi passe par la reconnaissance des l’autre et est médiate, donc mutuelle. Ce processus dépasse l’absoluité et suppose une lutte entre ces deux Cs, parce que chaque Cs veut être reconnue par l’autre, mais ne veut pas que l’inverse soit fait. Au départ, cette lutte est une lutte à mort, lutte de pure prestige et dépasse la lutte animale : on dit que c’est un moyen terme : si on est capable de mettre sa vie à distance, c’est qu’on ne se confond pas avec cette simple vie biologique, c’est à dire avec l’animalité. Or, si je reste en la seule compagnie de moi-même, je ne peux pas faire cette différence qui en moi sépare l’animalité de l’humanité. Je ne peux opérer cette différence qu’en prenant autrui à témoin de la possibilité où je suis de la faire. Il y a trois éléments dans la lutte : le JE, l’AUTRE, la VIE (monde extérieur et altérité). De ce combat sort un vainqueur et un vaincu. Le vainqueur a préféré la vie à la liberté ; le vaincu, la liberté à la vie, i.e. il a montré son indépendance vis-à-vis d’elle, ce qui constitue alors la dialectique du maître et de l’esclave. Le premier temps de la dialectique est que l’esclave (latin servus, celui qui a été conservé) n’a pas été tué afin d’être témoin et miroir de la victoire de son maître ; mais en mettant la vie au service de son maître, l’esclave perd sa liberté, vivant pour faire vivre son maître. Le second temps de la dialectique : parce qu’il a interposé un esclave entre lui et le monde, le vainqueur finit par ne plus connaître les contraintes de la vie matérielle et donc, il ne sait plus rien faire. Son esclave, en revanche, apprend à connaître , à transformer et à vaincre la nature, en se soumettant à ses lois : il connaît alors ses limites. C’est ainsi grâce à son travail que l’esclave acquiert une nouvelle liberté : le travail est formateur. Le troisième temps : De son côté, le maître a de plus en plus besoin de son esclave pour survivre, à tel point qu’il en devient dépendant. Il devient en quelque sorte l’esclave de l’esclave : le travail, finalement, a permis la formation et la transformation donc l’humanisation de l’esclave, tandis que le maître devient incapable de satisfaire par ses propres moyens ses propres désirs. Lorsque l’esclave en prend Cs, il va lutter pour se libérer de son maître. Dans cette optique, l’histoire, c’est l’histoire de la libération des esclaves, des oppressés et la fin de l’Histoire sera pour quand il n’y aura plus ni maître ni esclave. Au terme de cette dialectique, il y a une prise de Cs à faire dans le but d’une reconnaissance mutuelle. Chez Hegel, ce conflit et cette relation de domination est un long moment, qui comme tel, est appelé à être dépassé, mais d’une manière plus pessimiste, plus négative et peut-être plus réaliste, ce rapport n’est-il pas le fondement qui constitue toute relation avec autrui ? Sartre le dit dans sa pièce de théâtre Huis clos : « l’enfer, c’est les autres «. Nos relations avec les autres sont toujours des relations de dominant à dominé, étant tour à tour l’un des deux (Cf. La Prophétie des Andes). Il faut donc, si l’on ne veut pas toujours être dominé savoir s’imposer parmi ses semblables et cette relation dominé/ dominant est à l’œuvre dans l’épreuve du regard. Ma liberté est constamment menacée par la présence d’autrui et son regard qui me rabaisse au rang de chose, d’objet, i.e. par le regard que l’autre porte sur moi ou pourrait porter sur moi, je suis destitué de ma liberté ; c’est pourquoi affronter le regard d’autrui est une épreuve angoissante. Autrui apparaît comme une menace permanente qui plane sur moi. Donc, menaces, conflits et moyens sont les maîtres mots autour deD_TsE_ø___LØb_0ªC_¿å___Ôb_5ê@_Dê@__Òb_oËC___b_¿å__¢ä__Qå__¸å__ôæ__ýæ___ç___ç__«ç__ªç__@è__Sè__Ñè__øè___é__3é__hë__\"ë__†ë__ðë__Æì__íì__-í__ƒí__³í__Áí__Kî__cî__âî__íî__ˆï__ï__-ð__Að__Èó__ƒô__å÷___ø__9ù__Fù__êúÏb_(þb__þû¿0’÷¿ÿÿÿÿ¸Ïb_`J÷¿____sE_ÿöC_ÔÓb_ÌÏb_0ªC_dÓb_äÏb_Tá@__iD_TsE_ø___LØb_0ªC_Ðæ___Ôb_5ê@_Dê@__Òb_oËC___b_Ðæ__¢ä__Qå__¸å__ôæ__ýæ___ç___ç__«ç__ªç__@Ïb_(þb__þû¿0’÷¿ÿÿÿÿ¸Ïb_`J÷¿_ÏbÏb_(þb__þû¿0’÷¿ÿÿÿÿ¸Ïb_`J÷¿____sE_ÿöC_ÔÓb_ÌÏb_0ªC_dÓb_äÏb_Tá@__iD_TsE_ø___LØb_0ªC_Ðæ___Ôb_5ê@_Dê@__Òb_oËC. Mais, de manière pratique, que signifie le mot respect ? En d’autres termes, comment dois-je agir si je veux respecter l’autre, c’est à dire agir moralement ? C’est à cette question qu’a voulu répondre Kant dans Fondements de la Métaphysique des mœurs. Il se pose la question essentielle qui est : « Quelles règles morales, universelles doit-on suivre si ‘on vise autrui comme fin et non comme moyen ? «. Kant nous propose deux types de fins : ¨ Les fins relatives puisqu’elles concernent le Bonheur. Elles sont relatives parce que notre conception du bonheur varie selon l’individu. Elles fondent des impératifs hypothétiques qui s’écrivent : « si tu veux A, fais B « Dans ce cas, l’action est toujours intéressée parce qu’elle comporte un intérêt. ¨ La fin absolue. Elle est absolue parce qu’elle vaut pour tous les êtres raisonnables (il y a une différence entre les êtres doués de raison). Cette fin absolue fonde un impératif catégorique qui est moral et vaut pour n’importe qui et dans n’importe quelles circonstances. C’est pourquoi il s’énonce sous la forme d’un ordre inconditionné et désintéressé : « Fais A ! «. Il vaut pour loi morale qui doit être pur désintéressement. Autrui doit relever de cet impératif si j’entends le respecter comme alter ego. Autrui est la fin qui vise une volonté raisonnable, cette loi doit être valable pour tous les êtres raisonnables parce que la loi morale est une loi de raison. Comment savoir si cette loi morale respecte l’autre ? Pour le savoir, il faut que la maxime de l’action, c’est à dire ce qui me pousse à agir doit être universalisable et doit pouvoir valoir pour tout le monde. Si elle ne l’est pas, elle est subjective et comporte donc un intérêt : on retourne donc aux fins relatives. Mais, ce qu’il faut savoir, c’est que le contenu de cette loi ne peut être qu’une forme, parce qu’elle ne doit pas dicter des préceptes bien précis puisque chaque situation est différente. Il faut donc une formule qui vaille dans tous les cas qui soient formels. « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité non seulement dans ta personne, mais dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen «. La formule telle qu’elle est énoncée ne nous dit aucunement la manière d’agir. Il faut remarquer que lorsque Kant parle d’autrui, c’est d’une personne universalisable, comme une simple forme : je dois respecter l’autre, non pour son individualité mais parce que c’est un représentant de l’humanité. Cette loi morale est un devoir pour tout être raisonnable. Devoir qui renvoie à l’idée d’obligation. La contrainte est différente de l’obligation parce qu’elle s’exerce de l’extérieur : on n’est donc pas libre ; alors que l’obligation est une décision de notre part, souvent en relation avec la morale. Pourquoi y a-t-il obligation ? La loi morale vient de la raison, du côté intelligible. Le Pb est que nous sommes aussi des êtres sensibles et, à ce titre, on a des fins particulières. Or, si l’on veut suivre la morale à la lettre, on doit les mettre de côté. Le respect de l’autre, c’est l’oubli de soi. La morale n’est pas innée, mai c’est une tâche à accomplir. Ce doit être l’élément raisonnable en nous qui doit produire cette loi morale. C’est le même être qui crée, produit et devant qui le moi sensible se soumet. On dit qu’un être moral est autonome (par différenciation d’avec hétéronome). CONCLUSION : Cette loi morale Kantienne paraît la meilleure solution si on veut vivre dans une respect mutuel ; c’est malheureusement difficilement réalisable pour l’homme car elle suppose que tous soient raisonnables et qu’elle conduise à cette loi. Pour l’instant, les hommes en sont incapables car hétéronomes et ont besoin d’une loi extérieure qui les contraignent à ne pas toujours agir selon leur mobile sensible et égoïste. Le but est donc d’être autonome . Cette loi morale est un idéal vers lequel on doit tendre pour agir le plus moralement possible. TEXTE 1 : Rousseau pose ici le Pb de la reconnaissance et de la connaissance d’Autrui. L’idée principale est que la reconnaissance d’Autrui passe par la réflexion et donc par la comparaison parce que si je ne connais pas autrui je ne peux pas prendre Cs qu’il souffre parce que je n’en prend pas Cs. En fait, d’un homme qui n’a pas réfléchi, on ne peut pas dire qu’il soit moral ou immoral, on dit qu’il est amoral, i.e. il n’a pas de morale. Donc, si je ne réfléchis pas, et donc si je ne possède ni raison ni imagination, je ma retrouve alors « seul au milieu du genre humain « puisque sans réflexion, il ne peut y avoir ni connaissance ni reconnaissance de l’autre. La source de la réflexion est la comparaison : plus il y a d’idées, plus on les compare donc, plus on réfléchit. Si on voit toujours le même objet, il n’y a pas d’élément de comparaison et donc pas de comparaison. De la même manière, si on voit toujours le même nombre de choses, ou les mêmes personnes depuis notre enfance, on ne va pas chercher à les comparer, parce qu’avec l’habitude, on n’analyse pas. Mais, si un objet nouveau se présente, cela va nous étonner et du même coup, on va vouloir la connaître, se poser des questions et le comparer. Cela va donc décider le début de la réflexion : l’inconnu va être un moyen pour analyser et réfléchir sur le connu. On applique tout cela aux premiers hommes : les hommes primitifs étaient à nos yeux des barbares, mais ils n’avaient pas Cs d’être barbares parce qu’ils ne connaissaient pas ce qui était extérieur à aux, n’en avaient aucune Cs, et s’ils ne reconnaissaient pas les autres hommes, cela implique qu’ils ne se connaissaient pas eux-mêmes. Donc, si les hommes ne connaissaient que les liens du sang : ils ne connaissaient qu’eux-mêmes et leur famille proche ; le reste ne représentait rien à leurs yeux : ils étaient clos sur eux-mêmes et n’avaient aucun lien avec les autres. Cela vient du fait qu’ils ne savaient pas que les autres étaient leurs semblables. TEXTE 7 : On retrouve le Pb du respect mutuel qui, selon Kant ne s’accomplit complètement qu’avec l’Amitié. L’amitié sert en fait de balance, d’équilibre entre l’amour et le respect. Donc, respecter autrui, c’est poser une limite à mon égocentrisme. Mais, ce qu’il donne, c’est la définition d’une amitié pure et idéale. « Union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques «. En fait, on revient au Pb de la véritable amitié qui est de voir en l’autre une fin et non un moyen, ce qui implique que l’amitié est pure et désintéressée. Si dans cette amitié, il y a un réel désintéressement, on dit qu’elle est satisfaisante du point de vue moral parce que ce sentiment nous rend heureux et rend heureux les autres. Cette amitié est un enrichissement désintéressé parce que l’autre m’apporte ce que je n’ai pas et vice-versa, ce qui conduit à une vie et à une attitude plus morale. Et donc, de par ce que j’apporte à mon ami, je travaille à son Bonheur et lui au mien, c’est pourquoi l’amitié est un devoir morale chez Kant. Mais ces amitiés parfaites décrites par Kant restent un idéal vers lequel je dois tendre, idéal qui est moralement obligatoire : il est de l’ordre du devoir-être. Je dois sans cesse me perfectionner pour approcher le plus possible de cette amitié. Le Pb qui peut se poser alors , quant à cette union de deux personnes est que l’autre, qu’en sais-je ? Est-il réellement aussi désintéressé que moi ? C’est pourquoi l’amitié chez Kant est un sentiment pur, différent de l’amour parce que l’amour est de l’ordre des désirs et qu’il aboutit souvent à une détérioration du respect de l’autre car il est intéressé. En effet, l’amour c’est aimer, d’une part, mais d’autre part, c’est être aimé, ce qui est réconfortant. Mais l’amour n’est pas souvent un sentiment objectif : on peut aimer quelqu’un sans qu’il le mérite (ou l’inverse) et finalement, telle personne nous aime parce qu’elle ne peut aller contre le sentiment d’amour : c’est donc une histoire de pulsions : si on ne respecte pas l’autre en tant qu’être humain, il peut nous aimer quand même. Finalement, l’amitié est un amour modéré et réfléchi auquel s’ajoute une certaine dose de respect. On respecte l’autre pour ce qu’il est et donc, il y a un mécanisme qui fait que les sentiments se trouvent équilibrés : l’amour est une force d’attraction ; le respect est une force de répulsion parce qu’il y a mise à distance de l’autre. èL’amitié est une attraction envers son ami contrebalancé par le respect qu’on lui doit. TEXTE 10 : Ce texte dénonce de manière globale l’impersonnalité de la foule, d’abord parce que c’est l’indifférence totale de tous envers tous et l’indifférence par rapport à autrui, c’est la non-reconnaissance d’autrui et cette impersonnalité entraîne l’individualisme ; contrairement à ce qu’on pourrait croire, la foule est loin d’être solidaire. Autre chose, « la foule c’est le mensonge «parce que c’est l’hypocrisie : se noyer dans une foule revient à fuir ses responsabilités et donc être lâche. Même un soldat n’osa défier Caius Marcus , mais si quelques femmes avaient constitué une petite foule, elles l’auraient frappé parce qu’elles en auraient eu la possibilité : la foule est un moyen de paraître brave sans l’être. Le véritable courage n’est pas de se fondre dans la foule pour faire telle ou telle chose, c’est de commettre un acte seul et d’en avoir l’entière responsabilité. Le mensonge consiste à dire que ce que fait la personne avec la foule, elle le ferait même en étant seule. La foule étant impersonnelle, elle est donc abstraite : « la foule est une abstraction et n’a pas de mains «, sa lâcheté est plus importante et plus dangereuse que la lâcheté individuelle parce que dans le cas de la lâcheté individuelle, on sait qui est lâche, ce qui diffère de la foule parce qu’on ne sait pas qui est lâche. La foule méprise l’individualité parce que le meneur est totalement indifférent aux individus. La vérité est le respect de l’homme, lié à un devoir morale ; contrairement à l’esprit de la foule, on doit prêter attention même à un individu isolé : la vérité réside dans une conduite morale et charitable qui n’a rien à voir avec la quantité de personnes. TEXTE 13 P.77 : Lévi Strauss pose le problème de la relation à autrui au sens de la relation interculturelle. La thèse qui est mise en avant par les sociologues est que tout homme est déterminé par la culture, religion, etc. de son pays, qu’on lui a inculqué dès son enfance et a eut pour conséquence de l’intolérance et un sentiment de supériorité et finalement, sans essayer de comprendre les cultures d’un pays éloigné, on les répudie au nom d’une supériorité culturelle. Cette attitude est dangereuse puisqu’elle entraîne de l’intolérance et surtout la croyance qu’une telle culture est supérieure à une autre, la conséquence étant guerres, colonialisme… Mais cette attitude n’est pas nouvelle puisqu’elle date de l’antiquité et qu’elle est réciproque car peur de l’étranger, et donc, on ne reconnaît pas cet étranger en tant que Cs libre et finalement, l’intolérance est souvent la méconnaissance de l’autre. PHILOSOPHIE VI LE TEMPS : INTRODUCTION : Il est très difficile, à travers les diverses expressions, de définir ce concept. Il est appréhendé soit comme une période qui s’écoule, soi comme un changement continuel et irréversible selon une dimension linéaire en vertu de laquelle le présent devient le passé et l’avenir le présent. Mais on peut malgré tout remarquer le caractère insaisissable du temps, à savoir que nous y sommes plongés sans jamais pouvoir nous en abstraire. Nous n’en avons d’ailleurs qu’une intuition immédiate et continue qu’il est difficile de concevoir et de penser. Intuition (intuese = voir), c’est un mode de connaissance immédiat et direct qui place d’emblée l’esprit en présence de son objet. Nous avons du mal à le penser tout simplement parce que nous sommes des êtres dans le temps et on ne peut penser ni connaître en dehors du temps. Il nous apparaît d’abord comme une contrainte, un obstacle que rencontre un être vivant dans son action : le temps s’écoule, nous fait vieillir et en dernière instance nous donne la mort. Une des contraintes du temps est son irréversibilité : on ne peut revenir en arrière et on va voir quels problèmes cela nous pose. Quel est alors le statut du présent, du passé et du futur ? D’autre part, le temps se trouve-t-il dans les choses mêmes ou dans la Cs des choses ? I- Caractéristique principale du temps : son irréversibilité : Le temps est difficile à définir, mais on peut déjà en énoncer la propriété principale qui est l’irréversibilité de son ordre : il y a en effet un ordre et cet ordre est lui-même irréversible. En effet, la Physique moderne avait remis en cause cette irréversibilité par le biais de deux théories : ¨ La théorie de l’irréversible selon laquelle il n’existe pas de système fixe relativement auquel on pourrait mesurer un mouvement car ce dernier est toujours relatif par rapport à un point de référence. ¨ La théorie des Quanta de M. Planck en 1905. Mais « la totalité des phénomènes physiques est d’un caractère tel qu’elle ne fournit pas de base pour introduire le concept du mouvement absolu «. La conséquence de ces deux théories est que le temps n’est pas irréversible et retrouve une légitimité dans les théories physiques contemporaines, notamment avec S. Hauking qui écrit en 1988 une Brève histoire du temps qui prend appui sur des théories elles-mêmes contemporaines : il y a trois raisons pour lesquelles on peut soutenir le caractère irréversible du temps : ¨ Une raison psychologique : on ne se souvient que du passé, jamais de l’avenir, donc cela prouve l’existence d’un certain ordre dans le temps. ¨ Une raison thermodynamique, principe appelé entropie qui est la tendance à l’accroissement du désordre. Le Temps conduit toujours à un système clos à évoluer de l’ordre vers le désordre mais jamais l’inverse. ¨ Une raison cosmologique selon laquelle l’univers est en expansion, jamais en contraction. Quand le Temps ou l’aspect temporel d’une chose n’est pas en jeu, tout ce qui a un sens peut être renversé. Quand j’observe une maison, je peux commencer indifféremment par le toit, la porte ou une fenêtre ; elle a , malgré tout dans son ensemble une cohérence, un sens. Parce qu’elle est déjà inscrite dans le temps, je ne peux donc pas l’effacer. Donc, en ce qui concerne l’homme, cette irréversibilité a des conséquences éthiques ou morales. Pourquoi, Admettant que je veux faire une chose quelconque dans un proche avenir : je la fais et aussitôt après, elle appartient au passé et ne peut plus être corrigé : il n’existe alors que par le souvenir. Et donc, je peux éprouver des remords ou des regrets quant à ces choses du passé puisque je ne peux y revenir et corriger mes erreurs, d’où le fantasme d’une machine, d’un moyen pur revenir dans le temps parce que de cette façon, je ne ferai plus d’erreurs. Le problème est que nous ne pouvons pas effacer les erreurs du passé : donc, il faut s’y faire, mais surtout ne pas rester dans le passé en culpabilisant car ce serait une impasse morale. Que faire ? Il faut faire autre chose qui combinera mes erreurs passées en agissant en fonction de ce passé, mais en se tournant vers le futur. D’un point de vue moral, je peux transformer le remords en repentir, sentiment de culpabilité ouvert au désir d’expiation et de perfectionnement. Cela offre une solution morale positive. L’ordre irréversible du temps est ensuite ressenti selon trois modalités que sont le passé, le présent et l’avenir. Mais, n’est-ce pas à l’intérieur du présent que se trouvent ces trois mouvements de Cs : le présent serait l’attention à l’existence actuelle, le passé serait le retour vers ce qui a été et qui n’est plus et l’avenir serait une projection vers ce qui va se produire. C’est pourquoi, chez St Augustin, seul le présent existe , et existe sous trois formes : le passé n’est plus et l’avenir n’existe pas encore. « Il y a, en effet, dans l’âme ces trois instances et je ne les vois pas ailleurs : un présent relatif au passé, la mémoire ;un présent relatif au présent, la perception ;un présent relatif à l’avenir, l’attente. « dira saint Augustin. Le problème est que ce présent peut être vécu et interprété de plusieurs façons : toute fraction de devenir que l’on considère comprend un commencement déjà passé et une fin qui n’est pas encore là. Dans cette optique, le présent apparaît comme le passage du « n’être déjà plus « au « n’être pas encore « ; Le présent dont on pourrait croire qu’il est seul réel serait en fait le passage d’un non-être à l’autre : le passé et le futur, passage qui est lui-même fuyant. Dans ce cas, le temps ne serait-il qu’une succession d’instants ? L’instant est au temps ce que le point est à l’espace . Mais sur le plan du vécu, l’instant ne se réduit pas à une coupure idéale entre le passé et le futur : si le temps n’était constitué que d’une succession d’instants, cela impliquerait la discontinuité essentielle du temps. Le problème est que si tel était le cas, le présent ne serait que rupture perpétuelle. La conséquence est tout changerait sans cesse sans qu’il ne reste rien. Or, on a déjà vu que derrière le changement subsistait quelque chose. Il faut donc supposer l’idée d’une continuité dans le déroulement d’un événement ou la persistance d’un phénomène. Par exemple, il pleut pendant une heure, je ne peux pas rationnellement séparer la pluie en autant de gouttes d’eau. cette idée que l’on retrouve dans le concept de durée tel que l’a défini Bergson. Ce concept de durée suppose une continuité dans les actes et dans les faits et ne fait pas du temps une succession d’instants morcelés et isolés. Par exemple, quand je fais de la cuisine, un plat relativement précis, il n’y a pas de saut, de rupture entre ce que je viens de faire et ce que je vais faire, sinon tout cela ne s’ordonnerait pas dans un ensemble. Il faut aussi distinguerséparer la pluie en autant de gouttes d’eau. cette idée que l’on retrouve dans le concept de durée tel que l’a défini Bergson. Ce concept de durée suppose une continuité dans les actes et dans les faits et ne fait pas du temps une succession d’instants morcelés et isolés. Par exemple, quand je fais de la cuisine, un plat relativement précis, il n’y a pas de saut, de rupture entre ce que je viens de faire et ce que je vais faire, sinon tout cela ne s’ordonnerait pas dans un ensemble. Il faut aussi distinguerséparSi je veux me préparer un verre d’eau sucré, je dois attendre que le sucre fonde « dira Bergson. En ce qui concerne la durée, nous en éprouvons l’écoulement, c’est à dire que nous la vivons quotidiennement et ce, concrètement. Certes, il y a un temps artificiel, le temps auquel nous sommes astreints dans notre vie sociale, celui qui nous sert à découper nos journées en segments égaux. Mais à côté de ce temps, homogène fait de minutes, d’heures, etc., il y a un temps vrai qui n’est autre que la vie même de notre Cs telle que nous la découvrons et prenant à chaque minute des directions nouvelles. Peut-on cependant confondre le temps et la perception que j’en ai ? Autrement dit, le temps est-il dans les choses mêmes ? Existe-t-il un temps séparé des choses, un temps absolu, ou appartient-il en propre à notre Cs ? II- Le temps comme forme a priori de la sensibilité : La notion de temps absolu a-t-elle un sens ? Elle impliquerait qu’il existe un temps avant le temps, ce qui est un non-sens. Donc, c’est ce que montre Leibniz en réponse au philosophe Clarke qui affirmait que Dieu aurait pu créer les choses à un autre moment. Pour Leibniz, cette affirmation n’a aucun sens car le temps ne peut ni être perçu ni conçu en dehors d’un rapport avec les choses créées et le rapport entre les choses et le temps n’est que possible. Pour qu’il ait une réalité, il faut qu’il y ait un rapport entre les choses et les objets. « Supposer que Dieu ait créé le même monde plus tôt est supposer quelque chose de chimérique. C’est faire… et la quantité de leurs changements. « écrira Leibniz dans le texte 5 du livre page 90. Car, en fait, signifier que le temps n’est pas une substance , une entité mais un ordre, i.e. un système de relations donc une forme. Chez Kant, le temps est une forme a priori de la sensibilité. Cette forme s’impose à toute expérience quelque soit son contenu : deux événements distincts sont soi simultanés soi successifs, et s’ils sont successifs, leur ordre ne peut en aucun cas être changé. C’est donc une nécessité qui est en même temps la marque de l’a priori. L’a priori qualifie les éléments de connaissance indépendants de toute expérience. Le temps ainsi conçu est la forme de toute expérience, même intérieure ou imaginaire. C’est aussi la forme des phénomènes extérieurs autant qu’ils doivent prendre place dans notre expérience. Un tel ordre est connu de nous par intuition immédiate, qu’on appelle sensibilité. Chez Kant, les objets nous sont donnés par la sensibilité (qui est donc la faculté de pouvoir recevoir des objets) grâce , entre autres, aux intuitions pures, i.e. aux formes a priori de la sensibilité : à savoir le temps et l’espace. Donc, pour qu’un objet puisse être donné, il faut qu’il se produise en un instant déterminé du temps, i.e. avant, pendant ou après ; tout cela, pourtant ne concerne que notre expérience, c’est à dire les phénomènes : la façon dont les choses se manifestent à nous, la façon dont nous les appréhendons et ne concernent pas les noumènes. Il ne faut pourtant pas en déduire que le temps est une apparence, que le temps est illusoire. Le monde des phénomènes est réel, il est en fait la forme nécessaire selon laquelle le réel nous apparaît : je ne peux pas connaître le réel en dehors des phénomènes, les choses qui sont insérés dans l’espace et dans le temps. Le temps est alors la condition de la possibilité de notre expérience : c’est ce qui rend possible notre connaissance. Conclusion : Quelle que soit la manière dont on le conçoit, le temps reste pour nous une contrainte en ce qu’on ne peut y échapper et qu’on ne peut le remonter, et là encore, on s’aperçoit qu’il est la marque de notre finitude. C’est aussi le cas chez Kant car il ne nie pas la finitude de l’homme puisqu’on ne peut connaître un objet hors du temps et de l’espace, mais aussi, on ne peut pas connaître sans la possibilité de l’expérience. On ne pourra jamais atteindre les choses en soi, que Kant nomme Noumènes. Philosophie VII : L’HISTOIRE. Introduction : En français, le mot « histoire « exprime deux choses : il indique en premier lieu le récit des événements passés et constitue une Histoire en tant que discours voire en tant que science, et en second lieu que l’histoire est l’ensemble de ces événements au moment où ils se produisent, on parle alors de cours de l’histoire. Deux problèmes qui paraissent différents se posent alors à propos de ce concept : d’une part, comment écrire l’histoire, autrement dit, à quelles conditions peut-elle être une science du passé ? C’est donc un problème épistémologique (véritable réflexion sur le savoir, l’épistémologie étudie de façon critique les principes, les hypothèses générales et les conclusions des différentes sciences afin d’en apprécier la valeur et la portée objective, contrairement aux scientifiques qui cherchent sans s’occuper de morale). D’un autre côté, si l’on parle d’un cours de l’histoire, quel est-il réellement, autrement dit, l’histoire de l’humanité a-t-elle un sens, une orientation globale vers un but précis ? Ce problème est un problème philosophique parce qu’il concerne le statut du passé : on sait que le passé a un rôle dans les événements présents, la question est alors de savoir lequel et comment, voire même pourquoi, mais aussi parce qu’il engage la question de l’humanité, à savoir que ce que je fais, en ce moment a des sources dans le passé , mais aussi des répercutions sur le futur. Ces deux problèmes paraissant différents, mais ils sont en fait liés, donc il y a un lien entre les deux sens du mot « Histoire «, parce que finalement, le passé humain n’a d’existence et de réalité pour nous que dans et par l’Histoire écrite par les historiens. En fait, si on n’avait pas écrit l’histoire des événements, qu’en resterait-il dans notre mémoire, et donc, dans ce cas, on ne pourrait pas lier les événements entre eux et affirmer qu’ils concourent à une même fin. D’où est venue cette idée d’écrire et de décrire les événements d’une civilisation, en d’autres termes, l’histoire a elle-même une propre histoire, c’est à dire une origine avec des auteurs dont l’existence est incontestable et avec une évolution des méthodes utilisées. Le premier historien est Hérodote (-485 ;-420), et était grec. Chez lui, l’Histoire est uniquement synonyme d’informations et d’enquêtes, ce qu’il montre parfaitement en écrivant ses Guerres Médiques, c’est à dire les guerres des Grecs contre les Perses. Malheureusement, dans ce qu’a écrit Hérodote, il n’y a pas de sélection d’informations, mélangeant ce qui est essentiel avec ce qui est évitable (comme le menu des Grecs en tant de guerre…), mais ce livre contient malgré tout des informations très précieuses sur les mœurs , la vie quotidienne et les institutions de l’époque. Ensuite vient Thucydide qui est contemporain du premier, qui transforme ce simple récit en un véritable modèle de récit historique en écrivant la Guerre du Péloponnèse. La différence d’avec Hérodote est que Thucydide a voulu dégager un principe d’intelligibilité, i.e. qu’il ne se contente pas de décrire , mais il cherche les causes et dépasse Hérodote en ce que sa méthode se veut être plus exacte et plus rigoureuse. Donc, l’approche n’est plus seulement narrative, mais elle se veut aussi être critique. En bref, Thucydide a introduit en Histoire le souci d’objectivité. Ainsi, on est passé d’une discipline littéraire à une discipline scientifique qui s’appuie sur des document analysés rigoureusement ; on utilise encore la méthode scientifique en Histoire pour dater, certains documents, les identifier et les authentifier. Il faut distinguer deux principes rigoureusement différents que sont la Chronique et l’Histoire. Pour ce qui est de la chronique, les événements sont simplement relatés dans l’ordre de leur apparition sans en donner aucunement de causalité, ce qui diffère dans son essence même de l’histoire. Cette exigence de rigueur scientifique fait-elle pourtant de l’histoire une science à part entière, à savoir une discipline dont le principal caractère est l’objectivité ? I- L’Histoire est-elle une discipline scientifique ? Le caractère principale d’une science exacte est l’objectivité. Or, à la base, est objectif ce qui appartient en propre à un objet : c’est une qualité de l’objet. L’objet est placé devant celui qui le regarde : le sujet. Ensuite, il y a eu un déplacement de signification avec Kant et ce qui est objectif est devenu ce qui existe indépendamment du sujet et de la connaissance que celui-ci peut en avoir. Ainsi, l’objectivité de la connaissance est réalisé quand l’esprit constitue un objet de pensée pouvant faire en droit l’accord des esprits, ce qu’on appelle l’universalité ; en ce sens, l’universalité est synonyme de rationalité. Et, dernière caractéristique, l’objectivité requiert l’impartialité du sujet donc pas de prise de position : c’est donc la neutralité et la conformité du récit aux événements eux-mêmes. Le problème est que l’Histoire doit comprendre une réalité humaine et aussi les comportements porteurs de sens et d’intentions plus ou moins claires qu’il faut déchiffrer. En d’autres termes, l’homme est doué de liberté : comment alors rationaliser des faits d’hommes libres qui agissent à leur guise ? Ce souci d’objectivité a été très importante au XIX° siècle, avec l’école de pensée créée par Auguste Comte : le positivisme. Chez les positivistes, seules les sciences sont capables de donner des réponses valables, c’est à dire que seules les sciences sont capables de nous mener vers la vérité : si on veut faire de l’histoire une science, il lui faut appliquer des méthodes identiques aux méthodes scientifiques. Le problème est que les scientifiques s’appuient sur l’observation, sur la théorie, sur l’expérimentation, alors que l’histoire se base sur des faits uniques. Mais dans l’optique des positivistes voulant faire de l’histoire une science, on traite les actions humaines comme des faits abstraits, mécaniques, déterminés, c’est à dire différents de libre. Or, l’homme est libre donc les événements passés sont le fait d’êtres libres et le récit historique est lui-même construit par un homme qui n’est pas une machine. Par conséquent, cette objectivité ne doit-elle pas inclure la subjectivité de l’historien dans la méthode d’approche de son objet, mais la subjectivité est tout ce qui est intérieur, individuel, bref tout ce qui est propre à un être particulier et en ce sens, la subjectivité de l’historien ne s’oppose pas forcément à une attitude objectivante, i.e. une attitude ayant le souci d’objectivité. L’historien sait que ce qu’il raconte est fait par des hommes libres, ce qui est objectif, mais ce qui ne l’empêche pas de vouloir avoir une attitude objectivante et dans ce cas, il ne s’agit pas de n’importe quelle subjectivité, mais plutôt de celle qui est oubli volontaire de soi et ouverture à l’autre. si l’on veut comprendre en tant qu’historien les actes humains, il faut prendre en compte l’aspect psychologique, social ou économique d’une époque, ou pour le plan psychologique en tout cas, d’un acteur de l’Histoire. Prenons l’exemple d’Hitler chez qui l’on peut expliquer sa xénophobie et son ambition décorante en cherchant dans sa vie et en particulier dans son enfance. Par rapport à la causalité, il y a un autre gros problème : si l’on affirme la forme déterminante de grands ensembles historiques régis par des lois rigoureuses, cela implique que l’on restreint l’invention et la liberté des individus et des peuples. Ce problème implique de se poser une question essentielle en philosophie depuis le XIX° siècle : qui fait l’Histoire, et par extension, l’Histoire a-t-elle une orientation globale et une signification, autrement dit une sens ? Effectivement, on part d’un paradoxe : il existe un désordre apparent des événements, désordre qui répond à une multiplicité d’intentions individuelles, mais, d’un autre côté, on peut observer un certain ordre qui semble se dégager de l’ensemble. II- L’Histoire a-t-elle un sens ? Si l’Histoire a un sens, cela implique que les individus la construisent de manière consciente, avec des intentions et des buts précis. Or, de prime abord, il est rare que les individus se sentent auteurs de leur histoire. Ils se perçoivent en fait plutôt comme des victimes, ce qui est une des sources d’une croyance en un destin ou une providence divine. Le destin est une force impersonnelle qui a déterminé à l’avance le cours général des événements et contre laquelle toute intervention personnelle reste impuissante. Par exemple, chez les Grecs, l’Histoire est vue comme une sorte de grand théâtre où les hommes, tels des pantins, se livrent à des combats dont la signification réelle leur échappe. La providence, contrairement à l’idée de destin, que l’on trouve à partir du Stoïcisme (-100 ;+100) est une puissance impersonnelle puisqu’elle émane de Dieu, bienveillante, et qui oriente l’histoire humaine de façon ascendante, donc, il y a une certaine idée de progrès et lui donne une signification réconfortante : celle du Salut. Le problème, c’est que cette idée de Providence grandit démesurément l’homme et l’idéalise et aplanit tous les obstacles. Or, on constate que le progrès est lent et pénible. En fait, le spectacle de l’Histoire superficielle est désolant : c’est celui de la folie des hommes poursuivant leurs intérêts qui leur sont propres et leurs passions . Donc, d’un point de vue moral, on peut être pessimiste, et si on écarte ce point de vue, on peut alors affirmer, de même que Hegel que tant de sacrifices et de déchirements sanglants ne sont pas vains puisqu’ils concourent aux progrès de la raison dans l’histoire de l’humanité. (Cf. chapitre sur les Passions : idée de ruse de la raison). Cette idée de progrès, malgré des apparences contraires , vient de Leibniz (XVII° siècle) qui a écrit des Essais de Théodicée dans lequel il tente de solutionner le problème de l’existence du Mal et de concilier en fait cette existence avec celle de Dieu. Comment, de fait, se fait-il qu’il y ait tant de manifestations du Mal alors que Dieu, s’il existe est son « ennemi « ? Pour Leibniz, Dieu a choisi le meilleur des mondes possibles et si le mal existe, c’est toujours pour un plus grand bien. « L’histoire universelle est le progrès dans la Cs de la liberté. « écrira Hegel dans ses Leçons sur la philosophie de l’Histoire. Pour cela, il suffit des constater et de repérer les différentes étapes du processus de reconnaissance de la liberté : Antiquité avec la Démocratie imparfaite des Grecs, la Réforme en France et en Europe et la Révolution française dans cette optique, la philosophie n’est pas une activité de réflexion autonome puisqu’elle suppose la connaissance de tout le passé historique. L’Histoire est à la fois pour la Philosophie son objet et sa condition objective, en d’autres termes, une philosophie ne peut exister indépendamment de l’époque historique durant laquelle elle se situe. Á partir de Hegel, on s’est mis à considérer que tout ce qui est humain est historique car temporel, et par conséquent, il est possible de donner une définition de la philosophie : prise de Cs dans la pensée d’une raison qui s’exprime dans l’Histoire. en fait, la rationalité n’est ni un idéal qui s’oppose au réel, ni un modèle que l’on s’efforcerait de réaliser : il faut reconnaître que la réalité historique est profondément rationnelle. « Tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel «. Cette rationalité, par contre, ne se fait que par l’effort des hommes au hasard des conditions matérielles plus ou moins favorables . S’il y a une nécessité historique du développement de la liberté, ce progrès n’est pas une évolution naturelle, certaine, homogène. Cette évolution peut parfois stagner voire régresser selon le degré de Cs que les hommes acquièrent et conservent de leur liberté et de leur solidarité et, selon leur discernement (= capacité de distinguer le vrai du faux) et leur volonté d’agir. Donc, la philosophie selon Hegel, que l’on appelle (par coïncidence plus que par raisonnement) philosophie de l’histoire, considère le cours des événements comme un ensemble de faits accomplis ou en voie de l’être. Dans ce cadre, l’histoire est interprétée, mais le domaine des actions historiques est séparé du moment réflexif que constitue la philosophie de l’histoire : il y a toujours un décalage entre les actions et leurs explications, ce que Marx critiquera beaucoup en disant dans son Manifeste du parti communiste que « les philosophes ont interprété le monde ; maintenant, il s’agit de le transformer «, ce qui marque son départ de la philosophie en insistant sur la possibilité pour les hommes de faire leur histoire, et donc de transformer le monde. Dans La Sainte Famille, il écrit aussi que « l’Histoire ne se sert pas de l’homme comme d’un moyen pour réaliser (comme si elle était un personnage particulier) ses propres buts, elle n’est que l’activité de l’homme qui poursuit ses objectifs. « Le problème est que Marx a essayé de faire une science de l’histoire. Sa doctrine s’appelle matérialisme historique parce qu’elle explique l’histoire par les conditions économiques ; l’organisation sociale étant déterminée par le mode de production. « L’Histoire de la société est l’Histoire de la lutte des classes «. ainsi, chez Marx, dans toute société et à toute époque, il existe des classes antagonistes. Par exemple, au XIX° siècle, il y avait deux classes principales, à savoir les capitalistes, c’est à dire ceux qui possédaient les moyens de production et le prolétariat qui ne possède rien et est obligé de vendre sa force de travail aux capitalistes pour pouvoir survivre. Ce qu’il faut savoir, c’est que l’Histoire, chez Marx comme chez Hegel suit un mouvement dialectique : on passe d’un mouvement de production à un autre parce que les classes antagonistes entrent en lutte puisque leøöÑöòöÑöÙöòöÑöòöÑöòöÝö. Par exemple, au XIX° siècle, il y avait deux classes principales, à savoir les capitalistes, c’est à dire ceux qui possédaient les moyens de production et le prolétariat qui ne possède rien et est obligé de vendre sa force de travail aux capitalistes pour pouvoir survivre. Ce qu’il faut savoir, c’est que l’Histoire, chez Marx comme chez Hegel suit un mouvement dialectique : on passe d’un mouvement de production à un autre parce que les classes antagonistes entrent en lutte puisque les différents pays se sont arrêtés à cette étape intermédiaire. Mais, au-delà de cela, la théorie marxiste est problématique puisque concilier une théorie scientifique selon laquelle l’Histoire est un processus déterminé avec une doctrine politique selon laquelle l’action des hommes est nécessaire pour transformer les choses est, d’un point de vue philosophique, contradictoire voire impossible. Conclusion : Les philosophies sur l’Histoire de Hegel et de Marx qui prétendent tous deux qu’elle a un sens et une fin posent problème et danger d’un point de vue politique : le problème du totalitarisme parce que ces doctrines prétendent totaliser le passé, le présent et l’avenir en leur donnant un sens. Or, ceci est une chose impossible puisque ces philosophes eux-mêmes sont pris dans l’Histoire, en d’autres termes, ils ne sont pas hors du processus historique et pour pouvoir totaliser l’histoire, il faudrait être extérieur à elle. Comment alors affirmer la structure de l’avenir ? Concrètement, le danger vient de la vision totalitaire du monde telle qu’on a pu la voir et la subir dans le Nazisme et les dictatures en règle général parce qu’à chaque fois, le dictateur prétend connaître le sens de l’histoire et justifie en ce nom les pires atrocités comme a pu le faire Hitler avec sa théorie sur la Race arienne. Ces théories totalisantes sont aujourd’hui contestées par les historiens parce qu’elles ont trop souvent été employées à des fins personnelles et qu’elles ont utilisé des moyens de répressions atroces. Il faut quand même reconnaître que les idées de Marx, Hegel et de Kant fournissent des principes d’intelligibilité. ces tentatives de rationalisation historique sont encore dignes d’attention parce qu’elles relèvent finalement d’un besoin intellectuel humain qui consiste à dégager du sens donc des liens de cause à effet et ce, dans de nombreux domaines ; Il faut néanmoins être prudent et méfiant à l’égard de ceux qui prétendent détenir par avance le sens ultime du devenir. Les gourous de diverses sectes prétendent détenir le sens de la destinée humaine, et justifient de cette manière leurs pratiques plus que douteuses. Philosophie VIII LE LANGAGE : Introduction : Quel élément de notre culture distingue l’homme de l’animal ? Quel élément nous a fait sortir de l’animalité pour nous diriger vers l’humanité ? Pour Bergson, l’homme est essentiellement un « homofaber «, i.e. homme qui fabrique des outils et invente des techniques ; mais pour un linguiste tel que Claude Hagège, l’homme est plus fondamentalement encore un « homoloquens « i.e. un homme qui parle. La parole est-elle uniquement un privilège réservé à l’humanité ? Au premier abord, non évidemment : en effet, les animaux peuvent émettre des signaux par lesquels ils échangent des informations tout comme les êtres humains. Par exemple, Karl Von Frisch dans son étude de 1965 Vie et mœurs des abeilles a montré qu’une abeille peut signaler à ses congénères la direction et la distance d’une source de nourriture par un certain type de danse dont la direction et la vitesse varient en fonction de ces paramètres. La question est de savoir si c’est réellement un langage ? Effectivement non, pour diverses raisons. En premier lieu les messages sont tous de type biologiquement déterminé (donc inné) et les informations transmises sont limitées à l’expression de quelques situations déterminées. De plus, il n’y a pas de dialogue chez les abeilles parce qu’à un message, les abeilles répondent par une conduite et non par un autre message comme le font les êtres humains ; enfin, le message des animaux ne se laisse pas analyser tandis que les énoncés du langage humain se laissent décomposer en éléments qui sont des unités grammaticales et sonores qui peuvent se combiner en une infinité de manières. Seul l’homme peut à tout moment composer de nouvelles phrases et comprendre des discours qu’il n’a jamais entendu. Á ce propos, Rousseau affirmait dans son Discours sur l’origine des langues que « l’invention de l’art de communiquer nos idées dépend moins des organes qui nous servent à cette communication que d’une faculté propre à l’homme qui lui fait employer ces organes à cet usage « : le langage articulé est une fonction d’expression et de communication qui est lié à la pensée. La possibilité de parler ne se réduit pas à des dispositifs neurobiologiques et organiques qui en sont tout de même une condition manifeste, mais se prolonge par des aptitudes à tirer parti de ces dispositifs qui sont justement ce qui fait du langage l’objet de multiples questions. S’il y a un lien entre la pensée et le langage, lequel précède l’autre ? La question vaut pour quelqu’un qui sait parler tout autant que pour quelqu’un à l’origine. Une autre source de question vient aussi : devant la multiplicité culturelle du langage, on peut se demander en quoi consistent et comment fonctionnent ces différentes langues ? I- La pensée précède-t-elle le langage ? ou les fonctions du langage : Les différentes interrogations à propos du langage se sont d’abord ancrées dans la certitude que le langage était essentiellement un véhicule de la pensée et cette parenté entre la raison et le discours est frappante dans la langue grecque qui les désigne tous deux par le même mot, à savoir « logos « : l’homme qui est un animal rationnel est du coup un animal parlant, et de ce fait, la question de l’origine des langues va soulever des difficultés : comment ont-elles été constituées ? Ainsi, par exemple, Rousseau suppose un état de nature, état dans lequel se situe l’homme avant toute constitution civile ou sociale et avant toute vie en communauté, état dans lequel les hommes n’auraient pas eu besoin de communiquer ; mais il se heurte à de grosses difficultés lorsqu’il cherche à fonder l’invention des langues sur le progrès de la pensée. En fait, il y a plusieurs problèmes : si le langage est un médiateur de la pensée, pourquoi celle-ci a-t-elle besoin d’un intermédiaire : elle pourrait se suffire à elle-même. L’autre problème est de savoir quels liens unissent ces deux facultés qui témoignent de l’intelligence humaine et dont l’une est perçue comme subordonnée à l’autre : le langage subordonné à la pensée ? On a aussi cherché à comprendre comment étaient nées les premières langues qui ont disparues. Le problème est insoluble parce qu’on ne peut espérer en retrouver des traces parce qu’elles étaient orales et non écrites ni même la trace des conditions de leur apparition, mais même si le problème est insoluble, cette question est intéressante puisqu’elle permet de réfléchir sur la ou les fonctions du langage, et en fait, une des plus plausibles hypothèses retenues à ce jour est que le langage aurait été une nécessité puisque les premières manifestations du langage articulé ont permis de satisfaire un certain nombre de besoins. Les travaux des anthropologues et des biologistes sur le langage permettent d’affirmer qu’il a pour fonction originaire de rendre possible la communication indispensable à la survie ; Il apparaît alors comme un instrument commode pour rendre ses demandes accessibles à autrui et être informé des siennes. Mais il est plus qu’un instrument de communication, il est la texture même de notre monde dans la mesure où celui-ci est un monde déjà investi par le langage, autrement dit un mode parlé et un monde parlant. Le langage appartient à la culture, c’est à dire à ce que l’homme ajoute à la nature, ce qu’il ne reçoit pas par hérédité biologique, mais à quoi chaque génération doit s’initier par apprentissage. La culture : tout homme a une culture et finalement, il n’y a d’être humain que par la culture. La nature peut être comparée à tout ce qui est inné, de l’ordre de l’instinct alors que la culture, elle s’effectue par apprentissage. L’homme devient humain par le biais de la culture, de l’éducation… Le langage n’est pas seulement un élément de la culture parmi d’autres puisque les valeurs et les savoirs acquis par l’enfant sont d’abord des paroles qu’il entend. En fait, en même temps que sa langue maternelle, l’enfant apprend les symboles qui structurent sa vision du monde propre à la culture du groupe auquel il appartient. Chaque langue correspond à une certaine façon de s’approprier le réel et de l’organiser. Á ce propos, E.Benvériste dira : « Nous pensons un univers que notre langage a d’abord modelé «. Cela explique que d’une langue à une autre, certaines expressions soient difficiles à traduire. Le langage a une fonction expressive ; en effet, il me permet, même en l’absence d’un interlocuteur, de donner corps à nos propres pensées et, déjà à l’époque, Platon définissait la pensée comme étant « un discours que l’âme se tient à elle-même «. Mais, pense-t-on réellement avec les mots, que ceux-ci soient ou non proférés ? J’ai parfois l’impression que la pensée précède le langage, notamment lorsqu’on n’arrive pas à dire ce que l’on pense. En ce sens, la pensée ne peut pas se passer du langage, mais sans lui, elle n’aurait aucun mode d’existence structurée. L’organisation des mots et celle des idées sont intimement liées et dans cette optique, l’ineffable n’est peut-être rien d’autre que le non-pensable. Ainsi, pour Hegel, c’est dans les mots que nous pensons, et en fait il n’y a pas de pensée véritable en dehors du langage parce que, par les mots, le sujet pensant donne une forme objective à ses pensées et les rend accessible à sa Cs. Il veut en fait expliquer et démystifier l’ineffable, ce quelque chose de si nuancé, de si subtil qu’aucune parole ne saurait exprimer. L’ineffable, « c’est la pensée obscure, la pensée à l’état de fermentation et qui ne devient claire que lorsqu’il trouve le mot «. On constate finalement que la réflexion sur le langage a commencé par porter sur ce moyen particulier que les hommes disposent pour manifester leur pensée et communiquer entre eux et, jusqu’au début du XVIII° siècle, on n’a jamais fait du langage un objet d’études autonomes. En fait, c’est en étudiant pourquoi et comment s’exerce la pensée que l’on pourrait être amené à étudier le langage vu comme un moyen mis au service d’une faculté supérieure. Le problème est qu’il existe une multitude de langues différentes. Ce qui importait alors n’était pas cette diversité mais l’unicité, l’universalité de la faculté qui la sous-tend. Cette diversité est même gênante parce que si la raison humaine est universelle, valable pour tous, comment expliquer la diversité de ces manifestations? II- Langue et langage : Le seul fait universel est que l’on parle, mais le fait que l’on parle des langues différentes a longtemps été perçu comme un accident de l’histoire et de la géographie et non comme un fait majeur de la philosophie. De fait, lorsque les philosophes s’intéressent aux langues et plus seulement au langage, c’est soit pour en chercher l’origine, soit pour essayer de penser une langue universelle parfaite puisqu’elle serait totalement artificielle et commune à tous puisqu’elle serait le langage de la raison. Mais au début du XIX° siècle, à l’occasion de la découverte d’une langue morte, le sanskrit, indienne, et avec l’intérêt grandissant pour l’histoire, on en vint à réfléchir sur l’histoire des langues et notamment sur l’existence ou non d’un lien de parenté entre des langues très différentes et très éloignées. Par exemple, nos langues européennes et le sanskrit sont à mettre en rapport. Le deuxième grand type de problème soulevé par le langage se résume en une question, à savoir en quoi consistent les langues et comment fonctionnent-elles ? Question qui est à une science nouvelle, la linguistique, de tenter de répondre. Ferdinand de Saussure, dans son Cours de linguistique général définit le langage comme : « un système de signes exprimant des idées «. en fait, la linguistique appartient à une discipline beaucoup plus vaste qui est la science des systèmes de signes en général : la sémiologie, qui comprend également l’étude des images, des modes vestimentaires et des mythes. Qu’en est-il du signe linguistique ? Il est une entité double qui unit non pas une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique, autrement dit un signifié (=le concept) et un signifiant (=support du signifié, manifestation sonore ou graphique du mot). Le lien unissant le signifiant au signifié à l’intérieur d’un signe est arbitraire : cela ne veut pas dire que pour un signifié donné, chacun a le droit d’employer le signifiant de son choix ; le caractère arbitraire du signe indique simplement qu’il n’existe aucun rapport de motivation, aucune ressemblance entre le signifiant et le signifié : « L’idée de sœur n’est liée par aucun rapport interne avec la suite de sons [s-œ-r] qui lui sert de signifiant. « (F. de Saussure). Un signe linguistique unit des sons et du sens et il suffit d’articuler chacune des combinaisons possibles d’une langue donnée pour évoquer la part de réalité dont elle tient lieu. En fait, pour les linguistes, la langue ne se confond pas avec le langage. Saussure la définit comme « un produit social de la faculté du langage et une ensemble de conventions nécessaires adopté par le corps social pour permettre l’exercice de ces facultés chez les individus «. C’est alors à la structure des langues et à la nature propre des signes linguistiques qu’il faut s’attacher, mais si on distingue langue et langage, il faut faire de même entre la langue et la parole. En fait, le langage a un côté social et un côté individuel : le côté social, c’est la langue, commune à un groupe ; le côté individuel est la parole qui est la mise en œuvre individuelle de ce code par les sujets parlants. Alors que la langue est pure passivité en ce que le sujet seul ne peut ni la créer ni la modifier, la parole est au contraire de l’ordre de l’activité puisqu’en quelque sorte, chaque parole est une invention propre de celui qui le possède. Pour Saussure, « le fait de la parole précède toujours « : historiquement, ce sont les paroles échangées par les hommes qui ont fait émerger la langue ; d’autre part, c’est en entendant les paroles des autres que l’enfant apprend de manière empirique sa langue maternelle (il va ensuite réapprendre cette langue de manière théorique à l’école par le biais de la grammaire, de la conjugaison, etc.). Et enfin, c’est encore la parole, et ce, en s’affranchissant parfois des règles ou en forgeant de nouveaux mots (=néologismes) qui fait évoluer la langue. Conclusion : Parler est le moyen premier et essentiel que possède l’homme pour maîtriser le monde puisque finalement, nommer les choses et les idées est la première condition de possibilité du savoir, donc de la classification et de l’utilisation des connaissances par lesquelles on s’approprie symboliquement le monde. C’est en ce sens que l’on peut affirmer que les mots ont un très grand pouvoir puisque c’est grâce à eux que se structure la perception de l’univers dans lequel nous vivons. Il permet ainsi d’agir sur autrui : on peut en effet, avec de simples mots, obtenir de l’autre un service, le flatter, lui faire peur ou le blesser : c’est la maîtrise de ce pouvoir qui fait d’un homme un bon rhéteur (ce qu’on a vu avec les sophistes). Comment une simple parole peut elle devenir un outil de manipulation voire de domination ? La réponse est simple : parce que le langage possède une dimension incantatoire. D’après un célèbre sophiste, Gorgias, le discours est capable de charmer l’âme de l’auditeur et d’en changer les dispositions à volonté. Ainsi, par l’usage de figures de rhétoriques appropriées, l’orateur peut susciter chez ses auditeurs la haine ou la colère aussi bien que l’enthousiasme ou la joie. Il y a danger, d’ailleurs, parce que la rhétorique permet de manipuler une foule dans un but particulièrement malsain. PHILOSOPHIE IX. THÉORIE ET EXPÉRIENCE. Introduction : Dans le langage courant, ces deux concepts apparaissent opposés : l’expérience est une connaissance et un savoir-faire qui, obtenue progressivement par la pratique de la vie, enrichit la pensée et la personnalité ; c’est une pratique, un vécu qui permet d’acquérir un savoir qu’il n’est pas toujours possible d’expliquer par des mots. Á l’opposé, la théorie est une connaissance spéculative (qui relève de l’activité de l’esprit) abstraite qui est classiquement opposée à la pratique. On l’entend aussi comme une opinion personnelle avec une connotation péjorative parce que souvent vue comme éloignée de la réalité. Au-delà de cette opposition, il existe un point commun : ces deux domaines ont trait à la connaissance et en fait, la question sous-jacente est : que puis connaître ? Autrement dit, quelles sont les limites de la connaissance humaine ? Cette connaissance est possible sous deux conditions ou plutôt par la présence en nous de deux facultés perçues comme opposées : d’abord la sensibilité, qui est la faculté d’obtenir par les sens des impressions sur ce qui existe hors de nous ; et ensuite l’entendement, qui est la faculté de penser les objets de la connaissance, i.e. de classer ou d’ordonner les données de l’expérience grâce à des concepts qu’on appelle les catégories. En fait, la matière de la connaissance est ordonnée selon leur cohérence. Nous avons en nous ces catégories qui sont, depuis Kant, séparées en quatre parties avec au total douze catégories : ¨ La quantité : unité, pluralité et totalité. ¨ La qualité : réalité, négation, limitation. ¨ La relation : inhérence et subsistance, causalité et dépendance (ou cause et effet), et enfin communauté (i.e. action réciproque entre l’agent et le patient). ¨ La modalité : possibilité et impossibilité, existence et non-existence, et enfin nécessité et contingence. La théorie serait du côté de l’entendement puisque c’est un ensemble de représentations et d’explications qui sont en fait abstraites de la réalité. L’abstraction est une opération intellectuelle qui consiste à isoler un élé __© __ô La théorie serait du côté de l’entendemeÏb_(þb__þû¿0’÷¿ÿÿÿÿ¸Ïb_`J÷¿____sE_ÿöC_ÔÓb_ÌÏb_0ªC_dÓb_äÏb_Tá@__iD_TsE_ø___LØb_0ªC_1¾___Ôb_5ê@_Dê@__Òb_oËC___b_1¾__ô¿___À__!À__µÀ__ÀÀ__XÄ__£Ä__cÎ__}Î__\"Î__õÎ__êá__6â__Bã__=ä__‹ë__?ì__hì__›ì__4ó__‰ó__˜ÿ__½ÿ__Âÿ__óÿ__ ___6___œ __© __ô Ïb_(þb__þû¿0’÷¿ÿÿÿÿ¸Ïb_`J÷¿____sE_ÿöC_ÔÓb_ÌÏb_0ªC_dÓb_äÏb_Tá@__iD_TsE_ø___LØb_0ªC_1¾___Ôb_5ê@_Dê@__Òb_oËC___b_1¾__ô¿___À__!À__µÀ__ÀÀ__XÄ__£Ä__cÎ__}Î__\"Î__õÎ__êá__6â__Bã__=ä__‹ë__?ì__hì__›ì__4ó__‰ó__˜ÿ__½ÿ__Âÿ__óÿ__ ___6___œ __© __ô d’être une faculté qui recevrait et qui organiserait mais qui ne construirait pas. I- Nos connaissances nous sont-elles uniquement données par l’expérience ? Au premier abord, on peut penser que la sensibilité et l’expérience sont les seules sources possibles de la connaissance puisque ce sont elles qui nous fournissent la matière principale, essentielle : en effet, c’est des sens que nous recevons les impressions et c’est avec nos sens que nous percevons les phénomènes susceptibles d’être connus. Ici, on se situe dans une optique empiriste. L’empirisme est une école de pensée du XVIII° siècle pour qui toutes les connaissances viennent de l’expérience, autrement dit, la connaissance humaine déduit de l’expérience non seulement ses principes (les lois physiques, par exemple), mais aussi ses objets : l’esprit scientifique serait alors toujours passif et en fait les scientifiques peuvent être comparés à un simple photographe qui s’en tient uniquement aux faits qui deviennent alors des dons purs et simples. L’observation est en quelque sorte un acte de soumission pour ne rien déformer. Mais, il y a deux problèmes : d’une part, l’expérience est donnée par les sens. Or, ce que les choses donnent à voir n’est souvent qu’apparence (Cf. Descartes) et d’autre part, le problème est de savoir si tous nos concepts sont tirés ou non de l’expérience. L’exemple est l’idée de cause, i.e. le fait de trouver à chaque phénomène un lien. Pour Hume, cette idée de cause n’est rien d’autre que le résultat d’une habitude : en fait, c’est parce que nous voyons un phénomène succéder à un autre que nous croyons pouvoir en déduire qu’une relation de causalité les unit et donc, le rapport de cause à effet se réduit à une succession constante, observable, entre un phénomène antécédent et un phénomène conséquent qui s’associent dans notre esprit et ce qui se passe, c’est que l’habitude elle-même confortée par la répétition fortifie cette association de cause à effet : ce ne serait donc qu’une habitude, voir qu’une croyance. Or, rien ne nous prouve qu’il y ait un lien causal. Mais le problème est que ce concept de cause contient lui-même l’idée de liaison nécessaire entre la cause et l’effet. Si je dis que les nuages gris sont la cause de la pluie, il y a là une liaison nécessaire. Or, les empiristes tirent ce concept de l’expérience et dans le cas de l’expérience, il n’y a que de la contingence. L’idée de cause ne peut donc pas provenir de l’expérience donc il existe des connaissances a priori, c’est à dire uniquement produites par la raison et qui sont en fait les conditions de possibilité de l’expérience. Kant dira en effet dans la Critique de la raison pure que « si toute connaissance débute avec l’expérience, cela ne prouve pas qu’elle dérive toute [entière] de l’expérience «. Chronologiquement, notre savoir commence avec l’expérience parce que c’est elle qui éveille notre curiosité et donc notre envie de connaître. De ces expériences, on va produire des idées, les comparer et les organiser. En clair, chez un être humain, l’expérience est toujours première puisqu’il faut d’abord un objet d’expérience qui va susciter la réflexion, mais ensuite, nous n’avons pas besoin à chaque fois d’une expérience pour avoir l’idée de quelque chose. Ce qui se passe, c’est qu’une fois mise en éveil par l’expérience, notre esprit peut en être indépendant et peut fonctionner sans elle. On en déduit donc qu’il existe des connaissances indépendantes de l’expérience que l’on appelle des connaissances a priori. Cette vision Kantienne peut s’appliquer aux sciences physiques puisque le point de départ de la connaissance scientifique semble être l’expérience, mais ce n’est pas une expérience quelconque : il s’agit d’une expérience « polémique «, d’après G. Bachelard, épistémologue : les phénomènes qui motivent la recherche scientifique sont souvent des observations contradictoires avec le système du monde précédemment admis. La recherche n’a pratiquement pas pour origine le fait de l’expérience considéré à part mais le problème posé par le fait, c’est à dire la contradiction entre le fait nouveau et les concepts théoriques antérieurs. Pour résoudre le problème posé par le fait polémique, le savant propose une hypothèse (l’hypothèse n’est pas une conjoncture, c’est une théorie ou un embryon de théorie), en l’occurrence ici, il s’agit d’une anticipation de l’imaginaire sur la connaissance , mais imagination rationnelle. L’imagination est la faculté de former des images qui soit reproduisent ce qui a été perçu, soit reproduisent mentalement ce qui a antérieurement fait l’objet d’une perception : on parle alors d’imagination reproductrice. Mais c’est aussi une faculté qui combine des images qui proviennent de l’expérience en un nouvel ensemble : on parle alors d’imagination créatrice ou reproductrice. Lors de cette étape, l’esprit scientifique du savant est actif et cette nouvelle théorie restaure l’intelligibilité que l’expérience polémique avait rompue. Donc, le savant ne répond pas directement et définitivement au pourquoi par une proposition affirmative mais procède par le détour d’une nouvelle interrogation. L’hypothèse est une invention de l’intelligence pour résoudre le problème posé par le fait polémique, par la contradiction entre l’ancienne théorie ou science constituée et le fait nouveau livré par l’expérience qui forme la science constituante. L’hypothèse est en fait un effort pour comprendre, c’est à dire aussi les systématiser. Ce qu’il faut retenir, c’est que sans cette étape de l’hypothèse, il n’y aurait pas de progrès scientifique. La dernière étape vérifie l’hypothèse : c’est l’expérimentation. Elle se fait au moyen d’un dispositif expérimental qui permet de recomposer artificiellement un phénomène et doit réaliser la liaison supposée dans l’hypothèse entre les phénomènes . elle devient bien souvent la base d’une nouvelle observation . Bref, le contact direct avec la nature est la condition nécessaire mais non suffisante de sa connaissance ; la nature en elle-même est muette et seul l’homme peut la faire parler. Le seul gros problème ici va être de poser les bonnes questions afin de forcer la nature à nous répondre, mais l’y forcer n’a d’intérêt que si l’on peut préjuger de ses réponses. En réalité, un fait reste brut si l’on en reste à la simple constatation objective. Par exemple, la Terre tournait autour du soleil bien avant que Copernic ne le découvre : ce ne sont pas les faits qui ont changé mais ce sont les concepts scientifiques que l’on était en train d’élaborer pour rendre compte des mouvements respectifs des planètes et du soleil qui ont permis de donner un sens nouveau au phénomène observé. En d’autres termes, pour que la rotation de la Terre autour du soleil devienne vraiment un fait scientifique, il fallait d’abord qu’elle soit une idée. Dans le domaine scientifique, le but n’est pas ce qui est donné mais ce qu’on doit construire en raisonnant, en calculant, en élaborant des concepts, en utilisant des instruments et en procédant à des vérifications expérimentales. L’objet scientifique est ce dont on se rapproche par élimination progressive de la subjectivité (préjugés et opinions) que Gaston Bachelard nomme des obstacles épistémologiques. Ces obstacles ne viennent pas de l’objet ou du phénomène observé, ni d’une défaillance des sens ou de la raison humaine mais c’est dans le processus même de la connaissance qu’on les observe. En d’autres termes, , c’est à cause des mentalités, mœurs d’une époque donnée que la conscience scientifique subit de lenteurs ou des régressions parce que la science démystifie le réel. Bachelard dira : « Le réel n’est jamais ce qu’on pourrait croire mais ce qu’on aurait du penser «. La science et la religion s’opposent toujours. En effet, au XIX° siècle, parallèlement à l’explosion des sciences, il y a eu baisse du nombre de croyants. Mais, on ne peut pas effacer ces croyances et ces préjugés en un seul instant. Bachelard dira à ce sujet : « Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très vieux car il a l’âge de ses préjugés. Accéder à la science, c’est spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. «. Une société qui s’appuie sur des préjugés ou des opinions est vieille à cause de son étroitesse d’esprit : un esprit jeune est beaucoup plus ouvert et prêt à apprendre, contrairement à un homme âgé car il n’a pas encore trop de préjugés. Si la nature est muette, l’expérience seule l’est aussi car elle s’appuie sur les sens (qui sont défaillants) : elle aurait alors toujours besoin du support de la théorie. La démarche scientifique doit prendre cette constatation en compte : il faut l’appui d’une théorie rationnelle. On a commencé à en prendre conscience avec Galilée (XVI- XVII° siècle) et Newton (XVII- XVIII° siècle) puisqu’ils ont en effet contribué à faire construire un nouveau modèle de démarche scientifique qui associe étroitement l’expérimentation à l’expression des lois et des théories dans un langage mathématique parce qu’il abandonne l’interprétation théologique ou métaphysique et dit : « La nature est écrite en langage mathématique qu’il nous faut déchiffrer « et la remplace par une physique mathématisée fondée sur des démonstrations géométriques. Galilée est aussi le premier à avoir recours à l’expérimentation et à la mesure des grandeurs physiques (temps, vitesse, longueur…) pour vérifier ses hypothèses théoriques. La science a un nouveau fondement qui est la méthode expérimentale qui est une méthode de forme hypothético-déductive : le raisonnement part de propositions posées à des hypothèses pour en déduire les conséquences qui en découlent nécessairement. Ces conséquences peuvent ensuite être comparées à la réalité telle qu’elle apparaît au travers de l’expérimentation. Dons, ce sont l’énoncé des théories mathématisées et l’expérimentation qui constituent désormais les bases d’une connaissance de l’univers et non plus l’évidence intuitive tirée de la simple observation : c’est le rationalisme cartésien. Einstein dira : « Galilée nous a appris qu’il ne faut pas toujours se fier aux conclusions intuitives basées sur l’observation immédiate car elles conduisent parfois à des fils conducteurs trompeurs «. De la même manière, Newton dans les Principes mathématiques de la philosophie naturelle en 1687 postule l’existence d’une force d’attraction agissant à grande distance sur les corps et énonce la célèbre théorie de la gravitation universelle. Cette théorie a un tel pouvoir d’explication et de prédiction qu’elle devient au cours du XVIII° siècle le modèle même de la science : elle permet d’expliquer des phénomènes aussi divers que le mouvement des corps sur la Terre, des planètes et de leurs satellites, les marées et la forme du globe terrestre. Les calculs ont en outre permis de prédire le retour de la comète de Halley en 1759. Ces deux exemples montrent bien qu’une théorie scientifique est une construction intellectuelle mais qu’elle n’est pas non plus un produit arbitraire (i.e. basé sur l’opinion et sur ce qui nous arrange) de l’imagination. Ce qui fait sa valeur, c’est qu’elle se rapporte à la réalité par son pouvoir d’explication et de prédiction. En énonçant des relations mathématiques universelles, la théorie de Newton montre également la grande fécondité des mathématiques pour la connaissance des phénomènes physiques. C’est à partir de là que se pose un problème : une théorie physique est-elle un reflet tout à fait fidèle de la réalité ? Ne serait-elle pas plutôt une interprétation de la réalité qui dépend de nos facultés de connaître ? En effet, la connaissance que nous avons de la réalité est relative à la manière dont nous pouvons connaître le réel et on sait qu’on est limité à cause de notre capacité de sentir et de percevoir et à cause de notre raison. On peut donc raisonnablement penser que la réalité est toujours beaucoup plus complexe que les théories auxquelles notre esprit est tenté de la réduire afin de pouvoir la comprendre. II- qu’est-ce qu’une théorie juste ? Ou à quelles exigences doit-elle se soumettre ? Les concepts et les théories physiques sont des créations de l’esprit humain et non des copies de la réalité. Une théorie n’est donc pas directement descriptive ou explicative, mais constitue plutôt un modèle abstrait dont on déduira des descriptions ou des explications correctes de la réalité. Par exemple, la supériorité des théories de la relativité vient non pas parce qu’elle serait vraie et rendrait complètement faux les principes newtoniens mais parce qu’on peut en déduire un grand nombre d’explications cohérentes d’un plus grand nombre de phénomènes. (Soit dit en passant, mais l’ambition de tout chercheur scientifique est de trouver une théorie expliquant tout…). Pour mesurer le degré de pertinence des théories physiques, il faut donc ajouter aux critères de la confirmation expérimentale des critères de rigueur et de cohérence interne, et cela d’autant plus que les recherches contemporaines sur les structures les plus complexes de la matière ou de l’univers portent la physique à un niveau d’abstraction plus élevé et on s’aperçoit que la construction mathématique est même souvent une condition nécessaire de la découverte. En effet, au XIX° siècle, l’astronome Le Verrier a affirmé l’existence de la planète Neptune par le calcul avant même que les observations de ses prédécesseurs ne lui donne finalement raison. Donc, une théorie juste serait celle qui serait vérifiée par l’expérimentation, mais peut-on affirmer qu’une théorie scientifique soit réellement vérifiable par le biais de l’expérience, Il est clair que lorsque les conséquences tirées de la théorie se révèlent contraires aux faits expérimentaux, la théorie est effectivement réfutée, mais aucune expérience ne peut vérifier définitivement une théorie : ce n’est pas parce que les conséquences d’une théorie sont conformes aux données expérimentales qu’elle est vérifiée car rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’un expérience ultérieure ne mettra pas la théorie en défaut. (une expérience est alors du domaine du contingent). Qu’est-ce qui alors donne son caractère scientifique à une théorie ? Une des solutions consiste à dire qu’une théorie est n’est scientifique que si elle est réfutable. En effet, quelle valeur aurait une théorie qui ne peut jamais être mise à l’épreuve de l’expérimentation ? Dans cette optique, tant que les résultats des tests expérimentaux sont conformes aux prédictions de la théorie, on dit que cette théorie est corroborée par l’expérience. si, au contraire, la théorie ne résiste pas aux teste, on dit qu’elle est falsifiée par l’expérience, i.e. rendue fausse. Karl Popper, épistémologue, en déduit ainsi un critère de démarcation antre ce qui est scientifique et ce qui ne l’est pas : est scientifique toute théorie qui peut être falsifié, i.e. qui admet que certains résultats pourraient l’infirmer. Au contraire, n’est pas scientifique qui resterait valable quelque soit les résultats de ces tests expérimentaux. C’est donc la falsibilité d’une théorie qui détermine son caractère scientifique et son degré de certitude. En effet, K. Popper dit dans la Logique de la découverte scientifique : « Un système faisant partie de la science empirique (= sciences physiques) doit pouvoir être réfutée par l’expérience «. Ainsi, vérifier une théorie revient à tester sa résistance aux contrôles négatifs, i.e. dont le succès aboutirait à sa réfutation. Le problème est que même expérimentalement établie, la vérité scientifique n’est jamais définitive, ce qui revient à dire que les théories ont une histoire et si l’on peut supposer que l’ordre de l’univers change peu, sa connaissance en revanche n’est qu’une successions d’erreurs corrigées et vérités approximatives. Dans cette optique, le rapport entre l’expérience et la théorie peut se présenter de deux manières : d’abord comme l’intégration de faits nouveaux à une théorie établie que Thomas Kahn appelle un paradigme et ensuite de voir ce rapport comme le renversement d’une ancienne théorie par la découverte de faits nouveaux qui ne peuvent plus s’y intégrer. Un paradigme est un monde idéal qui concerne l’ordre et les lois de la nature et qui est retenu, plébiscité en vertu de ses succès expérimentaux mais aussi de considérations physiques (au sens général), c’est à dire qu’on s’accorde sur un paradigme parce qu’il y a d’une part une cohérence interne et d’autre part parce qu’il y a un contexte favorable. Thomas Kahn estime que toute recherche scientifique se développe en prenant modèle sur une théorie scientifique exemplaire : c’est le paradigme. Par exemple, la théorie newtonienne a servi de paradigme tout au long du XVIII° siècle. Donc, une science opère toujours de façon plus ou moins explicite dans le cadre d’un paradigme donné qui détermine la façon de poser des problèmes et qui influence la perception que l’on a de la nature. Aussi longtemps qu’un paradigme est dominant, il n’est pas réfutable et tous les faits et phénomènes qui contredisent ce paradigme sont traités comme des anomalies, des exceptions et jamais comme des éléments de réfutation du modèle dominant. Kahn objecte à Karl Popper que son principe de réfutabilité ne peut rendre pleinement compte de l’histoire des théories scientifiques. Là encore, cela se rapporte à l’idée d’obstacle épistémologique de Bachelard : on peut se demander ce qui a fait qu’à un moment donné, on change de paradigme. Lorsqu’un paradigme nouveau entrer en concurrence avec le paradigme dominant, la confrontation ne joue pas seulement au niveau des observations et des tests expérimentaux, mais également pour une grande part au niveau de la croyance en un paradigme : il y a en fait des conditions psychologiques à l’avènement d’un nouveau paradigme. Les preuves qui sont au fondement d’un nouveau paradigme ne sont pas lisibles dans l’ancien modèle et elles rencontrent donc la résistance de la communauté scientifique qui est unie par un même type d’adhésion à l’ancien paradigme. Ce que veut montrer Kahn, c’est que la science ne se développe pas de façon progressive, mais qu’elle avance aussi et surtout par crises et par ruptures dans lesquelles les théories connaissent de nouvelles révolutions. Conclusion : Finalement, l’analyse des rapports entre l’expérience et la théorie dans la démarche expérimentale montrerait que le progrès scientifique ne doit pas se lire comme une accumulation régulière de faits : la connaissance avance en apportant des solutions toujours provisoires aux contradictions entre les anciennes théories et les expériences nouvelles. Cette connaissance est le produit de ce que Bachelard nomme la dialectique expérimentale ; la dialectique est un mouvement qui concerne la pensée, le rationnel, etc. et qui procède par un schéma de type thèse, antithèse et synthèse. PHILOSOPHIE X : LOGIQUE ET MATHÉMATIQUES : Introduction : La logique, au sens le plus général, est une science qui prend pour objet l’étude des jugements en tant qu’il s’applique à la distinction du vrai et du faux. Les Mathématiques sont l’ensemble des sciences ayant pour objet les nombres, l’ordre et l’espace. On emploie le pluriel pour en souligner la multiplicité. Pourquoi traite-t-on ces deux sujets dans le même chapitre ? D’abord, elles ont des points communs : ces deux disciplines ont connu un grand développement au même moment que la philosophie en Grèce, à partir du VI° siècle avant J.-C. et ce pour la même raison : il s’agit de l’effort d’explication rationnelle du monde, et la philosophie, la logique et le mathématiques en sont ses trois raisons principales puisqu’elles ont toutes trois trait au logos (=raison et discours, mais aussi calculs). Le second point commun est que ces deux disciplines se préoccupent de la forme du raisonnement plus que du contenu et d’ailleurs, on assimile souvent logique et rationnel. C’est avec Aristote que la logique prend son véritable essor : elle désigne chez lui la science des formes du raisonnement qu’on appelle aussi forme d’une opération de l’entendement : c’est la nature du rapport qui relie entre eux les termes auxquels cette opération s’applique, abstraction faite des ce que sont les termes en eux-mêmes et également de ce à quoi il renvoie dans la réalité. Ce qui pose problème, c’est le rapport de ces deux disciplines à la réalité : à force de s’en abstraire, la représente-t-elle véritablement ? Et pour y répondre il faut savoir sur quoi elles se fondent. I- L’ambition de formalisation : Aristote, père de la logique, a d’abord constitué la première forme de raisonnement productif du point de vue de la connaissance, ce qu’on appelle le syllogisme. Le syllogisme est un type de raisonnement déductif composé de trois propositions : les deux premières sont des prémisses dont la première est le prémisse majeur et la seconde est le prémisse mineur qui sont nommés ainsi parce qu’un même terme y est pris dans son acceptation d’abord la plus large puis particulière et la troisième est une conclusion logiquement tirée des deux premières parce qu’elle était implicite. Le modèle général du syllogisme, dans sa forme la plus simple, c’est « Tout A est B ; or, C est A donc C est B «. « A « est nommé moyen terme parce qu’il sert d’intermédiaire entre B et C On remarque que la logique, afin de fournir des critères normatifs de validité du raisonnement, doit être formelle, c’est à dire qu’Aristote substitue aux propositions concrètes des schémas formels où des lettres purement symboliques remplacent les termes qui sont pourvus d’une certaine signification dans la langue ordinaire : de cette manière, on ne regarde que la forme. Le syllogisme est ainsi rigoureusement formel : il n’enrichit pas la connaissance mais il donne à ce qui était antérieurement acquis une présentation nouvelle et rigoureuse. En ce sens, on peut avoir un syllogisme formellement vrai (ou logiquement correct ou encore valide) élaboré à partir de prémisses absurdes ou fausses. L’objet de la logique n’est pas la vérité matérielle des propositions qui composent les raisonnements étudiés, mais la logique établit les conditions de la validité des enchaînements de propositions. En raison de son caractère formel, il ne permet aucune invention mais tout raisonnement quelconque devrait pouvoir s’y ramener et c’est en ce sens qu’Aristote affirme que les mathématiques ne sont qu’une suite de syllogismes. Avec la découverte de la logique s’est créée une grande entreprise constituée de structures formelles et donc débarrassées de tout contenu empirique ou intuitif de telle sorte que la connaissance s’y déduit uniquement des axiomes initiaux par application rigoureuse des lois logiques. Un axiome est une proposition indémontrable parce qu’évidente et admise comme point de départ du raisonnement. Pour devenir un outil parfaitement rigoureux et puissant, il faut que la logique soit un système de signes absolument univoque donc distincts de ceux employés dans les langues naturelles. Les opérations de la logique moderne sont ainsi ramenés à des enchaînements de calculs qui sont dépouillés de tout appel à l’intuition. la logique formelle a été remaniée entre le XIX° et le XX° sicle car elle avait des limites : certaines propositions ne peuvent pas être formalisées par un raisonnement syllogistique. Donc, au XIX - XX° siècle, avènement du formalisme avec trois logiciens : Frege, Russel, et Wittgenstein. Le formalisme est une théorie qui constate que les vérités scientifiques et en particulier les vérités mathématiques sont strictement formelles et reposent ou doivent reposer sur des symboles préalablement établis. Donc, Bertrand Russel a voulu démontrer qu’on pouvait réduire entièrement les mathématiques aux notions et opérations de la logique. En d’autres termes, tout élément mathématique doit pouvoir être analysé dans un langage précisément défini parce que la logique constitue le langage parfait dans lequel on pourra exprimer la totalité des énoncés mathématiques et, dans la mesure où les sciences doivent se conformer au modèle mathématique, c’est finalement une grande partie de notre savoir qui doit pouvoir entrer dans le cadre de la logique formelle. En fait, le formalisme apparaît comme une réponse ou comme une solution à un problème qui est qu’au XIX° siècle, les mathématiques traversent une crise qui est due aux limites de leur formalisation. Il est clair que seul un langage complètement artificiel et donc parfaitement contrôlable permet de fonder la validité de toutes les opérations effectuées à partir des signes qui le constituent. Or, le langage mathématique, au XIX° siècle, ne remplit pas complètement toutes ces conditions, comme on peut le voir avec l’intuition qui jouait parfois un rôle dans la définition des objets mathématiques ou avec le fait que certains énoncés mathématiques étaient nécessaires mais non démontrables, ce qui pose évidemment un grave problème. L’idée s’impose alors que la solution au problème du fondement des mathématiques pourrait venir de la logique : les mathématiciens ne devraient-ils pas emprunter à la logique ses procédures parfaitement codifiées ? II- Les Mathématiques et le Réel : Le terme « Mathématiques « a désigné pendant plus de 2000 ans la science qui a pour objet les nombres, autrement dit l’arithmétique et les figures de l’espace, soit la géométrie. Aristote a défini la Mathématique comme la science de la quantité en général, mis il y a deux sortes de quantité : les quantités discrètes ou continues : ce sont les nombres ; et d’autre part les quantités continues qui sont constituées par la géométrie. De cette manière, il unifie les mathématiques . Au Moyen-Âge, la diffusion des chiffres arabes en Europe permet de définir un nouveau système d’écriture des nombres. Cette écriture facilite la formulation de règles pour les opérations et aussi la formulation de conventions de calculs qui rendront possible, à partir du XVI° siècle l’invention de l’algèbre (arabe : al-jabre = réduction). Au XVII° siècle, la création de la géométrie analytique et l’introduction de l’idée de fonction donneront naissance à de nombreuses branches des mathématiques comme par exemple le calcul infinitésimal et le calcul des probabilités. Au XIX° siècle sont apparus la théorie des nombres, la topologie, la théorie des ensembles. Cette diversité des contenus soulève la question de l’unité de la mathématique qui repose sur la nature des objets considérés et sur la méthode pour les connaître ; Les objets étudiés en maths ne sont pas donnés dans l’espace : il s’agit d’objets abstraits. Quant à la méthode, elle est fondée sur les démonstrations de propositions abstraites. C’est d’ailleurs en Grèce qu’est apparue l’idée d’une connaissance démonstrative des objets mathématiques. Cette connaissance est logiquement raisonnée : les théorèmes sont démontrés à partir de propositions primitives que sont les définitions et les axiomes. Un axiome est une proposition indémontrable parce qu’évidente et admise comme point de départ d’un raisonnement ; ces propositions peuvent également être posées comme des hypothèses dont dépendent les preuves qui les utilise. Le rapport entre les êtres mathématiques et le monde réel reste alors incompréhensible pour le non-spécialiste. Comment puis-je me représenter, dans la mesure où je ne suis pas mathématicien, le rapport concret entre une équation différentielle et la trajectoire d’une planète ? Dans les éléments, Euclide s’appuie sur des axiomes qui seront remis en cause à partir du XIX° siècle, en particulier un qui paraît évident mais qui est indémontrable : on a une droite et un point : alors il n’existe qu’une seule droite parallèle à la première et passant par le point. Cet axiome sera remis en cause par un mathématicien qui étudie la géométrie non-euclidienne : Remain qui, à partir de là, développe vers 1850 la théorie des espaces courbes qui introduit une quatrième dimension : il s’agit d’une théorie de géométrie pure parce qu’elle n’a aucune vérification expérimentale. La notion d’un espace courbe est inconcevable à l’époque où il la démontre, dans le cadre de la géométrie classique euclidienne qui décrit les propriétés de l’espace en trois dimensions dans lequel nous évoluons. Mais, cinquante ans plus tard, la théorie de la relativité générale est décrite dans les termes de la géométrie des espaces courbes. Á partir de là, comment expliquer que l’invention d’un mathématicien , qui est le seul produit de ses seules intuitions imaginatives, puisse servir à décrire un secteur fondamental de la réalité physique qui échappe à toute possibilité d’observation directe. En d’autres termes, quel rapport y a-t-il entre la monde idéal (qui relève de l’idée) des mathématiques et le monde concret des phénomènes physiques. Ce problème entre la correspondance entre Maths et réalité peut recevoir deux types de solutions : soit on suppose que l’univers lui-même est régi par un ordre mathématique, soit on considère que l’esprit humain, lorsqu’il cherche à connaître la Nature, lui imprime des formes mathématiques qui appartiennent à l’esprit lui-même. La première solution est soutenue par Platon et Pythagore. En effet, Platon soutient que toute réalité est nombre et donc, pour lui, la mathématique est la voie que l’homme doit emprunter pour atteindre l’être des choses (= les idées). Mais, chez Platon, la mathématique n’est pas pour autant la connaissance la plus haute : il souligne en fait le caractère hypothétique d’un type de connaissance qui ne peut être fondé sur les constations de l’expérience mais qui doit toujours être démontrée logiquement à partir de certains prémisses : la mathématique est donc un niveau intermédiaire entre l’opinion, dérivée de la connaissance sensible, et la philosophie, véritable science des idées qui constitue le monde intelligible. Kant, pour qui le temps et l’espace ne sont pas des données objectives de la perception mais des intentions pures de la sensibilité (forme a priori). En fait, la simple perception de la réalité extérieure semble impliquer l’existence objective d’un espace à l’intérieur duquel les objets sont exposés. Mais Kant montre qu’on ne peut pas construire l’espace à partir de nos sensations dans la mesure où l’espace doit exister préalablement pour que la perception des phénomènes soit possible. L’espace est le cadre dans lequel nous percevons les phénomènes qui composent la réalité extérieure : l’espace est donc une condition a priori de l’expérience, c’est à dire un condition nécessaire pour rendre possible notre expérience du monde. Dans cette optique, les mathématiques sont l’instrument de mesure des relations possibles dans l’espace et le temps. Et en fait, les êtres mathématiques ne sont pas des formes de la réalité mais des constructions de notre esprit mesurant et calculant sur la réalité. Nous ne pouvons donc connaître du monde que les éléments qui sont mathématisables, c’est à dire que l’on peut énoncer et définir dans une logique mathématique. Conclusion : En conclusion, les mathématiques sont un des instruments les plus puissants pour la connaissance du monde naturel. Les sciences physiques n’ont pu se développer véritablement qu’à partir du moment où les savants ont mathématisé la nature, mais comment expliquer ce rapport entre le monde idéal des mathématiques et le monde concret de la Physique ? Soit les mathématiques constituent un secteur essentiel de la réalité fondamentale du monde, soit on pense que les mathématiques sont inscrites dans les structures mêmes de l’esprit humain. Sachant que l’analyse logique des procédures démonstration a montré que la vérité des propriétés mathématiques repose non pas sur l’expérience mais sur la cohérence interne du raisonnement. PHILOSOPHIE XI : LA CONNAISSANCE DU VIVANT : Introduction : Pourquoi parler de la connaissance du vivant plutôt que de connaissance de la vie ou de biologie ? C’est une question capitale qui résume à elle seule une part importante des problèmes concernant cette connaissance. Á la différence des mots mathématiques ou physiques qui ont été très tôt employés pour désigner des domaines clairement délimités de la connaissance scientifique, le terme de biologie n’a été créé et utilisé la première fois qu’au début du XIX° siècle par un biologiste français nommé Lamarck : « l’unique et vaste objet de la biologie, c’est tout ce qui est généralement commun aux animaux et aux végétaux comme toutes les facultés qui sont propres à chacun de ces êtres sans exception «. Or, pour le commun de ces deux sortes d’êtres est d’être tous essentiellement ou par essence des corps vivants. Alors, pourquoi a-t-on attendu le XIX° siècle pour que l’étude des êtres vivants reçoivent un nom ? Pourquoi aussi la biologie a-t-elle attendu plus de vingt siècles pour se constituer comme science ? Il y a deux conditions fondamentales pour qu’un domaine du savoir devienne une science : ¨ Son objet doit être clairement défini. ¨ Il faut posséder des méthodes rigoureusement adaptées à l’investigation de cet objet. Ce sont justement ces deux exigences auxquelles la connaissance du vivant s’est longtemps trouvé dans l’impossibilité de satisfaire. Il faut, par conséquent, mettre en évidence les raisons de cette impossibilité pour comprendre la spécificité du phénomène de la vie et de son étude. Ce phénomène est-il aussi évident qu’il n’y paraît ? Que désigne ce concept de la vie ? Quels sont les différents modèles d’explication ? Parler de la vie semble enfin renvoyer à une certaine unité, quelle est-elle et quel en est son sens ? I- La vie : une notion faussement évidente : Le spectacle de la nature nous montre l’incroyable diversité des espèces vivantes sur la terre, l’évaluation de leur nombre est d’ailleurs très difficile car celui-ci varie selon les estimations : de trois à plus de dix millions dont deux millions sont aujourd’hui identifiés avec certitude. La notion de vie pensée à partir de cette profusion du vivant nous semble une donnée évidente de l’expérience immédiate, i.e. la distinction entre le vivant et la matière inerte (soit le vivant et le mort) paraît aller de soi, mais savoir ce qui est vivant ne permet pas pour autant de déterminer ce que c’est qu’être vivant, de la même manière , la vie n’existe pas comme objet d’une investigation complètement scientifique tant qu’elle n’est qu’un mot qui désigne la différence entre l’inerte et l’animé. Parler de la vie en biologiste, c’est rendre compte des phénomènes dont la conjonction produit cette différence. Pour qu’une science du vivant soit possible, il faut commencer par définir les propriétés qui caractérisent son objet propre et qui la distingue des objets étudiés dans les autres sciences de la nature. Autrement dit, en quoi la vie se distingue-t-elle de la matière ? Il est clair que la vie présente des propriétés qui ne sont pas réductibles aux lois physiques et chimiques qui régissent les phénomènes matériels. Tous les êtres vivants ont en commun deux aptitudes qu’ils sont seuls à posséder : ils sont en relation constante avec un milieu extérieur grâce auquel ils se nourrissent et se développent ; et d’autre part, ils sont capables de se reproduire entre eux selon des mécanismes propres à leur espèce. Ce sont deux conditions nécessaires à la fois de l’existence et de la permanence de la vie. Pour aller plus loin, les êtres vivants sont des organismes aptes à l’autoconstruction, à l’autoconservation, à l’autorégulation et en partie seulement apte à l’autoréparation. « Organisme « vient du grec « organon « qui veut dire instrument ; C’est donc un système organisé en parties qui concourent au fonctionnement et à la survie de l’ensemble dans un milieu particulier : un organisme est un système, existant par soi, dont tous les éléments sont interdépendants, telles sont les principales fonctions, qui si elles sont remplies, font qu’un être est vivant, d’où la formule de Bichat (en 1800) : « la vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort «. Tout le problème est là : comment étudier un phénomène qui est par nature inséparable des fonctions par lesquelles il se manifeste ? Quelle est la valeur de la méthode expérimentale qui très vite se heurte au danger de faire disparaître l’objet même de l’expérimentation ? Ces problèmes ont longtemps été des obstacles à la connaissance du vivant et à la formation de connaissance comme science. La vie pourrait en outre se définir par la longévité des organismes. Mais opposer schématiquement la vie à la mort ne suffit pas à rendre pleinement compte de la spécificité du vivant : la mort n’atteint pas la matière qui compose l’être vivant mais son organisation. Par conséquent, le vivant ne peut être définit par la seule description des parties et des fonctions qui la composent : c’est en fait l’essence même du vivant qu’il faut interroger pour comprendre la vie. D’où la nécessité d’analyser les différents types d’explication de la vie. II- Les modèles de la vie : 1°) La vie : animisme ou mécanisme ? La science des corps animés commence avec Aristote qui s’appuie sur des observations sans précédent en anatomie, en physiologie et en embryologie. Anatomie : étude de la structure des organes. Physiologie :étude de la fonction des organismes vivants. Pour Aristote, l’être vivant est pourvu d’une âme. Le mot « âme « vient du latin anima, souffle vital (qui se dit en grec : psyche). Cette âme est le principe explicatif de tous les êtres vivants, elle anime aussi l’ensemble des fonctions vitales telles que la croissance, la reproduction, la sensibilité, la locomotion et jusqu’à l’intellect. L’âme anime le corps donc elle lui donne vie. donc, l’être vivant est l’unité de la matière et de l’âme qui lui donne forme. L’âme n’est pas une réalité séparée du corps mais se confond avec la matière à laquelle il donne forme. Dans cette optique, étudier l’être vivant revient à étudier l’âme qui comprend trois degrés : ¨ L’âme végétative qui possède comme fonctions la nutrition, la croissance et la reproduction ¨ L’âme sensitive (caractérise les animaux) qui possède comme fonctions les trois auparavant citées auxquelles s’ajoutent motricité et sensation. ¨ L’âme intellective (caractérise les hommes) qui possède comme fonctions les cinq auparavant citées auquel s’ajoute la pensée. Dans cette perspective, une substance est composée de matière et de forme ; un corps est une substance animée et organisée en vue d’une finalité qui lui est propre. Donc, par exemple, le corps du poisson est organisé afin de nager. Cette doctrine est appelée Finalisme. Proposer une interprétation finaliste des manifestations de la vie, c’est affirmer qu’aucune d’entre elles n’est due au hasard mais existe et se poursuit conformément au but qui lui a été fixé d’avance. La nature, prise dans son ensemble obéirait à un plan, une invention qui expliquerait sa structure hiérarchique. On peut, en effet, classer les êtres selon leur degré de complexité de leur organisation, mesuré chez les finalistes, par rapport à l’organisme le plus proche de la perfection qui est l’homme : c’est le fameux thème de l’homme comme fin de la nature, qu’on retrouve dans la Bible : tout sur Terre a été créé pour l’homme. Chaque organisme peut de la même manière être décrit en terme finaliste parce que l’harmonie est telle entre les différentes parties d’un être vivant et ses besoins vitaux qu’il est tentant de justifier l’existence des organes par la nécessité des fonctions à remplir. Le problème est que le finalisme ajoute à une attitude scientifique une dimension non scientifique qui est plutôt d’origine métaphysique voire théologique, parce que quand on dit que la vie répond à une fin donc à une intention conscient, on ne peut pas ne pas penser à Dieu… Et si, justement, la vie et ses manifestations ne répondait à aucun projet, la nature serait alors une grande machine dont le fonctionnement découle uniquement de l’agencement des différentes parties. Cette idée s’appelle le mécanisme et est apparemment opposée au finalisme. Pour les mécanistes, les fonctions de la substance corporelle sont vues comme celles d’un automate dont le mouvement est entièrement défini par les lois physiques. Descartes dira : « Ces fonctions suivent tout naturellement, en cette machine, de la seule disposition de ses organes ni plus ni moins que font les mouvements d’une horloge ou d’un automate, de celle de ses contrepoids ou de ses roues. « dans le Traité de l’homme. Descartes est l’initiateur du mécanisme et il faut prendre le mot machine au sens d’automate dont la technologie s’est développée au XVII° siècle. Les horloges ou les montres sont caractérisées par le fait qu’ils ont la capacité de fonctionner par eux-mêmes une fois leur construction achevée. Automate vient du grec automatos : qui se meut de lui-même. Dans cette optique, l’âme n’est plus la forme du corps : chez Descartes, ce sont deux substances bien différentes. Le corps fonctionne comme une machine dont les principales mécaniques relèvent des lois physiques qui régissent tous les corps. Les lois du vivant ne sont pas à chercher dans les lois métaphysiques : c’est la théorie de l’animal machine. Il faut donc étudier le vivant selon les mêmes méthodes que dans les sciences physiques ? Si l’on considère le corps vivant selon ce modèle, seules les fonctions supérieures de l’âme, à savoir le langage et la pensée conservent à l’homme sa place supérieure dans l’échelle de la vie. Le mécanisme est néanmoins une sorte d’obstacle épistémologique à la connaissance de la vie : se représenter la nature et les composants qui la composent sur le modèle de la machine, c’est oublier la spécificité du vivant : le mécanisme est donc une théorie obtue. Descartes se trouve en fait dans l’impossibilité de répondre à deux questions essentielles : qui a construit la machine et comment son « moteur « a-t-il été mis en marche ? La seule solution est de répondre par Dieu qui a voulu, puis construit puis finalement mis en marche la machine. Le problème est que Descartes réintègre un principe métaphysique donc irrationnel à l’intérieur même du rationnel, donc du finalisme dans le mécanisme. Ils ne sont contradictoires qu’en apparence parce qu’ils font tous deux appel à un principe fondamental indémontrable qui est Dieu. 2°) Le modèle vitaliste : Le vitalisme appariait comme une solution face aux problèmes posés par le finalisme et le mécanisme parce qu’il faut rendre à la vie sa spécificité niée dans le mécanisme sans pour autant supposer l’action d’une force surnaturelle et mystérieuse comme le faisait le finalisme. Le vitalisme vient d’Hypocrate (on y revient au XVIII° siècle) qui affirme une différence de nature entre le vivant et la matière inerte, mais ceci suppose d’admettre l’existence d’un principe vital qui est distinct des lois matérielles ou lois physiques. Chez les vitalistes, c’est l’action d’une force vitale qui expliquerait l’irréductible spécificité de tout être vivant. Kant lui-même, même s’il n’est pas vitaliste, objecte aux mécanistes que le vivant n’est pas seulement un être organisé mais un être qui s’auto-organise ; Il est vrai que l’être vivant a en soi de la matière, mais la simple matière est inerte et sans vie : il faut donc admettre l’existence d’un principe particulier de vie qui est immatériel ; effectivement, le vivant peut être comparé à une machine, mais à la différence d’une montre, il se reproduit lui-même, s’auto-régule et s’auto-régénère. Si en plus, le mouvement de la montre est l’effet de chaque rouage du mécanisme, aucun de ses rouages n’est l’effet d’un autre. En clair, la cause efficiente (cause productrice : mes parents) de la montre est l’horloger qui produit chaque rouage ; de plus, chaque pièce de la montre est dans le mécanisme pour produire le mouvement des aiguilles qui indiquera alors l’heure, ce pour quoi elle est faite. La cause finale de la montre n’est donc pas contenu dans la matière dont elle est faite, mais dans le projet de l’horloger. Par contre, on ne saurait affirmer que les êtres vivants résultent d’un projet, qu’ils sont la réalisation concrète de l’intention conscient d’une force supérieure, mais il est tout aussi impossible de prouver qu’une disposition quelconque de la nature n’aie pas du tout de fin. Donc, l’idée de finalité n’a aucune objectivité scientifique, mais est indispensable à celui qui étudie la vie ; et donc, Kant en conclut à l’impossibilité d’une connaissance pleinement rationnelle de la vie puisqu’il est vain de vouloir expliquer ses qualités vitales. Le vitalisme pose certains problèmes. En effet, l’intérêt porté à ce qui caractérise le phénomène de la vie a des effets bénéfiques sur la recherche, à l’époque de grandes découvertes sur le cerveau, et d’observations importantes sur la reproduction animale ; Néanmoins, l’interprétation des résultats et plus métaphysique que scientifique. De plus, à force de ne s’attacher qu’à ce que le vivant a de spécifique, on finit par en faire un être totalement à part, donc étranger au milieu dans lequel il vit. Le vitalisme n’est pas une position tenable jusqu’au bout car s’il y a bien dans la vie quelque chose d’irréductible à une force mystérieuse ne donne pas forcément de solution au problème de la vie. Mais, même si toute finalité est exclue de l’étude physiologique expérimentale du vivant, il faut reconnaître que toutes les fonctions du corps sont ordonnées par rapport à une même finalité qui est la conservation de la vie. Finalement, la finalité de la vie ne serait-elle pas la vie elle-même ? III- Unité du vivant et évolution de la vie : L’unité du vivant qui fonde l’individualité d’un être se situe-t-elle plutôt au niveau de l’espèce, de la cellule ou des gènes ? Trois découvertes décisives au XIX° siècle ont fait évoluer la réflexion en biologie et même en philosophie : ¨ Élaboration de la théorie cellulaire selon laquelle il existe un constituant commun à tous les vivants ( : la cellule). Cette théorie fait progresser la connaissance des relations d’échanges qui unit tout vivant à son milieu. ¨ Les premières découvertes des lois de la génétique mettent en évidence les mécanismes de transmission héréditaire et contribue à la maîtrise du phénomène de la reproduction. ¨ Le XIX° siècle est l’époque des premières théories de l’évolution qui éclairent le devenir des différentes espèces vivantes et qui augmentent notre connaissance de l’histoire des relations entre les différentes parties de la nature. Effectivement, au XIX° siècle, on assiste à un courant de pensée qui est l’évolutionnisme, ensemble de théories dont les principales sont l’œuvre de Lamarck et de Darwin, qui affirment que le vivant a une histoire et que les espèces n’ont pas toujours été telles qu’elles le sont aujourd’hui, mais qu’elles résultent plutôt d’une longue et lente évolution. L’évolutionnisme contrecarre les théories ou la doctrine précédemment acquise : le fixisme ou le créationnisme dont les derniers représentants en France sont Linné et Bouffon et qui posent que Dieu aurait créé une fois pour toutes les espèces du vivant sous ses formes fixes et ce, dès l’origine. Mais cette doctrine n’arrivait pas à expliquer de manière satisfaisante l’existence de monstres car ils disaient qu’ils étaient des accidents de la nature. Donc, au XIX°, ils ont été contrecarré par la découverte de l’hybridation : on prend alors conscience que le fixisme n’est pas tenable jusqu’au bout et on passe donc à l’évolutionnisme qui met en avant l’unité du vivant. En effet, pour Darwin, la vie est un tout, i.e. un mouvement unique qui va des formes les plus élémentaires aux organismes les plus complexes et d’autre part, l’évolution a produit en l’homme une forme de vie supérieure à toutes les autres d’un point de vue de son organisation et de ses performances, mais cela ne veut pas dire pour autant que l’homme est supérieur aux autres êtres dans l’échelle du vivant. Ainsi, non seulement il contrecarre le fixisme, mais aussi ma théorie de la supériorité humaine. Il refuse en effet que l’homme occupe une position à part du fait de la prétendue supériorité de ses aptitudes mentales. En effet, l’homme est construit sur le même modèle que les autres mammifères : il n’y a finalement pas de nature différente entre les facultés mentales de l’homme et celle des autres êtres vivants. Les animaux possèdent les mêmes sens, les mêmes intuitions fondamentales que l’homme et ils sont capables d’une certaine aptitude au raisonnement et ces différences de degré n’autorisent pas à faire de l’homme une espèce supérieure. La vie est un tout en évolution : elle ne connaît pas de rupture ni de sauts mais elle est une succession d’étapes progressives. Darwin affirme donc la parenté et l’ascendance commune de tous les êtres vivants , en d’autres termes, l’origine de la vie est unique, mais cette évolution est néanmoins soumise à des principes : ¨ D’abord l’adaptation qui est a capacité d’un vivant à faire face à d’éventuelles modifications de son milieu. ¨ Ensuite le principe de la sélection qui est l’élimination naturelle des individus les moins capables de s’adapter et qui s’explique par la concurrence vitale qui élimine les plus faibles. Chez l’homme, ce principe de sélection naturelle est de plus en plus mise en échec car l’homme peut se sauvegarder par le biais de la médecine. Si l’espèce humaine n’est pas capable de s’adapter aux modifications irréversibles qu’elle a fait subir à son milieu, il faut alors accepter l’idée qu’elle puisse un jour disparaître. ¨ Le troisième principe qui est de loin le plus discutable est que cette sélection naturelle permet à l’espèce de se perfectionner de générations en générations et l’espèce entière se transformera et progressera grâce à l’accumulations de variations favorables : c’est ce qu’on appelle l’hérédité des caractères acquis. Mais ce troisième principe n’est plus admis de nos jours puisqu’il est prouvé que les variations somatiques (du corps) ne jouent aucun rôle dans l’évolution : seuls sont héréditaires les modifications au niveau du germe et c’est ce qu’on appelle les mutations dues à une modification dans la constitution des gènes. Mais le mérite de Darwin, même si certains points sont discutables, est d’avoir modifié des savoirs qui étaient jusqu’alors hétérogènes. Après lui, les lois de l’hérédité dont la principale est que seuls les caractères inscrits dans le code génétique d’un individu sont transmissibles à ses descendants, seront reliés à une meilleure connaissance des mécanismes et des conditions de la reproduction d’une part et d’autre part, de la nature et de l’importance des échanges entre le vivant et son milieu. Or, c’est justement de la réunion de ses caractéristiques que le phénomène de la vie tire sa spécificité. C’est finalement tout cela qu’il fallait comprendre pour que la biologie, ayant un objet propre, puisse se constituer comme science. Conclusion : La théorie de l’évolution des espèces laisse encore aujourd’hui un certain nombre de questions sans réponses certaines : quel est le moteur essentiel de cette évolution ? La question, ici, est de savoir si les mutations génétiques brusques suffisent à expliquer les changements irréversibles. Beaucoup de spécialistes admettent la théorie de Jacques Monod qui se résume dans le titre de son œuvre, à savoir : Le hasard et la nécessité. Sa théorie est que l’évolution de l’espèce humaine résulte d’une conjonction de hasard et de nécessités : d’un côté, les mutations génétiques brusques peuvent aboutir à une transformation profonde des individus à l’intérieur d’une espèce, mais de l’autre côté, une évolution sélectionne dans les transformations possibles ce qui est compatible avec la survie de l’espèce entière. La deuxième grande question qui reste sans réponse est : l’évolution a-t-elle ou non un sens ? Les scientifiques avouent d’ailleurs leur impuissance puisque la question de la finalité n’est pas encore tranchée : voir les textes 7-A & 7-B p.158-159 où les deux auteurs, qui sont des scientifiques reconnus et admirés, s’opposent sur la question de savoir si l’évolution poursuit un projet. Philosophie XII LA VÉRITÉ. Introduction : Dans le langage courant, on qualifie de vrai ou de faux aussi bien des énoncés que des objets, des événements ou des situations. Le point commun, c’est que ces deux adjectifs renvoient aux idées de concordance et de non-concordance, d’adéquation et de non-adéquation, et enfin aux idées de conformité et de non-conformité. Mais, peut-on qualifier une chose de vrai comme on peut le faire d’un énoncé ? Dire, par exemple, d’une bague qu’elle est en « vrai or « signifie qu’elle n’est pas une imitation, mais ce qui est qualifié, est-ce le jugement porté sur la bague ou l’objet lui-même ? En clair, ne confond-on pas vérité et réalité ? Il faut donc d’abord savoir en quel sens on parle de vérité. D’autre part, on a vu que la philosophie, du moins à l’origine, est la recherche de la vérité. Ce qu’il faut comprendre, c’est que cette vérité n’est jamais inventée, mais découverte peu à peu (elle nécessite un long travail) : à quels obstacles se heurte-t-elle ? En effet, quand on dit : « à chacun sa vérité «, ne confond-on pas vérité et opinion ; l’opinion étant ce contre quoi la philosophie s’insurgeait et s’insurge et ce par quoi elle a pris naissance (Socrate a voulu rechercher la sagesse car il s’est aperçu que tout n’était que préjugé, donc qu’il n’y avait de vérité que relative) ? Si cet accès à la vérité est difficile, peut-on poser des critères de cette vérité ? En d’autres termes, ces critères me permettront de dire que ce que je pense est la réalité. I- En quel sens parlons-nous de vérité ? La vérité désigne le plus souvent la conformité des paroles dites ou des récits entendus avec ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir. Spinoza, philosophe hollandais dit que « la première signification de vrai et de faux semble avoir tiré son origine des récits ; et on a dit vrai quand le fait est réellement arrivé ; faux quand le fait raconté n’était arrivé nulle part. Plus tard, les philosophes ont employé ce mot pour désigner l’accord ou le non-accord d’une idée avec son objet ; ainsi on appelle idée vraie celle qui montre une chose comme elle est en elle-même ; fausse celle qui montre une chose autrement qu’elle n’est en réalité «. Á l’origine, on dit que c’est vrai ou que c’est faux à propos de paroles ou de récits ; en outre l’obligation de dire la vérité est ce qui rend possible les rapports de confiance parce qu’une parole ne se contente pas d’être une constatation véridique de ce qui est : il peut s’agir d’une promesse qui engage pour l’avenir. La vérité d’une parole est alors une exigence morale. On situe alors la vérité dans l’ordre du devoir-être, i.e. de l’ordre des valeurs. Pourquoi une valeur morale est dite de l’ordre du devoir-être ? Spontanément, ce qui est n’est pas moral : le but d’une éducation est de montrer ce qui doit être. Cette valeur morale s’exprime d’abord dans le refus de tromper et d’être trompé, mais il a ensuite une valeur politique. Un état démocratique institue en effet un double rapport à la vérité : d’une part il exige la transparence des institutions puisque, dans une démocratie, celui qui est le chef de l’état, est censé être le représentant du peuple et d’autre part, l’instruction convenable de tous les citoyens afin qu’ils comprennent tous ce qui est écrit sur les lois. C’est pourquoi il est naturel au pouvoir dans son entreprise de domination d’être l’ennemi de la vérité ;c’est aussi pourquoi une des caractéristiques des régimes totalitaires est d’essayer de transformer en vérité les propres mensonges des dictateurs. Comme le montre Spinoza, cette explication originale s’est déplacée et c’est en fait dans un sens dérivé que l’on peut qualifier de vrai des idées et quant à la dernière utilisation de l’adjectif, il ne convient que par métaphores de parler de vérité à propos des choses : « ainsi nous disons de l’or vrai ou de l’or faux comme si l’or présenté racontait quelque chose sur lui-même « écrira Spinoza, autrement dit, quand on qualifie un objet de vrai ou de faux, c’est impropre. Revenons à la vérité d’une idée qui signifie sa conformité avec la réalité. Mais, le problème est le suivant : qu’entend-on par réalité ? Dire qu’une chose est vraie signifie souvent qu’elle a lieu ou que c’est un fait acéré. Mais doit-on concevoir la réalité comme ce qui relève de l’expérience sensible. La définition de la vérité dépend alors de la conception que l’on se fait de la réalité. Platon considère que la réalité se trouve dans le monde des idées, que seul l’esprit peut atteindre et refuse parfois d’accorder de la réalité aux choses sensibles parce que le monde sensible n’est constitué que d’apparences (mauvaises copies de la réalité) qui sont changeantes et temporelles et donc ça lui permet d’identifier réalité et vérité qui elle, est intemporelle, immuable et universelle. Il y a malgré tout un problème : n’y a-t-il de vérité qu’intelligible ? Ou ne peut-on pas trouver de vérité dans le onde sensible ? Pour cela, il faut distinguer deux types de vérité : ¨ Vérité de raison qui renvoie aux idées qui sont les objets de la pensée (comme les vérités mathématiques) ¨ Les vérités de fait qui peuvent faire l’objet d’une expérience sensible (comme le soleil se lève tous les matins). C’est donc une réalité que l’on constate avant de pouvoir l’expliquer par la raison. Ces deux types de vérité peuvent encore se distinguer de la vérité « sensible au cœur « (citation de Blaise Pascal) : c’est la vérité dévoilée par Dieu ; Mais, là encore, il faut faire la distinction entre vérité révélée et vérité rationnelle :la vérité révélée m’est donnée par la Foi sous forme de dogmes qui sont des vérités fondamentales enseignées sans être démontrées et sans qu’il soit autorisé d’en douter. Elles se trouvent dans les textes sacrés et les écrits des docteurs de l’Église. Á propos de Pascal, sa fameuse citation « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas « est, tout du moins quand il parle du cœur, il parle des vérités révélées. D’autre part, la vérité rationnelle est une vérité que l’on recherche à l’aide de la raison humaine qui doit donc être fondée et démontrée. Cependant, de quelle manière se manifeste la vérité parce que, si l’on en connaît la définition, est-ce pour autant aussi simple de l’atteindre ? Et en fait, contre quoi doit-on s’ériger pour la rechercher ? II- La difficile découverte de la vérité : Constitué d’apparences, le réel sensible dans lequel nous vivons est source d’erreurs et d’illusions. L’erreur est un acte dans lequel l’état d’un esprit qui donne pour vrai et existant ce qui est faux est inexistant. L’erreur se distingue du mensonge par son caractère involontaire. D’autre part, l’illusion est une tromperie qui se joue de nos sens et de notre esprit ; elle est proche de l’erreur dans la mesure où elle fait également intervenir un jugement erroné mais s’en distingue par la présence du désir qui la rend rebelle à toute réfutation rationnelle. La vérité est à rechercher au-delà, parce qu’elle n’est pas consolatrice dans l’être véritable, intelligible, i.e. accessible à l’intelligence seule. Cette distinction de l’être et du paraître pourrait être assimilée à une conception religieuse de la vérité qui sépare aussi le monde en deux mais d’en sépare au moins sur un point essentiel : l’accès au monde intelligible pour Platon, n’est pas l’effet d’une révélation mais le résultat d’un effort de la raison. Donc, d’un côté, l’idée d’un monde intelligible est le produit d’une réflexion sur la nécessaire universalité et immuabilité du vrai : en effet, une vérité qui change selon les points de vue ou avec le temps, peut elle être une vérité ? Non, car c’est du domaine de l’opinion. Et d’un autre côté, se libérer des apparences comme le prisonnier que l’on délivre et qui se tourne pour la première fois vers les véritables réalités, c’est se libérer de l’opinion, état d’esprit qui affirme ou qui nie avant d’avoir jugé ou qui ne préjuge que sur les apparences en fonction des besoins. Dans cette optique, savoir qu’on ne sait rien est la première condition de la recherche de la vérité, mais cette recherche est difficile, ce que Platon veut montrer d’après la longueur du texte : la situation des prisonniers enchaînés dans une caverne, ne voyant que les ombres qu’ils prennent pour des réalités symbolisent leurs illusions et même si l’on suppose qu’on en libère un de ses chaînes (symbolisant opinions, préjugés, etc.), la quête s’avère pénible parce qu’il faut d’abord qu’il prenne conscience de son ignorance pour ensuite pouvoir quitter son univers de croyance et qu’il ose s’aventurer seul et donc qu’il s’érige contre le plus grand nombre, parce que même si on le guide dans cette recherche, la vérité ne se révèle qu’à un esprit prêt à le recevoir. En fait, on ne reçoit jamais la vérité : on la découvre soi-même au prix d’un effort de la pensée. Évidemment, la vérité existe indépendamment de l’esprit qui la découvre et dans le texte, l’acte par lequel elle est découverte est comparée à la vision, mais le soleil qui éclaire peut aussi éblouir et aveugler, ce qui est le cas pour le prisonnier évadé: il faut donc qu’une pédagogie prépare l’esprit à recevoir la vérité et ainsi, inévitablement pour Platon, l’éducation des enfants est d’une grande importance et le rôle de la philosophie est de retourner dans la caverne afin d’éduquer les esprits. L’allégorie de la caverne oppose les idées vraies aux existences sensibles qui ne sont que leurs images bien moins vraies et bien moins réelles que les idées, mais la connaissance de la vraie beauté, du vrai bien, de la vraie justice nous permet de reconnaître la Beauté, le Bien, le Juste de ce qui se présente à nous dans le monde sensible. Mais la vérité ne peut résulter que de l’examen critique des opinions : un homme qui la recherche doit donc remettre en cause tout ce qu’il a appris dans son enfance et l’expérience qu’il a eue d’opinions tenues pour vraies et qui se sont ensuite révélées fausse l’incite à douter de tous les préjugés. Par rapport à ce point précis, Descartes est très proche de Socrate et de Platon : c’est le doute méthodique qui est le moyen d’accéder à la vérité et douter me prouve que je suis libre, que je ne me contente pas de recevoir ce qu’on me dit, mais que je réfléchis par moi-même. Néanmoins, si je sais quels sont les moyens pour purifier son esprit des opinions, le problème du critère de la vérité reste posé. III- Y a-t-il un critère de la vérité ? 1°) La cohérence logique : C’est par l’usage de la raison dans le langage que les hommes cherchent à atteindre la vérité, mais l’accès à la vérité se complique par la pluralité des discours sur elle : les différentes vérités cherchent la vérité sous un certain angle. De la même manière, chaque philosophe a sa propre méthode pour l’appréhender qui s’inscrit dans son propre système d’où l’utilité de la logique qui est un critère indispensable pour la recherche de la vérité. En effet, en examinant quelle doit être la forme d’un discours correct, on peut repérer la fausseté de certains discours pour les réfuter. Et cette science s’appuie sur différents principes qui sont la base d’un discours cohérent : ¨ le principe de non-contradiction selon lequel une même chose ne peut pas à la fois être et ne pas être : je ne peux pas poser comme également vraie une proposition et sa contradictoire. ¨ Le principe du tiers exclu selon lequel lorsqu’on a deux propositions, que l’une est vraie et que l’autre est fausse, il n’y a pas de tierce possible. Mais la cohérence formelle d’un discours n’est pas un critère suffisant de sa vérité, même s’il est nécessaire puisqu’un raisonnement qui ne présente aucune contradiction est valide, mais n’est que formellement vrai et peut être matériellement faux. 2°) La conformité de la connaissance à son objet : Pour ne pas se contenter d’un critère formel, on définit la vérité comme l’adéquation de l’idée à la chose ou de la pensée au réel. Cette définition a été donnée par les scolastiques, philosophes du Moyen-Âge et a été utilisée jusqu’au XVIII° siècle où elle a enfin pu être démontée. Selon cette définition, il y a vérité quand il y a accord, correspondance entre la pensée et le réel. Ici, la vérité définit une relation de représentation adéquate. Mais il y a un problème : pour savoir qu’une représentation est vraie, il faudrait connaître l’objet représenté ; or, on ne peut la connaître qu’à partir de l’idée qu’on en possède. Le vrai s’éprouve sans pouvoir se vérifier, donc il faut recherche une autre voie et cette autre voie consiste à affirmer que ce qui est vrai est dans ce dont on est certain. 3°) Certitude et évidence : La certitude est un état d’esprit de celui qui, donnant pleinement son assentiment, tient un jugement pour assuré et croit de ce fait posséder la vérité. Le problème est que ce terme est ambigu parce qu’il désigne une conviction qui s’appuie sur des critères objectifs, mais il désigne également une attitude subjective qui relève de la croyance, donc fondée sur des motivations irrationnelles. La certitude peut alors porter sur une opinion fausse. Mais on peut toujours en douter. Néanmoins, l’évidence d’une idée n’est pas son caractère spécifique. Il y a évidence quand une idée s’impose clairement et distinctement. D’où la formule de Descartes : « est évident ce qui se présenterait si clairement, si distinctement à mon esprit que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute. « L’évidence est donc le critère qui apparaît le moins discutable : c’est l’esprit qui est certain, mais c’est l’idée qui est évidente. Et, face à l’évidence, l’esprit reçoit le Vrai comme dans une vision. Donc, la vérité se découvre alors quand la certitude de l’esprit rencontre l’évidence de l’idée par la reconnaissance de l’existence du sujet pensant par lui-même. L’évidence est donc la manière dont une subjectivité consciente éprouve le vrai tout en reconnaissant la valeur objective de sa représentation. Effectivement, chez Descartes, le cogito est la première vérité, mais le je pendant est aussi la condition de toute vérité : il n’y a de vérité que par et dans un sujet pensant. On peut cependant reprocher à l’évidence de n’être qu’un critère subjectif de la vérité puisque, communément parlant, ce qui est évident pour moi ne l’est pas forcément pour les autres. La réponse de Descartes est que l’objectivité permet d’être reconnue universellement, mais d’un autre côté, la subjectivité rend possible la connaissance. Il n’y a donc de vérité subjective que pour un sujet pensant. Chez Descartes, cette évidence est garantie et fondée sur un fondement métaphysique : Dieu, parce que Dieu est tout puissant, et surtout non trompeur et ainsi, il est le créateur des vérités éternelles. Mais un fondement théologique est-il acceptable ? Non, car un savoir est ce qui peut être vérifié par l’expérience, sinon, la vérité est seulement l’affirmation d’une croyance. Nous ne pouvons accéder à la vérité de certaines idées, notamment celle de Dieu : cela concerne toutes les questions métaphysique : le savoir laisse croire à la croyance et à la foi. Conclusion : La définition de la vérité est embarrassante : réside-t-elle dans l’évidence de l’idée ou dans la cohérence de la pensée ou encore dans la conformité des discours à la réalité ou enfin dans la possibilité qu’une théorie soit vérifiée par l’expérience ? Finalement, deux états d’esprit opposés sont à choisir : d’une part le scepticisme qui nie la possibilité d’atteindre la Vérité, et d’autre part, le dogmatisme qui affirme une vérité de manière absolue. L’un et l’autre de ces courants de pensée ne sont pas tenables jusqu’au bout car douter est bien, mais fait stagner et le dogmatisme l’est de même car nous sommes des êtres subjectifs et on doit remettre en cause sans cesse sons avoir. Il reste que la vérité est un idéal qui ne peut être atteint qu’en se méfiant de nos certitudes subjectives ou préjugés. De la même manière, fonder la vérité sur le postulat de l’existence de Dieu est tout aussi intenable car l’accès à un savoir véritable suppose qu’on cesse de croire. La croyance est l’attitude de l’esprit qui adhère à un énoncé, à un fait sans pouvoir en donner ou recevoir de preuve concrète et tout savoir est rationnel et donc prouvé. Philosophie XIII L’ART. Introduction : Le terme a longtemps désigné l’ensemble des savoir-faire artisanaux et les modes de production en général. Déjà, en Grèce, le mot « tekné « ou « techné «, autrement dit le métier, l’habileté à savoir faire quelque chose. La tekné recouvrait indifféremment l’activité des artistes et des artisans. Néanmoins, l’existence des différents arts dans les sociétés humaines a invité la philosophie dès son origine à s’interroger sur eux. Les principales questions originelles sont : quel est leur fonction, leur but ? Et d’autre part, doit-on s’en méfier ? Dans les faits, l’évolution des arts et surtout leur diversité rend difficile une définition de l’Art au singulier. Jusqu’au XVIII° siècle, ce terme désignait l’ensemble des techniques puis à partir de Kant, on sépare l’art en général des Beaux-Arts, le point commun est que l’art, quel qu’il soit, s’oppose à la nature, ce qui signifie que c’est une activité culturelle et que c’est produit par la liberté. Il n’y a d’art qu’humain. Aujourd’hui, l’art est un terme qui se suffit à lui-même car il est utilisé, contrairement à avant, sans épithète et sans adjectif. C’est une forme culturelle autonome qui, à travers les siècles, s’est émancipée aussi bien des techniques de production dans sa forme que des religions dans son contenu. Mais, surtout, parler de l’Art au singulier implique un jugement de valeur : en effet, on ne se contente pas d’englober un certain nombre d’objets mais on comprend aussi une manière d’être qui est celle de l’artiste qui a longtemps été assimilé à un génie et de plus, on comprend également une manière de faire particulière qui est la création d’œuvres et aussi une manière de ressentir qui est à l’œuvre dans l’expérience esthétique. Enfin, si les manifestations artistiques sont présentes dans toutes les cultures et quasiment dans toutes les époques, cela signifierait qu’il a un rôle prépondérant pour l’être humain. Quelle est la fonction de l’Art ? L’homme a-t-il besoin de l’art et dans quel but ? Et enfin, qu’est-ce qui distingue l’art d’une simple technique ? I- Quelle est la fonction de l’Art ? 1°) Art et Technique. Bacon, philosophe du XIII° siècle dit : « L’Art, c’est l’homme ajouté à la nature. «, ce qui veut dire en fait que l’art qualifie tous procédés qui sont le fruit de la liberté et de la raison humaine utilisée en vue d’une production. Il témoigne aussi du savoir-faire de l’artisan ou de l’artiste. L’éthymologie du mot « Art « confirme cette notion de savoir-faire. Du Grec « tekné « et du latin « Ars «, ces deux mots désignaient autrefois toutes les activités qui résultent d’une aptitude non-innée, mais acquise par un apprentissage approprié en vue d’une science, d’une technique ou d’un métier. Á cause de cette double origine , notre langue dispose de deux séries de mots qui regroupent des choses complètement différentes. Jusqu’au XVIII° siècle, on a divisé le vaste domaine des arts, d’une part dans les arts libéraux (qui occupent l’homme libre), appelés plus tard les beaux-arts qui englobent l’architecture, l’art décoratif, la gravure, la musique, la peinture et la sculpture. De l’autre côté, on a les arts mécaniques qui sont toutes les techniques fondées sur le travail manuel dans un but utilitaire. Néanmoins, à la fin du XVIII° siècle, apparaît le mot « technique « qui désigne à l’origine les procédés matériels qui interviennent dans un art. aujourd’hui, on entend par technique tous les procédés d’action et de fabrication, mais surtout ce qui applique un savoir scientifique et pour lequel l’enseignement théorique se joint à l’apprentissage pratique. Aujourd’hui, le terme « art « désigne uniquement les beaux-arts. On entend ainsi le séparer d’une simple technique. Mais, définir la technique par son but utilitaire et ses procédés rationnels et l’opposer à l’art c’est restreindre le domaine artistique sans encore dire ce qu’il recouvre. D’un autre côté, posséder une technique ne fait pas de moi un artiste : il est évident que l’art utilise des techniques mais ne se limite pas à leur application. 2°) Art et Vérité. Chronologiquement, la première fonction de l’art était de représenter le plus fidèlement possible la réalité à la fois sensible et intelligible, ce qui est le cas par exemple pour les fresques religieuses. Il a alors rapport à la réalité, c’est la raison pour laquelle les œuvres d’art ont longtemps été soumises à des règles :loin de laisser l’esprit de l’artiste libre de représenter ce qu’il voulait, l’art était un domaine avec des lois qu’il ne fallait pas enfreindre si on voulait être qualifié d’artiste et si on voulait que les œuvres produites soient nommées œuvres d’art. La première fonction de l’art était dons réduite à une imitation de la nature et c’est dans cette optique que c’est critiquable, ce que fait Platon dans sa République, livre dans lequel il considère que l’art, et en particulier la peinture et a poésie sont des activités mensongères car elles consistent à produire des faux-semblants. Il y a d’ailleurs deux raisons principales pour lesquelles il condamne l’art et qu’il affirme que dans la cité idéale, on peut très bien s’en passer. Cité idéale : Platon s’était assigné une tache : celle de fonder une cité parfaite et juste dont on trouve les caractéristiques dans la République. Il y a d’une part une raison morale au fait qu’il condamne l’art, c’est que la Tragédie Grecque traite de l’existence humaine dans son rapport aux divinités, mais la conception philosophique de Platon s’élève contre une conception de la condition humaine, décrite par la tragédie ou l’épopée homérique, livrée aux désordres des passions et des vices. Les dieux y sont peints de manière peu flatteuses, avec quantité de défauts, ce qui est incompatible avec la définition du divin. La seconde raison est une raison théorique selon laquelle il existerait trois niveaux de réalité : ¨ Ce qui est réellement, c’est à dire la forme intelligible. ¨ Le phénomène existant particulier que l’on perçoit de manière sensible. ¨ Le simulacre, qui copie artificiellement la réalité perçue de manière sensible : c’est le cas, par exemple de la peinture. On objecte à Platon que l’art imite non pas ce qui est, mais ce qui apparaît. Une œuvre d’art, c’est la copie d’une copie : l’art est donc éloignée de la vérité. Même si l’artiste ne fait qu’imiter ce qui apparaît, c’est à dire la nature sensible, l’activité artistique peut tout de même exprimer un authentique effort de connaissance. C’est de cette façon que le conçoit Aristote dans la Poétique, il affirme que la mimésis ou la ressemblance à l’œuvre dans l’art est avant tout utile à la connaissance car imiter n’est pas simplement copier une chose mais saisir son acte i.e. figurer la forme essentielle qu’elle actualise. Imiter une chose, c’est en saisir l’essence : la poésie, par exemple, est plus qu’une description pure et simple de faits singuliers car l’art permet d’atteindre l’être donc une vérité plus générale que la vérité immédiate, et par ce moyen, l’homme peut parvenir non seulement à connaître les choses extérieures mais aussi à se connaître lui-même. Aristote : « Nous avons plaisir à regarder les images les plus soignées des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité. […] La raison en est qu’apprendre est un plaisir non seulement pour les philosophes, mais également pour les autres hommes […] en effet si on aime à voir des images, c’est qu’en les regardant, on apprend à connaître et on conclut ce qu’est chaque chose. « Chacun sait aujourd’hui qu’imiter n’est pas le but de l’art, du moins qu’il ne se limite pas à une simple imitation. La preuve en est que lorsqu’il consiste en une reproduction, l’art ne peut finalement pas rivaliser avec la nature. De plus, un faussaire reproduisant une œuvre n’est pas un artiste, de la même manière, je peux être habile et reproduire parfaitement un paysage sans pour autant produire une œuvre d’art. 3°) Le Beau : On peut alors affirmer qu’il y a art quand il y a production d’une œuvre belle, mais il y a un problème car il y a beauté en dehors de l’art et en même temps, certaines formes d’art ne recherchent pas le Beau. Pour élucider ce paradoxe, il faut poser la question : Qu’est le Beau ? Pour cela, il faut d’abord distinguer le Beau de l’utile. Est utile tout ce qui satisfait un besoin directement ou indirectement. Mais, si la chose belle ne satisfait pas directement un appétit de consommation, elle ne contribue pas non plus à produire des moyens de satisfaire cet appétit. Autrement dit, devant une œuvre d’art, on ne demande pas à quoi ça sert, la réponse serait de toute façon : « à rien «. L’essence d’une œuvre d’art n’est pas de servir à quelque chose, mais il peut arriver qu’un objet soit beau et utile, et donc là, il faut encore distinguer deux sortes de types de beauté qui sont en corrélation avec deux types de jugement, distinction qui a été faite par Kant dans sa Critique de la faculté de juger, parce qu’il existe un autre paradoxe quant à l’art et c’est une question : peut-on dire, sans contradiction : « c’est beau mais ça ne me plaît pas « ? Ceci nous amène à distinguer ce que Kant nomme le jugement de goût ou jugement esthétique qui définit une beauté libre d’un jugement de l’agréable qui définit une beauté adhérente. La coïncidence entre beauté et utilité est recherchée en particulier dans ce que l’on nomme mes arts appliqués, et surtout dans l’architecture et donc la beauté adhérente est la beauté d’un objet qui est soumis à d’autres critères que le seul jugement esthétique. Ce qu’on demande en effet à un édifice n’est pas d’être beau mais d’être fonctionnel. La beauté dans ce cas est secondaire et ce qui prime est l’utilité. Parallèlement, le jugement de l’agréable comporte un intérêt qui est la satisfaction que nous unissons à la représentation de l’objet : l’intérêt est une attitude de consommation du réel et donc le jugement de l’agréable est toujours un jugement intéressé à l’existence de l’objet pour le consommer. Si je m’arrête devant la vitrine d’un pâtissier, ce n’est pas dans le seul but de regarder, mais de les regarder pour les consommer. Passons au jugement de goût. La beauté libre est celle qui n’est astreinte à aucune fonction extérieure au beau lui-même : c’est celle qui proprement, ne sert à rien et en ce sens, elle est plus pure parce qu’il n’y a aucune utilité qui rentre en ligne de compte. Kant définit le Beau de la façon suivante : « Est beau ce qui plaît universellement sans concept «.Le jugement de goût ne suppose pas l’existence de l’objet ou la possession, mais seulement sa représentation. Une œuvre d’art ne se possède jamais : elle se contemple par mes sens et ma raison. Dans le jugement de goût n’intervient pas seulement le côté sensible, mais aussi le côté intellectuel : c’est donc un jugement désintéressé et libre puisque rien ne me contraint à trouver une chose belle. Cette contemplation suppose en outre une harmonie de nos facultés intellectuelles avec nos facultés sensibles et on peut affirmer que l’homme est une unité dans le jugement de goût. Kant a écrit trois grands œuvres : la critique de la raison pure dans laquelle il nous montre que la connaissance fait appel à l’entendement avec les catégories : ceci concerne la science. D’autre part, la Critique de la raison pratique qui fait intervenir la raison et la bonne volonté et concerne cette fois-ci la morale. Ces deux facultés (raisons pures et raisons pratiques) posent le déchirement de l’homme et la faculté de juger unifie ces deux domaines séparés parce qu’elle fait appel à la raison et à nos sens. On peut même dire qu’il existe un postulat humaniste dans le jugement esthétique parce que ce que crée l’artiste est communicable à tous les hommes, sans forcément faire intervenir le langage. Le seul vrai rapport à autrui est donc la communication esthétique : l’art nous éveille aux autres et à nous-mêmes : on peut alors dire qu’il y a une espèce de connivence. Quand Kant emploie « sans concept « dans sa définition du beau, c’est pour dire que le jugement fait appel à des lois préétablies alors qu’en Art, il n’y a pas de lois et « sans concept « signifie alors sans lois, sans règles et sans recettes. Une précision : C’est au XVIII° siècle que se passe une révolution culturelle sur l’art et la façon de voir l’art en général : en effet, c’est à ce moment là que l’on commence à voir l’art sans concept, mais les mutations sont des mutations sur le papier, il faudra donc attendre un peu pour que ce soit réellement effectif. Le Beau répond donc à un besoin spécifique puisque c’est un besoin de l’esprit, mais qu’est-ce qui satisfait l’esprit humain quand il contemple une œuvre d’art ? II- La nature de l’œuvre d’art ? Il est impossible de définir l’œuvre d’art d’une manière unique car ce que l’on définit comme œuvre d’art varie selon les différentes époques. Donc la définition de l’art est historique et met en jeu aussi bien notre rapport au passé qu’à l’actualité. Au début du XIX° siècle, le mouvement Dada se proclame anti-art, ce qui pousse Marcel Deschamps à inventer le Ready-mode en composant que n’importe quel objet puisse être arbitrairement baptisé œuvre d’art et par provocation il choisit le fait qu’un urinoir soit considéré comme une œuvre d’art. La valeur et la signification d’une œuvre d’art deviennent alors extrêmement problématique. L’œuvre d’art a en effet longtemps été considérée comme un moyen d’entrer en relation avec le sacré : elle apparaît ainsi comme une réalité intrigante mais elle n’a, par elle-même qu’une réalité inconsistante parce qu’elle n’a de sens et de valeur que par rapport à ce qu’elle mime, c’est à dire ce qu’elle imite sans l’être. Ainsi, un masque est inquiétant parce qu’il simule en dissimulant une réalité. Dans un cérémonial magique, c’est un accessoire porté pour manifester autre chose, en l’occurrence une divinité bonne ou mauvaise, d’ailleurs : il fait donc peur non pas par ce qu’il est mais par ce qu’il représente. Plus généralement, les œuvres d’art, tant qu’elles sont perçues comme des fétiches, des objets magiques ou sacrés, ne sont pas encore appréciées comme œuvre d’art : le Chrétien qui prie devant un crucifix, n’est pas là pour admirer ou critiquer le travail de l’artiste. Néanmoins, la valeur culturelle des œuvres d’art s’est déplacée en situant le sacré dans l’œuvre elle-même et non pas dans ce qu’elle représente. L’œuvre d’art est alors une réserve de sens inépuisable puisque le regard du spectateur détecte telle ou telle signification non seulement selon son savoir, son ignorance, son degré de connaissance en fait, sa culture, mais aussi son imaginaire et globalement ses désirs inconscients qui lui donnent parfois un sens qu’elle n’avait pas, en fait que l’auteur ne lui avait pas donné. Mais il n’y a pas de contresens en matière de jugement esthétique puisqu’il est libre et d’ailleurs sont libres non seulement le jugement esthétique mais aussi la création artistique. Au contraire, on peut dire que toute nouvelle interprétation enrichit l’œuvre d’art : c’est la raison pour laquelle même si une religion a perdu ses adeptes, les symboles par lesquels elle s’est manifesté demeure comme œuvre d’art. L’interprétation des œuvres d’art, de même que la création est intimement lié au contenu de notre inconscient : c’est le principe de la sublimation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on peut avoir différentes interprétations. Mais malgré son interprétation lucide du sens caché de l’activité artistique, Freud était conscient de son incapacité à expliquer ce qu’est le don artistique, ou la véritable nature du génie. En effet, aussi bien pour le créateur que pour le spectateur, l’acte créateur reste mystérieux autant qu’obscur. III- L’artiste : Pour définir l’artiste, il faut s’interroger sur ce que la production d’œuvre a d’énigmatique parce que, tant qu’elle a été considérée comme une imitation de la nature, l’action artistique n’était pas comprise comme une création originale, mais comme une vulgaire imitation, mais dès lors qu’on a compris qu’une œuvre d’art n’était pas une simple reproduction, mais une représentation issue de l’esprit de l’artiste, l’acte de création devient prépondérant, mais en même temps pose un grave problème. En effet, d’où vient cette puissance de création ? La réponse longtemps admise se situe dans le génie et dans sa capacité de production. Á son origine, le génie artistique était perçu comme un pouvoir communiqué directement par les dieux par le biais de ce que l’on nomme l’inspiration. Génie vient du latin « genus « qui était une divinité présidant à la naissance, une sorte de pouvoir démoniaque qui guide l’artiste sans qu’il le comprenne lui-même véritablement. Remarquons d’autre part que démoniaque vient du grec : « Daimon « qui signifie génie ! Alors que la technique procède par l’application d’une science, le génie de l’artiste consiste à produire son œuvre sans posséder le savoir de ce qu’il fait. Á ce propos, citons Kant : « le génie est le talent (don naturel) qui donne les règles à l’art […] , le génie est la disposition innée (ingenium) par laquelle la nature donne les règles à l’art «. Ainsi, le génie est fréquemment admis comme inné, comme un don de la nature et pour comprendre cela, il faut se souvenir qu’il n’y a pas de lois dans l’art, ainsi le génie produit des œuvres exemplaires sans aucune recette préétablie, ce qui en revanche est le cas des imitateurs ou des faussaires. Donc, c’est l’artiste lui-même qui invente ses propres règles. Mais cette reconnaissance du génie s’accompagne nécessairement de la passivité de l’admirateur parce qu’elle maintient ainsi une opposition entre artiste d’un côté et non artiste de l’autre et cette opposition est contestable et même contestée par certains artistes eux-mêmes parce qu’elle tendrait à nier tout travail de la part de l’artiste. C’est pourquoi Nietzsche affirme que le génie est partout et n’est pas seulement un privilège réservé aux beaux-arts : le génie, c’est la pensée lorsqu’elle est active dans une direction unique donc il y a du génie dans n’importe quel domaine d’activité. Par conséquent, il n’y a aucun miracle propre au génie : d’où vient alors cette croyance ? Á cette question viennent deux réponses : la première est que nous voyons toujours l’œuvre d’art lorsqu’elle est terminée et nous oublions donc qu’elle résulte d’un travail parce que et l’artiste et l’œuvre d’art savent conjointement le faire oublier. C’est ainsi que Nietzsche écrira dans Humains trop humains : « Tout ce qui est finit, parfait, excite l’étonnement. Tout ce qui est en train de se faire est déprécié. Or personne ne peut voir dans l’œuvre de l’artiste comment elle s’est faite : c’est son avantage car partout où on peut assister à la formation, on est un peu refroidi «. La seconde raison est que c’est aussi un prétexte, une excuse qui incite à une certaine paresse parce qu’en séparant artiste et non artiste, je me donne une excuse pour ne pas faire d’effort : « Nommer quelqu’un « divin «, c’est dire : « ici, nous n’avons pas à rivaliser « «. Donc, c’est une façon de se conforter dans sa situation et d’y rester sans chercher à se perfectionner et c’est aussi oublier que tout est travail sur soi-même et sur l’extérieur. Conclusion : L’art intéresse la philosophie parce qu’il met en jeu une réflexion sur l’être. L’œuvre d’art, qu’elle séduise ou non par sa beauté ou parfois sa laideur, nous invite encore à nous interroger sur la réalité et à la distinguer de l’apparence : avec l’art, on découvre que l’illusion peut être plus vraie que l’apparence immédiate. L’art peut alors devenir un moyen d’atteindre la vérité parce qu’il est révélateur d’une vérité impossible à percevoir directement. Longtemps indissociable de la religion, l’art a pu ensuite faire l’objet d’un culte autonome mais ce culte semble menacé par la production industrielle des biens culturels. En ce sens, la réflexion philosophique sur l’art a été relancée par l’importance des mutations techniques et des nouvelles technologies de reproduction. Elle est aussi stimulée par les révolutions artistiques qui on profondément modifié l’art au XX° siècle. Philosophie XIV LA LIBERTÉ : Introduction : Être libre, est-ce une réalité ou une illusion ? pour l’homme de la rue, être libre, c’est faire ce qui lui plaît, c’est donc accomplir ses désirs sans obstacle ni contraintes. Agir librement, c’est donc agir volontairement ou agir volontiers. Par exemple, je vais librement au cinéma parce que j’en ai envie et qu’aucune tâche ne s’impose à moi. Cette acception du mot « liberté «rejoint d’ailleurs son sens originel, en effet, pour les anciens, un homme libre est un homme qui n’obéit à aucune loi si ce ne sont les siennes. Et contrairement à l’esclave qui est entièrement soumis à l’autorité de son maître, l’homme libre dispose de sa personne comme il l’entend. Pourtant, agir sans contraintes ne suffit pas pour définir une parfaite liberté parce que je peux volontairement me précipiter dans la servitude comme un animal se jette dans un piège car il a vu l’appât mais pas le filet. Pour appliquer cela à l’homme, Spinoza dit : « on pense que l’esclave est celui qui agit par commandement et l’homme libre celui qui agit selon son bon plaisir. Cela n’est pas cependant absolument vrai car, en réalité, être captif de son plaisir, c’est le pire esclavage «. Donc, ce sentiment immédiat de liberté n’est peut-être qu’un illusion. Il est vrai que chacun l’éprouve à certains moments, mais éprouver n’est pas prouver. Cette première définition de la liberté n’est pourtant pas suffisante puisque je me crois libre, mais le suis-je réellement ? Cette question en entraîne d’ailleurs une autre : qu’est-ce qu’être libre ? Et, en fait, on va s’apercevoir qu’il faut dépasser cette première approche pour être libre en pleine connaissance de cause. I- La liberté comme soumission à la nécessité : Le déterminisme, qui est présent partout dans la nature, nous détermine-t-il aussi ? Il est vrai que nous appartenons à la nature, nous en faisons partie intégrante parce que nous sommes des animaux, mais la connaissance que nous avons de ses lois augmente notre pouvoir d’action. et même si nous connaissons mieux les lois physiques, nous y sommes soumis et nous ne pouvons faire autrement que de nous y soumettre. Ce déterminisme ne concerne pourtant que notre moi sensible. Qu’en est-il alors de notre esprit? Et quelle est cette liberté si elle n’est pas l’abandon aux impulsions du désir ? N’est-elle pas la prise de conscience de la nécessité ? Donc, d’abord la prise de conscience que cette liberté qui consiste à faire ce que je veux est une pure illusion, parce que je ne fais jamais réellement ce que je veux. La liberté comme prise de conscience d’une soumission à la nécessité est ainsi vue par Épictète qui est un stoïcien et pour qui la liberté réside dans l’assentiment à l’ordre providentiel de la nature. L’homme peut en quelque sorte devenir l’égal des dieux s’il parvient à maîtriser ses désirs jusqu’à vouloir ce que veut la raison divine qui gouverne toute chose. La liberté peut alors être comprise de deux façons : la possibilité d’obtenir tout ce qu’on veut, mais c’est aussi la possibilité de soumettre sa volonté à l’ordre universel (on est ici encore dans une optique qui privilégie le tout bien ordonné : le cosmos). Investir de notre désir les choses qui ne dépendent pas de nous, ce qu’on peut globalement appeler les choses extérieures, est déraisonnable. La raison exige au contraire que nous ne considérions comme bonnes que les choses qui dépendent de nous et en fait, celui qui veut que les choses arrivent comme il le désire est en réalité l’esclave de ses passions. La vraie liberté réside alors dans l’assentiment à tout ce qui est. Puisqu’il y a des choses que je ne peux pas changer (telles la maladie ou la mort), le meilleur moyen de ne pas subir ce qui m’arrive, est de le vouloir pleinement, donc de l’accepter. Consentir à la nécessité, en d’autres termes vouloir ce que veut la raison divine qui ordonne toute chose, telle est la voie de la liberté selon Épictète. Á partir de là, l’homme libre ne considère pas comme des maux le froid, la maladie ou la méchanceté des hommes, parce qu’il sait que ces réalités concourent à l’ordre du monde. Le véritable esclave n’est donc pas celui dont le corps est à la merci des caprices du maître, mais celui dont l’âme est prisonnière de désirs excessifs qui vont à l’encontre de la nature. Par exemple, si je ne veux pas vieillir, je m’expose à subir les ravages du temps. En fait, si je ne l’acceptes pas, je vais vieillir, à mes yeux, encore plus vite. Le sage, en revanche, qui vit en harmonie avec la nature, jouit d’une absolue liberté : rien ne peut le troubler puisque tout ce qui lui arrive, il l’a voulu. Dans cette optique, la liberté n’a rien à voir avec la condition sociale : le maître peut très bien torturer son esclave, il ne saurait le forcer à vouloir ce qu’il ne veut pas. Néanmoins, Épictète donne à notre volonté un pouvoir absolu. Mais, cette volonté n’est-elle pas aussi déterminée sans que j’en aie conscience ? Ceci nous ramène au cours sur la psychanalyse de Freud. Spinoza, dans cette perspective, pose qu’il n’y a pas en l’homme de faculté particulière de vouloir. Il existe certes ce qu’il appelle des volitions, i.e. des actes particuliers du vouloir, mais elles sont rigoureusement déterminées au même titre que les phénomènes naturels donc, une chose singulière quelconque « ne peut exister et être déterminée à produire quelque effet si elle n’est déterminée à exister et à produire cet effet par une autre cause «. (L’éthique de Spinoza) : en fait, il n’y a rien de contingent dans la nature, mais tout y est déterminé à exister et à agir d’une certaine e choses de la nature, l’homme est strictement déterminé. S’il croit avoir sur ses actions un pouvoir absolu, c’est parce qu’il a conscience de ses propres désirs, mais il ignore les causes qui les déterminent et donc, ce que nous appelons liberté ne serait rien d’autre que notre ignorance des causes véritables qui nous déterminent à agir ou à penser de telle ou telle manière. Par conséquent, l’homme est d’abord esclave : comment, dans ce cas convertir en liberté la servitude originelle de l’homme ? On peut le faire d’abord par la connaissance, en effet pour accéder à la liberté, il me faut comprendre que tout ce qui m’arrive est nécessaire, et il faut donc que je coïncide, par le biais de la raison, avec cette nécessité inéluctable. Si, par exemple, le malheur me frappe, quand j’aurais compris que l’enchaînement des causes et des effets rendait ce malheur inéluctable, je serais apaisé parce que je cesserai d’envisager mes souffrances sous l’angle borné de mon individualité pour les considérer du point de vue de la totalité, i.e. du point de vue de la liaison de beaucoup de choses. Et, donc, comprendre activement ce que j’éprouvais passivement, n’est-ce pas finalement trouver dans la connaissance même des conditions de la servitude une nouvelle forme de puissance, de liberté et de bonheur ? et donc, chez Spinoza, l’homme peut accéder à une certaine forme de liberté s’il parvient à se réaliser, c’est à dire à faire correspondre ses actions avec son essence même. On parle dans ce cas là de la libre nécessité. Ceci dit, chez Spinoza, seul Dieu est véritablement libre parce que, dit-il : « il agit par les seules lois de sa nature et sans subir aucune contrainte «. Malgré tout, il me semble que je ne suis pas nécessairement soumis à la liberté, mais comment le prouver ? II- Le libre arbitre : Certes, je ne peux me soustraire à la loi de la pesanteur, mais il m’est toujours possible de dire ou non la vérité. Ma liberté se manifeste ainsi d’abord à moi comme le pouvoir de choisir entre plusieurs actions possibles : c’est proprement ce que l’on appelle le libre arbitre, mais cette liberté de choix possède deux degrés que met en avant Descartes. ¨ Le premier degré : il arrive parfois que je sois confronté à un choix qui me jette dans le plus grand embarras parce que je n’ai aucune raison de préférer une solution plutôt qu’une autre et un philosophe du XIV° siècle, Jean Buridan nous invite à méditer sur le cas d’un âne que aurait autant soif que faim et qui serait placé à égale distance d’une mesure d’avoine et d’un seau d’eau. Ne sachant que choisir au point d’en rester immobile, il finit par mourir. Pour pouvoir prendre une décision il aurait fallu qu’il soit doué, tout comme l’homme, du pouvoir de se déterminer même quand aucun motif ne l’emporte. Cette liberté, qu’on appelle liberté d’indifférence est le plus bas degré de la liberté parce qu’elle s’exerce toujours à l’occasion de choix insignifiants. L’indifférence est l’état dans lequel se trouve la volonté lorsque, confronté à un choix, « elle n’est pas poussée d’un côté plutôt que de l’autre par la perception du vrai ou du bien « et elle n’est nullement la condition de la liberté, au contraire, je suis d’autant plus libre que j’ai de bonnes raisons d’agir comme je le fais. ¨ Le second degré : quand je suis confronté à un choix crucial qui engage mon avenir, je ne peux pas décider de la conduite à tenir. Je suis alors d’autant plus libre, comme l’affirme Descartes, que je suis capable de discerner clairement la meilleure des solutions. Ce n’est donc pas dans l’absence de motifs que réside la liberté, mais dans le pouvoir que possède la volonté humaine d’arbitrer entre des motifs contraires. Cette puissance de la volonté que l’on appelle le libre arbitre, constitue pour Descartes en tout cas, la principale perfection de l’homme car elle le rend maître de ses actions. En effet, par sa nature, la volonté consiste en ce que nous pouvons nous déterminer à agir sans être contraint par une quelconque force extérieure et en cela, elle est absolument sans limite. Par exemple, même si un mensonge m’est avantageux, je suis libre de ,ne pas mentir, c’est à dire de donner la préférence au devoir de dire la vérité plutôt qu’à mon intérêt personnel : une décision libre n’est donc pas une décision laissée au hasard, mais une décision pleinement réfléchie et éclairée par la connaissance du vrai ou du bien. En ce sens, le libre arbitre nous rend pleinement responsable de nos actes : dès lors qu’un homme est capable de distinguer le bien du mal, le choix du mal ne peut être imputé seulement à des conditions extérieures comme notre passé ou notre milieu social. C’est le choix d’une volonté qui pourrait tout aussi bien faire le choix opposé : j’ai alors le devoir d’être responsable de mes actes. Donc, la liberté est un droit mais aussi une charge qu’il me faut assumer et en ce sens, la liberté est synonyme de responsabilité. C’est comme cela que la voit Sartre. Donc l’homme possède une liberté absolue et il ne peut pas rejeter ses fautes ou ses erreurs sur des causes extérieures donc, en fait, l’homme libre est sans excuse. Pourquoi Sartre affirme-t-il cela ? Sa réponse vient d’une de ses célèbres phrases : « L’existence précède l’essence «.Le verbe exister signifie être hors de : les hommes existent alors que les animaux sont : l’homme n’a ainsi pas de nature, ce qui implique qu’il est libre. Cette phrase signifie qu’on ne peut pas m’enfermer dans une nature bien définie parce que je peux changer, je ne suis donc pas figé dans un rôle et on part du principe que les animaux restent conformes à leur nature toute leur vie alors que les hommes non. Bref, rejeter sa faute sur une certaine nature humaine n’a pas de sens et n’est qu’un prétexte pour s’en décharger. Ainsi, « l’homme est condamné à être libre. Condamné parce qu’il ne s’est pas créé lui-même et par ailleurs cependant libre parce qu’une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu’il fait «. Sartre dans L’existentialisme est un humanisme. Donc, j’agis toujours librement quoi que je fasse, mais qu’est-ce qu’un acte libre ? On croit souvent que l’acte libre c’est l’acte indéterminé, étranger à tout motif. Ainsi, André Gide dans son livre Caves du Vatican imagine l’acte libre par excellence : il s’agit d’un crime gratuit, immotivé de son héros, Lafcadio, qui d’un compartiment de train, précipite un voyageur dans le vide. On finit par comprendre que l’idée d’acte gratuit est une illusion dont Lafcadio est prisonnier. En effet, s’il accomplit ce crime et c’est le cas, pour faire preuve de son absolue liberté, ce n’est plus un acte immotivé puisqu’il est motivé, déterminé par le désir de commettre un acte gratuit. Mais si tout acte est déterminé, est-ce à dire qu’aucun n’est libre ? La réponse est non parce que l’acte libre ne s’oppose pas à l’acte déterminé mais à l’acte contraint, c’est à dire imposé par une puissance extérieure. L’acte libre apparaît alors comme la solution la plus réfléchie à un problème. Pour l’illustrer, Racine et sa pièce Andromaque paraît le mieux trouvé. Dans cette pièce, Andromaque est pris par une cruel dilemme : ou, pour sauver son fils, elle épouse Pyrrhus et trahit alors la fidélité pour son défunt mari Hector ou elle n’épouse pas Pyrrhus, reste alors fidèle à son mari mais Pyrrhus fera mourir Astyanax son fils. Donc, Andromaque décide d’épouser Pyrrhus qui, lié par sa promesse assurera l’éducation de son fils et se donne la mort tout de suite après son mariage et par-là même, comme il n’est pas consommé, ne trahit pas non plus Hector. Donc cette solution tragique mais réfléchie est un acte libre parce qu’elle est la seule solution qui permet à Andromaque de concilier ses devoirs d’épouse avec ses devoirs de mère. Pour définir la liberté, il faut distinguer le fatalisme qui asservit du déterminisme qui libère. En effet, le fatalisme est une doctrine et une attitude selon laquelle tous les événements du monde et particulièrement ceux qui concernent la vie humaine obéissent à une nécessité absolue, c’est à dire qu’ils sont soumis à un destin irrévocable et inévitable. En clair, ce que dit le fataliste, c’est que ces événements que l’on craint sont inévitables quoiqu’il arrive auparavant et, quoi que l’on fasse pour l’éviter, il se produira quand même, ce que l’on voit dans Œdipe. Ainsi, quels que soient les événements qui le précèdent, le résultat final est nécessaire ; Le fatalisme rend donc impossible toute liberté humaine. D’un autre côté, le déterminisme affirme seulement que ces événements sont liés entre eux par des lois constantes et universelles : je sais par exemple qu’en voiture, il me faut beaucoup plus de temps et d’espace pour m’arrêter sur une route humide que sur une route sèche, et si je veux dans ces conditions pouvoir m’arrêter, il me suffit de réduire ma vitesse. Le déterminisme ne rend donc pas impossible la liberté : au contraire, la connaissance des lois causales augmente ma liberté parce que j’agis alors en connaissance de cause et no par impulsivité. Néanmoins, même si je suis un être libre, je ne vis pas seul, mais inséré dans une société régie par des lois. Qu’en est-il alors de cette liberté individuelle face à autrui et face aux lois. III- Lois et liberté : Que serait une conscience de soi libre si elle n’était pas reconnue comme telle ? C’est oublier notre condition première qui est le fait d’être aux autres avant d’être à nous-mêmes. À ce propos, Kant dira : « Penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien sans le pouvoir de communiquer avec nos semblables ? « Mais, dans la vie en société, a coexistence des libertés est problématique : quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d’autres. Il faut donc des limites à l’indépendance. mais comment poser ces limites sans tomber dans l’extrême inverse, c’est à dire la suppression totale des libertés individuelles ? C’est en ce sens que la Déclaration universelle des Droits de l’Homme dans son article 4 définit la liberté non comme le pouvoir de faire ce que l’on veut ou tout ce qui nous plaît, mais comme le pouvoir de faire « tout ce qui ne nuit pas à autrui «. Qu’il s’agisse de la liberté ou de tout autre droit, son exercice a pour limite d’assurer à autrui la jouissance de ce même droit. Ainsi, chaque droit pour moi est un devoir pour l’autre et vice-versa. C’est pourquoi Rousseau affirme dans son Contrat Social « qu’il n’y a point de liberté sans lois «. Á première vue, c’est une affirmation paradoxale voire même contradictoire parce que la loi est souvent ressentie par les individus comme une contrainte. En effet, elle interdit à chacun de faire tout ce qui lui plaît. Mais, c’est en ce sens aussi qu’elle le protège du bon plaisir d’autrui qui peut lui être nuisible voire mortel. Donc, l’absence de lois dans une société qui théoriquement assure la liberté de chacun aboutirait en fait à l’écrasement du plus faible par le plus faible. C’est pourquoi il faut distinguer comme le fait Rousseau dans son Contrat social la liberté naturelle de la liberté civile. La liberté naturelle est présente à l’état de nature : elle est même un droit illimité à tout ce qu’on peut atteindre et n’a pour bornes que les forces de l’individu. mais, chacun fait ce qui lui plaît. Le plus faible s’expose alors à subir ce qui plaît aux plus forts de lui faire subir. Or, « la liberté consiste moins à faire sa volonté qu’a n’être pas soumis à celle d’autrui «, ce qui dans ce cas fait que l’indépendance c’est à dire le pouvoir d’agir selon son bon plaisir ne finit que par produire le despotisme et donc l’esclavage parce que la liberté collective disparaît dès qu’un homme ou un groupe d’hommes peut sans être inquiété imposer sa volonté à celle d’autrui par force, violence verbale (menaces, etc.) ou physique. Aussi faut-il substituer à cette pseudo-liberté la liberté civile que seul le contrat social (contrat de tous envers chacun et de chacun envers tous) permet de garantir. Par ce contrat, « chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout «. Ainsi, chacun s’engageant envers tous à ne reconnaître que la liberté générale, la liberté de tous les membres politiques (tous ceux qui participent à la vie politique, i.e. les gouvernements et leurs sujets) est préservée de même que leur égalité. Tous peuvent alors jouir du même droit en toute sécurité et c’est en ce sens que la loi préserve la liberté. En fait, en obéissant à la loi qui est l’expression de la volonté générale, le citoyen n’obéit qu’à lui-même, ce que traduira Rousseau avec : « L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté «. La liberté, de ce fait, est obéissance, mais non pas obéissance aux puissants, mais à des lois qui s’imposent à tous, y compris aux puissants. Dans un État libre, personne n’est au-dessus des lois, le gouvernements eux-mêmes (qui ne sont pour Rousseau que de simples représentants) doivent servir les lois (d’ailleurs, le mot ministre vient du latin « ministere «, i.e. serviteur) et non pas se servir des lois pour leur propre profit. CONCLUSION : Si comme l’affirme Rousseau, « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté «, la vraie liberté réside dans l’autonomie, i.e. dans l’obéissance à la loi morale prescrite par la raison. Dans ce cas, la loi devient une obligation et non plus une contrainte. Si elle apparaît contraignante, c’est parce que nous ne sommes pas autonomes, mais hétéronomes. Parmi les principes pratiques, i.e. « les propositions renfermant une détermination générale de la liberté « (définition de Kant), il faut distinguer les maximes et les lois. Subjectives, les maximes sont les principes d’après lesquels le sujet agit tandis que les lois qui sont des principes objectifs, déterminent comment le sujet doit agir et donc, seul est moralement bon le vouloir dont la maxime peut être pensée comme une loi universelle, i.e. valable pour tout être raisonnable. La loi morale détermine la volonté de l’individu en tant que celui-ci est un être raisonnable, i.e. sans tenir compte de ses impulsions, penchants ou sentiments. C’est d’ailleurs sur ce point que se sont concentrées les critiques. Donc, pour Kant, la liberté et la loi morale s’impliquent réciproquement et ne peuvent être pensées l’une sans l’autre. C’est en effet parce que je saisis d’abord en moi le commandement de la loi morale que je connais ma liberté et réciproquement, c’est parce que je suis libre que je peux résister à mes penchants et accomplir mes devoirs. Philosophie XV LA JUSTICE : Introduction : La justice vient du latin « Jus « qui veut dire le Droit. La justice apparaît alors comme le respect du droit, la conformité au droit mais le droit renvoi lui-même à deux choses : l’institution judiciaire d’une part, e d’autre part la notion morale. Un droit est ce qui est conforme à une règle précise ou ce qui est permanent. Dans le premier cas, il ouvre pour le sujet la possibilité de le réclamer ou de l’exiger, et dans le second, il est autorisé par des lois plus ou moins explicités ou au sens le plus fort par des lois conformes au devoir moral. On voit tout de suite l’ambiguïté du terme justice puisqu’il est à la fois une vertu morale individuelle et l’exigence judiciaire collective qui applique le droit d’un pays donné. Ainsi, chacun se pense capable d’apprécier la justice ou l’injustice qui caractérise un acte, une décision, mais même les règles tendent à s’unifier en Europe, il faut également constater à travers le monde une certaine hétérogénéité des règles de droit. Ainsi, ce qui est conforme à la loi dans un pays donné peut nous paraître injuste ; dès lors, la prétendue justice rendue dans ce type de pays ne nous paraît-elle pas être une injustice ? Si les règles de droit dans un pays donné peuvent être qualifiées d’injustes, n’y a-t-il pas quelque chose d’autre qui prévaut sur les lois d’une nation ? Ne sommes-nous pas alors confrontés par la réalité elle-même à la question de savoir ce qu’est véritablement que la justice. Si nous jugeons que telle ou telle loi est injuste, c’est bien par rapport à une certaine idée de la justice et nous pensons que cette loi n’est pas conforme, mais quelle est cette idée ? Autrement dit, en vertu de quelles normes jugeons-nous un cas comme étant juste et un autre injuste ? I- JUSTICE ET ÉGALITÉ : C’est souvent lorsque l’on pense être soi-même une victime d’une injustice que l’on se soucie de savoir ce qu’est la justice. Par exemple, lorsqu’à travail égal, les salaires sont inégaux ou lorsqu’un héritage est inégalement réparti ou que les auteurs d’un même délit se voient infliger des peines différentes ; dans chacun de ces exemples, l’injustice prend la forme d’une inégalité dans la répartition des biens ou des peines : le justice peut donc logiquement pouvoir de définir par l’égalité. D’ailleurs, c’est bien une stricte égalité qui indique les plateaux de la balance, symbole de la justice, mais il es difficile de déterminer ce qu’est une égalité juste. Parce qu’il ne suffit pas d’attribuer des parts égales à chacun, parce que l’un peut mériter plus que l’autre ou être d’avantage dans le besoin, par quelle égalité peut-on donc définir la justice ? Les mêmes biens pour tous ? À chacun selon ses besoins ? Selon son mérite ? L’exigence d’égalité doit prendre en considération les différences qui existent de fait entre les individus mais d’un autre côté, la justice suppose aussi un traitement égal pour tous, en dépit des différences de chacun. Il faudrait donc pouvoir se référer à une norme qui préciserait quels sont les droits et les devoirs de chacun, mais comment définir une norme qui puisse valoir pour tous ? Personne ne peut affirmer sérieusement que les hommes sont égaux en fait. Aux inégalités naturelle telles que la force, la santé s’ajoutent des inégalités sociales. Cette sorte d’héritage introduit dès le départ des inégalités qui sont parfois renforcées par le système des castes lorsque les individus ne veulent pas sortir de ces castes dans lesquelles ils sont nés, mais la justice exige de chacun que les hommes soient égaux en droit (opposition habituelle entre « de jure « et « de facto «), c’est à dire que malgré leurs diversités et leurs inégalités de fait, ils aient droit à une égale reconnaissance de leur dignité humaine, au respect exigible par toutes personnes raisonnables. Ce principe de l’égalité des personnes fonde en démocratie l’égalité civile : il s’agit d’imposer à tous les citoyens quels qu’ils soient un même système de droits et de devoirs, et donc égaux en droit, les hommes sont aussi égaux en droits. Homme ou femme, chaque citoyen a droit de vote : cette égalité devant la loi est notamment affirmée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui refuse toutes les destinations qui ne seraient pas fondées sur l’utilité commune. Article 5 : « La loi n’a le droit de défendre ce que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. «. Cet article fait référence à Montesquieu qui affirme que « la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent «, encore faut-il que l’inégalité des conditions ne remette pas en question l’inégalité des droits. Que signifierait, en effet, un droit aux soins médicaux auxquels les plus pauvres n’auraient pas accès ? La justice exige non seulement que les mêmes chances soient données à tous, mais que les inégalités économiques et sociales soient dans la mesure du possible atténuées. Par exemple, les plus riches paieraient d’avantage d’impôts et les plus pauvres seraient aidés par l’État ou autre organisme. Le problème qui se pose alors est celui de savoir s’il faut aider les plus pauvres de façon égales ou en fonction de leurs besoins, ou encore en fonction de leur mérite ? Pour répondre à ce problème, il faut partir de l’idée que la justice est fondamentalement une vertu de l’individu, c’est à dire une disposition de l’âme qui consiste pour Platon « à faire son travail et à ne pas se mêler de celui d’autrui «. Mais, la justice est plus une vertu parmi d’autres puisqu’elle est celle qui réunit les trois autres vertus principales qui sont indispensables à l’établissement de la cité idéale. Ces trois vertus sont : v La sagesse qui doit être la vertu uniquement des gouvernements ; v Le courage qui concerne les gouvernements et les guerriers ; v La tempérance qui consiste à ne pas tomber dans les excès et qui concerne le(s) gouvernement(s), le(s) guerrier(s) et le(s) peuple(s). La justice doit tout de même passer par l’éducation des citoyens et l’organisation de la cité parce que la justice et l’injustice naissent des relations entre membres de la cité. La justice, c’est d’abord une vertu individuelle mais qui prend son sens par le biais de nos relations avec les autres et donc, Aristote reprend le problème de l’esclavage et il définit la justice à partir de l’excès et du défaut, c’est à dire à partir de la disproportion dans l’échange, mais avant tout, il faut distinguer la justice au sens général et au sens particulier. Chez Aristote, l’équité est une forme de justice qui cherche à adapter la loi dont la lettre est nécessairement générale aux cas particuliers qui peuvent se rencontrer et que la loi n’a pas prévu. Pour résoudre le problème posé au départ, Aristote distingue dans l’Éthique à Nicomaque trois espèces de justice : v La justice commutative : cette justice préside aux échanges et aux contrastes et elle repose sur une égalité arithmétique ; un échange est juste lorsque les services ou biens échangés ont sensiblement la même valeur. v La justice distributive : elle s’applique à la répartition des biens et des honneurs au sein de la cité. Cette répartition n’est pas arithmétique, mais proportionnelle au mérite, aux qualités de chacun ou encore au service rendu. v La justice rectificative ou corrective : elle est fondée sur une égalité arithmétique, c’est à dire sur la stricte égalité des personnes : elle concerne les crimes et les délits : devant traiter les criminels de la même façon, elle proportionne néanmoins les sanctions par rapport à la faute commise. Dans sa forme primitive, elle fait subir au coupable ce qu’il lui a fait subir à sa victime : c’est la loi de Talia : « œil pour œil, dent pour dent «). Une justice plus évolutive et plus évoluée tient compte des intentions du coupable et proportionne la punition à la mauvaise intention plutôt qu’à la gravité de l’action, mais dans tous les cas, il s’agit de rétablir au moyen d’un châtiment l’égalité qui a été rompue par le dommage parce que le coupable s’est octroyé un avantage ou un bien illicite au détriment de la victime. Le juste rectificatif est selon Aristote la moyenne entre le perte subie par la victime et le gain illicite obtenu par le responsable du dommage et c’est cette peine qui le coupable devra verser à la victime. Le juge doit évaluer l’importance du préjudice en terme pécuniaire, néanmoins, il faut reconnaître dans les faits que les peines infligées au criminel varient d’un individu à un autre parce que les règles de droit sont différentes, de même que leur application. N’est-ce pas contradictoire avec l’idée de justice ? II- DROIT POSITIF ET DROIT NATUREL : Y a-t-il justice en dehors de la sanction ? À l’état de nature, y a-t-il ou non une idée de justice ? T. Hobbes affirme qu’à l’état de nature, les égoïstes s’affrontent dans des conflits meurtriers : il affirme en effet : « À l’état de nature, l’homme est loup pour loup « Dans l’état de nature, rien ne peut être qualifié de juste ou d’injuste parce que la justice a été instituée en même temps que la cogitée civile. Hors de la société, tout ce qui est possible est permis et ma liberté n’a d’autres limites que les obstacles auxquels se heurtent ma puissance, et donc, l’état de nature qui résulte du jeu des forces individuelles est un état d’instabilité et de misère. Soumis aux passions individuelles, l’homme au départ n’est pas naturellement social ; il est sauvage, mais son instinct de conservation élémentaire qui est mis au service de son intérêt immédiat le conduit facilement à la rivalité. Ainsi, la droit à l’origine se confond avec la faculté que possède chacun de lutter pour sa survie, mais c’est ce même instinct de conservation qui, éclairé quand même par le biais de la raison poussera l’homme à sacrifier cette liberté naturelle pour fonder la société civile. L’humanité ne peut progresser dans un sens général qui si règne la paix et la sécurité et seule l’institution du corps politique est à même de garantir ces conditions par le biais de règles sociales imposées par la collectivité à tous les membres du groupe sous forme de lois écrites. L’ensemble de ces règles sociales constitue le droit positif qui est l’ensemble de règles, de mœurs, usages, coutumes, etc. en vigueur dans une société donnée. Idéalement, le droit positif devrait être la traduction pure et simple de ce que l’on appelle le droit naturel qui est l’ensemble des prérogatives que tout homme est en droit de revendiquer en raison même de son appartenance à la nature ou à l’espèce humaine. Ainsi, Montesquieu dans De l’esprit des lois montre que, malgré la diversité des coutumes et des institutions, le droit positif doit être l’application du droit naturel c’est à dire qu’il doit appliquer des principes rationnels et universels adaptés aux conditions particulières de chaque pays : « la loi en général est la raison humaine. En tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que des cas particuliers où s’appliquent cette raison humaine «. Montesquieu veut affirmer contre ceux qui dénonceraient la diversité des conceptions du juste et de l’injuste, la rationalité essentielle de la loi. Les lois positives ne feraient alors que traduire des réalités d’équité qui leur préexistent. Cette théorie du droit naturel est historique et elle tente de répondre à une question qui, à partir du XVII° siècle devenait primordiale : « Quid joris = de quel droit ? « sous-entendu de quel droit le Droit ? Quel est le fondement du Droit ? Jusqu’au XVII° siècle on a considéré le droit comme émanent de Dieu, mais plus tard, lors de la remise en question de Dieu, la doctrine du droit naturel apparaît comme une solution à la question car, contrairement à la légitimité incertaine du droit positif, elle est une norme régulatrice, et contrairement à la diversité des systèmes des droit, elle est universelle. Cette doctrine a été un puissant levier de contestation du droit existant.

«
dialogue en confrontant les différents points de vue.
La philosophie est en fait non seulement le fait de
posséder un savoir, une connaissance, mais aussi une manière de vivre.
Ainsi, Socrate est-il un homme
vertueux et applique ses théories.
« Ce dont il faut faire le plus de cas, ce n'est pas de vivre, mais de vivre bien ».
Socrate.
Parce qu'il gênait les sophistes, il a été condamné à mort.
Plus tard, un de ses élèves a voulu laisser une trace
de lui et de sa morale : il s'agit de Platon.
Alors, il reprend sa philosophie morale, mais la prolonge : en
constatant que dans ce monde, tout est en perpétuel changement.
Plus tard, Héraclite dira : « Tout coule, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ».
En effet, ce
n'est plus la même eau, mais en plus, le baigneur a lui aussi changé.
Le paradoxe se situe d'ailleurs ici : nous
gardons toute notre vie la même identité, mais nous changeons constamment.
Platon donne la théorie du
monde des idées : derrière tout changement, il existe un monde stable : la preuve en est que pour nommer une
sensation éprouvée, il faut en avoir une idée bien précise.
Monde de l'Apparence : Monde de l'être :
Monde sensible ;
Monde des sens ;
Monde de l'opinion ;
Monde des préjugés.
Monde intelligible ;
Monde des Idées ;
C'est un monde de changement.
C'est un monde qui demeure.
Chez Platon, le monde de l'être existe.
Donc, comme le philosophe recherche la vérité, il veut atteindre le
monde intelligible et veut connaître l'origine de chaque chose, mais ne prétend pas la connaître, reprenant
l'idée de Socrate : « Je sais que je ne sais rien.
» qui par cette phrase, reconnaît qu'il ne sait rien et par
conséquent, qu'il est ouvert aux idées des autres.
Il a pris conscience que beaucoup de choses que nous
pensons ne sont en fait que des préjugés et c'est donc un premier pas vers la vérité.
èFinalement, la philosophie est née de l'étonnement, puisque le monde suscite un grand nombre de questions..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication de texte de Karl Jaspers: introduction à la philosophie(14/20)
- INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE DU XIXe SIECLE
- INTRODUCTION AU XVIIIe siècle en philosophie
- Introduction / De la philosophie politique
- René DESCARTES, Principes de la philosophie (1644) Introduction / Problématisation Dans ce texte, Descartes s’attaque à un problème classique : pourquoi nous trompons-nous ?