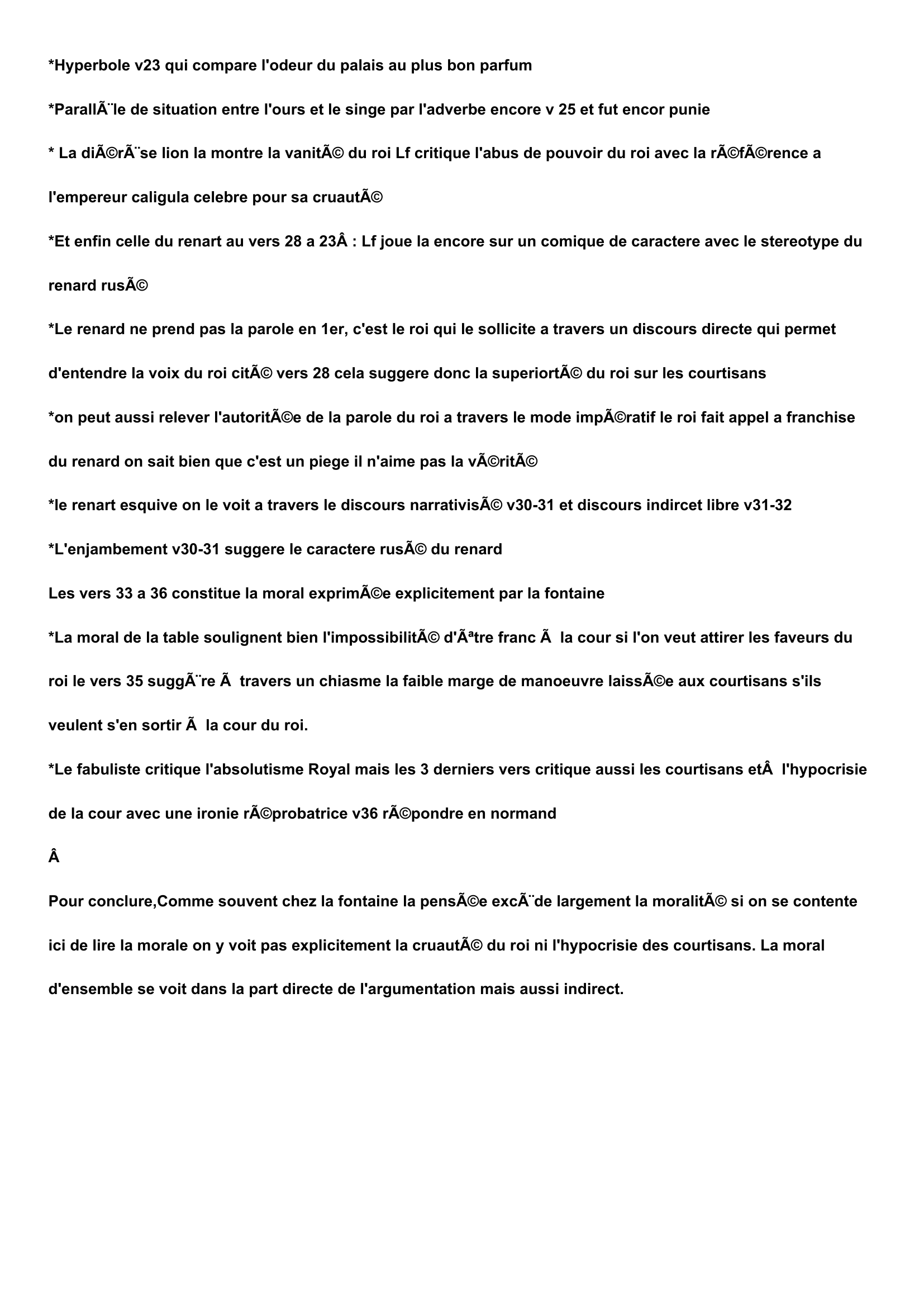Introduction : La fontaine est un écrivain du classicisme il écrit en 1678 son 2e recueil 10 ans après le premier.
Publié le 26/01/2020
Extrait du document
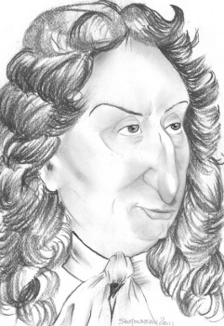
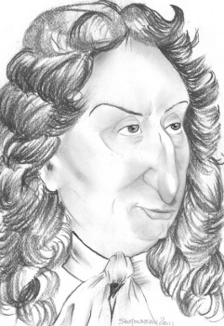
«
*Hyperbole v23 qui compare l'odeur du palais au plus bon parfum
*Parallèle de situation entre l'ours et le singe par l'adverbe encore v 25 et fut encor punie
* La diérèse lion la montre la vanité du roi Lf critique l'abus de pouvoir du roi avec la référence a
l'empereur caligula celebre pour sa cruauté
*Et enfin celle du renart au vers 28 a 23 : Lf joue la encore sur un comique de caractere avec le stereotype du
renard rusé
*Le renard ne prend pas la parole en 1er, c'est le roi qui le sollicite a travers un discours directe qui permet
d'entendre la voix du roi cité vers 28 cela suggere donc la superiorté du roi sur les courtisans
*on peut aussi relever l'autoritée de la parole du roi a travers le mode impératif le roi fait appel a franchise
du renard on sait bien que c'est un piege il n'aime pas la vérité
*le renart esquive on le voit a travers le discours narrativisé v30-31 et discours indircet libre v31-32
*L'enjambement v30-31 suggere le caractere rusé du renard
Les vers 33 a 36 constitue la moral exprimée explicitement par la fontaine
*La moral de la table soulignent bien l'impossibilité d'être franc à la cour si l'on veut attirer les faveurs du
roi le vers 35 suggère à travers un chiasme la faible marge de manoeuvre laissée aux courtisans s'ils
veulent s'en sortir à la cour du roi.
*Le fabuliste critique l'absolutisme Royal mais les 3 derniers vers critique aussi les courtisans et l'hypocrisie
de la cour avec une ironie réprobatrice v36 répondre en normand
Pour conclure,Comme souvent chez la fontaine la pensée excède largement la moralité si on se contente
ici de lire la morale on y voit pas explicitement la cruauté du roi ni l'hypocrisie des courtisans.
La moral
d'ensemble se voit dans la part directe de l'argumentation mais aussi indirect..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés ; par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l'abrégé de ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables », écrit La Fontaine dans sa Préface au premier recueil de ses Fables (1668). Trouve-t-on encore dans les Livres VII à XII de quoi justifier cette affirmation du fabuliste ?
- Parlant de Boileau, M. Kléber Haedens écrit : « Un Parisien casanier au sourire aigu, rompant avec les ennuyeux, pourchassant les ridicules, écrasant les médiocres, a guidé notre littérature au sommet de son royaume. Tout écrivain libre et fier a Boileau pour complice. Et si nous n'emportons pas ses oeuvres lorsque nous allons rêver sous les arbres, nous savons qu'il s'est battu pour la comédie la plus humaine et qu'il a protégé la naissance des poèmes tragiques les plus purs. Boileau
- Paul Valéry écrit dans le Préambule pour le Catalogue
- Jean-Claude Tournand écrit : «Il a fallu que s'élaborent au moyen d'une longue expérience les règles de chaque genre, que les écrivains apprennent à en dominer les contraintes et à conquérir à travers elles l'art de communiquer leurs plus intimes pensées. L'idéal classique exige à la fois une idée suffisamment claire pour être totalement communicable, et un langage suffisamment précis pour communiquer cette idée et elle seule : l'idée ne doit pas échapper au langage, mais le langage do
- A la fin de l'âge romantique, le grand critique russe Biélinski a affirmé que l'idéal, la beauté, la poésie n'avaient aucune place dans l'oeuvre d'art : seul importait qu'elle fût un fidèle miroir de la réalité. Cinquante ans plus tard, Anatole France écrit : « L'artiste doit aimer la vie et nous la montrer belle. Sinon nous en douterions. » A l'aide d'exemples empruntés à vos lectures, vous direz si, à votre avis, l'artiste, et spécialement l'écrivain doit nous présenter une image idé