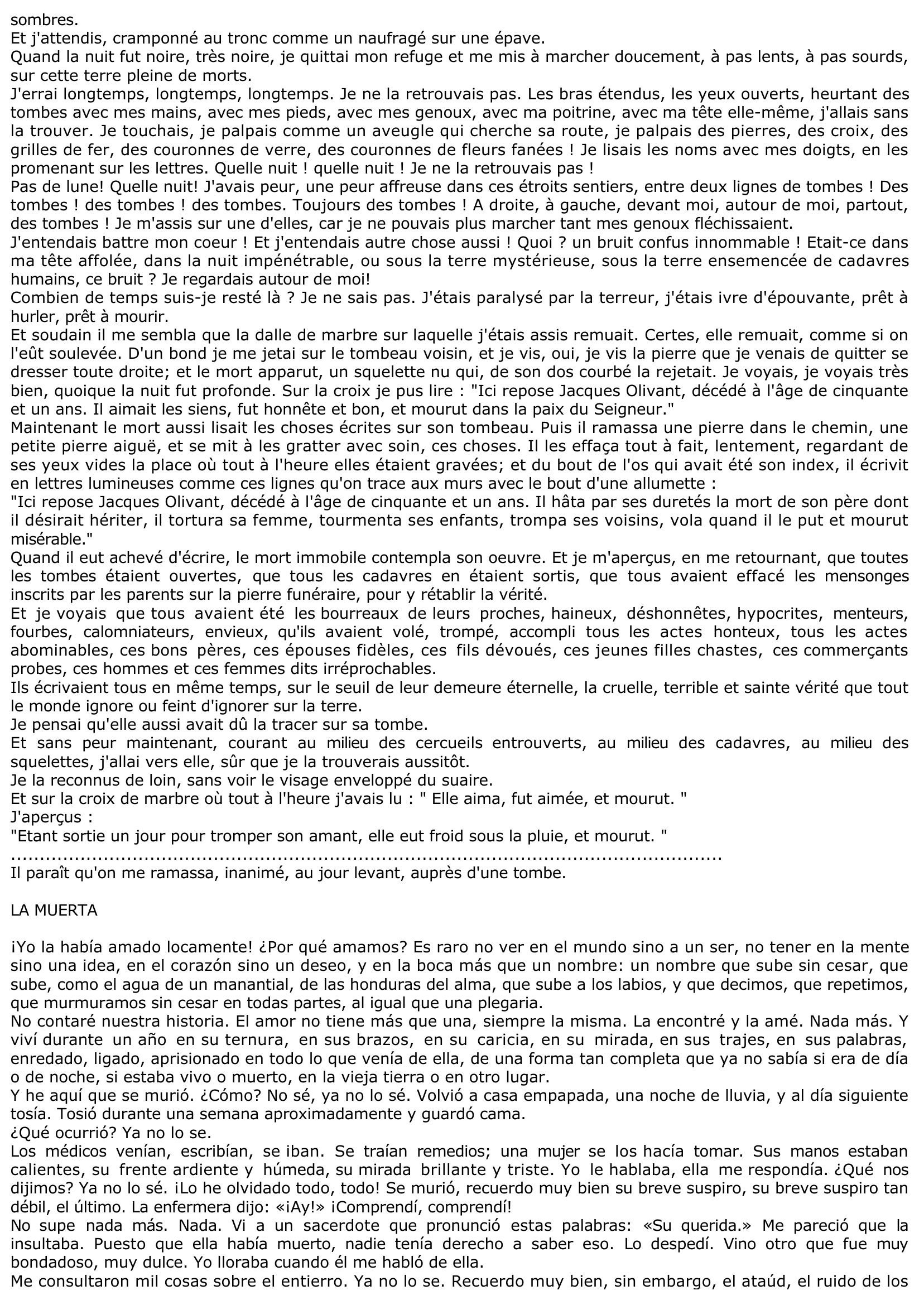LA MORTE
Publié le 07/03/2011

Extrait du document
«
sombres.Et j'attendis, cramponné au tronc comme un naufragé sur une épave.Quand la nuit fut noire, très noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lents, à pas sourds,sur cette terre pleine de morts.J'errai longtemps, longtemps, longtemps.
Je ne la retrouvais pas.
Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant destombes avec mes mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même, j'allais sansla trouver.
Je touchais, je palpais comme un aveugle qui cherche sa route, je palpais des pierres, des croix, desgrilles de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées ! Je lisais les noms avec mes doigts, en lespromenant sur les lettres.
Quelle nuit ! quelle nuit ! Je ne la retrouvais pas !Pas de lune! Quelle nuit! J'avais peur, une peur affreuse dans ces étroits sentiers, entre deux lignes de tombes ! Destombes ! des tombes ! des tombes.
Toujours des tombes ! A droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout,des tombes ! Je m'assis sur une d'elles, car je ne pouvais plus marcher tant mes genoux fléchissaient.J'entendais battre mon coeur ! Et j'entendais autre chose aussi ! Quoi ? un bruit confus innommable ! Etait-ce dansma tête affolée, dans la nuit impénétrable, ou sous la terre mystérieuse, sous la terre ensemencée de cadavreshumains, ce bruit ? Je regardais autour de moi!Combien de temps suis-je resté là ? Je ne sais pas.
J'étais paralysé par la terreur, j'étais ivre d'épouvante, prêt àhurler, prêt à mourir.Et soudain il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait.
Certes, elle remuait, comme si onl'eût soulevée.
D'un bond je me jetai sur le tombeau voisin, et je vis, oui, je vis la pierre que je venais de quitter sedresser toute droite; et le mort apparut, un squelette nu qui, de son dos courbé la rejetait.
Je voyais, je voyais trèsbien, quoique la nuit fut profonde.
Sur la croix je pus lire : "Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de cinquanteet un ans.
Il aimait les siens, fut honnête et bon, et mourut dans la paix du Seigneur."Maintenant le mort aussi lisait les choses écrites sur son tombeau.
Puis il ramassa une pierre dans le chemin, unepetite pierre aiguë, et se mit à les gratter avec soin, ces choses.
Il les effaça tout à fait, lentement, regardant deses yeux vides la place où tout à l'heure elles étaient gravées; et du bout de l'os qui avait été son index, il écriviten lettres lumineuses comme ces lignes qu'on trace aux murs avec le bout d'une allumette :"Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de cinquante et un ans.
Il hâta par ses duretés la mort de son père dontil désirait hériter, il tortura sa femme, tourmenta ses enfants, trompa ses voisins, vola quand il le put et mourutmisérable."Quand il eut achevé d'écrire, le mort immobile contempla son oeuvre.
Et je m'aperçus, en me retournant, que toutesles tombes étaient ouvertes, que tous les cadavres en étaient sortis, que tous avaient effacé les mensongesinscrits par les parents sur la pierre funéraire, pour y rétablir la vérité.Et je voyais que tous avaient été les bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs,fourbes, calomniateurs, envieux, qu'ils avaient volé, trompé, accompli tous les actes honteux, tous les actesabominables, ces bons pères, ces épouses fidèles, ces fils dévoués, ces jeunes filles chastes, ces commerçantsprobes, ces hommes et ces femmes dits irréprochables.Ils écrivaient tous en même temps, sur le seuil de leur demeure éternelle, la cruelle, terrible et sainte vérité que toutle monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre.Je pensai qu'elle aussi avait dû la tracer sur sa tombe.Et sans peur maintenant, courant au milieu des cercueils entrouverts, au milieu des cadavres, au milieu dessquelettes, j'allai vers elle, sûr que je la trouverais aussitôt.Je la reconnus de loin, sans voir le visage enveloppé du suaire.Et sur la croix de marbre où tout à l'heure j'avais lu : " Elle aima, fut aimée, et mourut.
"J'aperçus :"Etant sortie un jour pour tromper son amant, elle eut froid sous la pluie, et mourut.
"...........................................................................................................................Il paraît qu'on me ramassa, inanimé, au jour levant, auprès d'une tombe.
LA MUERTA
¡Yo la había amado locamente! ¿Por qué amamos? Es raro no ver en el mundo sino a un ser, no tener en la mentesino una idea, en el corazón sino un deseo, y en la boca más que un nombre: un nombre que sube sin cesar, quesube, como el agua de un manantial, de las honduras del alma, que sube a los labios, y que decimos, que repetimos,que murmuramos sin cesar en todas partes, al igual que una plegaria.No contaré nuestra historia.
El amor no tiene más que una, siempre la misma.
La encontré y la amé.
Nada más.
Yviví durante un año en su ternura, en sus brazos, en su caricia, en su mirada, en sus trajes, en sus palabras,enredado, ligado, aprisionado en todo lo que venía de ella, de una forma tan completa que ya no sabía si era de díao de noche, si estaba vivo o muerto, en la vieja tierra o en otro lugar.Y he aquí que se murió.
¿Cómo? No sé, ya no lo sé.
Volvió a casa empapada, una noche de lluvia, y al día siguientetosía.
Tosió durante una semana aproximadamente y guardó cama.¿Qué ocurrió? Ya no lo se.Los médicos venían, escribían, se iban.
Se traían remedios; una mujer se los hacía tomar.
Sus manos estabancalientes, su frente ardiente y húmeda, su mirada brillante y triste.
Yo le hablaba, ella me respondía.
¿Qué nosdijimos? Ya no lo sé.
¡Lo he olvidado todo, todo! Se murió, recuerdo muy bien su breve suspiro, su breve suspiro tandébil, el último.
La enfermera dijo: «¡Ay!» ¡Comprendí, comprendí!No supe nada más.
Nada.
Vi a un sacerdote que pronunció estas palabras: «Su querida.» Me pareció que lainsultaba.
Puesto que ella había muerto, nadie tenía derecho a saber eso.
Lo despedí.
Vino otro que fue muybondadoso, muy dulce.
Yo lloraba cuando él me habló de ella.Me consultaron mil cosas sobre el entierro.
Ya no lo se.
Recuerdo muy bien, sin embargo, el ataúd, el ruido de los.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse : Nature morte à l’échiquier, Lubin Baugin
- Media vita in morte sumus
- La Reine morte de Montherlant : l’œuvre théâtrale marquante
- SILVANIRE, OU LA MORTE VIVE (La) de Jean Mairet : Fiche de lecture
- REINE MORTE (La) d'Henry de Montherlant : Fiche de lecture