la sociologie
Publié le 31/12/2010

Extrait du document
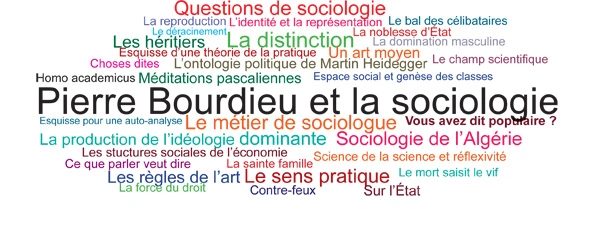
Marcel MAUSS et Paul Fauconnet
« La sociologie, objet et méthode «
Article « Sociologie « extrait de la Grande Encyclopédie,
vol. 30, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, Paris, 1901.
Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi
Courriel: [email protected]
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Cette édition électronique a été réalisée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi à partir de :
Article « Sociologie « extrait de la Grande Encyclopédie, vol. 30, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, Paris, 1901.
Polices de caractères utilisée :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5’’ x 11’’)
Édition complétée le 16 février 2002 à Chicoutimi, Québec.
Table des matières
La sociologie : objet et méthode (par Paul Fauconnet et Marcel Mauss) (1901)
Article « Sociologie « extrait de la Grande Encyclopédie, vol. 30, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, Paris, 1901.
Objet de la sociologie
Du phénomène social
De l’explication sociologique
Méthode de la sociologie
Définition
Observation des faits
Systématisation des faits
Caractères scientifique des hypothèses sociologiques
III. Divisions de la sociologie
La sociologie :
objet et méthode (1901) [1]
par Paul Fauconnet et Marcel Mauss
Retour à la table des matières
Mot créé par Auguste Comte pour désigner la science des sociétés. Quoique le mot fût formé d'un radical latin et d'une terminaison grecque et que pour cette raison les puristes aient longtemps refusé de le reconnaître, il a aujourd'hui conquis droit de cité dans toutes les langues européennes. Nous allons essayer de déterminer successivement l'objet de la sociologie et la méthode qu'elle emploie. Puis nous indiquerons les principales divisions de la science qui se constitue sous ce nom.
On remarquera sans peine que nous nous inspirons directement des idées qu'a exprimées Durkheim dans ses différents ouvrages. Si d'ailleurs nous les adoptons, ce n'est pas seulement parce qu'elles nous paraissent justifiées par des raisons théoriques, c'est encore qu'elles nous semblent exprimer les principes dont les diverses sciences sociales, au cours de leur développement, tendent à devenir de plus en plus conscientes.
I. OBJET DE LA SOCIOLOGIE
Parce que la sociologie est d'origine récente et qu'elle sort à peine de la période philosophique, il arrive encore qu'on en conteste la possibilité. Toutes les traditions métaphysiques qui font de l'homme un être à part, hors nature, et qui voient dans ses actes des faits absolument différents des faits naturels, résistent aux progrès de la pensée sociologique. Mais le sociologue n'a pas à justifier ses recherches par une argumentation philosophique. La science doit faire son œuvre dès le moment qu'elle en entrevoit la possibilité, et des théories philosophiques, même traditionnelles, ne sauraient constituer des objections à la légitimité de ses démarches. Si d'ailleurs, comme il est vraisemblable, l'étude scientifique des sociétés rend nécessaire une conception différente de la nature humaine, c'est à la philosophie qu'il appartient de se mettre en harmonie avec la science, à mesure que celle-ci obtient des résultats. Mais la science n'a pas plus à prévoir qu'à éviter ces conséquences lointaines de ses découvertes.
Tout ce que postule la sociologie, c'est simplement que les faits que l'on appelle sociaux sont dans la nature, c'est-à-dire sont soumis au principe de l'ordre et du déterminisme universels, par suite intelligibles. Or cette hypothèse n'est pas le fruit de la spéculation métaphysique; elle résulte d'une généralisation qui semble tout à fait légitime. Successivement cette hypothèse, principe de toute science, a été étendue à tous les règnes, même à ceux qui semblaient le plus échapper à ses prises : il est donc rationnel de supposer que le règne social - s'il est un règne qui mérite d'être appelé ainsi - ne fait pas exception. Ce n'est pas au sociologue à démontrer que les phéno mènes sociaux sont soumis à la loi : c'est aux adversaires de la sociologie à fournir la preuve contraire. Car, a priori, on doit admettre que ce qui s'est trouvé être vrai des faits physiques, biologiques et psychiques est vrai aussi des faits sociaux. Seul un échec définitif pourrait ruiner cette présomption logique. Or, dès aujourd'hui, cet échec n'est plus à craindre. Il n'est plus possible de dire que la science est tout entière à faire. Nous ne songeons pas à exagérer l'importance des résultats qu'elle a obtenus; mais enfin, en dépit de tous les scepticismes, elle existe et elle progresse : elle pose des problèmes définis et tout au moins elle entrevoit des solutions. Plus elle entre en contact avec les faits et plus elle voit se révéler des régularités insoupçonnées, des concordances beaucoup plus précises qu'on ne pouvait le supposer d'abord; plus, par conséquent, se fortifie le sentiment que l'on se trouve en présence d'un ordre naturel, dont l'existence ne peut plus être mise en doute que par des philosophes éloignés de la réalité dont ils parlent.
Mais si l'on doit admettre sans examen préalable que les faits appelés sociauxsont naturels, intelligibles et par suite objets de science, encore faut-il qu'il y ait des faits qui puissent être proprement appelés de ce nom. Pour qu'une science nouvelle se constitue, il suffit, mais il faut : d'une part, qu'elle s'applique à un ordre de faits nettement distincts de ceux dont s'occupent les autres sciences; d'autre part, que ces faits soient susceptibles d'être immédiatement reliés les uns aux autres, expliqués les uns par les autres, sans qu'il soit nécessaire d'intercaler des faits d'une autre espèce. Car une science qui ne pourrait expliquer les faits constituant son objet qu'en recou rant à une autre science se confondrait avec cette dernière. La sociologie satisfait-elle à cette double condition?
Du phénomène social
En premier lieu y a-t-il des faits qui soient spécifiquement sociaux? On le nie encore communément, et parmi ceux qui le nient figurent même des penseurs qui prétendent faire œuvre sociologique. L'exemple de Tarde est caractéristique. Pour lui, les faits dits sociaux ne sont autre chose que des idées ou des sentiments individuels, qui se seraient propagés par imitation. Ils n'auraient donc aucun caractère spécifique; car un fait ne change pas de nature parce qu'il est plus ou moins répété. Nous n'avons pas pour l'instant à discuter cette théorie; mais nous devons constater que, si elle est fondée, la sociologie ne se distingue pas de la psychologie individuelle, c'est-à-dire que toute matière manque pour une sociologie proprement dite. La même conclusion s'inspire, quelle que soit la théorie, du moment où l'on nie la spécificité des faits sociaux. On conçoit dès lors toute l'importance de la question que nous examinons.
Un premier fait est constant, c'est qu'il existe des sociétés, c'est-à-dire des agrégats d'êtres humains. Parmi ces agrégats, les uns sont durables, comme les nations, d'autres éphémères comme les foules, les uns sont très volumineux comme les gran des églises, les autres très petits comme la famille quand elle est réduite au couple conjugal. Mais, quelles que soient la grandeur et la forme de ces groupes et de ceux qu'on pourrait énumérer - classe, tribu, groupe professionnel, caste, commune - ils présentent tous ce caractère qu'ils sont formés par une pluralité de consciences indi vi duelles, agissant et réagissant les unes sur les autres. C'est à la présence de ces actions et réactions, de cesinteractions que l'on reconnaît les sociétés. Or la question est de savoir si, parmi les faits qui se passent au sein de ces groupes, il en est qui manifestent la nature du groupe en tant que groupe, et non pas seulement la nature des individus qui les composent, les attributs généraux de l'humanité. Y en a-t-il qui sont ce qu'ils sont parce que le groupe est ce qu'il est? A cette condition, et à cette condi tion seulement, il y aura une sociologie proprement dite; car il y aura alors une vie de la société, distincte de celle que mènent les individus ou plutôt distincte de celle qu'ils mèneraient s'ils vivaient isolés.
Or il existe bien réellement des phénomènes qui présentent ces caractères, seulement il faut savoir les découvrir. En effet, tout ce qui se passe dans un groupe social n'est pas une manifestation de la vie du groupe comme tel, et par conséquent n'est pas social, pas plus que tout ce qui se passe dans un organisme n'est proprement biologique. Non seulement les perturbations accidentelles et locales déterminées par des causes cosmiques, mais encore des événements normaux, régulièrement répétés, qui intéressent tous les membres du groupe sans exception, peuvent n'avoir aucune ment le caractère de faits sociaux. Par exemple tous les individus, à l'exception des malades, remplissent leurs fonctions organiques dans des conditions sensiblement identiques; il en est de même des fonctions psychologiques : les phénomènes de sensation, de représentation, de réaction ou d'inhibition sont les mêmes chez tous les membres du groupe, ils sont soumis chez tous aux mêmes lois que la psychologie recherche. Mais personne ne songe à les ranger dans la catégorie des faits sociaux malgré leur généralité. C'est qu'ils ne tiennent aucunement à la nature du groupement, mais dérivent de la nature organique et psychique de l'individu. Aussi sont-ils les mêmes, quel que soit le groupe auquel l'individu appartient. Si l'homme isolé était concevable, on pourrait dire qu'ils seraient ce qu'ils sont même en dehors de toute société. Si donc les faits dont les sociétés sont le théâtre ne se distinguaient les uns des autres que par leur degré de généralité, il n'y en aurait pas qu'on pût considérer comme des manifestations propres de la vie sociale, et dont on pût, par suite, faire l'objet de la sociologie.
Et pourtant l'existence de tels phénomènes est d'une telle évidence qu'elle a été signalée par des observateurs qui ne songeaient pas à la constitution d'une sociologie. On a remarqué bien souvent qu'une foule, une assemblée ne sentaient, ne pensaient et n'agissaient pas comme l'auraient fait les individus isolés; que les groupements les plus divers, une famille, une corporation, une nation avaient un « esprit «, un carac tère, des habitudes comme les individus ont les leurs. Dans tous les cas par consé quent on sent parfaitement que le groupe, foule ou société, a vraiment une nature propre, qu'il détermine chez les individus certaines manières de sentir, de penser et d'agir, et que ces individus n'auraient ni les mêmes tendances, ni les mêmes habitudes, ni les mêmes préjugés, s'ils avaient vécu dans d'autres groupes humains. Or cette conclusion peut être généralisée. Entre les idées qu'aurait, les actes qu'accom plirait un individu isolé et les manifestations collectives, il y a un tel abîme que ces dernières doivent être rapportées à une nature nouvelle, à des forces suigeneris : sinon, elles resteraient incompréhensibles.
Soient, par exemple, les manifestations de la vie économique des sociétés moder nes d'Occident : production industrielle des marchandises, division extrême du travail, échange international, association de capitaux, monnaie, crédit, rente, intérêt, salaire, etc. Qu'on songe au nombre considérable de notions, d'institutions, d'habitu des que supposent les plus simples actes d'un commerçant ou d'un ouvrier qui cherche à gagner sa vie; il est manifeste que ni l'un ni l'autre ne créent les formes que prend nécessairement leur activité : ni l'un ni l'autre n'inventent le crédit, l'intérêt, le salaire, l'échange ou la monnaie. Tout ce qu'on peut attribuer à chacun d'eux c'est une ten dance générale à se procurer les aliments nécessaires, à se protéger contre les intem péries, ou encore, si l'on veut, le goût de l'entreprise, du gain, etc. Même des sentiments qui semblent tout spontanés, comme l'amour du travail, de l'épargne, du luxe, sont en réalité, le produit de la culture sociale puisqu'ils font défaut chez certains peuples et varient infiniment, à l'intérieur d'une même société, selon les couches de la population. Or, à eux seuls, ces besoins détermineraient, pour se satisfaire, un petit nombre d'actes très simples qui contrastent de la manière la plus accusée avec les formes très complexes dans lesquelles l'homme économique coule aujourd'hui sa conduite. Et ce n'est pas seulement la complexité de ces formes qui témoigne de leur origine extra-individuelle, mais encore et surtout la manière dont elles s'imposent à l'individu. Celui-ci est plus ou moins obligé de s'y conformer. Tantôt c'est la loi même qui l'y contraint, ou la coutume tout aussi impérative que la loi. C'est ainsi que naguère l'industriel était obligé de fabriquer des produits de mesure et de qualité déterminées, que maintenant encore il est soumis à toutes sortes de règlements, que nul ne peut refuser de recevoir en paiement la monnaie légale pour sa valeur légale. Tantôt c'est la force des choses contre laquelle l'individu vient se briser s'il essaye de s'insurger contre elles : c'est ainsi que le commerçant qui voudrait renoncer au crédit, le producteur qui voudrait consommer ses propres produits, en un mot le travailleur qui voudrait recréer à lui seul les règles de son activité économique, se verrait condamné à une ruine inévitable.
Le langage est un autre fait dont le caractère social apparaît clairement : l'enfant apprend, par l'usage et par l'étude, une langue dont le vocabulaire et la syntaxe sont vieux de bien des siècles, dont les origines sont inconnues, qu'il reçoit par conséquent toute faite et qu'il est tenu de recevoir et d'employer ainsi, sans variations considé rables. En vain essayerait-il de se créer une langue originale : non seulement il ne pourrait aboutir qu'à imiter maladroitement quelque autre idiome existant, mais encore une telle langue ne saurait lui servir à exprimer sa pensée; elle le condamnerait à l'isolement et à une sorte de mort intellectuelle. Le seul fait de déroger aux règles et aux usages traditionnels se heurte le plus généralement à de très vives résistances de l'opinion. Car une langue n'est pas seulement un système de mots; elle a un génie particulier, elle implique une certaine manière de percevoir, d'analyser et de coordon ner. Par conséquent, par la langue, ce sont les formes principales de notre pensée que la collectivité nous impose.
Il pourrait sembler que les relations matrimoniales et domestiques sont nécessai rement ce qu'elles sont en vertu de la nature humaine, et qu'il suffit, pour les expliquer, de rappeler quelques propriétés très générales, organiques et psycho logiques, de l'individu humain. Mais, d'une part, l'observation historique nous apprend que les types de mariages et de familles ont été et sont encore extrêmement nombreux, variés; elle nous révèle la complication quelquefois extraordinaire des formes du mariage et des relations domestiques. Et, d'autre part, nous savons tous que les relations domestiques ne sont pas exclusivement affectives, qu'entre nous et des parents que nous pouvons ne pas connaître il existe des liens juridiques qui se sont noués sans notre consentement, à notre insu; nous savons que le mariage n'est pas seulement un accouplement, que la loi et les usages imposent à l'homme qui épouse une femme des actes déterminés, une procédure compliquée. Manifestement, ni les tendances organiques de l'homme à s'accoupler ou à procréer, ni même les sentiments de jalousie sexuelle ou de tendresse paternelle qu'on lui prêterait d'ailleurs gratuite ment, ne peuvent, à aucun degré, expliquer ni la complexité, ni surtout le caractère obligatoire des mœurs matrimoniales et domestiques.
De même les sentiments religieux très généraux qu'on a coutume de prêter à l'homme et même aux animaux - respect et crainte des êtres supérieurs, tourment de l'infini - ne pourraient engendrer que des actes religieux très simples et très indéter minés : chaque homme, sous l'empire de ces émotions, se représenterait à sa façon les êtres supérieurs et leur manifesterait ses sentiments comme il lui semblerait conve nable de le faire. Or une religion aussi simple, aussi indéterminée, aussi indivi duelle n'a jamais existé. Le fidèle croit à des dogmes et agit selon des rites entièrement compliqués, qui lui sont en outre inspirés par ]'Église, par le groupe religieux auquel il appartient; en général, il connaît très mal ces dogmes et ces rites, et sa vie religieuse consiste essentiellement dans une participation lointaine aux croyan ces et aux actes d'hommes spécialement chargés de connaître les choses sacrées et d'entrer en rapport avec elles; et ces hommes eux-mêmes n'ont pas inventé les dogmes ni les rites, la tradition les leur a enseignés et ils veillent surtout à les préserver de toute altération. Les sentiments individuels d'aucun des fidèles n'expliquent donc, ni le système complexe des représentations et des pratiques qui constitue une religion, ni l'autorité par laquelle ces manières de penser et d'agir s'imposent à tous les membres de l'Église.
Ainsi les formes suivant lesquelles se développe la vie affective, intellectuelle, active de l'individu, lui préexistent comme elles lui survivront. C'est parce qu'il est homme qu'il mange, pense, s'amuse, etc., mais s'il est déterminé à agir par des tendances qui lui sont communes avec tous les hommes, les formes précises que prend son activité à chaque moment de l'histoire dépendent de toutes autres conditions qui varient d'une société à une autre et changent avec le temps au sein d'une même société : c'est l'ensemble des habitudes collectives. Parmi ces habitudes il en est de différentes sortes. Les unes appellent la réflexion par suite de leur importance même. On en prend conscience et on les consigne dans des formules écrites ou orales qui expriment comment le groupe a l'habitude d'agir, et comment il exige que ses membres agissent; ces formules impératives ce sont les règles du droit, les maximes de la morale, les préceptes du rituel, les articles du dogme, etc. Les autres restent inexprimées et diffuses, plus ou moins inconscientes. Ce sont les coutumes, les mœurs, les superstitions populaires que l'on observe sans savoir qu'on y est tenu, ni même en quoi elles consistent exactement. Mais dans les deux cas, le phénomène est de même nature. Il s'agit toujours de manières d'agir ou de penser, consacrées par la tradition et que la société impose aux individus. Ces habitudes collectives et les transformations par lesquelles elles passent incessamment, voilà l'objet propre de la sociologie.
Il est d'ailleurs possible dès à présent de prouver directement que ces habitudes collectives sont les manifestations de la vie du groupe en tant que groupe. L'histoire comparée du droit, des religions, a rendu commune l'idée que certaines institutions forment avec certaines autres un système, que les premières ne peuvent se trans former sans que les secondes se transforment également. Par exemple, on sait qu'il existe des liens entre le totémisme et l'exogamie, entre l'une et l'autre pratique et l'organisation du clan; on sait que le système du pouvoir patriarcal est en relation avec le régime de la cité, etc. D'une façon générale, les historiens ont pris l'habitude de montrer les rapports que soutiennent les différentes institutions d'une même époque, de ne pas isoler une institution du milieu où elle est apparue. Enfin on est de plus en plus porté à chercher dans les propriétés d'un milieu social (volume, densité, mode de composition, etc.) l'explication des phénomènes généraux qui s'y produisent : on montre par exemple quelles modifications profondes l'agglomération urbaine apporte à une civilisation agricole, comment la forme de l'habitat conditionne l'organisation domestique. Or, si les institutions dépendent les unes des autres et dépendent toutes de la constitution du groupe social, c'est évidemment qu'elles expriment ce dernier. Cette interdépendance des phénomènes serait inexplicable s'ils étaient les produits de volontés particulières et plus ou moins capricieuses; elle s'explique au contraire s'ils sont les produits de forces impersonnelles qui dominent les individus eux-mêmes.
Une autre preuve peut être tirée de l'observation des statistiques. On sait que les chiffres qui expriment le nombre des mariages, des naissances, des suicides, des crimes dans une société, sont remarquablement constants ou que, s'ils varient, ce n'est pas par écarts brusques et irréguliers, mais généralement avec lenteur et ordre. Leur constance et leur régularité sont au moins égales à celle des phénomènes qui, comme la mortalité, dépendent surtout de causes physiques. Or il est manifeste que les causes qui poussent tel ou tel individu au mariage ou au crime sont tout à fait particulières et accidentelles; ce ne sont donc pas ces causes qui peuvent expliquer le taux du mariage ou du crime dans une société donnée. Il faut admettre l'existence de certains états sociaux, tout à fait différents des états purement individuels, qui conditionnent la nuptialité et la criminalité. On ne comprendrait pas, par exemple, que le taux du suicide fût uniformément plus élevé dans les sociétés protestantes que dans les sociétés catholiques, dans le monde commercial que dans le monde agricole, si l'on n'admettait pas qu'une tendance collective au suicide se manifeste dans les milieux protestants, dans les milieux commerciaux, en vertu de leur organisation même.
Il y a donc des phénomènes proprement sociaux, distincts de ceux qu'étudient les autres sciences qui traitent de l'homme, comme la psychologie : ce sont eux qui constituent la matière de la sociologie. Mais il ne suffit pas d'avoir établi leur existence par un certain nombre d'exemples et par des considérations générales. On voudrait encore connaître le signe auquel on peut les distinguer, de manière à ne pas risquer ni de les laisser échapper, ni de les confondre avec les phénomènes qui ressortissent à d'autres sciences. D'après ce qui vient d'être dit, la nature sociale a précisément pour caractéristique d'être comme surajoutée à la nature individuelle; elle s'exprime par des idées ou des actes qui, alors même que nous contribuons à les produire, nous sont tout entiers imposés du dehors. C'est ce signe d'extériorité qu'il s'agit de découvrir.
Dans un grand nombre de cas, le caractère obligatoire dont sont marquées les manières sociales d'agir et de penser est le meilleur des critères que l'on puisse souhaiter. Gravées au fond du -cœur ou exprimées dans des formules légales, spontanément obéies ou inspirées par voie de contrainte, une multitude de règles juridiques, religieuses et morales sont rigoureusement obligatoires. La plupart des individus y obéissent; même ceux qui les violent savent qu'ils manquent à une obligation; et, en tout cas, la société leur rappelle le caractère obligatoire de son ordre en leur infligeant une sanction. Quelles que soient la nature et l'intensité de la sanction, excommunication ou mort, dommages-intérêts ou prison, mépris public, blâme, simple notation d'excentricité, à des degrés divers et sous des formes diverses, le phénomène est toujours le même : le groupe proteste contre la violation des règles collectives de la pensée et de l'action. Or cette protestation ne peut avoir qu'un sens : c'est que les manières de penser et d'agir qu'impose le groupe sont des manières propres de penser et d'agir. S'il ne tolère pas qu'on y déroge, c'est qu'il voit en elles les manifestations de sa personnalité, et qu'en y dérogeant on la diminue, on la détruit. Et d'ailleurs si les règles de la pensée et de l'action n'avaient pas une origine sociale, d'où pourraient-elles venir? Une règle à laquelle l'individu se considère comme soumis ne peut être l'œuvre de cet individu : car toute obligation implique une autorité supé rieure au sujet obligé, et qui lui inspire le respect, élément essentiel du sentiment d'obligation. Si donc on exclut l'intervention d'êtres surnaturels, on ne saurait trouver, en dehors et au-dessus de l'individu, qu'une seule source d'obligation, c'est la société ou plutôt l'ensemble des sociétés dont il est membre.
Voilà donc un ensemble de phénomènes sociaux facilement reconnaissables et qui sont de première importance. Car le droit, la morale, la religion forment une partie notable de la vie sociale. Même dans les sociétés inférieures, il n'est guère de manifestations collectives qui ne rentrent dans une de ces catégories. L'homme n'y a pour ainsi dire ni pensée ni activité propres; la parole, les opérations économiques, le vêtement même y prennent souvent un caractère religieux, par conséquent obligatoire. Mais, dans les sociétés supérieures, il y a un grand nombre de cas où la pression sociale ne se fait pas sentir sous la forme expresse de l'obligation : en matière écono mique, juridique, voire religieuse, l'individu semble largement autonome.
Ce n'est pas que toute coercition soit absente : nous avons montré plus haut sous quels aspects elle se manifestait dans l'ordre économique et linguistique, et de combien il s'en fallait que l'individu fût libre en ces matières d'agir à sa guise. Cependant il n'y a pas d'obligation proclamée, pas de sanctions définies ; l'innovation, la dérogation ne sont pas prescrites en principe. Il est donc nécessaire de chercher un autre critère qui permette de distinguer ces habitudes dont la nature spéciale n'est pas moins incontestable, quoique moins immédiatement apparente.
Elle est incontestable en effet parce que chaque individu les trouve déjà formées et comme instituées, puisqu'il n'en est pas l'auteur, puisqu'il les reçoit du dehors, c'est donc qu'elles sont préétablies. Qu'il soit ou non défendu à l'individu de s'en écarter, elles existent déjà au moment où il se consulte pour savoir comment il doit agir; ce sont des modèles de conduite qu'elles lui proposent. Aussi les voit-on pour ainsi dire, à un moment donné, pénétrer en lui du dehors. Dans la plupart des cas, c'est par la voie de l'éducation, soit générale, soit spéciale, que se fait cette pénétration. C'est ainsi que chaque génération reçoit de son aînée les préceptes de la morale, les règles de la politesse usuelle, sa langue, ses goûts fondamentaux, de même que chaque travailleur reçoit de ses prédécesseurs les règles de sa technique professionnelle. L'éducation est précisément l'opération par laquelle l'être social est surajouté en chacun de nous à l'être individuel, l'être moral à l'être animal; c'est le procédé grâce auquel l'enfant est rapidement socialisé. Ces observations nous fournissent une caractéristique du fait social beaucoup plus générale que la précédente : sont sociales toutes les manières d'agir et de penser que l'individu trouve préétablies et dont la transmission se fait le plus généralement par la voie de l'éducation.
Il serait bon qu'un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble que le mot institutions serait le mieux approprié. Qu'est-ce en effet qu'une institution sinon un ensemble d'actes ou d'idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s'impose plus ou moins à eux? Il n'y a aucune raison pour réserver exclusivement, comme on le fait d'ordinaire, cette expression aux arrangements sociaux fondamen taux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques ou les organisations juridiques essentielles; car tous ces phénomènes sont de même nature et ne diffèrent qu'en degré. L'institution est en somme dans l'ordre social ce qu'est la fonction dans l'ordre biologique : et de même que la science de la vie est la science des fonctions vitales, la science de la société est la science des institutions ainsi définies.
Mais, dira-t-on, l'institution est le passé; c'est, par définition, la chose fixée, non la chose vivante. Il se produit à chaque instant dans les sociétés des nouveautés, depuis les variations quotidiennes de la mode jusqu'aux grandes révolutions politiques et morales. Mais tous ces changements sont toujours, à des degrés divers, des modi fications d'institutions existantes. Les révolutions n'ont jamais consisté dans la brusque substitution intégrale d'un ordre nouveau à l'ordre établi; elle ne sont jamais et ne peuvent être que des transformations plus ou moins rapides, plus ou moins complètes. Rien ne vient de rien : les institutions nouvelles ne peuvent être faites qu'avec les anciennes, puisque celles-ci sont les seules qui existent. Et par consé quent, pour que notre définition embrasse tout le défini, il suffit que nous ne nous en tenions pas à une formule étroitement statique, que nous ne restreignions pas la sociologie à l'étude de l'institution supposée immobile. En réalité l'institution ainsi conçue n'est qu'une abstraction. Les institutions véritables vivent, c'est-à-dire changent sans cesse : les règles de l'action ne sont ni comprises ni appliquées de la même façon à des moments successifs, alors même que les formules qui les expriment restent littéralement les mêmes. Ce sont donc les institutions vivantes, telles qu'elles se forment, fonctionnent et se transforment aux différents moments qui constituent les phénomènes proprement sociaux, objets de la sociologie.
Les seuls faits que l'on pourrait non sans raison regarder comme sociaux et qui, cependant, rentreraient difficilement dans la définition des institutions, sont ceux qui se produisent dans les sociétés sans institutions. Mais les seules sociétés sans institutions sont des agrégats sociaux ou bien instables et éphémères comme les foules, ou bien en cours de formation. Or des unes et des autres on peut dire qu'elles ne sont pas encore des sociétés proprement dites, mais seulement des sociétés en voie de devenir, avec cette différence que les unes sont destinées à aller jusqu'au bout de leur développement, à réaliser leur nature sociale, tandis que les autres disparaissent avant d'être parvenues a se constituer définitivement. Nous sommes donc ici sur les limites qui séparent le règne social des règnes inférieurs. Les phénomènes dont il s'agit sont en train de devenir sociaux plutôt qu'ils ne sont sociaux. Il n'est donc pas surprenant qu'ils ne puissent rentrer exactement dans les cadres d'aucune science. Certes la sociologie ne doit pas s'en désintéresser, mais ils ne constituent pas son objet propre. D'ailleurs, par l'analyse précédente, nous n'avons nullement cherché à découvrir une définition définitive et complète de tous les phénomènes sociaux. Il suffit d'avoir montré que des faits existent qui méritent d'être appelés ainsi et d'avoir indiqué quelques signes auxquels on peut reconnaître les plus importants d'entre eux. A ces critères, l'avenir en substituera bien certainement d'autres moins défectueux.
De l'explication sociologique
Ainsi la sociologie a un objet propre, puisqu'il y a des faits proprement sociaux; il nous reste à voir si elle satisfait à la seconde des conditions que nous avons indiquées, c'est-à-dire s'il y a un mode d'explication sociologique qui ne se confonde avec aucun autre. Le premier mode d'explication qui ait été méthodiquement appliqué à ces faits est celui qui a été pendant longtemps en usage dans ce qu'il est convenu d'appeler la philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire a été, en effet, la forme de spécu lation sociologique immédiatement antérieure à la sociologie proprement dite. C'est de la philosophie de l'histoire que la sociologie est née : Comte est le successeur immé diat de Condorcet, et lui-même a construit une philosophie de l'histoire plutôt qu'il n'a fait de découvertes sociologiques. Ce qui caractérise l'explication philosophi que, c'est qu'elle suppose l'homme, l'humanité en général prédisposée par sa nature à un développement déterminé dont on s'efforce de découvrir toute l'orientation par une investigation sommaire des faits historiques. Par principe et par méthode on néglige donc le détail pour s'en tenir aux lignes les plus générales. On ne cherche pas à expliquer pourquoi, dans telle espèce de sociétés, à telle époque de leur développe ment, on rencontre telle ou telle institution : on cherche seulement vers quel but se dirige l'humanité, on marque les étapes qu'on juge lui avoir été nécessaires pour se rapprocher de ce but.
Il est inutile de démontrer l'insuffisance d'une telle explication. Non seulement elle laisse de côté, arbitrairement, la majeure partie de la réalité historique, mais comme il n'est plus possible aujourd'hui de soutenir que l'humanité suive une voie unique et se développe dans un seul sens, tous ces systèmes se trouvent, par cela seul, privés de fondement. Mais les explications que l'on trouve encore aujourd'hui dans certaines doctrines sociologiques ne diffèrent pas beaucoup des précédentes, sauf peut-être en apparence. Sous prétexte que la société n'est formée que d'individus, c'est dans la nature de l'individu qu'on va chercher les causes déterminantes par lesquelles on essaie d'expliquer les faits sociaux. Par exemple Spencer et Tarde procèdent de cette façon. Spencer a consacré presque tout le premier volume de sa Sociologie à l'étude de l'homme primitif physique, émotionnel et intellectuel; c'est par les proprié tés de cette nature primitive qu'il explique les institutions sociales observées chez les peuples les plus anciens ou les plus sauvages, institutions qui se transforment ensuite au cours de l'histoire, suivant des lois d'évolution très générales. Tarde voit dans les lois de l'imitation les principes suprêmes de la sociologie : les phénomènes sociaux sont des modes d'action le plus souvent utiles, inventés par certains individus et imités par tous les autres. On retrouve le même procédé d'explication dans certaines sciences spéciales qui sont ou devraient être sociologiques. C'est ainsi que les écono mistes classiques trouvent, dans la nature individuelle de l'homo œconomicus, les principes d'une explication suffisante de tous les faits économiques : l'homme cherchant toujours le plus grand avantage au prix de la plus petite peine, les relations économiques devaient nécessairement être telles et telles. De même les théoriciens du droit naturel recherchent les caractères juridiques et moraux de la nature humaine, et les institutions juridiques sont à leurs yeux, des tentatives plus ou moins heureuses pour satisfaire les rigueurs de cette nature; l'homme prend peu à peu conscience de soi, et les droits positifs sont des réalisations approximatives du droit qu'il porte en soi.
L'insuffisance de ces solutions apparaît clairement dès qu'on a reconnu qu'il y a des faits sociaux, des réalités sociales, c'est-à-dire dès qu'on a distingué l'objet propre de la sociologie.
Si, en effet, les phénomènes sociaux sont les manifestations de la vie des groupes en tant que groupes, ils sont beaucoup trop complexes pour que des considérations relatives à la nature humaine en général puissent en rendre compte. Prenons de nou veau pour exemple les institutions du mariage et de la famille. Les rapports sexuels sont soumis à des règles très compliquées : l'organisation familiale, très stable dans une même société, varie beaucoup d'une société à une autre; en outre, elle est liée étroi te ment à l'organisation politique, à l'organisation économique qui, elles aussi, présentent des différences caractéristiques dans les diverses sociétés. Si ce sont là les phénomènes sociaux qu'il s'agit d'expliquer, des problèmes précis se posent : comment se sont formés les différents systèmes matrimoniaux et domestiques ? peut-on les rattacher les uns aux autres, distinguer des formes postérieures et des formes antérieures, les premières apparaissant comme le produit de la transformation des secondes? Si cela est possible, comment s'expliquer ces transformations, quelles en sont les conditions? Comment les formations de l'organisation familiale affectent-elles les organisations politiques et économiques? D'autre part, tel régime domestique une fois constitué, comment fonctionne-t-il? A ces questions, les sociologues qui demandent à la seule psychologie individuelle le principe de leurs explications, ne peuvent pas fournir de réponses. Ils ne peuvent, en effet, rendre compte de ces institu tions si multiples, si variées, qu'en les rattachant à quelques éléments très généraux de la constitution organico-psychique de l'individu : instinct sexuel, tendan ce à la possession exclusive et jalouse d'une seule femelle, amour maternel et pater nel, hor reur du commerce sexuel entre consanguins, etc. Mais de pareilles explica tions sont d'abord suspectes au point de vue purement philosophique : elles consistent tout simplement à attribuer à l'homme les sentiments que manifeste sa conduite, alors que ce sont précisément ces sentiments qu'il s'agirait d'expliquer; ce qui revient, en som me à expliquer le phénomène par les vertus occultes des substances, la flamme par le phlogistique et la chute des corps par leur gravité. En outre, elles ne détermi nent entre les phénomènes aucun rapport précis de coexistence ou de succession, mais les isolent arbitrairement et les présentent en dehors du temps et de l'espace, détachés de tout milieu défini. Quand bien même on considérerait comme une explication de la monogamie l'affirmation que ce régime matrimonial satisfait mieux qu'un autre les instincts humains ou concilie mieux qu'un autre la liberté et la dignité des deux époux, il resterait à chercher pourquoi ce régime apparaît dans telles sociétés plutôt que dans telles autres, à tel moment et non à tel autre du développement d'une société. En troisième lieu, les propriétés essentielles de la nature humaine sont les mêmes partout, à des nuances et à des degrés près. Comment pourraient-elles rendre compte des formes si variées qu'a prises successivement chaque institution. L'amour paternel et maternel, les sentiments d'affection filiale sont sensiblement identiques chez les primitifs et chez les civilisés; quel écart cependant il y a entre l'organisation primitive de la famille et son état actuel, et, entre ces extrêmes, que de changements se sont produits! Enfin les tendances indéterminées de l'homme ne sauraient rendre compte des formes si précises et si complexes sous lesquelles se présentent toujours les réalités historiques. L'égoïsme qui peut pousser l'homme à s'approprier les choses utiles n'est pas la source de ces règles si compliquées qui, a chaque époque de l'histoire, constituent le droit de propriété, règles relatives au fonds et à la jouissance, aux meubles et aux immeubles, aux servitudes, etc. Et pourtant le droit de propriétéin abstracto n'existe pas. Ce qui existe, c'est le droit de propriété tel qu'il est ou était organisé, dans la France contemporaine ou dans la Rome antique, avec la multitude des principes qui le déterminent. La sociologie ainsi entendue ne peut donc atteindre de cette manière que les linéaments tout à fait généraux, presque insaisissables à force d'indétermination des institutions. Si l'on adopte de tels principes, on doit confesser que la plus grande partie de la réalité sociale (tout le détail des institutions) demeure inexpliquée et inexplicable. Seuls les phénomènes que détermine la nature humaine en général, toujours identique dans son fonds, seraient naturels et intelligibles; tous les traits particuliers qui donnent aux institutions, suivant les temps et les lieux, leurs caractères propres, tout ce qui distingue les individualités sociales, est considéré comme artificiel et accidentel; on y voit, soit les résultats d'inventions fortuites, soit les produits de l'activité individuelle des législateurs, des hommes puissants dirigeant volontairement les sociétés vers des fins entrevues par eux. Et l'on est ainsi conduit à mettre hors de la science, comme inintelligibles, toutes les institutions très déter minées, c'est-à -dire les faits sociaux eux-mêmes, les objets propres de la science sociologique. Autant dire qu'on anéantit, avec l'objet défini d'une science sociale, la science sociale elle-même et qu'on se contente de demander à la philosophie et à la psychologie quelques indications très générales sur les destinées de l'homme vivant en société.
A ces explications qui se caractérisent par leur extrême généralité s'opposent celles qu'on pourrait appeler les explications proprement historiques : ce n'est pas que l'histoire n'en ait connu d'autres, mais celles dont nous allons parler se retrouvent exclusivement chez les historiens. Obligé par les conditions mêmes de son travail à s'attacher exclusivement à une société et à une époque déterminées, familier avec l'esprit, la langue, les traits de caractères particuliers de cette société et de cette époque, l'historien a naturellement une tendance à ne voir dans les faits que ce qui les distingue les uns des autres, ce qui leur donne une physionomie propre dans chaque cas isolé, en un mot ce qui les rend incomparables. Cherchant à retrouver la mentalité des peuples dont il étudie l'histoire, il est enclin à accuser d'inintelligence, d'incom pétence tous ceux qui n'ont pas, comme lui, vécu dans l'intimité de ces peuples. Par suite, il est porté à se défier de toute comparaison, de toute généralisation. Quand il étudie une institution, ce sont ses caractères les plus individuels qui attirent son attention, ceux qu'elle doit aux circonstances particulières dans lesquelles elle s'est constituée ou modifiée, et elle lui apparaît comme inséparable de ces circonstances. Par exemple la famille patriarcale sera une chose essentiellement romaine, la féoda lité, une institution spéciale à nos sociétés médiévales, etc. De ce point de vue les institutions ne peuvent être considérées que comme des combinaisons accidentelles et locales qui dépendent de conditions également accidentelles et locales. Tandis que les philosophes et les psychologues nous proposaient des théories soi-disant valables pour toute l'humanité, les seules explications que les historiens croient possibles ne s'appliqueraient qu'à telle société déterminée, considérée à tel moment précis de son évolution. On n'admet pas qu'il y ait de causes générales partout agissantes dont la recherche peut être utilement entreprise; on s'assigne pour tâche d'enchaîner des événements particuliers à des événements particuliers. En réalité, on suppose dans les faits une infinie diversité ainsi qu'une infinie contingence.
A cette méthode étroitement historique d'explication des faits sociaux, il faut d'abord opposer les enseignements dus à la méthode comparative : dès maintenant l'histoire comparée des religions, des droits et des mœurs a révélé l'existence d'ins
Liens utiles
- SES chapitre 2 sociologie: Quels sont les fondements du commerce International et de l'internationalisation de la production ?
- Intro a la sociologie
- sociologie anglo-saxone
- UE 1.1. S1 Psychologie, sociologie, anthropologie Les grands domaines de la psychologie
- PRINCIPES DE SOCIOLOGIE, Herbert Spencer (résumé)
