Le Réalisme: Courbet et Millet
Publié le 15/04/2013

Extrait du document
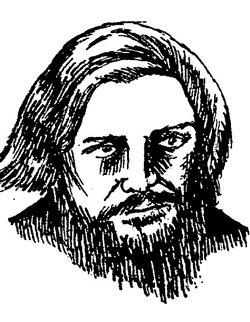
Introduction: Dans le cadre du voyage scolaire à Paris, Clarice et moi allons vous présenter deux courants: le Réalisme et le Naturalisme. Nous vous illustrerons ces courants à l'aide de deux peintres emblématiques Gustave Courbet et Jean-François Millet. Nous vous parlerons d'une période qui s'étend de 1850 jusqu'à la fin du XIXème siècle. Nous nous limiterons à vous parler exclusivement de la peinture et non de l'aspect littéraire. Pour commencer, nous vous décrirons le Réalisme avec ses origines et ses principaux représentants. Nous ferons de même pour le Naturalisme mais cela plus brièvement. Ensuite, nous analyserons chacune une oeuvre réaliste et nous terminerons par une brève synthèse des idées principales de notre exposé. Corps: Le Réalisme commence en France après la révolution en 1848 et se termine fin du XIXème siècle. Suite à cette révolution, les artistes se préoccupent de plus en plus de la véritable situation des ouvriers et des paysans. Le Réalisme est également une réaction au Romantisme, il s'oppose clairement à son idéalisme. Comment pourrions-nous définir le Réalisme ? Le Réalisme est une doctrine qui vise à décrire la réalité telle qu'elle est, sans la déformer notamment dans ses dimensions matérielles et sociales. Les peintres qui illustrent le mieux ce courant sont: Gustave COURBET, Jean-François MILLET, Honoré DAUMIER, Ernest MEISSONIER et Rosa BONHEUR. Le Naturalisme ne s'étend que de 1880 à 1900 contrairement au Réalisme qui s'étend sur une période beaucoup plus longue. Le Naturalisme est une forme de Réalisme encore plus poussée qui décrit la réalité telle qu'elle est, dans tous ses aspects, même les plus vulgaires. Une peinture illustrant parfaitement cette volonté de montrer la réalité sous tous ses aspects y compris les plus vulgaires est L'Origine du monde de Gustave COURBET. Nous avons choisis de ne pas vous la montrer pour des raisons de pudeur. Les peintres qui illustrent le mieux ce courant sont: Jean-Charles CAZIN et Bastien LEPAGE. Je vais céder la parole à Claire pour qu'elle puisse vous parler de son oeuvre. Je vais commencer par vous donner les informations les plus importantes sur la vie de Gustave Courbet à l'aide d'une ligne du temps. Biographie : Gustave Courbet est né à Ornans le 10 juin 1819. Agé d'à peine 18 ans, ce jeune homme s'installe à Besançon et suit une formation chez un ancien élève de David. Courbet comprend vite qu'il veut devenir artiste et arrête donc les études de droit en 1840. Ensuite, il étudie seul au Louvre et à l'académie Suisse. Il copie les maîtres du Louvre comme Hals, Rubens ou Rembrandt. Courbet découvre également Vélasquez et admire ses concitoyens Géricault et Delacroix. Il s'en inspira notamment pour les grands formats qu'utilisaient ces peintres romantiques. Ce jeune peintre expose régulièrement ses oeuvres au Salon malgré que peu d'entre elles soient exceptées. Il montre déjà toute son ambition de jouer un rôle au premier plan dans l'histoire de l'art. Courbet provoque le scandale avec certaines de ses oeuvres. En effet, il utilise de grands formats pour représenter des sujets banals alors que ces grands formats n'étaient jusque là réservés que pour des thèmes historiques.A la suite du Second Empire, il est élu Président de la Fédération des artistes. Courbet est arrêté et emprisonné en 1871 par les Versaillais accusé d'avoir participé à la démolition de la colonne Vendôme. Il est ensuite libéré et part s'installer en Suisse de peur d'être a nouveau emprisonné. L'Etat saisit les biens du peintre durant son exil. Gustave Courbet va finir par sombrer dans celui-ci et meurt à la Tour-de-Peilz le 31 décembre 1877, quelques jours après que son atelier de Paris soit dispersé en vente publique. L'oeuvre que j'ai choisis de vous analyser s'appelle Un enterrement à Ornans. Elle a été peinte vers 1850. Regardez ses dimensions. Quand nous irons au musée d'Orsay, nous constaterons que cette toile est immense. En effet, elle mesure plus de 3 mètres de haut et presque 7 mètres de large !Je vais tout de suite vous la décrire.Description : Un enterrement à Ornans : Il est difficile de savoir combien de plans figurent sur cette oeuvre. On pourrait penser qu'il en existe deux. Le premier qui comprend la fosse, le chien et les différentes personnes assistant à la scène et le second qui comprend le calvaire et les paysages de montagnes. En réalité, il existe bien trois plans. Le chien, l'homme d'Eglise, le fossoyeur et la fosse sont compris dans le premier plan. Au second plan, figurent les villageois d'Ornans. Le calvaire et les paysages de montagnes sont donc compris à l'arrière plan.Quand on regarde le tableau dans son ensemble, on peut remarquer que du coté droit du tableau du tableau les habitants d'Ornans, en grande majorité des femmes, sont tous habillés en noir, couleur sombre mis à part l'homme en turquoise. On peut aussi voir un chien blanc qui attire facilement l'attention dans cette PENOMBRE. Par contre du coté gauche du tableau, les couleurs sont plus diversifiées et il n'y a que des hommes. On peut aussi voir le curé d'Ornans accompagné d'un aide qui porte la croix et d'un sacristain. Les deux personnages en rouges sont des bedeaux qui aidaient à l'office et qui accomplissaient des tâches subalternes à l'Eglise. Passons maintenant à l'analyse de cette peinture. Analyse de l'oeuvre : Courbet veut représenter ce qu'il voit le plus fidèlement possible. C'est une négation de l'idéalisme. Il utilise une toile aux dimensions exceptionnelles, comme je vous l'ai dis tout à l'heure. Des tableaux aussi grands n'étaient jusque là réservés que pour représenter des scènes historiques ou religieuses. Courbet fait poser des habitants de son village pour pouvoir ensuite les peindre grandeur nature sur ce tableau. Plus de 40 personnages y sont représenté avec exactitude. Cela donne à la toile un aspect monumental. Tous ces personnages sont authentiques et jugés laids par certains, ce qui renforce le côté réaliste du tableau.Courbet représente un épisode banal, familier. La présence du chien marque bien la triste réalité de la scène. De plus, ce chien blanc est assez vite remarquable car il est placé devant des personnages portant des vêtements sombres, noirs. Après l'oeuvre Un enterrement à Ornans, je vais vous parler Des Glaneuses de Jean-François MILLET. Je vais d'abord vous décrire sa vie également à l'aide d'une ligne du temps. Biographie de J-F MILLET : Jean-François Millet naquit le 4 octobre 1814 à Gruchy et est mort le 20 janvier 1875 à Barbizon. Elevé dans une famille de paysans aisés, il est très vite passionné par le dessin et est envoyé à Cherbourg en 1833 où il étudiera les principes néo-classiques de David. En 1838, il obtient une bourse et part à Paris dans l'atelier du peintre d'histoire Paul Delaroche. Il peint surtout des portraits jusqu'aux alentours de 1842 où ses commandes vont diminuer. Il va alors favoriser les thèmes de la vie quotidienne du peuple à cette époque. En 1849, il s'enfuit de Paris et s'installe à Barbizon. C'est à partir de 1865 que les thèmes ruraux deviennent à la mode et que Millet connaîtra un grand succès (il reçoit d'ailleurs la Légion d'honneur en 1868). Etant malade, il refuse de décorer le Panthéon et meurt à Barbizon. Maintenant, je vais vous la décrire. Description : Des Glaneuses : Sur ce tableau nous pouvons observer deux plans: Au niveau du premier, nous pouvons observer trois paysannes dans les champs. Celles-ci sont courbées en train de travailler. Au niveau du second, nous pouvons percevoir au loin une ferme, des fermiers ainsi que de nombreuses meules de foins. Nous distinguons également un homme à cheval. Nous pouvons donc supposer que cette scène rurale se déroule fin de journée car la moisson est terminée. Je vais tout de suite vous analyser cette peinture, et ensuite je relèverai les différentes caractéristiques du mouvement. Analyse de l'oeuvre : Il aura fallut 10ans pour que MILLET peigne ce tableau. En effet, la précision des faits est une valeur chère aux peintres réalistes. En ce qui concerne les trois paysannes au premier plan: D'abord, l'action. Celles-ci sont en train de glaner (ramasser les épis après la moisson). Elles se contentent donc de ramasser les restes pour pouvoir se nourrir. Cette action illustre bien la situation misérable des personnes dans la campagne. Ces trois femmes ont chacune une position différente qui représentent en fait les trois mouvements principaux du glanage : -la paysanne située à gauche se baisse. -la paysanne située au centre ramasse les épis. -la paysanne située à droite se relève. Ensuite, leurs vêtements. Les paysannes portent des vêtements simples, ici des robes que portaient les classes inférieures à cette époque. C'est d'ailleurs un signe de pauvreté, en effet ces femmes n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se payer de belles robes comme les dames de la noblesse. En ce qui concerne le second plan: L'homme à cheval est présent pour vérifier si le travail de moisson est effectué convenablement et dans les règles. Cet homme nous rappelle que la société au 18ième siècle est bien hiérarchisée.
Liens utiles
- Gustave Courbet Le début du réalisme socialiste?
- Gustave Courbet et Jean-François Millet
- Le réalisme dans les contes voltairiens
- PROBLÈMES DU RÉALISME Georges Lukâcs (résumé)
- POUR UN RÉALISME SOCIALISTE. Louis Aragon
