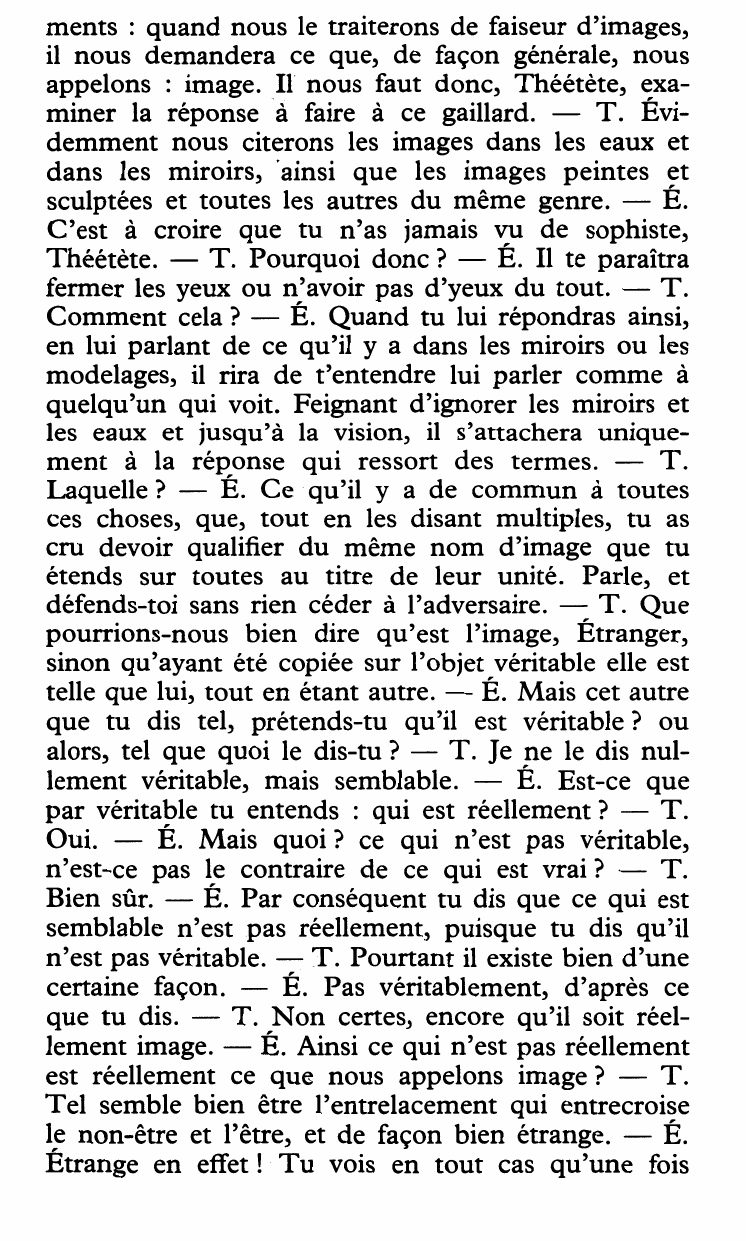qui produit aussi les vivants ?
Publié le 22/10/2012

Extrait du document
«
174 PLATON PAR LUI-MÊME
ments : quand nous le traiterons de faiseur d'images,
il nous demandera ce que, de façon générale, nous
appelons : image.
Il nous faut donc, Théétète, exa
miner la réponse à faire à ce gaillard.
- T.
Évi
demment nous citerons les images dans les eaux et
dans les miroirs, ·ainsi que les images peintes et
sculptées et toutes les autres du même genre.
-É.
C'est à croire que tu n'as jamais vu de sophiste,
Théétète.
- T.
Pourquoi donc? -É.
Il te paraîtra
fermer les yeux
ou n'avoir pas d'yeux du tout.
- T.
Comment cela ? - É.
Quand tu lui répondras ainsi,
en lui parlant de ce qu'il y a dans les miroirs ou les
modelages,
il rira de t'entendre lui parler comme à
quelqu'un qui voit.
Feignant d'ignorer les miroirs et
les eaux et jusqu'à la vision, il s'attachera unique
ment à la réponse qui ressort des termes.
- T.
Laquelle ? -É.
Ce qu'il y a de commun à toutes
ces choses, que,
tout en les disant multiples, tu as
cru devoir qualifier
du même nom d'image que tu
étends sur toutes au titre de leur unité.
Parle, et
défends-toi sans rien céder à l'adversaire.
- T.
Que
pourrions-nous bien dire qu'est l'image, Étranger,
sinon
qu'ayant été copiée sur l'objet véritable elle est
telle
que lui, tout en étant autre.
-É.
Mais cet autre
que tu dis tel, prétends-tu qu'il est véritable ? ou
alors, tel que quoi le dis-tu? - T.
Je ne le dis nul
lement véritable, mais semblable.
-É.
Est-ce
que
par véritable tu entends : qui est réellement? - T.
Oui.
-É.
Mais quoi? ce qui n'est pas véritable,
n'est-ce pas le contraire de ce
qui est vrai? - T.
Bien sûr.
-É.
Par conséquent tu dis que ce qui est
semblable
n'est pas réellement, puisque tu dis qu'il
n'est pas véritable.
- T.
Pourtant il existe bien d'une
certaine façon.
- É.
Pas véritablement, d'après ce
que tu dis.
- T.
Non certes, encore qu'il soit réel
lement
image.- É.
Ainsi ce qui n'est pas réellement
est réellement ce
que nous appelons image? - T.
Tel semble bien être l'entrelacement qui entrecroise
le non-être
et l'être, et de façon bien étrange.
-É.
Étrange
en effet ! Tu vois en tout cas qu'une fois.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- urée 1 PRÉSENTATION urée, composé cristallin incolore, produit d'excrétion de l'ammoniac issu de la dégradation des protéines chez les êtres vivants (voir métabolisme).
- Grand Oral – Svt Quels sont les conséquences de la prise d’un produit dopants sur l’organisme : exemple du Trenbolone
- L’éloquence est elle un don ou le produit d’un apprentissage ?
- La politique de produit
- Les êtres vivants et l'énergie Baleine à bosse bondissant hors de l'eau près des côtes d'Alaska, États-Unis.