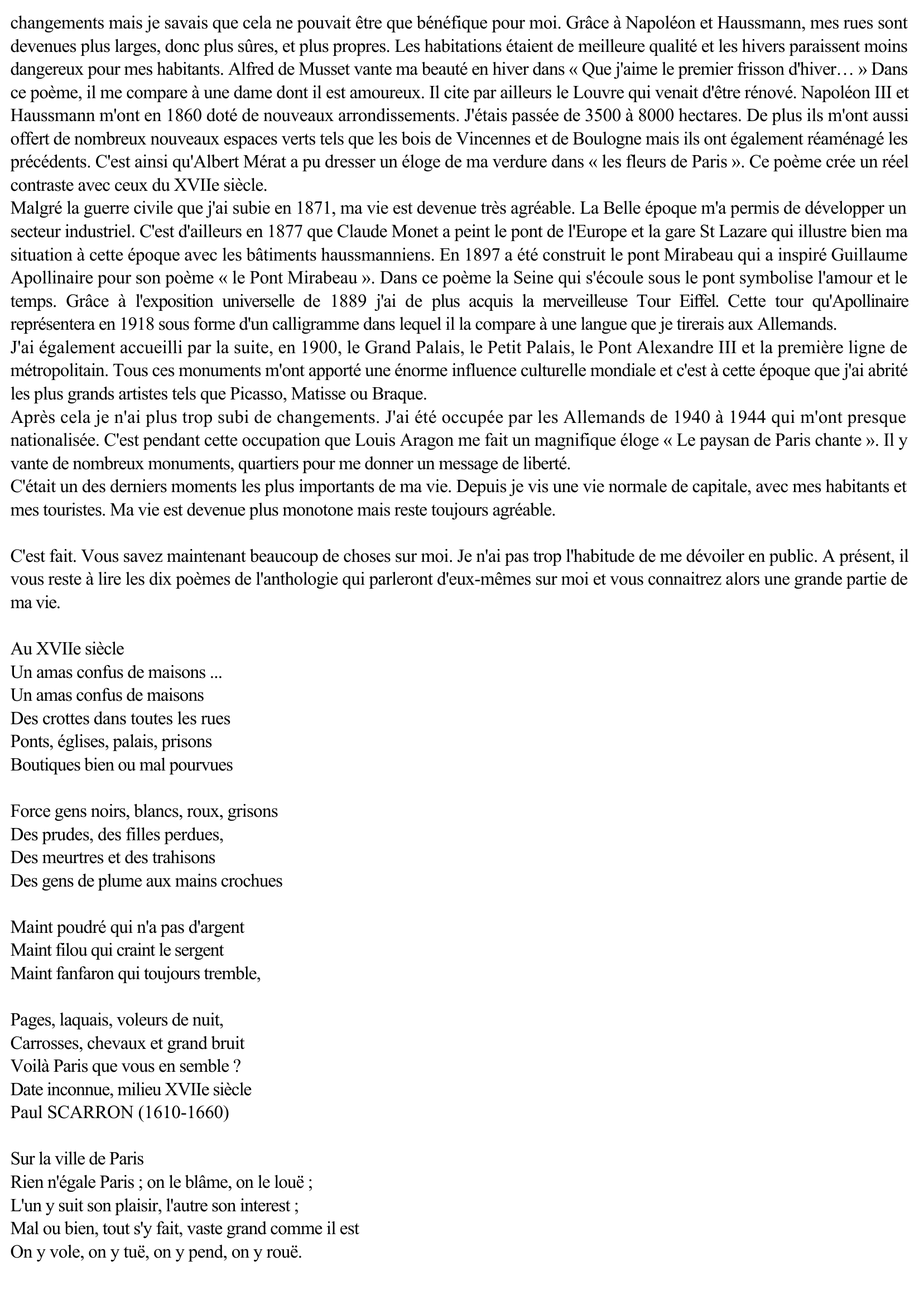Réaliser une anthologie de 10 poèmes autour d'un thème particulier, organisés logiquement, ainsi que la préface de cette anthologie.
Publié le 11/09/2006

Extrait du document
Anthologie : Paris en poèmes, du XVIIe au XXe siècle Claude Monet – Le pont de l’Europe, la gare Saint-Lazare Préface Je loge chez moi près de deux millions de personnes, qu’en moyenne vingt-six millions d’étrangers viennent me voir. Vous ne savez pas qui je suis ? Si je vous dis que malgré ma Défense, mon Sacré Cœur fait un Triomphe chez mes visiteurs qui après un petit Tour, admirent la beauté de mes Champs. J’imagine que vous aviez déjà deviné, je suis Paris. Pourquoi fais-je moi-même la préface d’une anthologie à mon sujet ? Parce que qui mieux que moi connait Paris ? Si vous ne me connaissez pas beaucoup, cette préface nous permettra de nous familiariser. Je me décrirai moi-même en un premier temps, puis je vous raconterai ce qui m’est arrivé ces 400 dernières années. Au cours de ma vie j’ai abrité de nombreux artistes comme Lully, Chopin, Hemingway, Balzac, Hugo, Monet, Picasso, Sartre, Prévert, Edith Piaf,… Ce n’est pas pour rien que je suis la capitale de la France. Sans vouloir me vanter, je me demande si l’on peut vraiment me qualifier de ville. Je vaux bien plus que cette simple nomenclature ! On me considère comme une mosaïque de quartiers, de cultures. Je ne suis pas comme toutes ces autres villes qui ne proposent que des activités urbaines ! Non, je suis aussi un assortiment d’espaces verts, du jardin des Plantes au parc de la Villette en passant par le bois de Vincennes. Je suis de plus un pôle culturel avec plus de 150 musées, plus de 58 bibliothèques, 3 opéras, plus de 115 théâtres, en j’en passe. J’ai toujours été un thème important en art que soit en littérature avec les Mystères de Paris d’Eugène Sue, les Misérables de Victor Hugo ou encore les Rougon-Macquart d’Emile Zola, mais aussi en peinture puisque j’ai servi de modèle pour Jean Baptiste Corot, Claude Monet, Camille Pissarro, Paul Gauguin et j’en oublie. J’ai également servi de décor pour le cinéma, ou le domaine de la photographie. En chanson je suis encore une fois un thème réitéré. Je ne veux pas passer pour une prétentieuse, mais on peut facilement dire que je suis une sorte de muse. Je pense que c’est dans le domaine de la poésie que j’apparais le plus souvent. Au fil du temps, de nombreux poèmes m’ont pour sujet. Je suis soit l’objet de blâmes, soit celui d’éloges. Et cela dépend en grande partie des époques. Si je vis aujourd’hui mon heure de gloire, ça n’a pas toujours été le cas. J’ai effectivement vécu une période sombre de ma vie du XVIIe jusqu’à la moitié du XIXe siècle. Mais ce n’est pas parce que j’en garde un mauvais souvenir que je veux l’oublier. C’est pourquoi j’ai décidé de regrouper une anthologie de dix poèmes organisés chronologiquement du XVIIe au XXe siècle qui retracent différentes étapes de ma vie. Ah le XVIIe siècle, c’est de loin la pire période de ma vie ! Avec la crise de 1648, j’étais ruinée, ma population affamée et la mortalité ne faisait qu’augmenter. Quel horrible souvenir ! L’insécurité régnait dans mes quartiers. Paul Scarron me traitait même « d’amas confus de maison « dans un sonnet de ce nom. Mais il avait raison, il est vrai que mes quartiers étaient sales et pauvres, que la criminalité était élevée. Isaac de Benserade pense la même chose à travers son sonnet « sur la ville de Paris «, dans le quel il critique aussi le fait que le roi ne siège pas chez moi. Je devais à peu près être peuplée de 400000 habitants mais je n’étais pas très grande à cet âge-là, la densité de population était très élevée. C’est cette forte densité que critique Nicolas Boileau dans « les embarras de Paris « en dénonçant également le bruit du à cette population et mon insécurité le soir. Ils me critiquaient tous mais ils avaient raison. Malgré l’obtention de nouveaux arrondissements en 1749, mon état ne s’était guère amélioré. La révolution de 1789 n’a pas été une période très agréable non plus. J’ai perdu de belles églises au profit de lotissements mal construits. J’étais impuissante. Lors de la prise du pouvoir de Napoléon Bonaparte, j’ai tout de même été la capitale de son empire. Après lui, ni Louis XVIII ni Charles X n’a su m’améliorer. C’est pourquoi j’ai encore reçu des critiques de poètes comme Auguste Barbier qui m’appelle en 1831 « la cuve « dans un poème éponyme. Il dénonce comme les poètes du XVIIe siècle mon hygiène et la mortalité qu’elle engendre, la corruption qui régnait chez moi ainsi que ma surpopulation. Alphonse Esquiros critique le nombre de mendiants et de prostituées que l’on pouvait trouver chez moi, mais également les exécutions publiques dans mes rues à travers son poème « Paris aux réverbères «. Ces poèmes hélas reflètent concrètement ma situation à cette époque. C’est pour cela que je les ai placé dans mon anthologie. Car même si j’ai honte de cette période, ces poèmes me décrivent de manière relativement réaliste. Heureusement, cette période n’a pas duré. Entre 1840 et 1844 Louis-Philippe m’a offert l’enceinte de Thiers. L’évènement qui, je pense, a le plus changé ma vie est ma modernisation sous Napoléon III. De 1852 à 1870 j’ai vécu une période travaux, de changements mais je savais que cela ne pouvait être que bénéfique pour moi. Grâce à Napoléon et Haussmann, mes rues sont devenues plus larges, donc plus sûres, et plus propres. Les habitations étaient de meilleure qualité et les hivers paraissent moins dangereux pour mes habitants. Alfred de Musset vante ma beauté en hiver dans « Que j’aime le premier frisson d’hiver… « Dans ce poème, il me compare à une dame dont il est amoureux. Il cite par ailleurs le Louvre qui venait d’être rénové. Napoléon III et Haussmann m’ont en 1860 doté de nouveaux arrondissements. J’étais passée de 3500 à 8000 hectares. De plus ils m’ont aussi offert de nombreux nouveaux espaces verts tels que les bois de Vincennes et de Boulogne mais ils ont également réaménagé les précédents. C’est ainsi qu’Albert Mérat a pu dresser un éloge de ma verdure dans « les fleurs de Paris «. Ce poème crée un réel contraste avec ceux du XVIIe siècle. Malgré la guerre civile que j’ai subie en 1871, ma vie est devenue très agréable. La Belle époque m’a permis de développer un secteur industriel. C’est d’ailleurs en 1877 que Claude Monet a peint le pont de l’Europe et la gare St Lazare qui illustre bien ma situation à cette époque avec les bâtiments haussmanniens. En 1897 a été construit le pont Mirabeau qui a inspiré Guillaume Apollinaire pour son poème « le Pont Mirabeau «. Dans ce poème la Seine qui s’écoule sous le pont symbolise l’amour et le temps. Grâce à l’exposition universelle de 1889 j’ai de plus acquis la merveilleuse Tour Eiffel. Cette tour qu’Apollinaire représentera en 1918 sous forme d’un calligramme dans lequel il la compare à une langue que je tirerais aux Allemands. J’ai également accueilli par la suite, en 1900, le Grand Palais, le Petit Palais, le Pont Alexandre III et la première ligne de métropolitain. Tous ces monuments m’ont apporté une énorme influence culturelle mondiale et c’est à cette époque que j’ai abrité les plus grands artistes tels que Picasso, Matisse ou Braque. Après cela je n’ai plus trop subi de changements. J’ai été occupée par les Allemands de 1940 à 1944 qui m’ont presque nationalisée. C’est pendant cette occupation que Louis Aragon me fait un magnifique éloge « Le paysan de Paris chante «. Il y vante de nombreux monuments, quartiers pour me donner un message de liberté. C’était un des derniers moments les plus importants de ma vie. Depuis je vis une vie normale de capitale, avec mes habitants et mes touristes. Ma vie est devenue plus monotone mais reste toujours agréable. C’est fait. Vous savez maintenant beaucoup de choses sur moi. Je n’ai pas trop l’habitude de me dévoiler en public. A présent, il vous reste à lire les dix poèmes de l’anthologie qui parleront d’eux-mêmes sur moi et vous connaitrez alors une grande partie de ma vie. Au XVIIe siècle Un amas confus de maisons ... Un amas confus de maisons Des crottes dans toutes les rues Ponts, églises, palais, prisons Boutiques bien ou mal pourvues Force gens noirs, blancs, roux, grisons Des prudes, des filles perdues, Des meurtres et des trahisons Des gens de plume aux mains crochues Maint poudré qui n'a pas d'argent Maint filou qui craint le sergent Maint fanfaron qui toujours tremble, Pages, laquais, voleurs de nuit, Carrosses, chevaux et grand bruit Voilà Paris que vous en semble ? Date inconnue, milieu XVIIe siècle Paul SCARRON (1610-1660) Sur la ville de Paris Rien n'égale Paris ; on le blâme, on le louë ; L'un y suit son plaisir, l'autre son interest ; Mal ou bien, tout s'y fait, vaste grand comme il est On y vole, on y tuë, on y pend, on y rouë. On s'y montre, on s'y cache, on y plaide, on y jouë ; On y rit, on y pleure, on y meurt, on y naist : Dans sa diversité tout amuse, tout plaist, Jusques à son tumulte et jusques à sa bouë. Mais il a ses défauts, comme il a ses appas, Fatal au courtisan, le roy n'y venant pas ; Avecque sûreté nul ne s'y peut conduire : Trop loin de son salut pour être au rang des saints, Par les occasions de pécher et de nuire, Et pour vivre long-temps trop prés des médecins. Date inconnue, milieu du XVIIe siècle Isaac de BENSERADE (1613-1691) Les embarras de Paris Qui frappe l'air, bon Dieu ! de ces lugubres cris ? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris ? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, Rassemble ici les chats de toutes les gouttières ? J'ai beau sauter du lit, plein de trouble et d'effroi, Je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moi : L'un miaule en grondant comme un tigre en furie ; L'autre roule sa voix comme un enfant qui crie. Ce n'est pas tout encor : les souris et les rats Semblent, pour m'éveiller, s'entendre avec les chats, Plus importuns pour moi, durant la nuit obscure, Que jamais, en plein jour, ne fut l'abbé de Pure. Tout conspire à la fois à troubler mon repos, Et je me plains ici du moindre de mes maux : Car à peine les coqs, commençant leur ramage, Auront des cris aigus frappé le voisinage Qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, Qu'éveillera bientôt l'ardente soif du gain, Avec un fer maudit, qu'à grand bruit il apprête, De cent coups de marteau me va fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, Les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir : Tandis que dans les airs mille cloches émues D'un funèbre concert font retentir les nues ; Et, se mêlant au bruit de la grêle et des vents, Pour honorer les morts font mourir les vivants. Encor je bénirais la bonté souveraine, Si le ciel à ces maux avait borné ma peine ; Mais si, seul en mon lit, je peste avec raison, C'est encor pis vingt fois en quittant la maison ; En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse D'un peuple d'importuns qui fourmillent sans cesse. L'un me heurte d'un ais dont je suis tout froissé ; Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. Là, d'un enterrement la funèbre ordonnance D'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance ; Et plus loin des laquais l'un l'autre s'agaçants, Font aboyer les chiens et jurer les passants. Des paveurs en ce lieu me bouchent le passage ; Là, je trouve une croix de funeste présage, Et des couvreurs grimpés au toit d'une maison En font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison. Là, sur une charrette une poutre branlante Vient menaçant de loin la foule qu'elle augmente ; Six chevaux attelés à ce fardeau pesant Ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant. D'un carrosse en tournant il accroche une roue, Et du choc le renverse en un grand tas de boue : Quand un autre à l'instant s'efforçant de passer, Dans le même embarras se vient embarrasser. Vingt carrosses bientôt arrivant à la file Y sont en moins de rien suivis de plus de mille ; Et, pour surcroît de maux, un sort malencontreux Conduit en cet endroit un grand troupeau de boeufs ; Chacun prétend passer ; l'un mugit, l'autre jure. Des mulets en sonnant augmentent le murmure. Aussitôt cent chevaux dans la foule appelés De l'embarras qui croit ferment les défilés, Et partout les passants, enchaînant les brigades, Au milieu de la paix font voir les barricades. On n'entend que des cris poussés confusément : Dieu, pour s'y faire ouïr, tonnerait vainement. Moi donc, qui dois souvent en certain lieu me rendre, Le jour déjà baissant, et qui suis las d'attendre, Ne sachant plus tantôt à quel saint me vouer, Je me mets au hasard de me faire rouer. Je saute vingt ruisseaux, j'esquive, je me pousse ; Guénaud sur son cheval en passant m'éclabousse, Et, n'osant plus paraître en l'état où je suis, Sans songer où je vais, je me sauve où je puis. Tandis que dans un coin en grondant je m'essuie, Souvent, pour m'achever, il survient une pluie : On dirait que le ciel, qui se fond tout en eau, Veuille inonder ces lieux d'un déluge nouveau. Pour traverser la rue, au milieu de l'orage, Un ais sur deux pavés forme un étroit passage ; Le plus hardi laquais n'y marche qu'en tremblant : Il faut pourtant passer sur ce pont chancelant ; Et les nombreux torrents qui tombent des gouttières, Grossissant les ruisseaux, en ont fait des rivières. J'y passe en trébuchant ; mais malgré l'embarras, La frayeur de la nuit précipite mes pas. Car, sitôt que du soir les ombres pacifiques D'un double cadenas font fermer les boutiques ; Que, retiré chez lui, le paisible marchand Va revoir ses billets et compter son argent ; Que dans le Marché-Neuf tout est calme et tranquille, Les voleurs à l'instant s'emparent de la ville. Le bois le plus funeste et le moins fréquenté Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté. Malheur donc à celui qu'une affaire imprévue Engage un peu trop tard au détour d'une rue ! Bientôt quatre bandits lui serrent les côtés : La bourse ! ... Il faut se rendre ; ou bien non, résistez, Afin que votre mort, de tragique mémoire, Des massacres fameux aille grossir l'histoire. Pour moi, fermant ma porte et cédant au sommeil, Tous les jours je me couche avecque le soleil ; Mais en ma chambre à peine ai-je éteint la lumière, Qu'il ne m'est plus permis de fermer la paupière. Des filous effrontés, d'un coup de pistolet, Ébranlent ma fenêtre et percent mon volet ; J'entends crier partout: Au meurtre ! On m'assassine ! Ou : Le feu vient de prendre à la maison voisine ! Tremblant et demi-mort, je me lève à ce bruit, Et souvent sans pourpoint je cours toute la nuit. Car le feu, dont la flamme en ondes se déploie, Fait de notre quartier une seconde Troie, Où maint Grec affamé, maint avide Argien, Au travers des charbons va piller le Troyen. Enfin sous mille crocs la maison abîmée Entraîne aussi le feu qui se perd en fumée. Je me retire donc, encor pâle d'effroi ; Mais le jour est venu quand je rentre chez moi. Je fais pour reposer un effort inutile : Ce n'est qu'à prix d'argent qu'on dort en cette ville. Il faudrait, dans l'enclos d'un vaste logement, Avoir loin de la rue un autre appartement. Paris est pour un riche un pays de Cocagne : Sans sortir de la ville, il trouve la campagne ; Il peut dans son jardin, tout peuplé d'arbres verts, Recéler le printemps au milieu des hivers ; Et, foulant le parfum de ses plantes fleuries, Aller entretenir ses douces rêveries. Mais moi, grâce au destin, qui n'ai ni feu ni lieu, Je me loge où je puis et comme il plaît à Dieu. Recueil :Satire VI 1866 Nicolas BOILEAU (1636-1711) Jusqu’au début du XIXe siècle La cuve Il est, il est sur terre une infernale cuve, On la nomme Paris ; c'est une large étuve, Une fosse de pierre aux immenses contours Qu'une eau jaune et terreuse enferme à triples tours C'est un volcan fumeux et toujours en haleine Qui remue à longs flots de la matière humaine ; Un précipice ouvert à la corruption, Où la fange descend de toute nation, Et qui de temps en temps, plein d'une vase immonde, Soulevant ses bouillons, déborde sur le monde. Là, dans ce trou boueux, le timide soleil Vient poser rarement un pied blanc et vermeil ; Là, les bourdonnements nuit et jour dans la brume Montent sur la cité comme une vaste écume ; Là, personne ne dort, là, toujours le cerveau Travaille, et, comme l'arc, tend son rude cordeau. On y vit un sur trois, on y meurt de débauche ; Jamais, le front huilé, la mort ne vous y fauche, Car les saints monuments ne restent dans ce lieu Que pour dire : Autrefois il existait un Dieu. Là, tant d'autels debout ont roulé de leurs bases, Tant d'astres ont pâli sans achever leurs phases, Tant de cultes naissants sont tombés sans mûrir, Tant de grandes vertus, là, s'en vinrent pourrir, Tant de chars meurtriers creusèrent leur ornière, Tant de pouvoirs honteux rougirent la poussière, De révolutions au vol sombre et puissant Crevèrent coup sur coup leurs nuages de sang, Que l'homme, ne sachant où rattacher sa vie, Au seul amour de l'or se livre avec furie. Misère ! Après mille ans de bouleversements, De secousses sans nombre et de vains errements, De cultes abolis et de trônes superbes Dans les sables perdus et couchés dans les herbes, Le Temps, ce vieux coureur, ce vieillard sans pitié, Qui va par toute terre écrasant sous le pié Les immenses cités regorgeantes de vices, Le Temps, qui balaya Rome et ses immondices, Retrouve encore, après deux mille ans de chemin, Un abîme aussi noir que le cuvier romain. Toujours même fracas, toujours même délire, Même foule de mains à partager l'empire ; Toujours même troupeau de pâles sénateurs, Mêmes flots d'intrigants et de vils corrupteurs, Même dérision du prêtre et des oracles, Même appétit des jeux, même soif des spectacles ; Toujours même impudeur, même luxe effronté, Dans le haut et le bas même immoralité, Mêmes débordements, mêmes crimes énormes, Moins l'air de l'Italie et la beauté des formes. La race de Paris, c'est le pâle voyou Au corps chétif, au teint jaune comme un vieux sou ; C'est cet enfant criard que l'on voit à toute heure Paresseux et flânant, et loin de sa demeure Battant les maigres chiens, ou le long des grands murs Charbonnant en sifflant mille croquis impurs ; Cet enfant ne croit pas, il crache sur sa mère, Le nom du ciel pour lui n'est qu'une farce amère ; C'est le libertinage enfin en raccourci ; Sur un front de quinze ans c'est le vice endurci. Et pourtant il est brave, il affronte la foudre, Comme un vieux grenadier il mange de la poudre, Il se jette au canon en criant : Liberté ! Sous la balle et le fer il tombe avec beauté. Mais que l'Emeute aussi passe devant sa porte, Soudain l'instinct du mal le saisit et l'emporte, Le voilà grossissant les bandes de vauriens, Molestant le repos des tremblants citoyens, Et hurlant, et le front barbouillé de poussière, Prêt à jeter à Dieu le blasphème et la pierre. Ô race de Paris, race au coeur dépravé, Race ardente à mouvoir du fer ou du pavé ! Mer, dont la grande voix fait trembler sur les trônes, Ainsi que des fiévreux, tous les porte-couronnes ! Flot hardi qui trois jours s'en va battre les cieux, Et qui retombe après, plat et silencieux ! Race unique en ce monde ! effrayant assemblage Des élans du jeune homme et des crimes de l'âge ; Race qui joue avec le mal et le trépas, Le monde entier t'admire et ne te comprend pas ! Il est, il est sur terre une infernale cuve, On la nomme Paris ; c'est une large étuve, Une fosse de pierre aux immenses contours Qu'une eau jaune et terreuse enferme à triples tours C'est un volcan fumeux et toujours en haleine Qui remue à longs flots de la matière humaine ; Un précipice ouvert à la corruption, Où la fange descend de toute nation, Et qui de temps en temps, plein d'une vase immonde, Soulevant ses bouillons, déborde sur le monde. Recueil : Iambes et Poèmes 1831 Auguste BARBIER (1805-1882) Paris aux réverbères Quid Romae faciam ? ( JUVENAL) Paris dort : avez-vous, nocturne sentinelle, Gravi, minuit sonnant, le pont de la Tournelle, C'est de là que l'on voit Paris de fange imbu ; Et comme un mendiant ivre près d'une cuve Le géant est qui ronfle et qui râle, et qui cuve Le vin ou le sang qu'il a bu. C'était donc aujourd'hui fête à la guillotine ; Un homme, ce matin, dressait une machine Sur la place où là-bas le sang est mal lavé, Au peuple qui hurlait comme autour d'une orgie, Le bourreau las jetait avec sa main rougie Une tête sur le pavé. Et puis voici surgir la vieille cathédrale Avec son front rugueux et son bourdon qui râle ; Comme un large vaisseau portant l'humanité Déployant ses deux mâts, avançant sa carène, Elle semble être prête, en labourant l'arène, A partir pour l'éternité ! Entendez-vous dans l'ombre aboyer les cerbères J'aime à voir dans les flots briller les réverbères ; C'est un concert de nuit ; c'est la grande cité, Avec ses yeux de feu, qui de loin me regarde. C'est la voix d'une ronde ou le fusil d'un garde Qui passe dans I'obscurité. Pendant que je suis là, que de haine assouvie ; C'est le fils, du linceul couvrant sa mère en vie, Le vieux magicien interrogeant l'enfer, La veuve qui poursuit quelque passant qui rôde, Et se vautre avec lui dans la couche encor chaude D'un époux qui vivait hier. Mais, atome perdu dans la cité béante, Je suis seul ; pas de main à ma main suppliante Ne s'unit ; non, pour moi, pas de souffle embaumé, Pas de regard de miel, pas une lèvre rose, Pas de sein où mon front fatigué se repose, Et je mourrai sans être aimé ! Si, du pont dans les flots, ma tête la première Tombait ; des bateliers, quand viendra la lumière Porteraient à la morgue un cadavre inconnu ; Et demain seulement, ma pauvre et vieille mère, En roulant dans les yeux une douleur amère, Se pencherait sur mon corps nu ! Une voix par-derrière, en riant me tutoie, Un bras lascif et nu dans l'ombre me coudoie, Une femme, en passant, que je n'ose toucher, Plus vile sous mes pieds que la fange du monde, Avec un sein qui gonfle, avec un rire immonde, Me dit : "Ange, viens donc coucher." Ô profanation ! Quelle pensée amère ! L'amour, ce don du ciel, qui se vend à l'enchère, On n'a plus pour dormir d'ombre sur les chemins Au lieu d'un papillon, on prend une chenille, On ne peut rien toucher, ni la fleur, ni la fille, Sans avoir de la boue aux mains. Oh ! que Paris est laid ! Sous ses sombres nuages Que j'ai souvent rêvé de longs et beaux voyages ! J'aimerais tant le ciel, les palmiers d'Orient, La gazelle qui fuit à l'ombre des platanes Et sous un dais brodé les magiques sultanes Qui regardent en souriant. Ou dans un vieux donjon, ma muse chatelaine Vide près du foyer sa coupe de vin pleine ; J'ai des vassaux, le soir, qui parlent du vieux temps, Un ami vient s'asseoir près de l'âtre fidèle. Je vois à ma fenêtre un nid où l'hirondelle Doit revenir pour le printemps. Dans un monde encor vierge, aux champs d'Océanie, Je voudrais promener ma fortune bannie ; Moi je suis fils des eaux, de l'orage et des vents ; Je voudrais, habitant d'une cité flottante, Vivre au milieu d'un fleuve et déployer ma tente Sur les joncs et les flots mouvants. Vains rêves ! Pour voler, mon coursier n'a pas d'aile, Personne ne voudra me prendre en sa nacelle ; L'argent, froid positif, m'enchaîne sur ces bords ; On ne peut pas franchir l'océan à la nage, Et les flots, sans salaire, au milieu de l'orage, Ne voiturent que les corps morts. Lors je me prends d'amour pour les blanches étoiles, Je regarde la lune au fond d'un ciel sans voiles ; Je rêve à la nature et dans l'ombre à pas lent, Plus heureux que celui que le remords agite, En grelottant de froid je regagne mon gîte Et prends pitié de l'opulent. Si vous voulez savoir où loge le poète Allez à Saint-Gervais, l'église où le vent fouette ; Regardez devant vous cette maison en deuil, Bien pauvre et bien vilaine où, comme lui, Voltaire Travaillait pour gagner quelques pouces de terre Entre la gloire et le cercueil. C'est là, voyez-vous bien, c'est là que loin du monde Il tient son coeur exempt de tout contact immonde ; C'est là qu'il faut monter pour lui serrer la main, Car sa porte est toujours ouverte à la jeunesse, Et comme Diogène il cherche, en sa détresse. Un homme dans le genre humain. Recueil : Les Hirondelles (1834) Alphonse ESQUIROS (1814-1876) Premières modernisations de Napoléon III et de Haussmann au milieu du XIXe siècle Sonnet : Que j'aime le premier frisson d'hiver ... Que j'aime le premier frisson d'hiver ! le chaume, Sous le pied du chasseur, refusant de ployer ! Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume, Au fond du vieux château s'éveille le foyer ; C'est le temps de la ville. - Oh ! lorsque l'an dernier, J'y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme, Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume (J'entends encore au vent les postillons crier), Que j'aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine Sous ses mille falots assise en souveraine ! J'allais revoir l'hiver. - Et toi, ma vie, et toi ! Oh ! dans tes longs regards j'allais tremper mon âme Je saluais tes murs. - Car, qui m'eût dit, madame, Que votre cœur sitôt avait changé pour moi ? Alfred de MUSSET (1810-1857) (Recueil : Premières poésies) 1852 Les fleurs de paris A Sully Prudhomme. Pour faire tous les coeurs contents Avril revient. C'est le printemps Qui pleure, qui rit et barbotte, Et qui, chargé de falbalas, Nous offre ses premiers lilas "Fleurissez-vous ! deux sous la botte !" Puis, comme un rêve parfumé, Les petites roses de mai, Et les dernières violettes, Avec les frais muguets des bois, Pareils à des chapeaux chinois Qui feraient trembler leurs clochettes ; Les seringas et les oeillets, Points rouges, blancs et violets, Fleurs en boutons et fleurs écloses, Les bluets comme dans les blés, Et les coquelicots mêlés Aux résédas parmi les roses... Car les jardins, les bois, les champs, Qui connaissent bien nos penchants, Ayant des fleurs, nous les envoient. Ils en gardent toujours assez. Nous marchons à pas trop pressés ; Il est bon que nos yeux les voient. Que le pavé soit sec ou gras, Jonchant les charrettes à bras, Déjà souffrantes et pâlies, Elles embaument, voulant bien Ne rien coûter ou presque rien, Bien que nous les trouvions jolies. Frêles, elles mourront demain Dans l'eau d'un vase, ou dans la main Distraite et blanche d'une femme, Et, bienfaisantes pour chacun, En rendant un dernier parfum, Elles exhaleront leur âme. Recueil : Tableaux parisiens 1880 Albert MERAT (1840-1909) La Belle Epoque, début du XXe siècle Le Pont Mirabeau Sous le pont Mirabeau coule la Seine Et nos amours Faut-il qu'il m'en souvienne La joie venait toujours après la peine Vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont je demeure Les mains dans les mains restons face à face Tandis que sous Le pont de nos bras passe Des éternels regards l'onde si lasse Vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont je demeure L'amour s'en va comme cette eau courante L'amour s'en va Comme la vie est lente Et comme l'Espérance est violente Vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont je demeure Passent les jours et passent les semaines Ni temps passé Ni les amours reviennent Sous le pont Mirabeau coule la Seine Vienne la nuit sonne l'heure Les jours s'en vont je demeure 1913 Guillaume Apollinaire (1880 - 1918) Guillaume Apollinaire 1918 Pendant l’occupation allemande, 1940-1944 Le paysan de Paris chante I Comme on laisse à l'enfant pour qu'il reste tranquille Des objets sans valeur traînant sur le parquet Peut-être devinant quel alcool me manquait Le hasard m'a jeté des photos de ma ville Les arbres de Paris ses boulevards ses quais Paris rêve et jamais il n'est plus redoutable Plus orageux jamais que muet mais rêvant De ce rêve des ponts sous leurs arches de vent De ce rêve aux yeux blancs qu'on voit aux dieux des fables De ce rêve mouvant dans les yeux des vivants Qui n'a pas vu le jour se lever sur la Seine Ignore ce que c'est que ce déchirement Quand prise sur le fait la nuit qui se dément Se défend se défait les yeux rouges obscène Et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant Toute aube est pour quelqu'un la peine capitale À vivre condamné que le sommeil trompa Et la réalité trace avec son compas Ce triste trait de craie à l'orient des Halles Les contes ténébreux ne le dépassent pas Paris s'éveille et moi pour retrouver ces mythes Qui nous brûlaient le sang dans notre obscurité Je mettrai dans mes mains mon visage irrité Que renaisse le chant que les oiseaux imitent Et qui répond Paris quand on dit liberté II C'est un pont que je vois si je clos mes paupières La Seine y tourne avec ses tragiques totons O noyés dans ses bras noueux comment dort-on C'est un pont qui s'en va dans ses loges de pierre Des repos arrondis en forment les festons Un roi de bronze noir à cheval le surmonte Et l'île qu'il franchit a double floraison Pour verdure un jardin pour roses des maisons On dirait un bateau sur son ancre de fonte Que font trembler les voitures de livraison L'aorte du Pont Neuf frémit comme un orchestre Où j'entends préluder le vin de mes vingt ans Il souffle un vent ici qui vient des temps d'antan Mourir dans les cheveux de la statue équestre La ville comme un coeur s'y ouvre à deux battants Sachant qu'il faut périr les garçons de mon âge Mirage se leurraient d'une ville au ciel gris Nous derniers nés d'un siècle et ses derniers conscrits Les pieds pris dans la boue et la tête aux nuages Nous attendions l'heure H en parlant de Paris Quand la chanson disait Tu reverras Paname Ceux qu'un oeillet de sang allait fleurir tantôt Quelque part devant Saint-Mihiel ou Neufchâteau Entourant le chanteur comme des mains la flamme Sentaient frémir en eux la pointe du couteau Depuis lors j'ai toujours trouvé dans ce que j'aime Un reflet de ma ville une ombre dans ses rues Monuments oubliés passages disparus J'ai plus écrit de toi Paris que de moi-même Et plus qu'en mon soleil en toi Paris j'ai cru La mort est un miroir la mort a ses phalènes Ma vie à ses deux bouts le même feu s'est mis Pour la seconde fois le monstre m'a vomi Je suis comme Jonas sortant de la baleine Mais j'ai perdu mon ciel ma ville et mes amis III C'est Paris ce théâtre d'ombres que je porte Mon Paris qu'on ne peut tout à fait m'avoir pris Pas plus qu'on ne peut prendre à des lèvres leur cri Que n'aura-t-il fallu pour m'en mettre à la porte Arrachez-moi le coeur vous y verrez Paris C'est de ce Paris-là que j'ai fait mes poèmes Mes mots sont la couleur étrange de ces toits La gorge des pigeons y roucoule et chatoie J'ai plus écrit de toi Paris que de moi-même Et plus que de vieillir souffert d'être sans toi Une chanson qui dit un mal inguérissable Plus triste qu'à minuit la Place d'Italie Pareille au Point-du-Jour pour la mélancolie Plus de rêves aux doigts que le marchand de sable Annonçant le plaisir comme un marchand d'oublies Une chanson vulgaire et douce où la voix baisse Comme un amour d'un soir doutant du lendemain Une chanson qui prend les femmes par la main Une chanson qu'on dit sous le métro Barbès Et qui change à l'Étoile et descend à Jasmin Le vent murmurera mes vers aux terrains vagues Il frôlera les bancs où nul ne s'est assis On l'entendra pleurer sur le quai de Passy Et les ponts répétant la promesse des bagues S'en iront fiancés aux rimes que voici 1943 Louis Aragon (1897-1982)
«
changements mais je savais que cela ne pouvait être que bénéfique pour moi.
Grâce à Napoléon et Haussmann, mes rues sontdevenues plus larges, donc plus sûres, et plus propres.
Les habitations étaient de meilleure qualité et les hivers paraissent moinsdangereux pour mes habitants.
Alfred de Musset vante ma beauté en hiver dans « Que j'aime le premier frisson d'hiver… » Dansce poème, il me compare à une dame dont il est amoureux.
Il cite par ailleurs le Louvre qui venait d'être rénové.
Napoléon III etHaussmann m'ont en 1860 doté de nouveaux arrondissements.
J'étais passée de 3500 à 8000 hectares.
De plus ils m'ont aussioffert de nombreux nouveaux espaces verts tels que les bois de Vincennes et de Boulogne mais ils ont également réaménagé lesprécédents.
C'est ainsi qu'Albert Mérat a pu dresser un éloge de ma verdure dans « les fleurs de Paris ».
Ce poème crée un réelcontraste avec ceux du XVIIe siècle.Malgré la guerre civile que j'ai subie en 1871, ma vie est devenue très agréable.
La Belle époque m'a permis de développer unsecteur industriel.
C'est d'ailleurs en 1877 que Claude Monet a peint le pont de l'Europe et la gare St Lazare qui illustre bien masituation à cette époque avec les bâtiments haussmanniens.
En 1897 a été construit le pont Mirabeau qui a inspiré GuillaumeApollinaire pour son poème « le Pont Mirabeau ».
Dans ce poème la Seine qui s'écoule sous le pont symbolise l'amour et letemps.
Grâce à l'exposition universelle de 1889 j'ai de plus acquis la merveilleuse Tour Eiffel.
Cette tour qu'Apollinairereprésentera en 1918 sous forme d'un calligramme dans lequel il la compare à une langue que je tirerais aux Allemands.J'ai également accueilli par la suite, en 1900, le Grand Palais, le Petit Palais, le Pont Alexandre III et la première ligne demétropolitain.
Tous ces monuments m'ont apporté une énorme influence culturelle mondiale et c'est à cette époque que j'ai abritéles plus grands artistes tels que Picasso, Matisse ou Braque.Après cela je n'ai plus trop subi de changements.
J'ai été occupée par les Allemands de 1940 à 1944 qui m'ont presquenationalisée.
C'est pendant cette occupation que Louis Aragon me fait un magnifique éloge « Le paysan de Paris chante ».
Il yvante de nombreux monuments, quartiers pour me donner un message de liberté.C'était un des derniers moments les plus importants de ma vie.
Depuis je vis une vie normale de capitale, avec mes habitants etmes touristes.
Ma vie est devenue plus monotone mais reste toujours agréable.
C'est fait.
Vous savez maintenant beaucoup de choses sur moi.
Je n'ai pas trop l'habitude de me dévoiler en public.
A présent, ilvous reste à lire les dix poèmes de l'anthologie qui parleront d'eux-mêmes sur moi et vous connaitrez alors une grande partie dema vie.
Au XVIIe siècleUn amas confus de maisons ...Un amas confus de maisonsDes crottes dans toutes les ruesPonts, églises, palais, prisonsBoutiques bien ou mal pourvues
Force gens noirs, blancs, roux, grisonsDes prudes, des filles perdues,Des meurtres et des trahisonsDes gens de plume aux mains crochues
Maint poudré qui n'a pas d'argentMaint filou qui craint le sergentMaint fanfaron qui toujours tremble,
Pages, laquais, voleurs de nuit,Carrosses, chevaux et grand bruitVoilà Paris que vous en semble ?Date inconnue, milieu XVIIe sièclePaul SCARRON (1610-1660)
Sur la ville de ParisRien n'égale Paris ; on le blâme, on le louë ;L'un y suit son plaisir, l'autre son interest ;Mal ou bien, tout s'y fait, vaste grand comme il estOn y vole, on y tuë, on y pend, on y rouë..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Préface D'Une Anthologie De Poèmes Engagés Sur Le Thème De L'Écologie
- Préface D'Une Anthologie De Poèmes Thème: L'Amour
- Confectionnez une anthologie de 5 poèmes autour d’un thème de votre choix. Les poèmes doivent être choisis à partir des Cahiers de Douai (1870) et de Poésies (1870-71) d’Arthur Rimbaud. Expliquez vos choix : comment Rimbaud poètes de 17 ans, traite-t-il ce thème ? qu’en dit-il ? sur quel ton ? par quels procédés ? quel sentiments le poète cherche-t-il à susciter ?...
- Préface d'une anthologie poétique sur le thème de la fuite du temps
- Préface anthologie de poèmes. Lien Poéme/Musique