thérèse raquin
Publié le 11/02/2013

Extrait du document
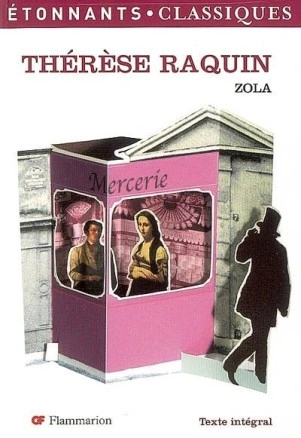
''Thérèse Raquin'' (1867) roman d'Émile ZOLA (240 pages) pour lequel on trouve un résumé puis un commentaire (page 3) enfin l'étude de la fin du roman (page 4) Bonne lecture ! Résumé Thérèse Raquin est la fille d'un capitaine français qui était en Algérie et d'une indigène. À l'âge de deux ans, il l'emmena en France, chez sa s?ur, femme au visage gras et placide qui vit à Vernon, pour qu'elle s'occupe d'elle parce que sa mère était morte. Madame Raquin a un fils, Camille, qui, les cheveux d'un blond terne, le visage couvert de taches de rousseur, est lymphatique et maladif. Elle éleva Thérèse dans l'unique pensée d'en faire l'infirmière puis l'épouse de son fils. Thérèse partagea son existence, même si, de tempérament nerveux, elle supportait mal la vie cloîtrée qu'on l'obligeait à mener. Quand elle eut vingt et un ans, Madame Raquin les maria. Mais Camille étant resté chétif, faible de constitution et d'allure languissante, était peu attirant, ressemblait toujours à un enfant malade et gâté, prématurément épuisé. Huit jours après le mariage, il eut assez de la province, et voulut aller vivre à Paris pour travailler dans une grande administration. Madame Raquin y trouva, passage du Pont- Neuf, sinistre galerie souterraine sombre et humide, une boutique de mercerie et un appartement où ils s'installèrent tous les trois, Thérèse ayant l'impression qu'on l'y enterrait. Camille trouva vite un travail dans l'administration du chemin de fer d'Orléans. Pour Thérèse, commence une vie monotone rythmée tous les jeudis soir par la visite de quatre invités, toujours les mêmes : un ami de Madame Raquin, le vieux Michaud, qui, maintenant à la retraite, était commissaire de police à Vernon, son fils, Olivier, qui travaille à la préfecture de police, sa femme, Suzanne, et Grivet, un employé du chemin de fer d'Orléans dont Camille a fait la connaissance au travail. On boit du thé, et on joue aux dominos. Thérèse déteste ces soirées. Un jeudi soir, Camille amène un nouvel invité, Laurent, qui est, lui aussi, employé au chemin de fer après avoir essayé de vivre de sa peinture. Il est paresseux, mais de tempérament sanguin. Il fait un portait de Camille qui n'est pas très bien réussi parce qu'il représente un noyé plutôt que le jeune homme tellement les couleurs sont ternes. Mais celui-ci le trouve très bien. Un jour que Laurent se trouve seul avec Thérèse, il l'embrasse. Après quelques instants, elle se laisse faire, voyant s'éveiller sa sensualité dans ses bras. Pendant huit mois, les deux amants se rencontrent régulièrement dans la chambre de Thérèse, lui inventant des prétextes pour quitter le travail pendant le jour, elle disant à sa tante qu'elle se sent mal. Mais voilà que le patron de Laurent lui interdit de quitter le travail pendant le jour. Pendant deux semaines, ils ne se voient pas. Un soir, Thérèse invente un prétexte pour sortir de la maison. Chez Laurent, elle a l'idée de tuer Camille. Trois semaines plus tard, un jeudi soir, Michaud raconte l'histoire d'un meurtre qu'on n'a jamais pu punir. Un mois plus tard, Laurent, Thérèse et Camille vont se promener à Saint- Ouen. Avant de manger, Laurent a l'idée de faire un tour en barque, et, au moment d'y monter, il annonce à Thérèse qu'il va tuer Camille. Quand ils arrivent au milieu de la Seine où personne ne peut les voir, il saisit Camille, et, même si celui-ci qui, soudain, a de la force, lui mord le cou, il l'étrangle et le jette par dessus bord. Quand il est noyé, Laurent fait chavirer la barque, et appelle à l'aide. Aux canotiers qui viennent à leur secours, il prétend que c'est un accident, et on le croit. Laurent et Thérèse vont ensuite chez les Michaud leur raconter ce qui s'est passé. Les canotiers confirment qu'il s'agit d'un accident, prétendant même avoir vu la scène. Madame Raquin est extrêmement choquée par la mort de Camille. Pour être sûr qu'il est bien mort, Laurent se rend pendant plus d'une semaine à la morgue, jusqu'au jour où il voit le corps extrêmement gonflé parce qu'il était resté près de deux semaines dans l'eau. Ensuite, Laurent revient souvent, le soir, à la boutique pour s'occuper des deux femmes, Thérèse jouant la comédie de la «veuve inconsolée«. Les soirées du jeudi reprennent. Quinze mois passent pendant lesquels Thérèse se met à faire des lectures exagérément sentimentales qui la font tomber dans une sorte de «rêverie vague«. Mais elle assume le crime mieux que Laurent qui, bourrelé par le remords, est de plus en plus tourmenté par le souvenir du crime, est hanté par le spectre de Camille, d'autant plus que la morsure à son cou ne disparaît pas. Thérèse souffre d'insomnies. Quelque temps plus tard, Michaud, pensant qu'elle aurait besoin d'un nouveau mari, trouve que Laurent est l'homme idéal. Celui-ci fait semblant de se laisser convaincre par Michaud. La nuit des noces, Laurent et Thérèse ne peuvent pas dormir. Ils croient que le fantôme de Camille est dans leur chambre. Cela se produit chaque nuit. Laurent croit même que le mort est entré dans le chat. Chaque fois qu'ils veulent se reposer, le cadavre de Camille est entre eux. Quatre mois plus tard, Laurent quitte son travail pour se remettre à la peinture. Après quelques portraits, il remarque qu'il dessine toujours Camille, et il y renonce. Madame Raquin devient paralysée et muette. Un soir, pendant une crise de nerfs, Laurent révèle le secret du meurtre devant elle qui, le jeudi suivant, essaie de dire la vérité aux invités ; mais, comme d'habitude, ils interprètent mal ses intentions. La vie de Thérèse et de Laurent devient un enfer : leurs nerfs se détraquent, toutes leurs disputes finissent par des coups. Battre Thérèse soulage Laurent, et, comme il déteste particulièrement le chat, il le tue. Madame Raquin pleure le chat presque autant qu'elle a pleuré Camille. Après six mois de mariage, Laurent et Thérèse ont l'intention de s'assassiner mutuellement. Laurent achète du poison, Thérèse cache un couteau. Un jeudi, quand les invités sont partis, Laurent verse du poison dans un verre d'eau destiné à Thérèse, tandis qu'elle prend le couteau. Quand ils voient ce qu'ils veulent faire, ils se suicident en buvant chacun la moitié du verre. Madame Raquin, qui assiste au dénouement, savoure le spectacle de leur double mort, et, sa paralysie l'ayant rendue puissante, elle survit à la disparition de tous les siens. Commentaire Cette première grande ?uvre de Zola fut l'aboutissement de dix années de lectures, de réflexions, d'essais. Elle a pour épigraphe la formule de Taine qu'il avait écrite dans l'introduction de son "Histoire de la littérature anglaise" : «Le vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et le sucre«. Cette référence scientifique fut affirmée dans la préface : « J'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères [...] des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang [...] J'ai cherché à suivre [...] les poussées de l'instinct, les détraquements cérébraux [...] Mon but a été un but scientifique avant tout. « Elle fut confirmée par la réduction des personnages à la physiologie (le remords du couple d'assassins «consiste en un simple désordre organique«). Zola voulut montrer comment l'équilibre d'un système de deux tempéraments, ceux de Thérèse et de Camille, est perturbé par l'intrusion d'un troisième, celui de Laurent. Il étudia les réactions, au sens chimique du terme, entraînées par cette intrusion, refusant l'analyse psychologique traditionnelle du remords. : «J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus.« Thérèse, qui, par son sang algérien, est l'étrangère inquiétante, est réduite aux fluctuations de son tempérament nerveux, est dominée par la névrose et l'hystérie. Laurent est d'abord une brute au tempérament sanguin, plein de puissance virile : il est totalement possédé par sa maîtresse ; mais, après le meurtre, il se transforme, ses nerfs l'emportent sur l'élément sanguin, il perd sa lourdeur et devient angoissé. Thérèse et Laurent forment d'abord une entité ; puis ils évoluent chacun à sa façon, aboutissant toutefois tous les deux à la dépression qui, dans la crise finale, les anéantit. Mais fantasmes et rêveries (mort, eau, matière...) subvertissent heureusement le projet scientifique, et font passer l'?uvre au fantastique. L'étude physiologique du «cas« médical disparut derrière la mythologie et les hantises personnelles de l'écrivain : peur de la Femme, peur de la fêlure, des forces incontrôlées et incontrôlables qui détraquent l'être humain, et le conduisent à la folie, hantise de l'émiettement physique et moral, de l'engrenage et de la mort, difficile acceptation de la vie trop «bourgeoise« menée entre sa femme et sa mère, que trahit, entre autres, une étonnante obsession du chiffre 3, etc. Le chat est une puissance diabolique qui hante Thérèse que son côté félin identifie à lui qui est, d'ailleurs, un vrai personnage, beaucoup plus humain que les joueurs de dominos qu'elle qualifie de «cadavres mécaniques«. Elle imite parfois l'animal qui sait tout de la vie des amants meurtriers. Au point que Laurent croit que Camille est entré dans le chat, et le tue. Il est lui-même hanté par le spectre de Camille. Zola s'était efforcé à une écriture simplifiée, «dégraissée«, qui imitait celle de Taine ou de Claude Bernard. Malgré l'utilisation trop appuyée des recettes du roman noir et du mélodrame, et la trop grande recherche de l'exceptionnel, ''Thérèse Raquin'', par son recours à la science, la richesse de son imaginaire et son intensité dramatique, est une oeuvre marquante de l'histoire du roman français. Le roman parut d'abord en feuilleton dans ''L'artiste'', l'habile découpage du texte piquant la curiosité du lecteur. La publication se poursuivit jusqu'au bout ; mais Arsène Houssaye supplia Zola de couper certains passages, «parce que, disait-il, l'impératrice lisait sa revue«. Le romancier y consentit, se réservant de tout rétablir dans le volume. Mais il se fâcha tout rouge lorsqu'il trouva, sur le dernier feuillet des épreuves, une phrase finale où Arsène Houssaye agrémentait l'oeuvre d'une belle conclusion morale. Il se montra intraitable, et le directeur dut lui céder. Mais le feuilleton provoqua un scandale, Louis Ulbach, qui faisait alors au ''Figaro'' ''Les lettres de Ferragus'', en consacra une à l'éreintement de l'?uvre, dénonça à l'indignation des honnêtes gens ce qu'il appelait «la littérature putride«, qui ne décrivait que des scènes obscènes, traita l'auteur de «misérable hystérique qui se plaît à étaler des pornographies«. Zola obtint, de M. de Villemessant, le directeur du journal, l'autorisation de lui répondre. Le volume parut en octobre 1867, chez l'éditeur Lacroix, et eut un certain succès, du fait de la polémique. Au commencement de 1868, il eut les honneurs d'une seconde édition, tandis que la première ?uvre de Zola, ''Les contes à Ninon'', qui avait été très bien accueillie par la critique, couverte d'éloges dans les moindres feuilles de choux, mit dix ans à se vendre à mille exemplaires. Dans cette seconde édition, Zola ajouta une préface où il défendait l'aspect scientifique de sa méthode en faisant l'apologie du naturalisme. En 1873, il adapta son roman pour le théâtre, en fit un drame en quatre actes, ce qui était aisé puisque l'unité de lieu était assurée, l'action se passant presque entièrement dans le passage du Pont-Neuf. La pièce eut neuf représentations au Théâtre de la Renaissance, fut publiée, jouée en province et à l'étranger, et reprise plusieurs fois. Mais elle déconcerta le public et ne fut pas un succès. Le roman fut adapté au cinéma : en 1911, au Danemark, par Einar Zangenberg ; en 1915, en Italie, par Nini Martoglio ; en 1926, en France, par Jacques Feyder qui en tira un film envoûtant, marqué par l'esthétique expressionniste ; en 1953, en France encore, par Marcel Carné qui fit jouer Simone Signoret et Raf Vallone ; en 1960, en France, Stellio Lorenzi tourna un téléfilm. ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- La fin du roman «Madame Raquin, sentant que le dénouement était proche, les regardait avec des yeux fixes et aigus. Et, brusquement, Thérèse et Laurent éclatèrent en sanglots. Une crise suprême les brisa, les jeta dans les bras l'un de l'autre, faibles comme des enfants. Il leur sembla que quelque chose de doux et d'attendri s'éveillait dans leur poitrine. Ils pleurèrent, sans parler, songeant à la vie de boue qu'ils avaient menée et qu'ils mèneraient encore, s'ils étaient assez lâches pour vivre. Alors, au souvenir du passé, ils se sentirent tellement las et éc?urés d'eux-mêmes, qu'ils éprouvèrent un besoin immense de repos, de néant. Ils échangèrent un dernier regard, un regard de remerciement, en face du couteau et du verre de poison. Thérèse prit le verre, le vida à moitié et le tendit à Laurent qui l'acheva d'un trait. Ce fut un éclair. Ils tombèrent l'un sur l'autre, foudroyés, trouvant enfin une consolation dans la mort. La bouche de la jeune femme alla heurter, sur le cou de son mari, la cicatrice qu'avaient laissée les dents de Camille. Les cadavres restèrent toute la nuit sur le carreau de la salle à manger, tordus, vautrés, éclairés de lueurs jaunâtres par les clartés de la lampe que l'abat-jour jetait sur eux. Et, pendant près de douze heures, jusqu'au lendemain vers midi, madame Raquin, roide et muette, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds.« Commentaire La fin de "Thérèse Raquin" avait été préparée depuis les premières pages du roman, en fonction des règles du déterminisme biologique que Zola emprunta à Claude Bernard. La scène finale est l'aboutissement fatal de la situation initiale, et doit se déduire nécessairement de la rencontre entre Thérèse et Laurent au chapitre V où, après une période de reproches mutuels et de menaces de dénonciation, les époux avaient essayé d'échapper à leur folie dans la débauche. Puis Thérèse s'était munie d'un couteau, Laurent d'un flacon de poison, chacun méditant de faire mourir l'autre. Ici, en comprenant les intentions l'un de l'autre, les deux époux «se firent pitié et horreur«. Cette pitié réciproque se traduit par une «crise suprême« qui n'est pas l'occasion d'un repentir ni d'une rédemption qui les rendraient sympathiques au lecteur. Ils la subissent, comme le montre la construction de la phrase : c'est le mot «crise« qui est le sujet, tandis que les héros sont représentés par les pronoms compléments d'objet «les«. L'emploi des pronoms personnels se fait aussi le reflet de cette réunion ultime : dans les paragraphes 2 et 3, on trouve quatre fois «les«, huit fois «ils«, une fois «eux-mêmes«, une fois «eux« : les époux sont donc désignés collectivement, de même que le nom «les cadavres« les rassemble et les déshumanise à la fois dans le troisième paragraphe. Dictée, non par le repentir, mais par l'impasse où se trouvent les meurtriers, la réconciliation est expliquée par la lassitude et du dégoût : «ils se sentirent tellement las et éc?urés d'eux-mêmes, qu'ils éprouvèrent un besoin immense de repos, de néant«. Le point de vue du narrateur dans le paragraphe central révèle les sentiments des personnages de l'extérieur, au moyen de leurs gestes et de leurs attitudes, au début et à la fin du paragraphe : «Et brusquement Thérèse et Laurent éclatèrent en sanglots. Une crise suprême les brisa, les jeta dans les bras l'un de l'autre, faibles comme des enfants.« - «Thérèse prit le verre, le vida à moitié et le tendit à Laurent qui l'acheva d'un trait.« En revanche, le lecteur bénéficie d'une focalisation interne entre ces deux phrases qui permet encore de réunir les époux en faisant voir qu'au moment de mourir, ils partagent les mêmes sentiments. Le lexique exprime la tendresse d'une enfance retrouvée : «éclataient en sanglots«, «dans les bras l'un de l'autre«, «faibles comme des enfants«, «quelque chose de doux et d'attendri«, «une consolation«. Au centre du paragraphe, le regard échangé est souligné par une réduplication : «un dernier regard, un regard de remerciement«, et le dernier sentiment rapporté par le narrateur est la gratitude réciproque, autre indice d'une suprême réconciliation dans la mort. Les modalités de la complicité entre Thérèse et Laurent n'ont pas non plus changé depuis le début de leur relation : c'est encore Laurent qui fournit le moyen pratique de donner la mort, le poison, bien préférable au couteau de Thérèse, celui-ci restant pourtant révélateur de son tempérament. C'est d'ailleurs elle qui fait le premier pas vers la mort, où Laurent la suit aussitôt. Dans cette histoire où la fatalité des tempéraments tient lieu de «fatum« tragique, les points communs avec la tragédie sont nombreux. Dès la première phrase, le mot «dénouement«, plusieurs fois employé dans les passages précédents, invite à un rapprochement avec un dénouement théâtral. On notait également plus haut les termes «horreur et pitié«, employés dans la phrase qui précède immédiatement le passage étudié ; or la terreur et la pitié sont les ressorts de la tragédie selon Aristote. Le «fatum«, le destin, est l'une des caractéristiques du tragique. Ici, les héros sont prisonniers d'une situation dont la seule issue est le suicide : ils semblent s'y résoudre après un dernier débat. «Ils pleurèrent, sans parler, songeant à la vie de boue qu'ils avaient menée et qu'ils mèneraient encore, s'ils étaient assez lâches pour vivre«. Mais le lecteur sait que leur sort est scellé depuis longtemps par une fatalité génétique plus puissante que leur volonté. Le spectacle est mis en scène par l'embrassement final, par ce dernier regard échangé, dramatisé par la présence du couteau et du verre de poison. Ce poison, on a appris au chapitre XXXI que c'est de l'acide prussique, c'est-à-dire de l'acide cyanhydrique, plus connu sous la forme du fameux cyanure, qui provoque une mort foudroyante, avec des convulsions atroces, sur lesquelles le narrateur ne s'attarde pas, sinon pour évoquer la chute de Thérèse sur Laurent. On trouve ici l'ultime occurrence du leitmotiv du cou de Laurent et de la cicatrice de la morsure de Camille, traduction et vecteur physique des remords de Laurent, et vengeance posthume du noyé, signe du destin encore. Comme la colère de Zeus dans les tragédies, ce poison foudroie («éclair«, «foudroyés«). Mais c'est surtout la vengeance de Mme Raquin qu'on voit s'exercer ici. C'est elle qui joue le rôle dévolu classiquement aux Érinyes. Au chapitre XXX, Mme Raquin avait songé un moment à se laisser mourir de faim, mais elle avait résolu de vivre jusqu'à ce qu'elle puisse dire à Camille : «Tu es vengé«. Elle éprouve enfin la «joie cuisante« de la vengeance qu'elle se promettait alors. Cela explique que l'évocation de son regard sur la mort des deux complices encadre le paragraphe qui rend compte de leur suicide. On relève dans ces deux paragraphes un champ lexical du regard : «yeux«, dans la première et la dernière phrase, «contemplant«, «regards«, qui trouve son écho dans le regard de pardon échangé entre Thérèse et Laurent. Mais les yeux de Mme Raquin sont, dans le premier paragraphe, «fixes et aigus«, comme pour mieux voir et précipiter une mort imminente, et ils traduisent à la fin un triomphe : «ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds.« On constate enfin que la dernière scène du roman, comme la description du passage du Pont-Neuf au début, n'est éclairée que d'une lumière «jaunâtre«, mot dont le suffixe péjoratif confirme le caractère étriqué et étouffant du milieu où s'est déroulé cette histoire sordide. Cette fin tragique permet de saisir une des originalités de "Thérèse Raquin" : la simplicité presque racinienne de l'action, menée par une destinée implacable. Le lecteur, comme le spectateur d'une tragédie, peut ressentir de la terreur, mais il n'éprouve guère de pitié.
Liens utiles
- Plan détaillé dissertation Thérèse Raquin: une oeuvre immorale ?
- Commentaire Thérèse Raquin chapitre XXXII
- Thérèse Raquin de Zola - Résumé par chapitre
- Résumé thérèse raquin par chapitre
- Les personnages - Thérèse Raquin de Zola
