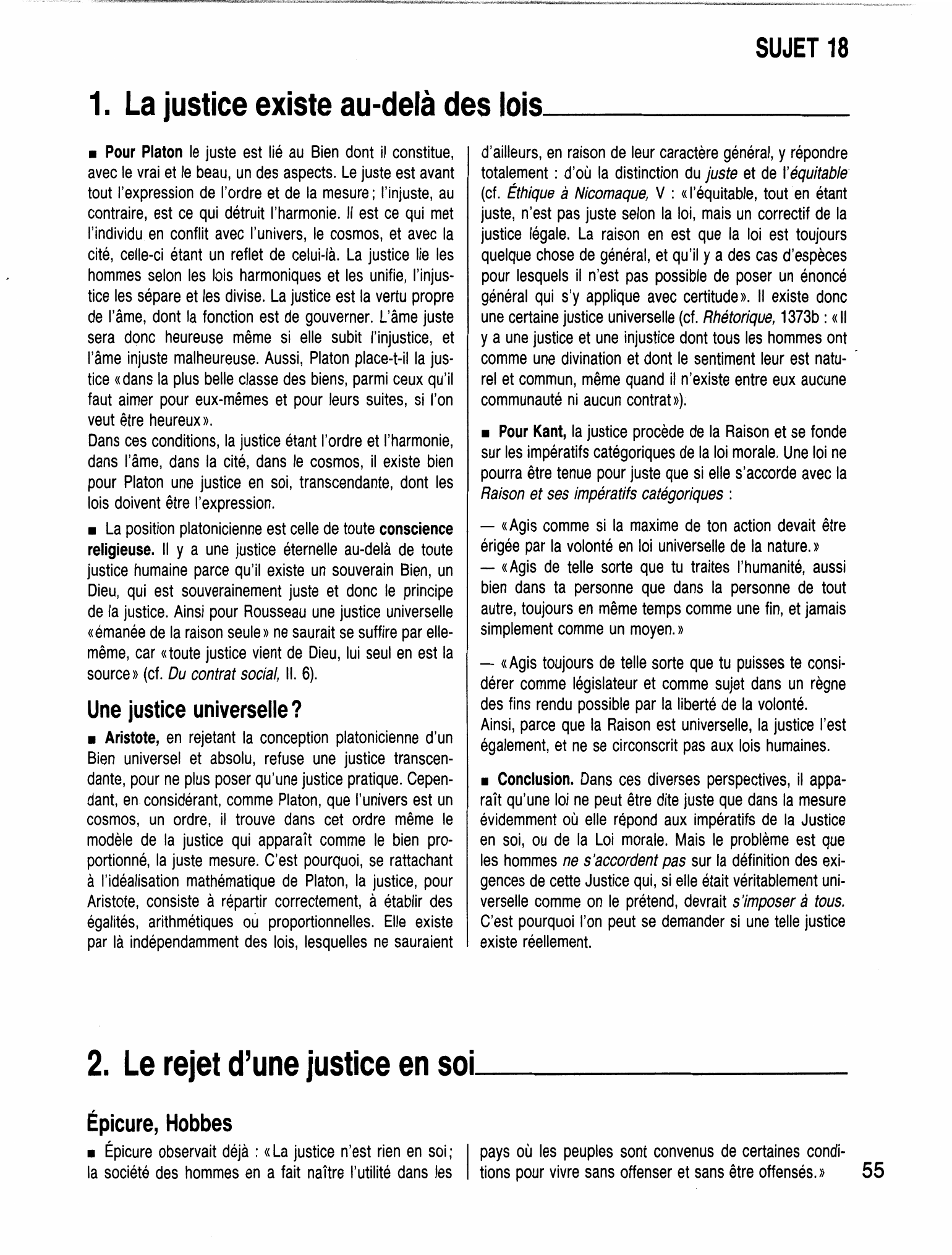Washington, État de
Extrait du document


«
SUJET 18
1.
La justice existe au-delà des lois ______ _
• Pour Platon le juste est lié au Bien dont il constitue,
avec le vrai et le beau, un des aspects.
Le juste est avant
tout l'expression de l'ordre et de la mesure; l'injuste, au
contraire, est ce qui détruit l'harmonie.
Il est ce qui met
l'individu en conflit avec l'univers, le cosmos, et avec la
cité, celle-ci étant un reflet de celui-là.
La justice lie les
hommes selon les lois harmoniques et les unifie, l'injus
tice les sépare et les divise.
La justice est la vertu propre
de l'âme, dont la fonction est de gouverner.
L'âme juste
sera donc heureuse même si elle subit l'injustice, et
l'âme injuste malheureuse.
Aussi, Platon place-t-il la jus
tice «dans la plus belle classe des biens, parmi ceux qu'il
faut aimer pour eux-mêmes et pour leurs suites, si l'on
veut être heureux».
Dans ces conditions, la justice étant l'ordre et l'harmonie,
dans l'âme, dans la cité, dans le cosmos, il existe bien
pour Platon une justice en soi, transcendante, dont les
lois doivent être l'expression.
• La position platonicienne est celle de toute conscience
religieuse.
Il y a une justice éternelle au-delà de toute
justice humaine parce qu'il existe un souverain Bien, un
Dieu, qui est souverainement juste et donc le principe
de la justice.
Ainsi pour Rousseau une justice universelle
«émanée de la raison seule» ne saurait se suffire par elle
même, car «toute justice vient de Dieu, lui seul en est la
source» (cf.
Du contrat social, Il.
6).
Une justice universelle?
• Aristote, en rejetant la conception platonicienne d'un
Bien universel et absolu, refuse une justice transcen
dante, pour ne plus poser qu'une justice pratique.
Cepen
dant, en considérant, comme Platon, que l'univers est un
cosmos, un ordre, il trouve dans cet ordre même le
modèle de la justice qui apparaît comme le bien pro
portionné, la juste mesure.
C'est pourquoi, se rattachant
à l'idéalisation mathématique de Platon, la justice, pour
Aristote, consiste à répartir correctement, à établir des
égalités, arithmétiques ou proportionnelles.
Elle existe
par là indépendamment des lois, lesquelles ne sauraient
d'ailleurs, en raison de leur caractère général, y répondre
totalement : d'où la distinction du juste et de l'équitable
(cf.
Éthique à Nicomaque, V : «l'équitable, tout en étant
juste, n'est pas juste selon la loi, mais un correctif de la
justice légale.
La raison en est que la loi est toujours
quelque chose de général, et qu'il y a des cas d'espèces
pour lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé
général qui s'y applique avec certitude».
Il existe donc
une certaine justice universelle (cf.
Rhétorique, 1373b : «Il
y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont
comme une divination et dont le sentiment leur est natu
rel et commun, même quand il n'existe entre eux aucune
communauté ni aucun contrat»).
• Pour Kant, la justice procède de la Raison et se fonde
sur les impératifs catégoriques de la loi morale.
Une loi ne
pourra être tenue pour juste que si elle s'accorde avec la
Raison et ses impératifs catégoriques :
-
«Agis comme si la maxime de ton action devait être
érigée par la volonté en loi universelle de la nature.»
- «Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi
bien dans ta personne que dans la personne de tout
autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais
simplement comme un moyen.»
- «Agis toujours de telle sorte que tu puisses te consi
dérer comme législateur et comme sujet dans un règne
des fins rendu possible par la liberté de la volonté.
Ainsi, parce que la Raison est universelle, la justice l'est
également, et ne se circonscrit pas aux lois humaines.
• Conclusion.
Dans ces diverses perspectives, il appa
raît qu'une loi ne peut être dite juste que dans la mesure
évidemment où elle répond aux impératifs de la Justice
en soi, ou de la Loi morale.
Mais le problème est que
les hommes ne s'accordent pas sur la définition des exi
gences de cette Justice qui, si elle était véritablement uni
verselle comme on le prétend, devrait s'imposer à tous.
C'est pourquoi l'on peut se demander si une telle justice
existe réellement.
2.
Le rejet d'une justice en soi ________ _
Épicure, Hobbes
• Épicure observait déjà : «La justice n'est rien en soi;
la société des hommes en a fait naître l'utilité dans les
pays où les peuples sont convenus de certaines condi-
tions pour vivre sans offenser et sans être offensés.» 55.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- commentaire de carte le monde vu de Washington en 2002
- Georges Washington devoir d'euro-histoire anglais
- CONTES DE L'ALHAMBRA (résumé & analyse) de Washington Irving
- WASHINGTON SQUARE.
- Le personnage de RIP VAN WINKLE Washington Irving