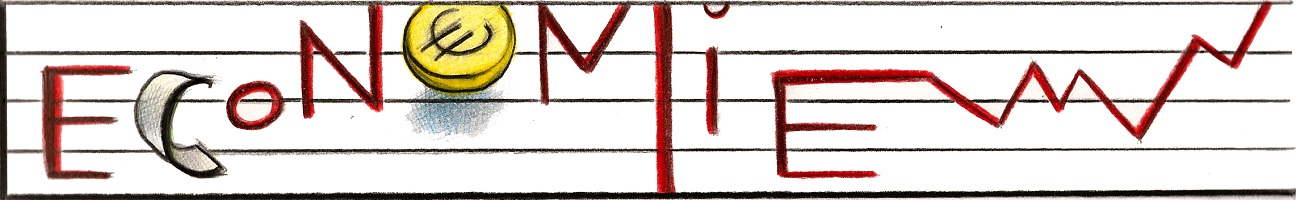Les Services en France
Publié le 26/10/2012

Extrait du document
La recherche d'une productivité croissante dans les services publics n'est pas toujours souhaitable (en matière d'éducation ou de santé, par exemple) et soulève en outre la question de savoir jusqu'où doit aller l'amélioration d'un service public. Il n'en demeure pas moins que l'impossibilité d'évaluer l'efficacité réelle de ces services, en l'absence de prix de vente et de chiffre d'affaires, demeure depuis plusieurs décennies l'une des principales critiques qui leur est adressée. En 1967, déjà, ce constat était à l'origine du rapport Nora, qui a révolutionné la gestion des services publics en France en introduisant l'évaluation précise des coûts (comptabilité), la transparence (contrat avec l'État stipulant les obligations de chaque service public) et des règles de gestion incitant à l'économie.
«
Prenant le contre-pied de l'Idée commune selon laquelle le progrès technique détruit des emplois, l'économiste, sociologue et démographe français Alfred Sauvy (1848-1990) a montré que ce dernier est au contraire source de création d 'emplois grace au mécanisme du déversement.
Selon cette théorie, le progrès technique entraîne des gains de productivité qui sont redistribuès aux salariès par une augmentation de revenus.
Cette augmentation de revenus provoque à son tour une augmentation de la demande dans d'autres secteurs d'activitès, et donc des créations d'emplois dont le nombre dépasse celui des emplois précédemment détruits.
Si le mécanisme du déversement a bien fonctionné durant les Trente Glorieuses (1945-1975), il semble aujourd'hui s'essouffler dans la mesure où il s'effectue surtout en faveur du secteur tertiaire, dans lequel les emplois créès sont proportionnellement moins nombreux (en raison des forts gains de productivité liès à l'Introduction des technologies de l'Information et de la communication) et sensiblement plus qualifiés que les emplois détruits .
précurseurs et Beille principal chef de file, a vu le jour dans les années 1960 et 1970.
Selon les tenants de cette approche , le processus de tertiarisation des économies contemporaines est tout à fait comparable aux bouleversements provoqué s à partir de la fin du XVIII' siècle par la révolution industrielle et conduira à l'avè neme nt d'une économie de services.
Il doit donc être considé ré comme le fait majeur d e l'histoire économ ique contemporaine.
• Le courant néo-industriel, appa ru à la fin des années 1970 et fondé entre autres travau x sur la théorie de l'« économie de self-service » de G ers huny repose au contraire sur la conviction que l'importance des activités d e services doit être relativisée au profit des activités industrielles .
Loin d'être en déclin, ces dernières activités constitueraient en effet le principal déterminant de la compétitivité des économ ies nationales et de l'expansion des activités tertiaires .
• Aujourd'hui , ces deux courants tendent toutefois à converger autour du constat que les services sont la principale source de création t------------_, d'emp lois et de richesses.
surnommées les «Trente Glorieuses" (1945-1975 ) a e ntraîn é une modification de leurs comportements de consomm atio n, qui se so nt diversifiés a u bénéfice des activité s tertiaires re latives aux loisirs, à l'éducation et à la santé .
• Enfin , à partir de la fin des années 1970, les grandes entrep rises ont recentré leurs activités vers leur cœur de métier et confié diverses activités annexes (conseil.
entretie n , gard iennage ...
) à des sociétés de prestation de services .
lA PLACE DES SERVICES DANS NOS ÉCONOMIES ET SOCIÉTÉS • Au-delà des con stats quantitatif s, quelle signification donner à l'inéluctab le tertiarisation des économies occide nta les? Sur ce point , deux approc hes peuvent être distinguées.
• L'approche postindustrielle , tout d'abord, dont Fourastié est l'un des
• Leur portée a en outre été limit ée par l'émergence , avec la «no uvelle économie », au milieu des années 1990, d'une troisième approche dite de la société informationnelle.
Ce dernier courant , structuré autour des travaux de Manuel Castells (The Rise of the Network Society, 1996}, a en effet renvoyé dos à dos les courants post- et néo-industriels en soutenant que l'opposition la plus structurante ne s'opé r ait plus entre biens et services, mais entre biens et information (au sens de production e t diffusion de connaissances) .
PROBLÉMATIQUES CONTEMPORAINES
Le secteur des servi ces s u scite divers débats sociétaux dont l'enjeu est évident au regard du volume d 'activité et d'emp loi représenté par ce secteu r dans les économies nationa les.
t---------------1 LA QUESTION DE LA TARIFICATION BEU 0 LA TH'ORIE DE LA SOCitrÉ
POmNDUmiELLE
Dans un célèbre ouvrage daté de 1973 , Vers la société postindustrielle , le sociologue américain Daniel Bell propose le premier de considérer l 'accroissement de la part des services dans les économies occidentales comme la manifestation évidente de l'avènement d'une société de type • postindustriel •, c'est-à-dire fondée sur les services plutôt que sur un système industriel de type fordiste.
Loin de se limiter à une évolution de la structure de l'emploi , cette nouvelle société reposerait en outre, selon lui, sur la maltrise de l'innovation et de la circulation de l'Information.
Au niveau social , enfin, elle serait à l'origine d'une modification en profondeur des rapports sociaux traditionnels et du renouvellement des élites dirigeantes .
DES SERVICES L e premier débat , relatif à la détermination du prix des services , est structuré autour de deux situation s idéales typiques .
• Le premier cas est celui des serv ices marchand s produits par des entreprises dans un secteur non régulé par les pouvoirs publics.
L a tarification , laissée à la discrétion de l'entreprise , se fait alors au prix du marché.
• Dan s le second cas, au con traire, les serv ices sont produits par les pouvoirs publics et financ és par les recettes fiscales .
Ces serv ices peuvent alors être proposés '----" """-'gratuiteme nt à
En réaction à la thèse de Daniel Bell, Jonathan Gershuny propose en 1978 la théorie néo-industrielle de l'•économie de self-service» , complétée par lan Miles en 1983.
D'inspiration microéconomique , cette théorie place au cœur de l'analyse les notions de besoin et de satisfaction .
Elle postule en substance qu'un c-..teur n 'achète pas un bien pour lui-même, mais pour le
service qu'illui procure en réponse à des besoins ressentis.
temps, se trouve en fait en situation d'arbitrage entre self-service (faire) ou service extérieur (laire faire) .
Selon Gershuny, le self-service doit logiquement l'emporter en raison du coût élevé du service extérieur, nécessitant le paiement d'un salaire .
Cela signifie donc que la consommation de biens devrait logiquement être supérieure à celle des services dans la consommation finale des individus.
Mais cette théorie n 'augure pas pour autant d'un déclin des activitès de services .
Au contraire, la faiblesse des gains de productivité dans le tertiaire à cette période, ainsi que la part prépondérante des activités de commerce , d'assurance, de financement.
d'entretien ou de distribution (dont le dynamisme
accesso irement Royaum e-Uni) est caractérisé par la domination de la sphè re privée concurrentielle dans la production de services .
• Le modèle scandinave (Suède, Norvège, Finland e, Danemark) , marqué au contraire par une forte implication financi è re et juridique des pouvoir s public s, repo se sur des services publi cs très développ és.
• L a France , au même titre que l'Allemagne ou la Belgique, se situe à mi-chemin entr e ces deux blocs.
TERTIARISATION ET CONDITIONS D'EMPLOI : VERS UN NOUVEAU DUALISME?
La question des conditions d'emploi dans les activités de services renvoie à une double segme ntation du secteur .
Tout d'abord , les emplois de serv ices présentent une forte hétérogénéité en termes de qualification, de 1-------------.--------------1 rémunération et de protection socia le .
est corrélé au volume de biens consommés) garantissent une progression de l'emploi , ralentie mais bien réelle, dans ce secteur.
Ce consommateur, soumis à une double contrainte de budget et de
leurs destinataires ou à un prix modique , déconnecté de leur vale ur réelle.
• Entre ces cas e xtrêmes , plusieurs situations mixtes existent , qui varient selon le poids des régu lations publiques et l 'implication financière des pouvoirs publics dans la production des services concernés .
À titre d'exemple, il est fréquent de voir les pouvoir s publics délég uer la fourniture d'un service public à une entrepri se privée, tenue en retour de respecter divers e ngagements .
OPPOSITION ENTRE LES MODtlES AN~LO·SAXON ET SCANDINAVE La question de la tarification des services soulève implicitement une autre question :celle des condition s de leur production .
Si cette question ne présente aucune difficulté dans la grande majorité des cas, elle s'avè r e problématique dans deux situations particulières .
Tout d 'abord, les travaux sur l'économie du bien-être montrent que la production de certains biens e t service s requiert l'intervention de l'État e n raison de l'existence de trois types de défaillances du march é : 1.
l'existence d 'externalités : si les actes d'un individu ont un impact sur les autres (nuisance s sonore s, pollution) , une régulation par les pouvoirs publics s'avère nécessaire ; 2.
l'existence de services « collectifs» : s'il est impossible d 'interdire l'accès à un service, i l doit être fourni gratuitement et financé par l 'imp ôt (par exempl e , l'éclairage public) ; 3.
le monopole naturel :lorsque le coût marginal de production décroît avec la quantité , le monopole est le mode de production le plus efficace (réseau de télécommunications ou de transports ) .
Mais , afin de limiter le s abus liés à la situat ion de monopole , celui-ci doit être public.
• Ensuite, les conditions de production d'un serv ice peuvent releve r de choix politiques :les pouvoirs publics peuvent en effet considérer que certains secteurs (santé , éducation ,
défense , admi nistrations publiques ...
) ne doivent pas être régulés par le marché pour des raisons idéologiques (souci d'égalité, refus de la rentabilité) .
On est alors en présence de services publics , c'est-à-di r e d' activités financées par la collectivité , la participation des usagers étant nulle ou modiqu e au regard du coût.
• Dans une perspective comparative, les choix politiques auxqu els donne lieu la production des serv ices publics débouchent sur une gra nde diversité d'écono mies de services , au sein de laquelle émergent deux modèles principaux.
• Le modèle anglo-saxon (États-U nis, Canada , Australie et
À titre d 'exemp le , le quotidien d'un livreur de pizzas n'est pas -.~ ...
comparab le
à celui d 'un
le note Gadrey (2003), les bas salaires du commerce de détail ou des s erv ices aux personnes étaient d'environ 10 euros de l'heure en Suède en 2002 contre seuleme nt 5 ,3 euros aux États-Unis .
Il n'en demeure pas moins que le nombr e élevé d'emplois tertiaires d e piètre t-------------1 qualité est considéré com m e une LA QUEmON DE L'EFFICACirt explicat ion majeure du faible taux DES SERVICES PUBUCS de chômage am é ricain .
La recherche d'une productivité croissante dans les services publics n'est pas toujours souhaitable (en matière d'éducation ou de santé, par exemple) et soulève en outre la question de savoir jusqu'où doit aller l'amélioration d'un service public .
Il n'en demeure pas moins que l'impossibilité d'évaluer l'efficacité réelle de ces services, en l'absence de prix de vente et de chiffre d 'affaires, demeure depuis plusieurs décennies l'une des principales critiques qui leur est adressée .
En 1967, déjà , ce constat était à l'origine du rapport Nora, qui a révolutionné la gestion des services publics en France en introduisant l'évaluation précise des coûts (comptabilité), la transparence (con trat avec l'État stipulant les obligations de chaque service public) et des règles de gestion incitant à l'économie .
DISTINCTION ENTRE FORMEL ET INFORMEL Une seconde lig n e de segm entation oppose en outre les activ ités de services appa rtenant à l'éco nomie formelle et celles relevant de l'éco nomi e informelle.
Cett e distinction formel/ informel s'avère particulièrement pertinente pour le secteur des services , activ ités intangibles requérant pe u de matières premières et d ' infra structu res, et échappant par conséquent aisément aux l égis lations fiscales .
On comprend dès lors mieux comment l'économie informe lle peut représenter jusqu'à 50% des emplois dans les pays e n développement.
Ces services informels étant souvent mal rémun érés et n'ouvrant droit à aucune protection socia le, ils contribuent au renforcement du dualisme du marché de l'emploi, déjà très marqué dans les services ..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les services en France: dynamisme et enjeux.
- Les services publics en France: L'Etat prestataire
- déclaration préalable à l'intervention dans le cadre d'une prestation de services d'un entrepreneur non établi en France.
- La France lettrée a célébré en 1924 le quatrième centenaire de Ronsard. Dites, sans insister sur quelques charmantes poésies bien connues, par quelles qualités et par quels services Ronsard a bien mérité de la littérature française.
- TPE SUR LES SERVICES PUBLICS EN FRANCE