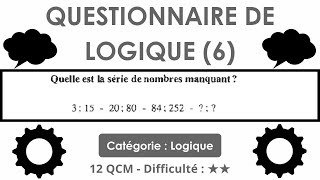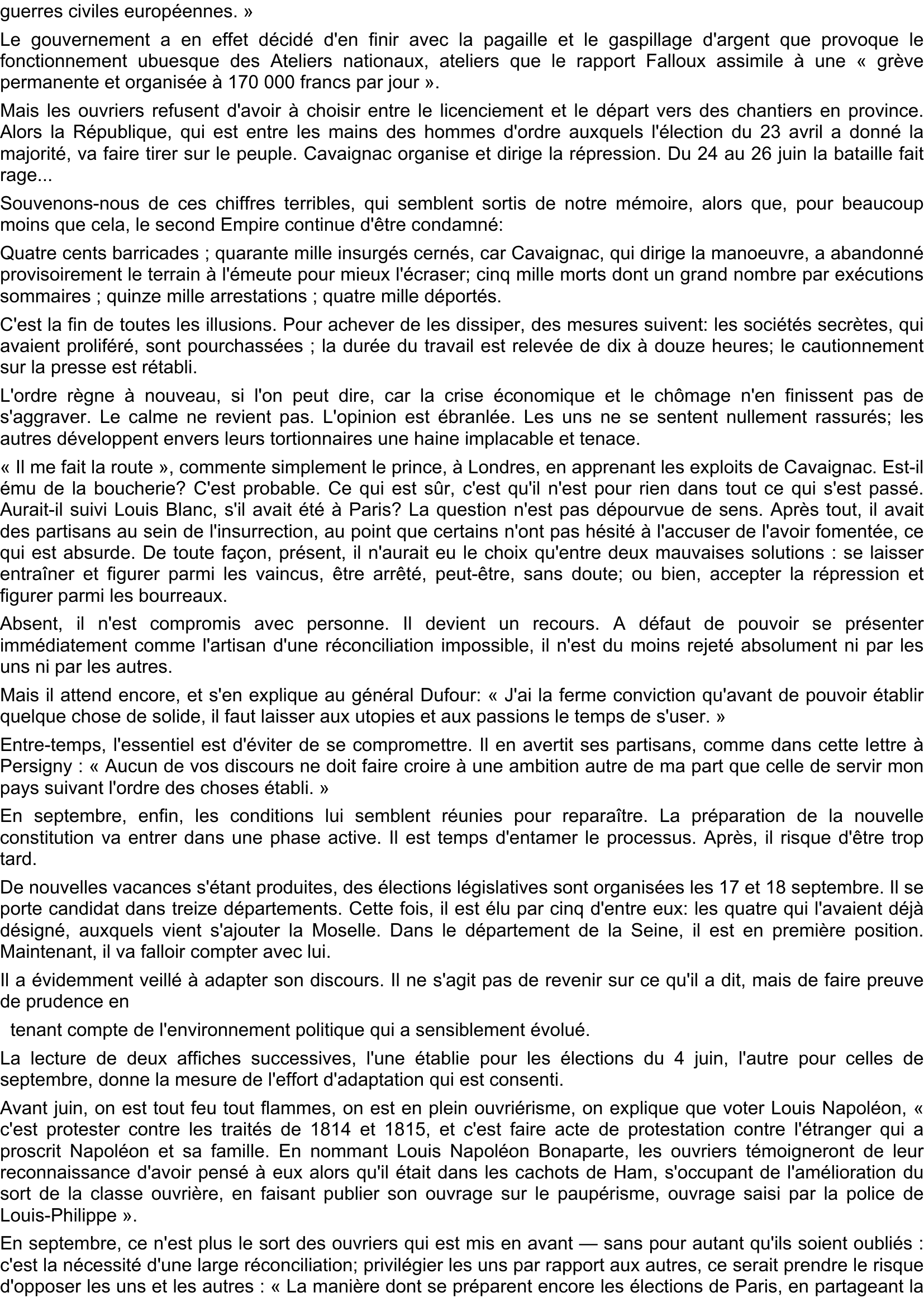Alors, Lamartine, Cavaignac, et leurs collègues, non seulement ne veulent pas de la validation, mais sont prêts à envisager l'arrestation du prince, au cas où celui-ci mettrait à nouveau le pied sur le sol de France.
Publié le 31/10/2013

Extrait du document
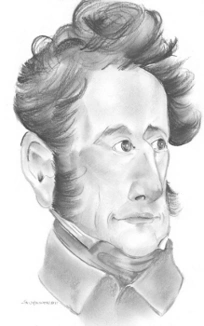
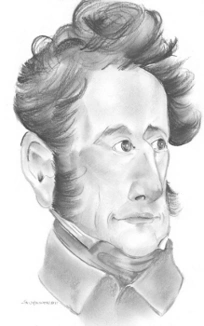
«
guerres
civileseuropéennes.
»
Le gouvernement aen effet décidé d'enfiniravec lapagaille etlegaspillage d'argentqueprovoque le
fonctionnement ubuesquedesAteliers nationaux, ateliersquelerapport Falloux assimile àune «grève
permanente etorganisée à170 000francs parjour ».
Mais lesouvriers refusent d'avoiràchoisir entrelelicenciement etledépart versdeschantiers enprovince.
Alors laRépublique, quiestentre lesmains deshommes d'ordreauxquels l'électiondu23 avril adonné la
majorité, vafaire tirersurlepeuple.
Cavaignac organiseetdirige larépression.
Du24au26 juin labataille fait
rage...
Souvenons-nous deces chiffres terribles, quisemblent sortisdenotre mémoire, alorsque,pour beaucoup
moins quecela, lesecond Empirecontinue d'êtrecondamné:
Quatre centsbarricades ;quarante milleinsurgés cernés,carCavaignac, quidirige lamanoeuvre, aabandonné
provisoirement leterrain àl'émeute pourmieux l'écraser; cinqmille morts dontungrand nombre parexécutions
sommaires ;quinze millearrestations ;quatre milledéportés.
C'est lafin de toutes lesillusions.
Pourachever deles dissiper, desmesures suivent:lessociétés secrètes, qui
avaient proliféré, sontpourchassées ;la durée dutravail estrelevée dedix àdouze heures; lecautionnement
sur lapresse estrétabli.
L'ordre règneànouveau, sil'on peut dire,carlacrise économique etlechômage n'enfinissent pasde
s'aggraver.
Lecalme nerevient pas.L'opinion estébranlée.
Lesunsnesesentent nullement rassurés;les
autres développent enversleurstortionnaires unehaine implacable ettenace.
« Ilme faitlaroute »,commente simplement leprince, àLondres, enapprenant lesexploits deCavaignac.
Est-il
ému delaboucherie? C'estprobable.
Cequi estsûr, c'est qu'iln'est pourriendans toutcequi s'est passé.
Aurait-il suiviLouis Blanc, s'ilavait étéàParis? Laquestion n'estpasdépourvue desens.
Après tout,ilavait
des partisans ausein del'insurrection, aupoint quecertains n'ontpashésité àl'accuser del'avoir fomentée, ce
qui estabsurde.
Detoute façon, présent, iln'aurait eulechoix qu'entre deuxmauvaises solutions:se laisser
entraîner etfigurer parmilesvaincus, êtrearrêté, peut-être, sansdoute; oubien, accepter larépression et
figurer parmilesbourreaux.
Absent, iln'est compromis avecpersonne.
Ildevient unrecours.
Adéfaut depouvoir seprésenter
immédiatement commel'artisan d'uneréconciliation impossible,iln'est dumoins rejetéabsolument nipar les
uns nipar lesautres.
Mais ilattend encore, ets'en explique augénéral Dufour:«J'ai laferme conviction qu'avantdepouvoir établir
quelque chosedesolide, ilfaut laisser auxutopies etaux passions letemps des'user.
»
Entre-temps, l'essentielestd'éviter desecompromettre.
Ilen avertit sespartisans, commedanscettelettre à
Persigny :« Aucun devos discours nedoit faire croire àune ambition autredema part quecelle deservir mon
pays suivant l'ordredeschoses établi.»
En septembre, enfin,lesconditions luisemblent réuniespourreparaître.
Lapréparation delanouvelle
constitution vaentrer dansunephase active.
Ilest temps d'entamer leprocessus.
Après,ilrisque d'êtretrop
tard.
De nouvelles vacancess'étantproduites, desélections législatives sontorganisées les17et18 septembre.
Ilse
porte candidat danstreize départements.
Cettefois,ilest élu par cinq d'entre eux:lesquatre quil'avaient déjà
désigné, auxquels vients'ajouter laMoselle.
Dansledépartement delaSeine, ilest enpremière position.
Maintenant, ilva falloir compter aveclui.
Il a évidemment veilléàadapter sondiscours.
Ilne s'agit pasderevenir surcequ'il adit, mais defaire preuve
de prudence en
tenant compte del'environnement politiquequiasensiblement évolué.
La lecture dedeux affiches successives, l'uneétablie pourlesélections du4juin, l'autre pourcelles de
septembre, donnelamesure del'effort d'adaptation quiestconsenti.
Avant juin,onest tout feutout flammes, onest enplein ouvriérisme, onexplique quevoter Louis Napoléon, «
c'est protester contrelestraités de1814 et1815, etc'est faireactedeprotestation contrel'étranger quia
proscrit Napoléon etsa famille.
Ennommant LouisNapoléon Bonaparte, lesouvriers témoigneront deleur
reconnaissance d'avoirpenséàeux alors qu'ilétait dans lescachots deHam, s'occupant del'amélioration du
sort delaclasse ouvrière, enfaisant publier sonouvrage surlepaupérisme, ouvragesaisiparlapolice de
Louis-Philippe ».
En septembre, cen'est pluslesort desouvriers quiestmis enavant —sans pourautant qu'ilssoient oubliés :
c'est lanécessité d'unelargeréconciliation; privilégierlesuns parrapport auxautres, ceserait prendre lerisque
d'opposer lesuns etles autres :« La manière dontsepréparent encorelesélections deParis, enpartageant la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DAVOUT, Louis Nicolas, duc d'Auerstaedt, prince d'Eckmühl (1770-1823) Maréchal de France, il accompagne Bonaparte en Egypte puis dans la campagne de Russie, où il s'illustre dans les batailles contre les Prussiens (1806) et les Autrichiens (1809).
- HENRI II DE MONTMORENCY (1595-1632) Fils d'Henri Ier, duc de Montmorency, maréchal et connétable de France, petit-fils du connétable Anne de Montmorency et beau-frère du prince de Condé.
- FRANÇOIS II de BRETAGNE (1435-1488) Après le mariage du Téméraire avec Marguerite d'York, Bretons, Anglais, Bourguignons se montrent prêts à frapper un grand coup contre la France.
- Quelle nationalité en cas de naissance en France de parents étrangers ?
- VAUBAN, Sébastien Le Prestre de (1er mai 1633-30 mars 1707) Maréchal de France A dix-sept ans, Vauban se met au service du prince de Condé, qui lutte contre son roi dans le temps de la Fronde.