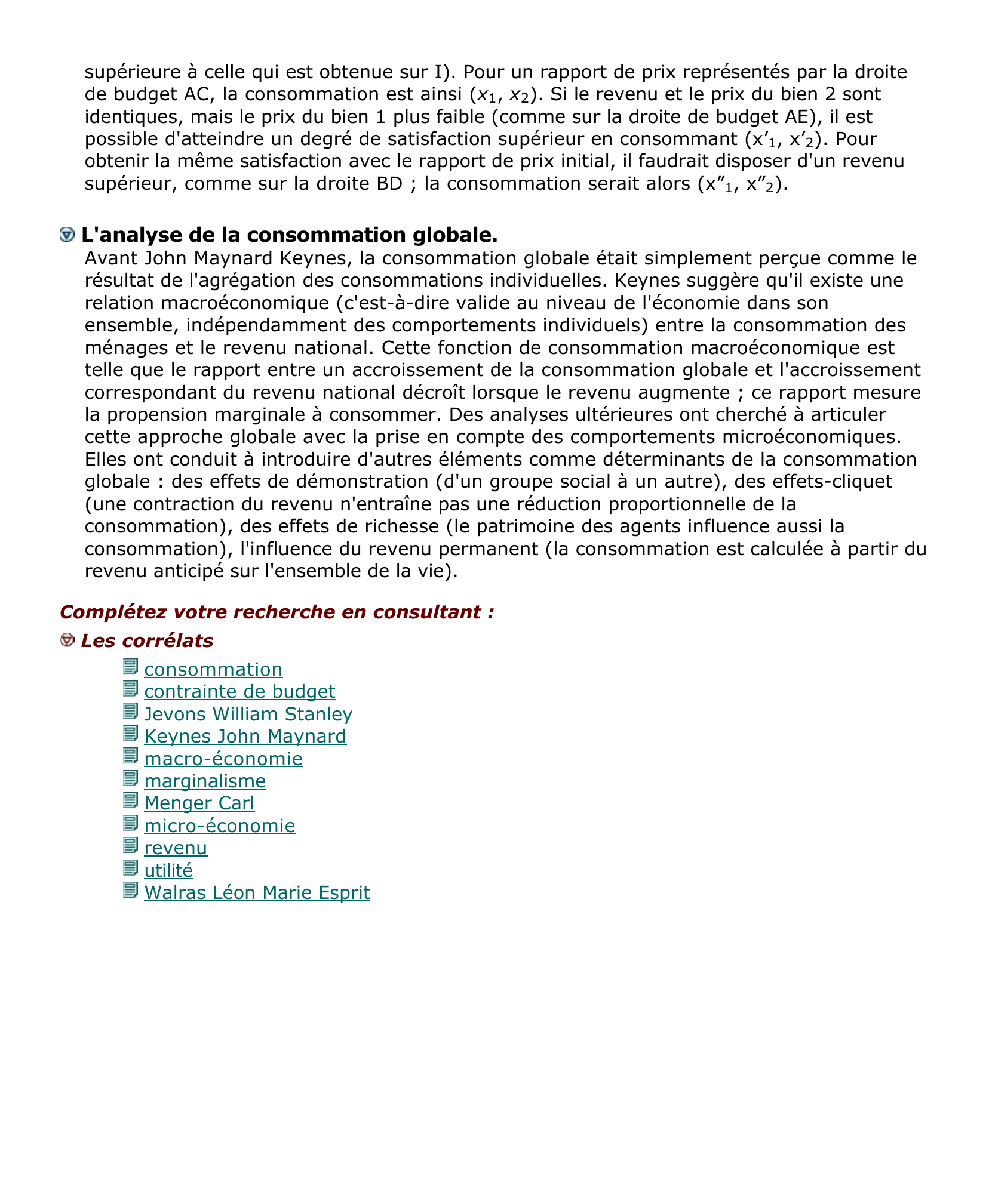consommation (théorie de la).
Publié le 25/10/2013

Extrait du document
«
supérieure à celle qui est obtenue sur I).
Pour un rapport de prix représentés par la droite
de budget AC, la consommation est ainsi ( x1, x2).
Si le revenu et le prix du bien 2 sont
identiques, mais le prix du bien 1 plus faible (comme sur la droite de budget AE), il est
possible d'atteindre un degré de satisfaction supérieur en consommant (x’ 1, x’ 2).
Pour
obtenir la même satisfaction avec le rapport de prix initial, il faudrait disposer d'un revenu
supérieur, comme sur la droite BD ; la consommation serait alors (x” 1, x” 2).
L'analyse de la consommation globale.
Avant John Maynard Keynes, la consommation globale était simplement perçue comme le
résultat de l'agrégation des consommations individuelles.
Keynes suggère qu'il existe une
relation macroéconomique (c'est-à-dire valide au niveau de l'économie dans son
ensemble, indépendamment des comportements individuels) entre la consommation des
ménages et le revenu national.
Cette fonction de consommation macroéconomique est
telle que le rapport entre un accroissement de la consommation globale et l'accroissement
correspondant du revenu national décroît lorsque le revenu augmente ; ce rapport mesure
la propension marginale à consommer.
Des analyses ultérieures ont cherché à articuler
cette approche globale avec la prise en compte des comportements microéconomiques.
Elles ont conduit à introduire d'autres éléments comme déterminants de la consommation
globale : des effets de démonstration (d'un groupe social à un autre), des effets-cliquet
(une contraction du revenu n'entraîne pas une réduction proportionnelle de la
consommation), des effets de richesse (le patrimoine des agents influence aussi la
consommation), l'influence du revenu permanent (la consommation est calculée à partir du
revenu anticipé sur l'ensemble de la vie).
Complétez votre recherche en consultant :
Les corrélats
consommation
contrainte de budget
Jevons William Stanley
Keynes John Maynard
macro-économie
marginalisme
Menger Carl
micro-économie
revenu
utilité
Walras Léon Marie Esprit.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Théorie du complot : L’Homme n’a jamais marché sur la lune
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- Peut-on atteindre le bonheur dans le cadre d'une société de consommation ?
- La théorie de la motivation
- Une théorie de l’inconscient psychique est-elle nécessaire pour expliquer les comportements humains ?