GAULLE (Charles de)
Publié le 17/01/2019

Extrait du document
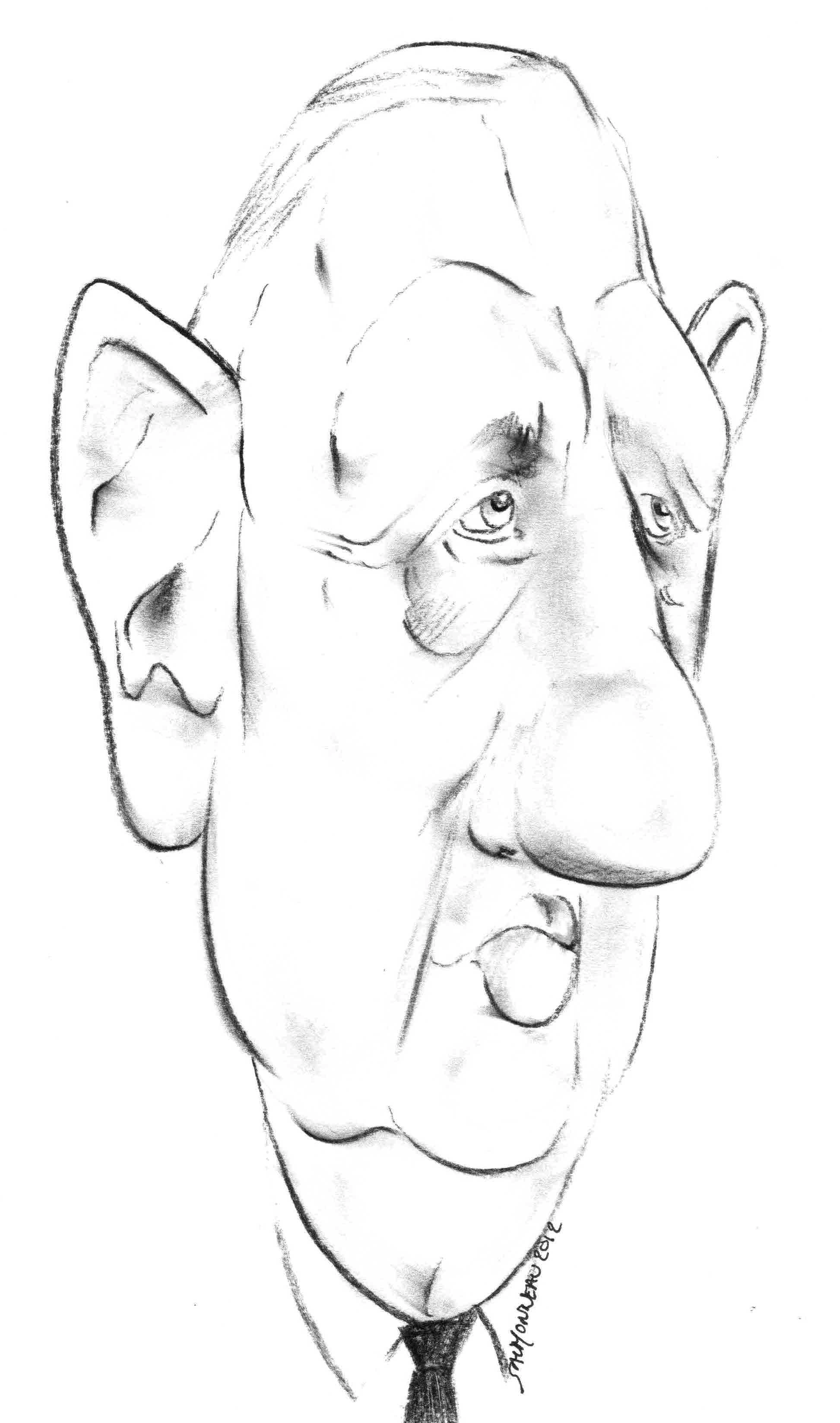
GAULLE (Charles de), général, homme politique et écrivain français (Lille 1890 - Colombey-les-Deux-Églises 1970). « Une certaine idée de la France » ne va pas sans une certaine idée du style. L'homme qui, homme de guerre ou politique, a su se plier à la « nature » ou à la « force » des choses, a constamment usé des mots. Et dans les registres les plus variés, de cette pièce en vers de sa jeunesse {Une mauvaise rencontre, 1906), influencée par Edmond Rostand et mise en scène à la télévision en novembre 1981, aux essais techniques et tactiques — qui analysent les qualités du chef et du soldat {la Discorde chez l'ennemi, 1924 ; Vers l'armée de métier, 1934) ou les rapports du politique et du militaire {le Fil de l'épée, 1932 ; la France et son armée, 1938) —, aux Discours et Messages ( 1940-1969) et aux Mémoires de guerre {1'Appel, 1954; l'Unité, 1956 ; le Salut, 1959) et d'Espoir (1970). Commentateur de l'action des autres (des nouvelles du front dans sa captivité d'Ingolstadt ; de l'histoire militaire à Saint-Cyr ; des péripéties de la guerre à la radio de Londres), de Gaulle est, à l'égard de sa propre action, à la fois homme de discours (orateur qui joue
de la persuasion ou de l'invective pour hisser au niveau de l'Histoire ces Français qui, selon Malraux, hésitent toujours « entre d'Artagnan et Croquebol ») et homme d'écriture (mémorialiste qui éclaire le dossier sur lequel l'Histoire le jugera). À la fois « signifiant et signifié de l'Histoire », de Gaulle possède une éloquence à deux voix (J. Lacouture) : la « basse » de l'homme de guerre, la « voix de tête » du politique. Ce qui est sûr, c'est que cette éloquence donne à l'ensemble de l'œuvre sa tonalité de littérature « parlée » (même si les discours sont écrits et appris « par cœur » et si l'orateur toujours assis donne pour l'histoire moderne la version télévisée du buste antique). On a beaucoup analysé la thématique du général, repéré ses mots clés (René Moreau, I. B. M.) dans le système d'équivalence de Gaulle/France ; on a cherché ses sources à la fois historiques et littéraires (Barrés, Maurras, Péguy, Claudel, Nietzsche) ; on a vu dans son style un mélange de Tacite et de Céline (E. Mannoni), sensible dans son élocution noble avec des étranglements faubouriens. Lui-même a été fort discret dans ses citations (Chateaubriand, Hugo, Verlaine) et références : il a fait de Malraux son ministre de la Culture, il a salué en Mauriac un « très grand écrivain », il a exprimé son intérêt pour Albert Samain. Malraux dit lui-même (Antimémoires) que son domaine d'allusions et de comparaisons était « souvent littéraire dans l'ironie ». En réalité, de Gaulle n'est ni Saint-Simon ni Guizot : à travers des points de mire qui sont le César de la Guerre des Gaules et Clausewitz, il parle non d'une vie mais d'un destin. Pour lui, le temps des mémorialistes s'incarne dans l'« espace » de la France, sa véritable appartenance. Marginal par rapport à l'idéologie de l'armée et de sa classe, de Gaulle s'est enraciné dans une France mythique ( « du fond des âges » ) qui ne serait pas encombrée des Français divisés et versatiles (mais, s'ils ne l'étaient pas, ils n'auraient pas besoin de héros). De Gaulle se pense, lui et son action, sous l'aspect de l'histoire et non sous l'aspect de l'éternité (comme Chateaubriand) qui est aussi celui de l'art. Or le seul territoire des grandes œuvres, c'est l'écriture, et leurs seules conquêtes non les frontières mais le Temps. Les seuls bilans qui s'inscrivent définitivement dans l'histoire de la littérature sont ceux de politiques ratés (Tacite, le cardinal de Retz, Chateaubriand) ou de ceux qui, aspirant à l'abolition de l'Histoire (saint Augustin, Bossuet), placent les « vanités » passagères dans la lumière du Jugement dernier ou, comme le disait Flaubert, du point de vue « d'une blague supérieure, c'est-à-dire comme le bon Dieu les voit ». À lire de Gaulle, on lit plutôt un journal de marche ou un livre de bord que des Mémoires. Il invite la France à « épouser le temps », « son temps ». Pièce du temps, son œuvre est donc plus reflet que miroir. On ne situe jamais si bien le moi dans l'histoire qu'à travers les histoires du moi (qui n'apparaissent que dans les Lettres, notes et carnets publiés en 1980) et l'imbrication continue des temps (celle que pratique Chateaubriand d'un bout à l'autre des Mémoires d'outre-tombe, quand il évoque, par exemple, à la fois son ambassade à Berlin en 1821, sa chasse maladroite avec Louis XVI en 1787 et la sylphide de son adolescence). D'où le déséquilibre sensible dans le style néoclassique du général, à qui il manque, dans le système de renvois, de symétries et de balancements, le tremblement né des doutes de l'homme et de l'arbitraire du destin.
Liens utiles
- commentaire: discours de bayeux de charles de gaulle
- Analyse du discours de Charles De Gaulle à l’hôtel de ville de Paris le 25 août 1944 Ce document est un discours prononcé par le général De Gaulle, à l’hôtel de ville de Paris le 25 août 1944.
- Une pollution sans frontières Aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, près de Paris, France.
- MÉMOIRES DE GUERRE de Charles De Gaulle (résumé)
- VERS L’ARMÉE DE MÉTIER de Charles de Gaulle (résumé)








