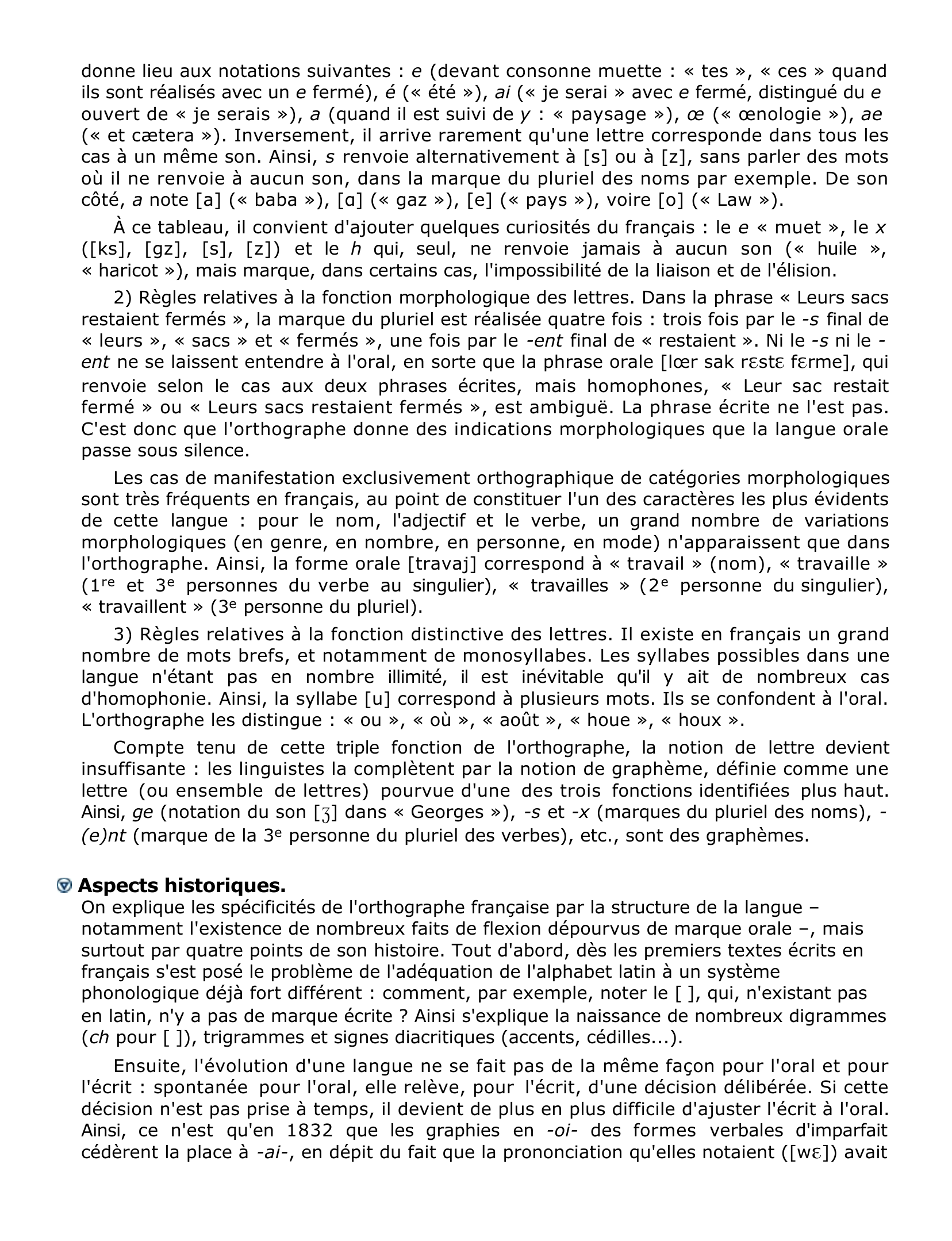orthographe.
Publié le 17/11/2013

Extrait du document
«
donne lieu aux notations suivantes : e (devant consonne muette : « tes », « ces » quand
ils sont réalisés avec un e fermé), é (« été »), ai (« je serai » avec e fermé, distingué du e
ouvert de « je serais »), a (quand il est suivi de y : « paysage »), œ (« œnologie »), ae
(« et cætera »).
Inversement, il arrive rarement qu'une lettre corresponde dans tous les
cas à un même son.
Ainsi, s renvoie alternativement à [s] ou à [z], sans parler des mots
où il ne renvoie à aucun son, dans la marque du pluriel des noms par exemple.
De son
côté, a note [a] (« baba »), [α] (« gaz »), [e] (« pays »), voire [o] (« Law »).
À ce tableau, il convient d'ajouter quelques curiosités du français : le e « muet », le x
([ks], [gz], [s], [z]) et le h qui, seul, ne renvoie jamais à aucun son (« huile »,
« haricot »), mais marque, dans certains cas, l'impossibilité de la liaison et de l'élision.
2) Règles relatives à la fonction morphologique des lettres.
Dans la phrase « Leurs sacs
restaient fermés », la marque du pluriel est réalisée quatre fois : trois fois par le -s final de
« leurs », « sacs » et « fermés », une fois par le -ent final de « restaient ».
Ni le -s ni le -
ent ne se laissent entendre à l'oral, en sorte que la phrase orale [lœr sak r pst p fprme], qui
renvoie selon le cas aux deux phrases écrites, mais homophones, « Leur sac restait
fermé » ou « Leurs sacs restaient fermés », est ambiguë.
La phrase écrite ne l'est pas.
C'est donc que l'orthographe donne des indications morphologiques que la langue orale
passe sous silence.
Les cas de manifestation exclusivement orthographique de catégories morphologiques
sont très fréquents en français, au point de constituer l'un des caractères les plus évidents
de cette langue : pour le nom, l'adjectif et le verbe, un grand nombre de variations
morphologiques (en genre, en nombre, en personne, en mode) n'apparaissent que dans
l'orthographe.
Ainsi, la forme orale [travaj] correspond à « travail » (nom), « travaille »
(1 re et 3 e personnes du verbe au singulier), « travailles » (2 e personne du singulier),
« travaillent » (3 e personne du pluriel).
3) Règles relatives à la fonction distinctive des lettres.
Il existe en français un grand
nombre de mots brefs, et notamment de monosyllabes.
Les syllabes possibles dans une
langue n'étant pas en nombre illimité, il est inévitable qu'il y ait de nombreux cas
d'homophonie.
Ainsi, la syllabe [u] correspond à plusieurs mots.
Ils se confondent à l'oral.
L'orthographe les distingue : « ou », « où », « août », « houe », « houx ».
Compte tenu de cette triple fonction de l'orthographe, la notion de lettre devient
insuffisante : les linguistes la complètent par la notion de graphème, définie comme une
lettre (ou ensemble de lettres) pourvue d'une des trois fonctions identifiées plus haut.
Ainsi, ge (notation du son [ È] dans « Georges »), -s et -x (marques du pluriel des noms), -
(e)nt (marque de la 3 e personne du pluriel des verbes), etc., sont des graphèmes.
Aspects historiques.
On explique les spécificités de l'orthographe française par la structure de la langue –
notamment l'existence de nombreux faits de flexion dépourvus de marque orale –, mais
surtout par quatre points de son histoire.
Tout d'abord, dès les premiers textes écrits en
français s'est posé le problème de l'adéquation de l'alphabet latin à un système
phonologique déjà fort différent : comment, par exemple, noter le [ ò], qui, n'existant pas
en latin, n'y a pas de marque écrite ? Ainsi s'explique la naissance de nombreux digrammes
(ch pour [ ò]), trigrammes et signes diacritiques (accents, cédilles...).
Ensuite, l'évolution d'une langue ne se fait pas de la même façon pour l'oral et pour
l'écrit : spontanée pour l'oral, elle relève, pour l'écrit, d'une décision délibérée.
Si cette
décision n'est pas prise à temps, il devient de plus en plus difficile d'ajuster l'écrit à l'oral.
Ainsi, ce n'est qu'en 1832 que les graphies en -oi- des formes verbales d'imparfait
cédèrent la place à -ai- , en dépit du fait que la prononciation qu'elles notaient ([w p]) avait.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Orthographe Le genre dans le groupe nominal Complète le tableau féminin masculin un gentil fermier sa
- Orthographe « ce » ou « se ».
- Orthographe La lettre « c » Complète avec "c" ou "ç".
- Orthographe Accords dans la phrase Tu accordes les mots soulignés si c'est nécessaire Le maître parle aux enfant .
- Orthographe Le nombre dans le groupe nominal Complète le tableau singulier pluriel un nouveau journal ces