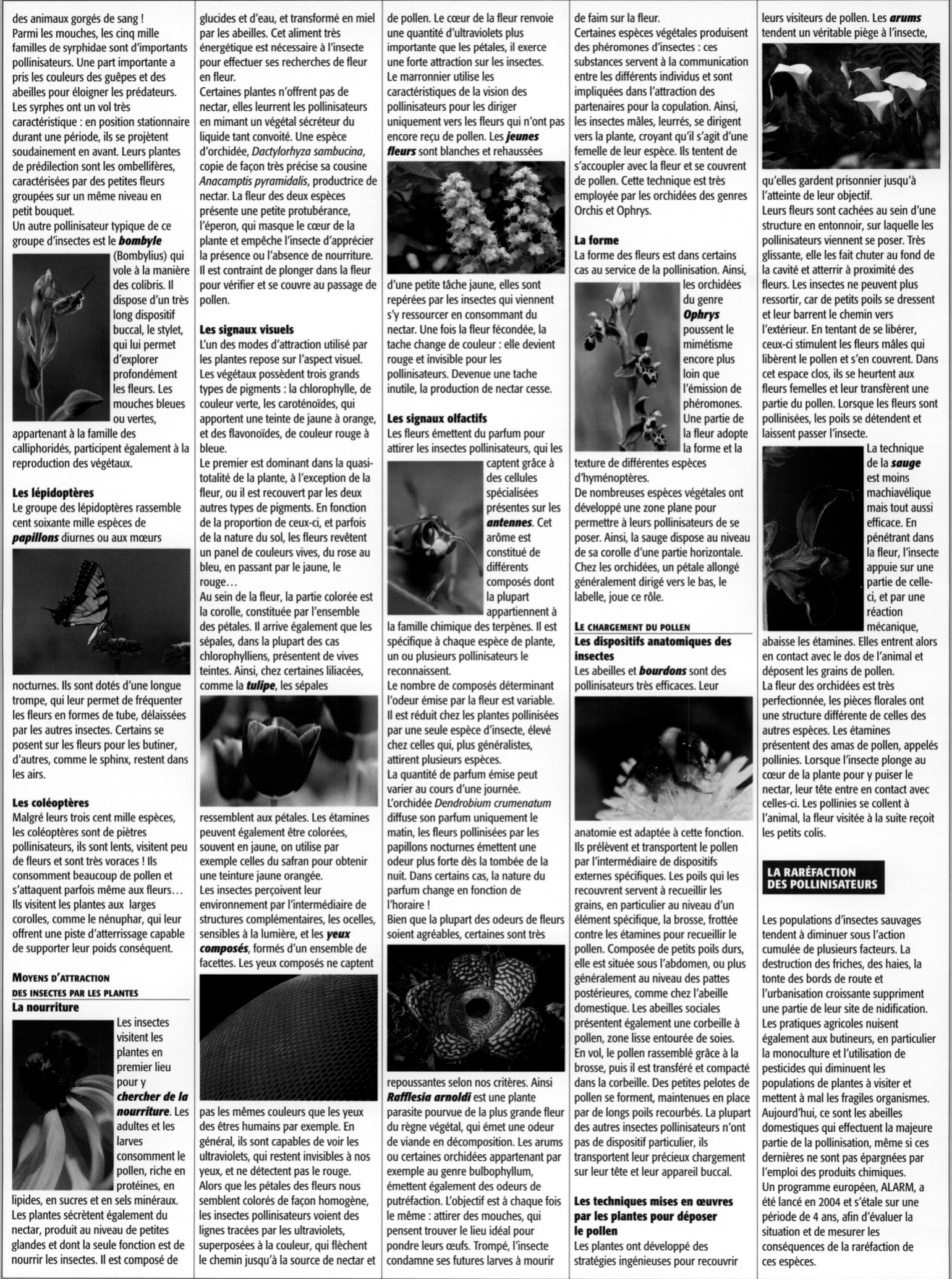Les insectes pollinisateurs
Publié le 15/09/2013

Extrait du document
Le milieu de vie des plantes aquatiques leur impose leur mode de pollinisation hydrophile, où le pollen dérive à la surface de l'eau au gré des courants.
Chez les angiospermes, les plantes les plus abouties du règne végétal, un mode de pollinisation trés perfectionné est apparu. Il implique des animaux comme vecteurs de transport du pollen. Ainsi, des chauves souris, des oiseaux, des mollusques ou plus généralement des insectes, pour une pollinisation alors qualifiée d'entomophile, servent de vecteurs de transport. Cette révolution dans le mode de pollinisation est liée à l'acquisition d'une nouvelle structure : la fleur. Dans la majorité des cas, elle est hermaphrodite : elle abrite à la fois la partie femelle, le pistil, et la partie mâle, constituée par les étamines. Cet ensemble est protégé par les pétales, aux multiples couleurs et par des petits éléments fréquemment verts, les sépales. Bien que l'autofécondation, réalisée au sein d'une même fleur ou entre deux fleurs de la même plante soit parfois possible, bon nombre de végétaux ont mis en place des mécanismes pour l'empêcher.
«
des animaux gorgés de sang ! Parmi les mouches, les cinq mille familles de syrphidae sont d'importants pollinisateurs.
Une part importante a pris les couleurs des guêpes et des abeilles pour éloigner les prédateurs .
Les syrphes ont un vol très caractéristique : en position stationnaire durant une période, ils se projètent soudainement en avant.
Leurs plantes de prédilection sont les ombellifères , caractérisées par des petites fleurs groupées sur un même niveau en petit bouquet.
Un autre pollinisateur typique de ce groupe d'insectes est le bombyle (Bomby lius) qui vole à la manière des colibris.
Il dispose d'un très long dispositif buccal, le stylet, qui lui permet d'explorer profondément les fleurs .
Les mouches bleues ou vertes , appartenant à la famille des calliphoridés , participent également à la reproduction des végétaux .
Les lépidoptères Le groupe des lépidoptères rassemble cent soixante mille espèces de papillons diurnes ou aux mœurs
nocturnes.
Ils sont dotés d'une longue trompe, qui leur permet de fréquenter les fleurs en formes de tube , délaissées par les autres insectes.
Certains se posent sur les fleurs pour les butiner, d'autres , comme le sphinx, restent dans les airs.
Les coléoptères Malgré leurs trois cent mille espèces, les coléoptères sont de piètres pollinisateurs, ils sont lents , visitent peu de fleurs et sont très voraces ! Ils consomment beaucoup de pollen et s'attaquent parfois même aux fleurs ...
Ils visitent les plantes aux larges corolles, comme le nénuphar, qui leur offrent une piste d'atterrissage capable de supporter leur poids conséquent.
MOYENS D'ATTRACTION DES INSECTES PAR LES PLANTES La nourriture
J
~
1 'l
A \1
Les insectes visitent les plantes en premier lieu pour y chercher de la nourriture.
Les adultes et les larves consomment le pollen, riche en protéine s, en lipides, en sucres et en sels minéraux .
Les plantes sécrètent également du nectar, produit au niveau de petites glandes et dont la seule fonction est de nourrir les insectes.
Il est composé de
glucides et d'eau , et transformé en miel par les abeilles .
Cet aliment très énergétique est nécessaire à l'insecte pour effectuer ses recherches de fleur en fleur.
Certaines plantes n'offrent pas de nectar , elles leurrent les pollinisateurs en mimant un végétal sécréteur du liquide tant convoité .
Une espèce d'orchidée , Dactylorhyza sambucina, copie de façon très précise sa cousine Anacamptis pyramida/is, productrice de nectar .
La fleur des deux espèces présente une petite protubérance , l'éperon, qui masque le cœur de la plante et empêche l'insecte d'apprécier la présence ou l'absence de nourriture.
Il est contraint de plonger dans la fleur pour vérifier et se couvre au passage de pollen .
Les signaux visuels L'un des modes d'attraction utilisé par les plantes repose sur l'aspect visuel.
Les végétaux possèdent trois grands types de pigments : la chlorophylle , de couleur verte, les caroténoïdes, qui apportent une teinte de jaune à orange, et des flavonoïdes, de couleur rouge à bleue .
Le premier est dominant dans la quasi totalité de la plante , à l'exception de la fleur, ou il est recouvert par les deux autres types de pigments.
En fonction de la proportion de ceux-ci , et parfois de la nature du sol, les fleurs revêtent un panel de couleurs vives , du rose au bleu, en passant par le jaune, le rouge ...
Au sein de la fleur , la partie colorée est la corolle, constituée par l'ensemble des pétales.
Il arrive également que les sépales, dans la plupart des cas chlorophylliens , présentent de vives teintes .
Ainsi , chez certaines liliacées , comme la tulipe , les sépales
ressemblent aux pétales .
Les étamines peuvent également être colorées, souvent en jaune , on utilise par exemple celles du safran pour obtenir une teinture jaune orangée .
Les insectes perçoivent leur environnement par l'intermédiaire de structures complémentaires, les ocelles, sensibles à la lumière, et les yeux composés , formés d'un ensemble de facettes.
Les yeux composés ne captent
pas les mêmes couleurs que les yeux des êtres humains par exemple.
En général, ils sont capables de voir les ultraviolets , qui restent invisibles à nos yeux, et ne détectent pas le rouge .
Alors que les pétales des fleurs nous semblent colorés de façon homogène , les insectes pollinisateurs voient des lignes tracées par les ultraviolets, superposées à la couleur, qui flèchent le chemin jusqu'à la source de nectar et
de pollen .
Le cœur de la fleur renvoie une quantité d 'ultraviolets plus importante que les pétales , il exerce une forte attraction sur les insectes.
Le marronnier utilise les caractéristiques de la vision des pollinisateurs pour les diriger uniquement vers les fleurs qui n'ont pas encore reçu de pollen.
Les jeunes fleurs sont blanches et rehaussées
d'une petite tâche jaune , elles sont repér ées par les insectes qui viennent s'y ressourcer en consommant du nectar.
Une fois la fleur fécondée , la tache change de couleur : elle devient rouge et invisible pour les pollinisateurs .
Devenue une tache inutile , la production de nectar cesse.
Les signaux olfadifs Les fleurs émettent du parfum pour attirer les insectes pollinisateurs , qui les captent grâce à des cellules spécialisées présentes sur les antennes.
Cet arôme est constitué de différents composés dont la plupart appartiennent à la famille chimique des terpènes .
Il est spécifique à chaque espèce de plante, un ou plusieurs pollinisateurs le reconnaissent.
Le nombre de composés déterminant l'odeur émise par la fleur est variable .
Il est réduit chez les plantes pollinisées par une seule espèce d 'insecte , élevé chez celles qui, plus généralistes, attirent plusieurs espèces.
La quantité de parfum émise peut varier au cours d'une journée.
L'orchidée Dendrobium crumenatum diffuse son parfum uniquement le matin, les fleurs pollinisées par les papillons nocturnes émettent une odeur plus forte dès la tombée de la nuit.
Dans certains cas, la nature du parfum change en fonction de l'horaire! Bien que la plupart des odeurs de fleurs soient agréables, certaines sont très
repoussantes selon nos critères.
Ainsi Rafflesia amoldi est une plante parasite pourvue de la plus grande fleur du règne végétal, qui émet une odeur de viande en décomposition .
Les arums ou certaines orchidées appartenant par exemple au genre bulbophyllum, émettent également des odeurs de putréfaction.
L'objectif est à chaque fois le même : attirer des mouches , qui pensent trouver le lieu idéal pour pondre leurs œufs.
Trompé , l'insecte condamne ses futures larves à mourir
de faim sur la fleur.
Certaines espèces végétales produisent des phéromones d'insectes : ces substances servent à la communication entre les différents individus et sont impliquées dans l 'attraction des partenaires pour la copulation.
Ainsi, les insectes mâles , leurré s, se dirigent vers la plante, croyant qu'il s'agit d'une femelle de leur espèce .
Ils tentent de s'accoupler avec la fleur et se couvrent de pollen.
Cette technique est très employée par les orchidées des genres Orchis et Ophrys .
La forme des fleurs est dans certains
du genre Ophrys poussent le mimétisme encore plus loin que l'émission de phéromones.
Une partie de la fleur adopte la forme et la texture de différentes espèces d 'hyménoptères .
De nombreuses espèces végétales ont développé une zone plane pour permettre à leurs pollinisateurs de se poser .
Ainsi, la sauge dispose au niveau de sa corolle d'une partie horizontale .
Chez les orchidées, un pétale allongé généralement dirigé vers le bas, le labelle , joue ce rôle .
LE CHARGEMENT DU POLLEN Les dispositifs anatomiques des in sertes Les abeilles et bourdons sont des
anatomie est adaptée à cette fonction.
Ils prélèvent et transportent le pollen par l'intermédiaire de dispositifs externes spécifiques.
Les poils qui les recouvrent servent à recueillir les grains, en particulier au niveau d'un élément spécifique, la brosse , frottée contre les étamines pour recueillir le pollen .
Compo sée de petits poils durs , elle est située sous l'abdomen, ou plus généralement au niveau des pattes postérieures , comme chez l'abeille domestique.
Les abeilles sociales présentent également une corbeille à pollen , zone lisse entourée de soies.
En vol, le pollen rassemblé grâce à la brosse , puis il est transfér é et compacté dans la corbeille.
Des petites pelotes de pollen se forment, maintenues en place par de longs poils recourbés .
La plupart des autres insectes pollinisateurs n'ont pas de dispositif part iculier, ils transportent leur précieux chargement sur leur tête et leur appareil buccal.
Les techniques mises en œuvres par les plantes pour déposer le pollen Les plantes ont développé des stratégies ingénieuses pour recouvrir
leurs visiteurs de pollen .
Les arums tendent un véritable piège à l'insecte,
qu'elles gardent prisonnier jusqu 'à l'atteinte de leur objectif.
Leurs fleurs sont cachées au sein d'une structure en entonnoir , sur laquelle les pollinisateurs viennent se poser .
Très glissante, elle les fait chuter au fond de la cavité et atterrir à proximité des fleurs.
Les insectes ne peuvent plus ressortir , car de petits poils se dressent et leur barrent le chemin vers l'extérieur.
En tentant de se libérer , ceux-ci stimulent les fleurs mâles qui libèrent le pollen et s'en couvrent.
Dans cet espace clos, ils se heurtent aux fleurs femelles et leur transfèrent une partie du pollen.
Lorsque les fleurs sont pollinisées, les poils se détendent et laissent passer l'insecte.
La technique de la sauge est moins machiavélique mais tout aussi efficace.
En pénétrant dans la fleur, l'insecte appuie sur une partie de celle ci, et par une réaction
en contact avec le dos de l'animal et déposent les grains de pollen.
La fleur des orchidées est très perfectionnée , les pièces florales ont une structure différente de celles des autres espèces.
Les étamines présentent des amas de pollen, appelés pollinies.
Lorsque l'insecte plonge au cœur de la plante pour y puiser le nectar, leur tête entre en contact avec celles-ci.
Les pollinies se collent à l'animal , la fleur visitée à la suite reçoit les petits colis.
LA RARÉFACTION DES POLLINISATEURS
Les populations d 'insectes sauvages tendent à diminuer sous l'action cumulée de plusieurs facteurs .
La destruction des friches, des haies , la tonte des bords de route et l'urbanisation croissante suppriment une partie de leur site de nidification.
Les pratiques agricoles nuisent également aux butineurs, en particulier la monoculture et l'utilisation de pesticides qui diminuent les populations de plantes à visiter et mettent à mal les fragiles organismes .
Aujourd'hui, ce sont les abeilles domestiques qui effectuent la majeure partie de la pollinisation, même si ces dernières ne sont pas épargnées par l'emploi des produits chimiques.
Un programme européen, ALARM , a été lancé en 2004 et s'étale sur une période de 4 ans, afin d'évaluer la situation et de mesurer les conséquences de la raréfaction de ces espèces..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MÉMOIRES POUR SERVIR A L’HISTOIRE DES INSECTES de René-Antoine de Réaumur - résumé, analyse
- LA CLASSIFICATION Le 1er classificateur est Aristote qui distingue 2 classes : les animaux avec sang -les animaux sans sang ou à sang incolore Au 18ème siècle Linné distingue 6 groupes : -les quadrupèdesles oiseaux - les amphibiens- les insectes- les poissons- les vers.
- Riche de 165 000 espèces actuellement décrites, l'ordre des lépidoptères constitue plus de 13 % de la classe des insectes et représente près de 10 % de l'ensemble du règne animal.
- L es insectes, dont on connaît actuellement 1 250 000 espèces, mais dont le nombre pourrait osciller entre 5 et 25 millions, représentent environ 80 % de l'ensemble du règne animal.
- Fabre Jean Henri, 1823-1915, né à Saint-Léon (Aveyron), entomologiste français connu pour ses travaux sur l'anatomie et le comportement des insectes.