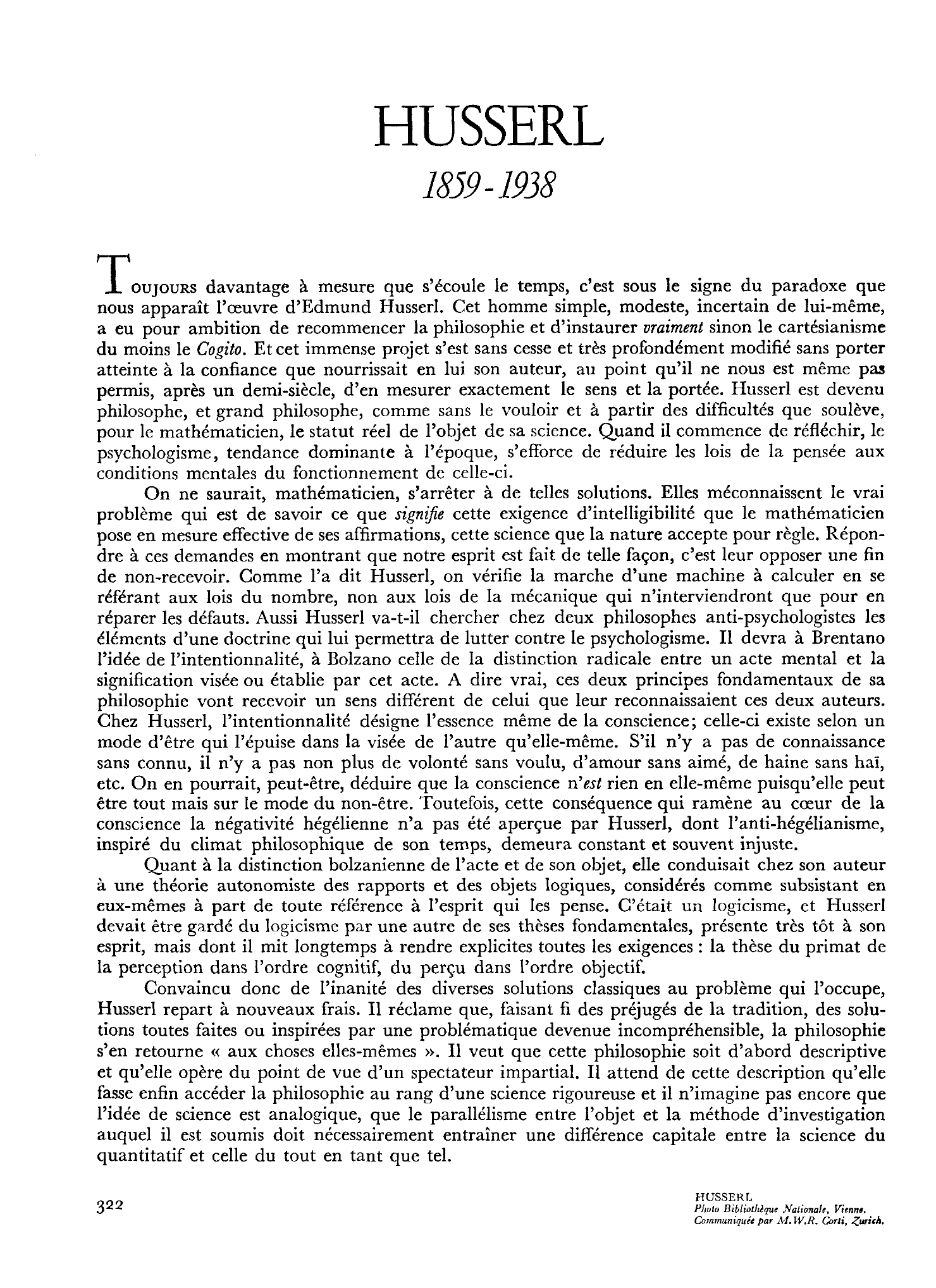FICHE DE REVISION: HUSSERL
Publié le 14/06/2011

Extrait du document
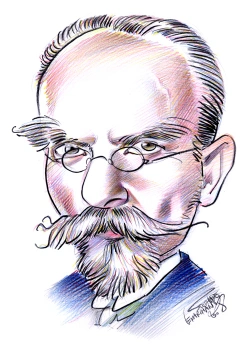
Dans l'esprit du néo-kantisme et réagissant contre les abus de la spéculation, Edmond HUSSERL, professeur à l'Université de Fribourg-en-Brisgau, donnait comme mot d'ordre : revenons « aux choses elles-mêmes «, c'est-à-dire à ce qui est donné immédiatement et par suite indiscutablement. Or, pour lui, il n'y a de données immédiates que les phénomènes. C'est donc le phénomène qui doit d'abord retenir l'attention du philosophe. Par là, HUSSERL est le fondateur de la phénoménologie dont il exposa le programme dans Idées directrices pour une phénoménologie (1913, trad. par P. RICŒUR, Gallimard, 1950). Il résuma sa philosophie dans des conférences données à la Sorbonne sous le titre de Méditations cartésiennes (1929). Depuis DESCARTES, la philosophie se bute à ce problème : n'y a-t-il que des phénomènes ou aussi des choses en soi ? L'impossibilité de répondre de façon satisfaisante doit venir d'un défaut de méthode. Il faut reprendre l'itinéraire cartésien, mais avec beaucoup plus de prudence.
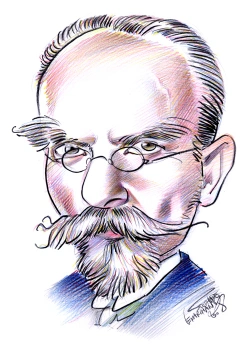
«
HUSSERL
1859-1938
TOUJOURS davantage à mesure que s'écoule le temps, c'est sous le signe du paradoxe que
nous apparaît l'œuvre d'Edmund Husserl.
Cet homme simple, modeste, incertain de lui-même,
a
eu pour ambition de recommencer la philosophie et d'instaurer vraiment sinon le cartésianisme
du moins le Cogito.
Et cet immense projet s'est sans cesse et très profondément modifié sans porter
atteinte à la confiance que nourrissait en lui son auteur, au point qu'il ne nous est même pas
permis, après un demi-siècle, d'en mesurer exactement le sens et la portée.
Husserl est devenu
philosophe,
et grand philosophe, comme sans le vouloir ct à partir des difficultés que soulève,
pour le mathématicien, le statut réel de l'objet de sa science.
Quand il commence de réfléchir, le
psychologisme,
tendance dominante à l'époque, s'efforce de réduire les lois de la pensée aux
conditions mentales du fonctionnement de celle-ci.
On ne saurait, mathématicien, s'arrêter à de telles solutions.
Elles méconnaissent le vrai
problème
qui est de savoir ce que signifie cette exigence d'intelligibilité que le mathématicien
pose en mesure effective de ses affirmations, cette science que la nature accepte pour règle.
Répon
dre à ces demandes en montrant que notre esprit est fait de telle façon, c'est leur opposer une fin
de non-recevoir.
Comme l'a dit Husserl, on vérifie la marche d'une machine à calculer en se
référant aux lois du nombre, non aux lois de la mécanique qui n'interviendront que pour en
réparer les défauts.
Aussi Husserl va-t-il chercher chez deux philosophes anti-psychologistes les
éléments
d'une doctrine qui lui permettra de lutter contre le psychologisme.
Il devra à Brentano
l'idée
de l'intentionnalité, à Bolzano celle de la distinction radicale entre un acte mental et la
signification visée ou établie par cet acte.
A dire vrai, ces deux principes fondamentaux de sa
philosophie
vont recevoir un sens différent de celui que leur reconnaissaient ces deux auteurs.
Chez Husserl, l'intentionnalité désigne l'essence même de la conscience; celle-ci existe selon un
mode d'être qui l'épuise dans la visée de l'autre qu'elle-même.
S'il n'y a pas de connaissance
sans connu, il
n'y a pas non plus de volonté sans voulu, d'amour sans aimé, de haine sans haï,
etc.
On en pourrait, peut-être, déduire que la conscience n'est rien en elle-même puisqu'elle peut
être tout mais sur le mode du non-être.
Toutefois, cette conséquence qui ramène au cœur de la
conscience la négativité hégélienne n'a pas été aperçue par Husserl, dont l'anti-hégélianisme,
inspiré
du climat philosophique de son temps, demeura constant et souvent injuste.
Quant à la distinction bolzanienne de l'acte et de son objet, elle conduisait chez son auteur
à une théorie autonomiste des rapports et des objets logiques, considérés comme subsistant en
eux-mêmes à part de toute référence à l'esprit qui les pense.
C'était un logicisme, et Husserl
devait
être gardé du logicisme par une autre de ses thèses fondamentales, présente très tôt à son
esprit, mais
dont il mit longtemps à rendre explicites toutes les exigences: la thèse du primat de
la perception dans l'ordre cognitif, du perçu dans l'ordre objectif.
Convaincu donc de l'inanité des diverses solutions classiques au problème qui l'occupe,
Husserl
repart à nouveaux frais.
Il réclame que, faisant fi des préjugés de la tradition, des solu
tions toutes faites
ou inspirées par une problématique devenue incompréhensible, la philosophie
s'en retourne « aux choses elles-mêmes ».
Il veut que cette philosophie soit d'abord descriptive
et qu'elle opère du point de vue d'un spectateur impartial.
Il attend de cette description qu'elle
fasse enfin accéder
la philosophie au rang d'une science rigoureuse et il n'imagine pas encore que
l'idée de science est analogique, que le parallélisme entre l'objet et la méthode d'investigation
auquel il est soumis doit nécessairement entraîner une différence capitale entre la science du
quantitatif et celle du tout en tant que tel.
HUSSERL Photo Bibliothèque }..falionale, Vienn1.
Communiquée par lvf.
W.R.
Corli, Zuriûa.
j
1
1
,
1
,
1 1 1
1 i.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FICHE DE REVISION Incipit Fin de Partie, Samuel Beckett
- Fiche revision HG Revolution industrielle
- Philosophie fiche de revision
- fiche de revision
- FICHE DE REVISION DROIT DES PERSONNES POUR CONTR. SC3