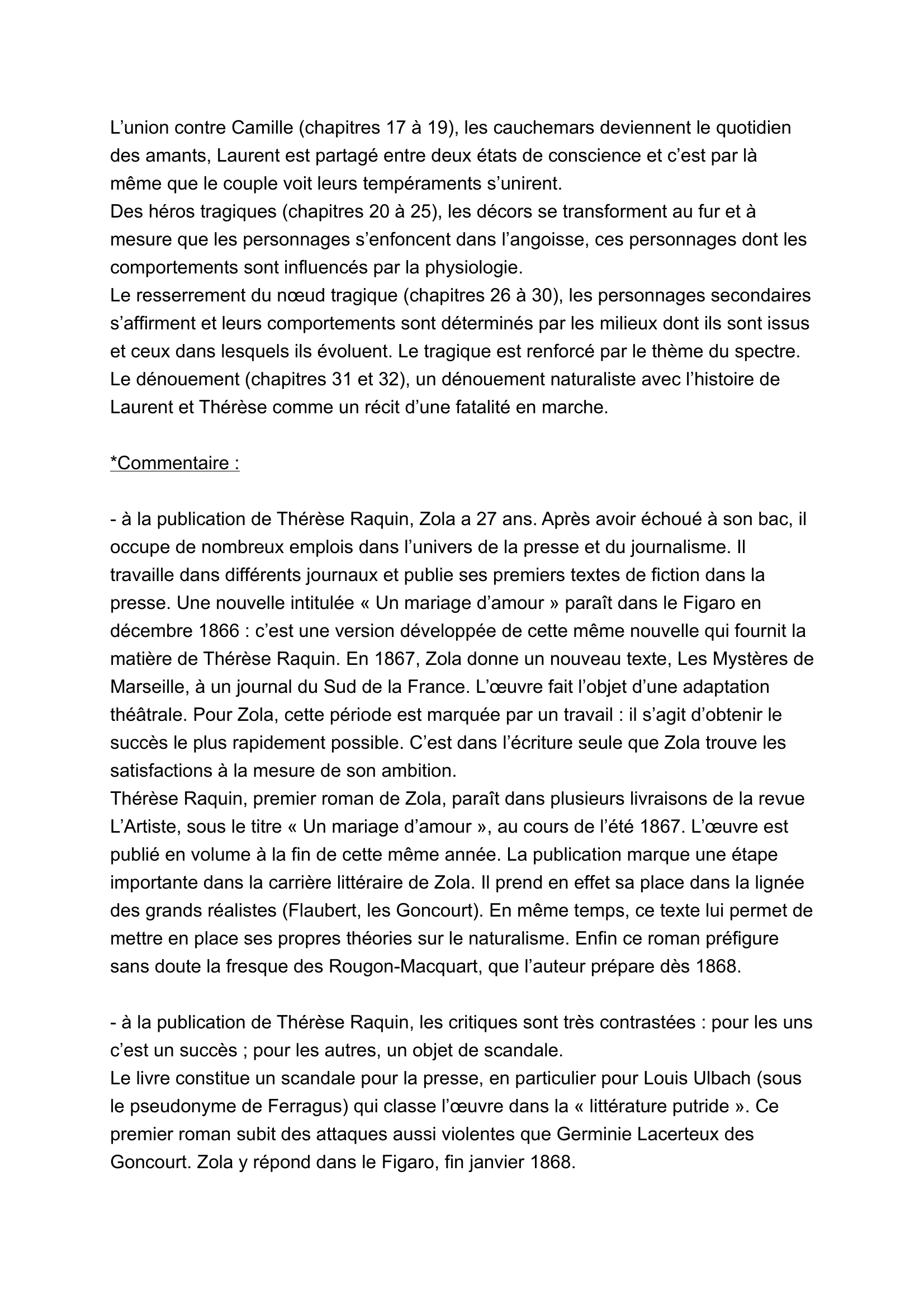Thrèse Raquin
Publié le 19/11/2012

Extrait du document
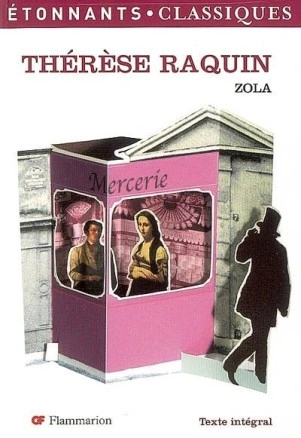
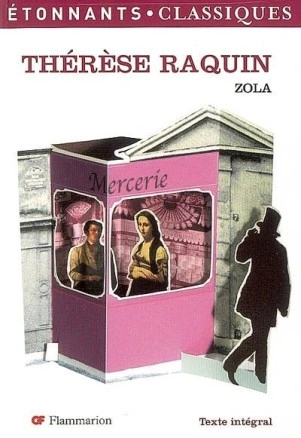
«
L’union contre Camille (chapitres 17 à 19), les cauchemars deviennent le quotidien
des amants, Laurent est partagé entre deux états de conscience et c’est par là
même que le couple voit leurs tempéraments s’unirent.
Des héros tragiques (chapitres 20 à 25), les décors se transforment au fur et à
mesure que les personnages s’enfoncent dans l’angoisse, ces personnages dont les
comportements sont influencés par la physiologie.
Le resserrement du nœud tragique (chapitres 26 à 30), les personnages secondaires
s’affirment et leurs comportements sont déterminés par les milieux dont ils sont issus
et ceux dans lesquels ils évoluent.
Le tragique est renforcé par le thème du spectre.
Le dénouement (chapitres 31 et 32), un dénouement naturaliste avec l’histoire de
Laurent et Thérèse comme un récit d’une fatalité en marche.
*Commentaire :
- à la publication de Thérèse Raquin, Zola a 27 ans.
Après avoir échoué à son bac, il
occupe de nombreux emplois dans l’univers de la presse et du journalisme.
Il
travaille dans différents journaux et publie ses premiers textes de fiction dans la
presse.
Une nouvelle intitulée « Un mariage d’amour » paraît dans le Figaro en
décembre 1866 : c’est une version développée de cette même nouvelle qui fournit la
matière de Thérèse Raquin.
En 1867, Zola donne un nouveau texte, Les Mystères de
Marseille, à un journal du Sud de la France.
L’œuvre fait l’objet d’une adaptation
théâtrale.
Pour Zola, cette période est marquée par un travail : il s’agit d’obtenir le
succès le plus rapidement possible.
C’est dans l’écriture seule que Zola trouve les
satisfactions à la mesure de son ambition.
Thérèse Raquin, premier roman de Zola, paraît dans plusieurs livraisons de la revue
L’Artiste, sous le titre « Un mariage d’amour », au cours de l’été 1867.
L’œuvre est
publié en volume à la fin de cette même année.
La publication marque une étape
importante dans la carrière littéraire de Zola.
Il prend en effet sa place dans la lignée
des grands réalistes (Flaubert, les Goncourt).
En même temps, ce texte lui permet de
mettre en place ses propres théories sur le naturalisme.
Enfin ce roman préfigure
sans doute la fresque des Rougon-Macquart, que l’auteur prépare dès 1868.
- à la publication de Thérèse Raquin, les critiques sont très contrastées : pour les uns
c’est un succès ; pour les autres, un objet de scandale.
Le livre constitue un scandale pour la presse, en particulier pour Louis Ulbach (sous
le pseudonyme de Ferragus) qui classe l’œuvre dans la « littérature putride ».
Ce
premier roman subit des attaques aussi violentes que Germinie Lacerteux des
Goncourt.
Zola y répond dans le Figaro, fin janvier 1868..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Plan détaillé dissertation Thérèse Raquin: une oeuvre immorale ?
- Commentaire Thérèse Raquin chapitre XXXII
- Thérèse Raquin de Zola - Résumé par chapitre
- Résumé thérèse raquin par chapitre
- Les personnages - Thérèse Raquin de Zola