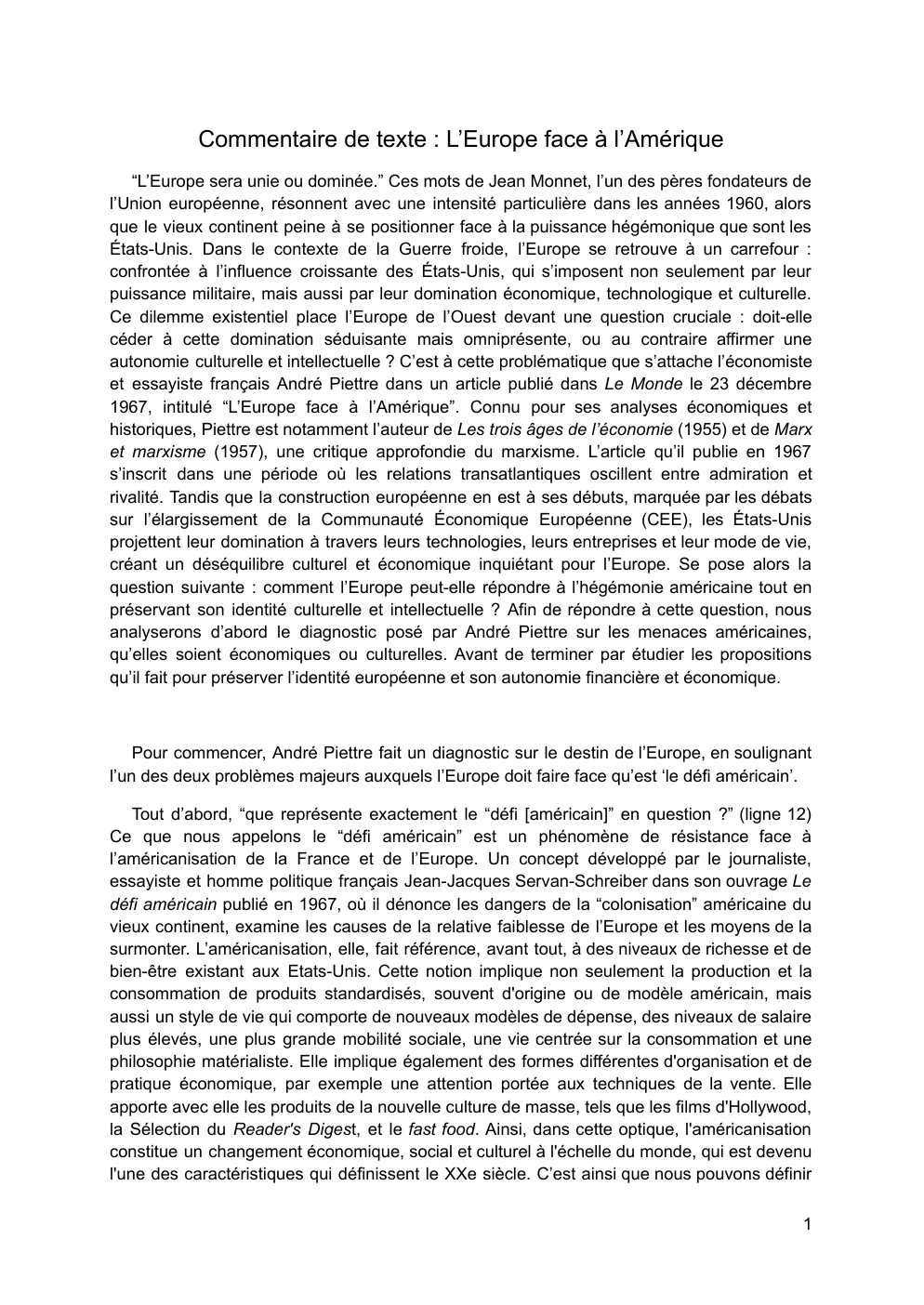Commentaire de texte : L'Europe face à l'Amérique
Publié le 25/04/2025
Extrait du document
«
Commentaire de texte : L’Europe face à l’Amérique
“L’Europe sera unie ou dominée.” Ces mots de Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de
l’Union européenne, résonnent avec une intensité particulière dans les années 1960, alors
que le vieux continent peine à se positionner face à la puissance hégémonique que sont les
États-Unis.
Dans le contexte de la Guerre froide, l’Europe se retrouve à un carrefour :
confrontée à l’influence croissante des États-Unis, qui s’imposent non seulement par leur
puissance militaire, mais aussi par leur domination économique, technologique et culturelle.
Ce dilemme existentiel place l’Europe de l’Ouest devant une question cruciale : doit-elle
céder à cette domination séduisante mais omniprésente, ou au contraire affirmer une
autonomie culturelle et intellectuelle ? C’est à cette problématique que s’attache l’économiste
et essayiste français André Piettre dans un article publié dans Le Monde le 23 décembre
1967, intitulé “L’Europe face à l’Amérique”.
Connu pour ses analyses économiques et
historiques, Piettre est notamment l’auteur de Les trois âges de l’économie (1955) et de Marx
et marxisme (1957), une critique approfondie du marxisme.
L’article qu’il publie en 1967
s’inscrit dans une période où les relations transatlantiques oscillent entre admiration et
rivalité.
Tandis que la construction européenne en est à ses débuts, marquée par les débats
sur l’élargissement de la Communauté Économique Européenne (CEE), les États-Unis
projettent leur domination à travers leurs technologies, leurs entreprises et leur mode de vie,
créant un déséquilibre culturel et économique inquiétant pour l’Europe.
Se pose alors la
question suivante : comment l’Europe peut-elle répondre à l’hégémonie américaine tout en
préservant son identité culturelle et intellectuelle ? Afin de répondre à cette question, nous
analyserons d’abord le diagnostic posé par André Piettre sur les menaces américaines,
qu’elles soient économiques ou culturelles.
Avant de terminer par étudier les propositions
qu’il fait pour préserver l’identité européenne et son autonomie financière et économique.
Pour commencer, André Piettre fait un diagnostic sur le destin de l’Europe, en soulignant
l’un des deux problèmes majeurs auxquels l’Europe doit faire face qu’est ‘le défi américain’.
Tout d’abord, “que représente exactement le “défi [américain]” en question ?” (ligne 12)
Ce que nous appelons le “défi américain” est un phénomène de résistance face à
l’américanisation de la France et de l’Europe.
Un concept développé par le journaliste,
essayiste et homme politique français Jean-Jacques Servan-Schreiber dans son ouvrage Le
défi américain publié en 1967, où il dénonce les dangers de la “colonisation” américaine du
vieux continent, examine les causes de la relative faiblesse de l’Europe et les moyens de la
surmonter.
L’américanisation, elle, fait référence, avant tout, à des niveaux de richesse et de
bien-être existant aux Etats-Unis.
Cette notion implique non seulement la production et la
consommation de produits standardisés, souvent d'origine ou de modèle américain, mais
aussi un style de vie qui comporte de nouveaux modèles de dépense, des niveaux de salaire
plus élevés, une plus grande mobilité sociale, une vie centrée sur la consommation et une
philosophie matérialiste.
Elle implique également des formes différentes d'organisation et de
pratique économique, par exemple une attention portée aux techniques de la vente.
Elle
apporte avec elle les produits de la nouvelle culture de masse, tels que les films d'Hollywood,
la Sélection du Reader's Digest, et le fast food.
Ainsi, dans cette optique, l'américanisation
constitue un changement économique, social et culturel à l'échelle du monde, qui est devenu
l'une des caractéristiques qui définissent le XXe siècle.
C’est ainsi que nous pouvons définir
1
l’américanisation.
Face à cela une réaction française va jaillir afin de s’opposer à ce
problème majeur qui tient “l’opinion et tiennent en suspens notre avenir : c’est à l’extérieur le
destin de l’Europe face au “défi américain” [...]” (lignes 1-2).
A ce “défi américain”, l’auteur en
tire “deux périls différents” (ligne 12).
Le premier est “le risque d’une sujétion économique”
(ligne 14) et le second le risque de “l’aliénation culturelle” de l’identité européenne (ligne 33).
Deux périls que nous allons immédiatement étudier.
Le premier péril que souligne André Piettre est celui d’une domination économique des
États-Unis sur l’Europe.
Il alerte ainsi sur un risque de dépendance croissante, qu’il qualifie
de "sujétion économique et financière" (lignes 14-15), comme en témoigne la signature des
accords de Bretton Woods en 1944, permettant la création d’un nouveau système monétaire
international tourné exclusivement autour du dollar où les taux de change étaient fixés à la
fois contre l’or et le dollar.
Cependant, il nuance ce constat en reconnaissant "les stimulants
que l'importation des techniques américaines vaut à nos propres progrès" (lignes 15-16),
rappelant les effets positifs du transfert de savoir-faire initié par des programmes comme le
Plan Marshall.
Ce plan, mis en œuvre au début des années 1950, visait non seulement à
reconstruire l’Europe mais aussi à promouvoir l’efficacité économique à l’américaine.
À ce
titre, des groupes de travail français sur la productivité furent envoyés aux États-Unis pour
observer leurs méthodes et processus.
Également, une loi votée en juillet 1948 a permis à
2.600 personnes de se rendre aux États-Unis pour une période de deux mois et d’observer
l’utilisation des techniques modernes.
Ces groupes de travail ont été financés à la fois par les
gouvernements français et américain et par la Confédération Nationale du Patronat Français.
En outre, la Commission du Plan met en place des comités de productivité présidés par
l’économiste Jean Fourastié.
Entre 1953 et 1957, le plan Hirsch prévoyait des gains de
productivité dans tous les secteurs de l’économie.
Ces initiatives ont permis à la France de
combler partiellement son retard : si, entre 1913 et 1950, les niveaux de productivité français
étaient passés de 56 à 45 (sur une échelle où les États-Unis atteignent 100), la période des
années 1950-1960 marque un début de rattrapage grâce à des efforts concertés dans les
secteurs économiques et technique clés.
Au point d’atteindre en 1973, 76.
Pour autant,
André Piettre insiste sur une problématique plus structurelle : la supériorité américaine
repose aussi sur une gestion des entreprises et une capacité d’innovation technologique
inégalées, comme en témoigne la situation des brevets en France, où 21 % des dépôts en
1966 provenaient des États-Unis (lignes 21-22).
Autre exemple, la première entreprise à
‘s’américaniser’, le journal Le Figaro qui a introduit ce qu'on a appelé une manière totalement
nouvelle de gérer l'entreprise de presse.
Jusqu'alors, l'approche européenne consistait à
s'appuyer sur des journalistes indépendants.
Mais dans les années 1880, Le Figaro a
embauché des journalistes à titre permanent et les a envoyés faire des recherches, comme
le faisaient les journaux aux États-Unis.
Cette méthode n'était pas seulement révolutionnaire,
elle était aussi extrêmement coûteuse : seuls les grands journaux pouvaient se permettre
d'utiliser la méthode américaine.
Avec un investissement d'une ampleur inconnue
jusqu'alors, Le Figaro s'est professionnalisé et commercialisé en adoptant les modèles de
comportement américains, et elle ne sera pas la dernière.
Troisième exemple, le fordisme.
Le fordisme est un modèle d’organisation industrielle et économique associé à l’entreprise
automobile américaine Ford Motor Company, fondée par Henry Ford au début du XXe siècle.
Un modèle qui repose sur l’utilisation systématique de la chaîne de montage, permettant de
diviser le travail en tâches simples et répétitives.
Cette organisation, combinée à la
standardisation des produits, réduit considérablement les coûts et accélère la fabrication.
Ces faits illustrent la dépendance européenne vis-à-vis des normes et modèles économiques
2
américains, que Piettre attribue également à un "gap technologique" qu’il qualifie de "
psychologique (ou pédagogique)" (ligne 19).
Pour comprendre ce "gap technologique", la
Silicon Valley des années 1960 offre un exemple emblématique.
Située autour de Palo Alto
en Californie, cette région devient un centre mondial de l’innovation grâce à plusieurs
facteurs : le rôle stratégique de Stanford University, qui collabore étroitement avec des
entreprises comme Fairchild Semiconductor et Hewlett-Packard ; l’appui du gouvernement
américain via des financements militaires et des contrats de recherche ; et une culture
entrepreneuriale unique favorisant la mobilité des talents et les partenariats entre
entreprises.
Cette dynamique permet aux États-Unis de construire un écosystème
technologique intégré, tandis qu’en Europe, les initiatives restent fragmentées et ancrées
dans des méthodes éducatives plus théoriques.
En effet, la recherche européenne, dans
l’après-guerre, était encore sous-financée et peu connectée aux besoins industriels.
En
intégrant les pratiques américaines tout en respectant les spécificités européennes, Piettre
appelle à une réforme des méthodes éducatives pour favoriser des synergies entre
universités et entreprises, comme celles observées en Californie.
Car, selon lui, cela “traduit
“l’infériorité intellectuelle de l’Europe vis-à-vis des Etat-Unis” (ligne 20).
Ainsi, une telle
stratégie serait essentielle pour réduire ce fossé technologique et protéger l’autonomie
économique de l’Europe face à l’hégémonie américaine.
Enfin, le second péril identifié par André Piettre est celui d’une "aliénation culturelle" (ligne
33), menaçant l’identité européenne face à l’influence croissante des États-Unis.
Comme le
souligne Raymond Aron : "c’est au moment précis où l’opinion publique se raidit à l’égard de
la politique américaine, que les mœurs […] tendent à s’américaniser" (ligne 34-36).
Exactement, alors qu’une partie des élites européennes critiquent ouvertement la politique
américaine, les modes de vie et les valeurs promues par les États-Unis s’imposent
progressivement au sein des sociétés européennes.
L’américanisation de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- COMMENTAIRE DE TEXTE « LES FORME DE LA PAUVRETE EN EUROPE » S.
- Commentaire de texte - Tocqueville - De la démocratie en amérique Tome II / 1ère partie / chap. 2
- Commentaire de texte : Extrait du discours de Barack OBAMA prononcé le 18 mars 2008 à Philadelphie – « De la race en Amérique »
- Constitution des Etats-Unis d'Amérique 17 septembre 1787 - Commentaire de texte historique
- COMMENTAIRE DE TEXTE (concours administratifs)