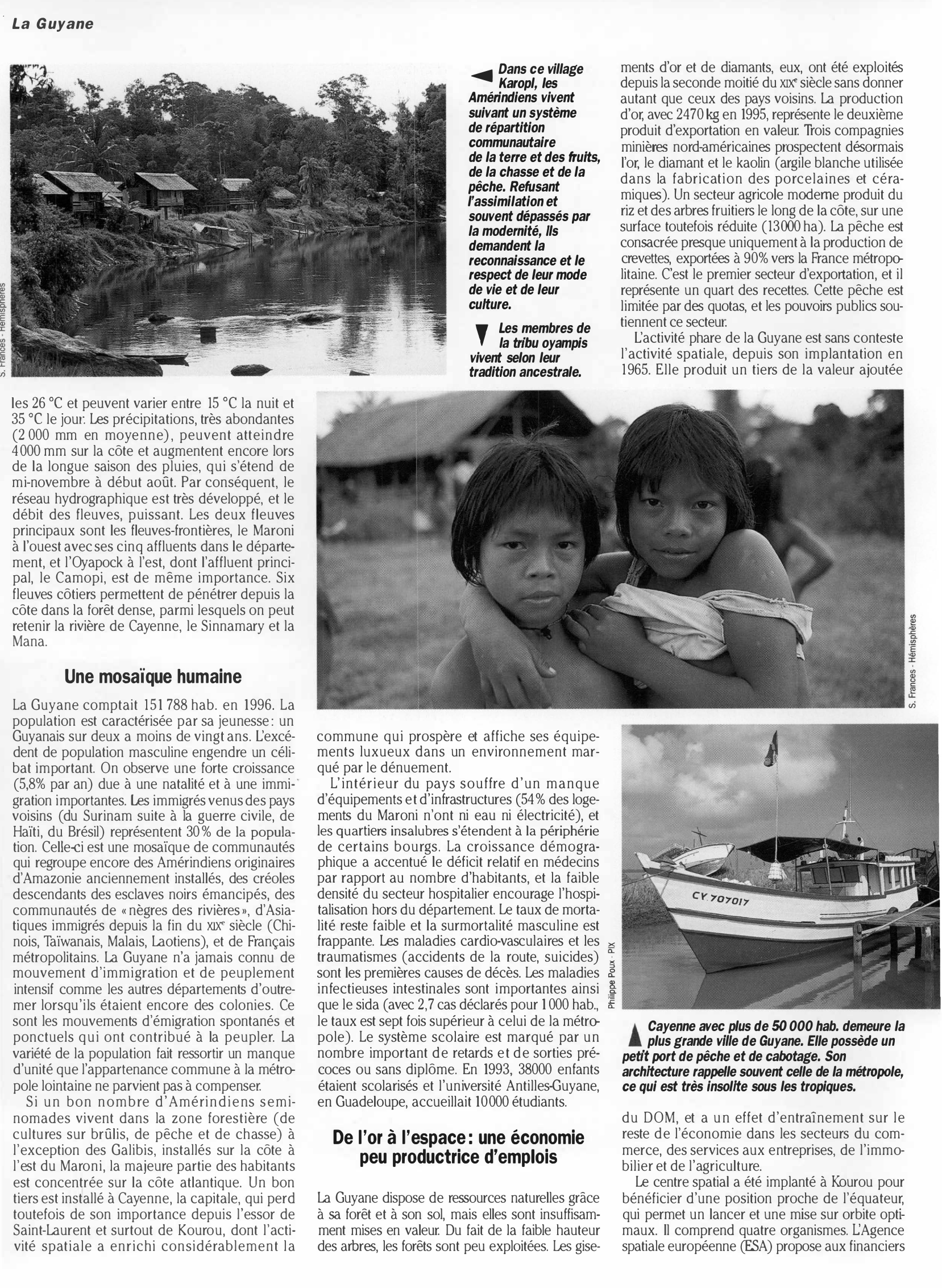Géographie LA GUYANE
Publié le 28/01/2019

Extrait du document
gées par la consommation de rhum. L’acculturation pose problème: alors que les Galibis, qui ont l'habitude du contact avec les Blancs, sont au centre d'un renouveau identitaire, les Wayapis sont dépassés par les mutations de leur société et oublient de se souvenir de leur culture. Les Arawaks et les Palikours vivent très mal cette confrontation. À côté des Amérindiens, les créoles se présentent eux-mêmes comme une large palette d'individus, pourtant liés par leur langue commune. Enfin, parmi les Asiatiques, les Hmongs, venus de Thaïlande, constituent un groupe qui a importé sa structure traditionnelle clanique dirigée par le conseil des anciens. Leurs langue, danses, costumes et fêtes traditionnelles préservés, ils réussissent par leur cohésion sociale et sans résister à la culture française à s'imposer dans la culture maraîchère, malgré tous les obstacles qu'on leur oppose .
LE SAVIEZ-VOUS?
Le créole est un langage qui a été inventé par les esclaves. Il s'est formé à partir des dialectes africains et de la langue française, de manière à être compris par tous les compagnons d'infortune qui se trouvaient enchaînés, tout en restant inintelligible aux maîtres français. Ce langage est également le support de toute une culture apparentée au vaudou haïtien.
.. Fleuve qui sépare - ou plutôt qui relie -la Guyane française au Surinam, le Maroni n'est pas une frontière facile à garder. Près de 10 000 surinamiens l'ont franchi entre 1985 et 1990 pour se réfugier en Guyane. Beaucoup sont depuis lors repartis. Même si les camps de réfugiés ont disparu, les va et vient d'un côté à l'autre de la frontière sont incessants.
LE SAVIEZ-VOUS?
1er janvier 1989: Awala-Yalimapo, la première commune amérindienne, est créée suite aux revendications de I'EPWWAG. Ce mouvement regroupe les six ethnies indiennes du territoire, dont les initiales forment Je nom : Ëme-rillons, Palikours, Wayanas, Wayampis, Arawaks et Galibis. La reconnaissance en tant que nation indigène et l'usage de la terre sont au cœur des revendications depuis 1984, et les communautés indiennes ont obtenu la reconnaissance de leurs droits d'usage et la cession de parcelles de terrain pour l'agriculture, la chasse et l'habitat selon leurs méthodes traditionnelles. Cela ne correspond pas toujours à leurs habitudes de nomades et s'apparente à la création de réserves indiennes, alors même que, depuis 1971, un territoire indien est officieusement accordé aux Oyampis, Émerillons et Wayanas, qui correspond au sud du département.
«
·
La Guyane
les 26 oc et peuvent varier entre 15 oc la nuit et
35 oc le jour.
Les précipitations, très abondantes
(2 000 mm en moyenne ), peuvent atteindr e
40 00 mm sur la côte et augmentent encore lors
de la longue saison des pluies, qui s'étend de
mi -nov embr e à début août.
Par conséquent, le
réseau hydrogr aphique est très développé, et le
débit des fleuves, puissant.
Les deux fleuv es
principaux sont les fleuves-fr ontières, le Maroni
à l'ouest avec ses cinq affluents dans le dépar te
ment, et l'O yapock à l'est, dont l'affluent princi
pal, le Camopi, est de même importance.
Six
fleuv es côtier s permettent de pénét rer depuis la
côte dans la forêt dense, parmi lesquels on peut
re tenir la rivière de Cay enne, le Sin nam ary et la
Mana.
Une mosaïque humaine
La Guyane comptait 151788 hab.
en 1996.
La
population est caractérisée par sa jeu nesse : un
Guyanais sur deux a moins de vingt ans.
L'excé
dent de population masculine engendre un céli
bat important.
On observe une forte croissance
(5,8% par an) due à une natalité et à une immi
gration importantes.
Les imm igrés venus des pays
voisins (du Surinam suite à la guer re civile, de
Haï ti, du Brésil) représentent 30% de la popula
tion.
Celle-ci est une mosaïque de communa utés
qui regroupe encore des Amérindiens originaires
d'Amazonie anciennement installés, des créoles
descendant s des esclaves noirs émancipés, des
commu nautés de "nègres des rivièr es», d'Asia
tique s imm igrés depuis la fin du XIX" siècle (Chi
nois, Taïwa nais, Malais, Laotiens), et de Français
métropolitains.
La Guyane n'a jamais connu de
mouvement d'immigration et de peuplemen t
intensif comme les autres département s d'ou tre
mer lorsq u'ils étaient encore des colonies.
Ce
sont les mouvement s d'ém igration spontanés et
ponctuels qui ont contribué à la peup ler.
La
variété de la population fait ressortir un manque
d'unité que l'appartenance commune à la métro
pole lointaine ne parvient pas à compen ser.
Si un bon nombr e d' Amér indien s semi
nomades vivent dans la zone forestièr e (de
cult ures sur brûlis, de pêche et de chasse) à
l' exception des Galibis, installés sur la côte à
l'e st du Mar oni, la majeur e partie des habitants
est concentrée sur la côte atlantique.
Un bon
tier s est installé à Cay enne, la capitale, qui perd
toutefois de son importance depuis l'essor de
Saint -Laurent et surtout de Kour ou, dont l'acti
vité spatiale a enrichi considér ablement la
1770 �
Dans ce village
Karopl, les
Am érindiens vivent
suivant un système
de répartition
communautaire
de la telle et des fruits,
de la chasse et de la
pêche.
Refusant
l'assimilation et
souvent dépassés par
la modernité, Ils
demandent la
reconnaissance et le
respect de leur mode
de vie et de leur
culture.
' Les membres de
la trib u oyampls
vivent selon leur
tradition ancestrale.
commune qui prospère et affiche ses équip e
ments luxueux dans un envir onnement mar
qué par le dénuement.
L' intérieur du pays souffre d'un manque
d'équ ipements et d'in frastructures (54% des loge
ments du Maroni n'ont ni eau ni électricité), et
les qua rtie rs insalubr es s'étendent à la périphérie
de certain s bour gs.
La croissance démogra
phique a accentué le déficit relatif en médecins
par rapport au nom bre d'habitants, et la faible
densité du secteur hospitalier encourage l'hospi
talisation hors du département.
Le taux de morta
lité reste faible et la surmortalité masculine est
fr appante.
Les maladies cardio-vasc ulaires et les x
traumatismes (accidents de la route, suicides) �
sont les premières causes de décès.
Les maladies 1?.
inf ectie uses intestinales sont importantes ainsi !
que le sida (avec 2,7 cas déclarés pour 1000 hab., il:
le taux est sept fois supérieur à celui de la métro
pole).
Le syst ème scolair e est marqué par un
nombre important de retards et de sorties pré
coces ou sans diplôme.
En 1993, 38000 enfants
étaient scolarisés et l'uni versité Antille s-Guyane,
en Guadeloupe, accueillait 10000 étudiants.
De l'or à l'e space : une économie
peu productrice d'emplois
La Guyane dispose de ressources naturelles grâce
à sa forêt et à son sol, mais elles sont insuffisam
ment mises en valeur.
Du fait de la faible hauteur
des arbres, les forêts sont peu exploitées.
Les gise- ments d'or
et de diamants, eux, ont été ex ploités
depuis la seconde moitié du XIX" siècle sans donner
autant que ceux des pays voisins.
La prod uction
d'or , avec 2470 kg en 1995, représente le deuxième
prod uit d'exportation en valeur.
Trois compagnies
minières nord-américaines prospectent désormais
l'or, le diamant et le kaolin (argile blanche utilisée
dans la fabri cation des porcelaine s et céra
miques).
Un secteur agricole moderne produit du
riz et des arbres fruitiers le long de la côte, sur une
surface toutefois réduite (13000 ha).
La pêche est
consacrée presque uniquement à la prod uction de
crevettes, exportées à 90% vers la France métropo
litaine.
C'est le premier secteur d'exportati on, et il
repré sente un quart des recettes.
Cette pêche est
li mitée par des quotas, et les pouvoirs publics sou
tiennent ce secteur.
L'activité phare de la Guyane est sans conteste
l' activité spatiale, depuis son impl antation en
19 65.
Elle produit un tiers de la valeur ajoutée i Cayenne avec plus de 50 000 hab.
demeure la A plus grande ville de Guyane.
Elle possède un
pe tit port de pêche et de cabo tage.
Son
architecture rappelle souvent celle de la métropole,
ce qui est très insolite sous les tropiq ues.
du DOM, et a un effet d'entraînement sur le
reste de l'économie dans les secteurs du com
merce, des services aux entreprises, de l'immo
bilier et de l'agricultur e.
Le centre spatial a été implanté à Kourou pour
bénéficier d'une position proche de l'éq uateur ,
qui permet un lancer et une mise sur orbite opt�
maux.
Il comprend quatre organismes.
L'Agence
spat iale européenne (ESA) propose aux financi ers.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Venezuela & Guyane (Travaux Personnels Encadrés – Géographie - Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)
- GUYANE FRANÇAISE (Géographie)
- -Le Théâtre“Le Malade Imaginaire” - Acte I Scène 1
- Cours d'histoire-géographie 2nd
- T. C. 27 nov. 1952, PRÉFET DE LA GUYANE, Rec. 642