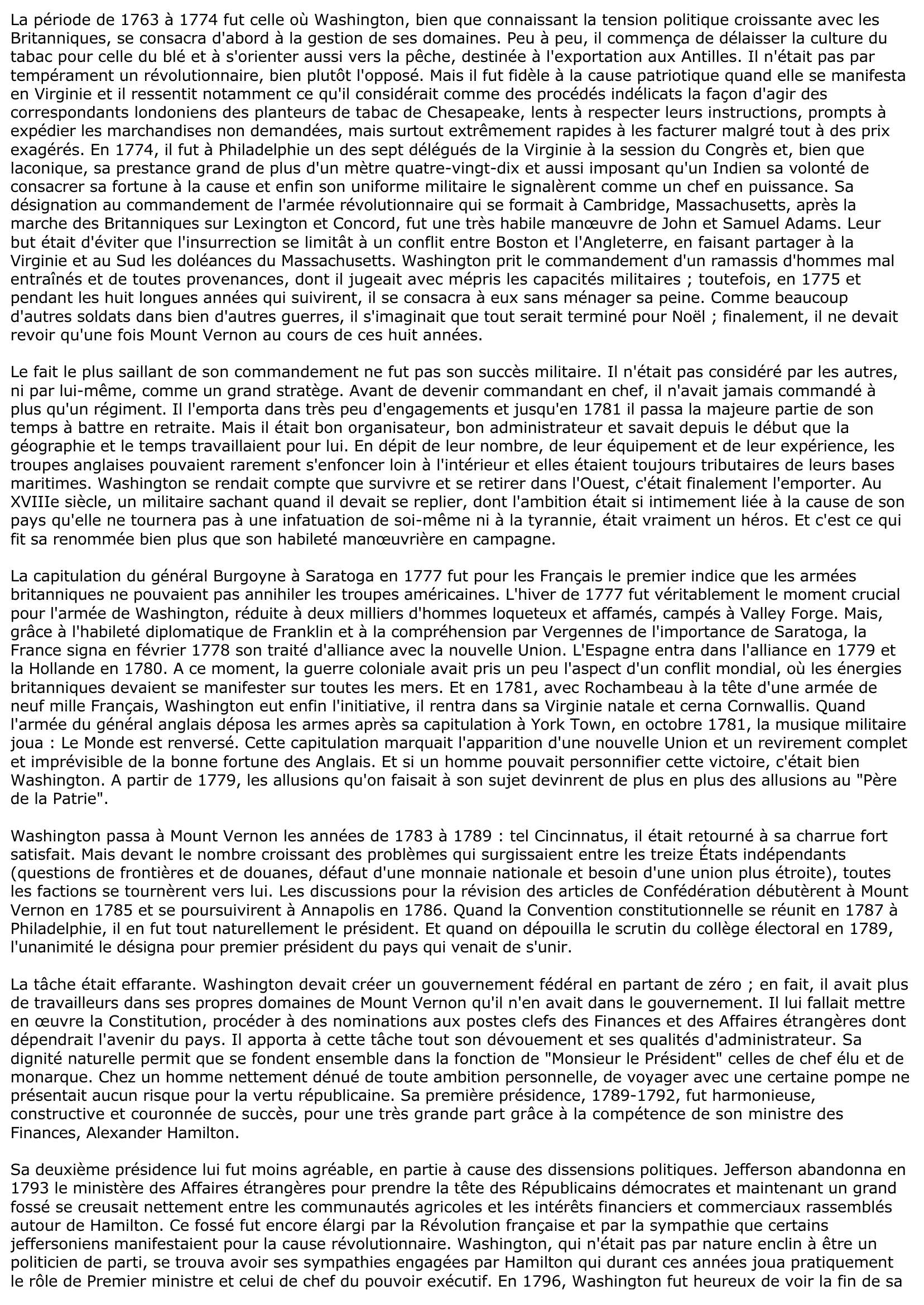George Washington
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
La période de 1763 à 1774 fut celle où Washington, bien que connaissant la tension politique croissante avec lesBritanniques, se consacra d'abord à la gestion de ses domaines.
Peu à peu, il commença de délaisser la culture dutabac pour celle du blé et à s'orienter aussi vers la pêche, destinée à l'exportation aux Antilles.
Il n'était pas partempérament un révolutionnaire, bien plutôt l'opposé.
Mais il fut fidèle à la cause patriotique quand elle se manifestaen Virginie et il ressentit notamment ce qu'il considérait comme des procédés indélicats la façon d'agir descorrespondants londoniens des planteurs de tabac de Chesapeake, lents à respecter leurs instructions, prompts àexpédier les marchandises non demandées, mais surtout extrêmement rapides à les facturer malgré tout à des prixexagérés.
En 1774, il fut à Philadelphie un des sept délégués de la Virginie à la session du Congrès et, bien quelaconique, sa prestance grand de plus d'un mètre quatre-vingt-dix et aussi imposant qu'un Indien sa volonté deconsacrer sa fortune à la cause et enfin son uniforme militaire le signalèrent comme un chef en puissance.
Sadésignation au commandement de l'armée révolutionnaire qui se formait à Cambridge, Massachusetts, après lamarche des Britanniques sur Lexington et Concord, fut une très habile manœuvre de John et Samuel Adams.
Leurbut était d'éviter que l'insurrection se limitât à un conflit entre Boston et l'Angleterre, en faisant partager à laVirginie et au Sud les doléances du Massachusetts.
Washington prit le commandement d'un ramassis d'hommes malentraînés et de toutes provenances, dont il jugeait avec mépris les capacités militaires ; toutefois, en 1775 etpendant les huit longues années qui suivirent, il se consacra à eux sans ménager sa peine.
Comme beaucoupd'autres soldats dans bien d'autres guerres, il s'imaginait que tout serait terminé pour Noël ; finalement, il ne devaitrevoir qu'une fois Mount Vernon au cours de ces huit années.
Le fait le plus saillant de son commandement ne fut pas son succès militaire.
Il n'était pas considéré par les autres,ni par lui-même, comme un grand stratège.
Avant de devenir commandant en chef, il n'avait jamais commandé àplus qu'un régiment.
Il l'emporta dans très peu d'engagements et jusqu'en 1781 il passa la majeure partie de sontemps à battre en retraite.
Mais il était bon organisateur, bon administrateur et savait depuis le début que lagéographie et le temps travaillaient pour lui.
En dépit de leur nombre, de leur équipement et de leur expérience, lestroupes anglaises pouvaient rarement s'enfoncer loin à l'intérieur et elles étaient toujours tributaires de leurs basesmaritimes.
Washington se rendait compte que survivre et se retirer dans l'Ouest, c'était finalement l'emporter.
AuXVIIIe siècle, un militaire sachant quand il devait se replier, dont l'ambition était si intimement liée à la cause de sonpays qu'elle ne tournera pas à une infatuation de soi-même ni à la tyrannie, était vraiment un héros.
Et c'est ce quifit sa renommée bien plus que son habileté manœuvrière en campagne.
La capitulation du général Burgoyne à Saratoga en 1777 fut pour les Français le premier indice que les arméesbritanniques ne pouvaient pas annihiler les troupes américaines.
L'hiver de 1777 fut véritablement le moment crucialpour l'armée de Washington, réduite à deux milliers d'hommes loqueteux et affamés, campés à Valley Forge.
Mais,grâce à l'habileté diplomatique de Franklin et à la compréhension par Vergennes de l'importance de Saratoga, laFrance signa en février 1778 son traité d'alliance avec la nouvelle Union.
L'Espagne entra dans l'alliance en 1779 etla Hollande en 1780.
A ce moment, la guerre coloniale avait pris un peu l'aspect d'un conflit mondial, où les énergiesbritanniques devaient se manifester sur toutes les mers.
Et en 1781, avec Rochambeau à la tête d'une armée deneuf mille Français, Washington eut enfin l'initiative, il rentra dans sa Virginie natale et cerna Cornwallis.
Quandl'armée du général anglais déposa les armes après sa capitulation à York Town, en octobre 1781, la musique militairejoua : Le Monde est renversé.
Cette capitulation marquait l'apparition d'une nouvelle Union et un revirement completet imprévisible de la bonne fortune des Anglais.
Et si un homme pouvait personnifier cette victoire, c'était bienWashington.
A partir de 1779, les allusions qu'on faisait à son sujet devinrent de plus en plus des allusions au "Pèrede la Patrie".
Washington passa à Mount Vernon les années de 1783 à 1789 : tel Cincinnatus, il était retourné à sa charrue fortsatisfait.
Mais devant le nombre croissant des problèmes qui surgissaient entre les treize États indépendants(questions de frontières et de douanes, défaut d'une monnaie nationale et besoin d'une union plus étroite), toutesles factions se tournèrent vers lui.
Les discussions pour la révision des articles de Confédération débutèrent à MountVernon en 1785 et se poursuivirent à Annapolis en 1786.
Quand la Convention constitutionnelle se réunit en 1787 àPhiladelphie, il en fut tout naturellement le président.
Et quand on dépouilla le scrutin du collège électoral en 1789,l'unanimité le désigna pour premier président du pays qui venait de s'unir.
La tâche était effarante.
Washington devait créer un gouvernement fédéral en partant de zéro ; en fait, il avait plusde travailleurs dans ses propres domaines de Mount Vernon qu'il n'en avait dans le gouvernement.
Il lui fallait mettreen œuvre la Constitution, procéder à des nominations aux postes clefs des Finances et des Affaires étrangères dontdépendrait l'avenir du pays.
Il apporta à cette tâche tout son dévouement et ses qualités d'administrateur.
Sadignité naturelle permit que se fondent ensemble dans la fonction de "Monsieur le Président" celles de chef élu et demonarque.
Chez un homme nettement dénué de toute ambition personnelle, de voyager avec une certaine pompe neprésentait aucun risque pour la vertu républicaine.
Sa première présidence, 1789-1792, fut harmonieuse,constructive et couronnée de succès, pour une très grande part grâce à la compétence de son ministre desFinances, Alexander Hamilton.
Sa deuxième présidence lui fut moins agréable, en partie à cause des dissensions politiques.
Jefferson abandonna en1793 le ministère des Affaires étrangères pour prendre la tête des Républicains démocrates et maintenant un grandfossé se creusait nettement entre les communautés agricoles et les intérêts financiers et commerciaux rassemblésautour de Hamilton.
Ce fossé fut encore élargi par la Révolution française et par la sympathie que certainsjeffersoniens manifestaient pour la cause révolutionnaire.
Washington, qui n'était pas par nature enclin à être unpoliticien de parti, se trouva avoir ses sympathies engagées par Hamilton qui durant ces années joua pratiquementle rôle de Premier ministre et celui de chef du pouvoir exécutif.
En 1796, Washington fut heureux de voir la fin de sa.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Washington George, 1732-1799, né dans le comté de Westmoreland, général et homme d'État américain, premier président des États-Unis.
- George Washington - Geschichte.
- George Washington par Esmond Wright L'histoire américaine compte peu d'hommes dont il soit aussi ardu de se faire une idée exacte que George Washington.
- George Washington - historia.
- Adams John, 1735-1826, né à Quincy (Massachusetts), deuxième président des États-Unis (1797-1801), fédéraliste et partisan de George Washington, à qui il succéda.