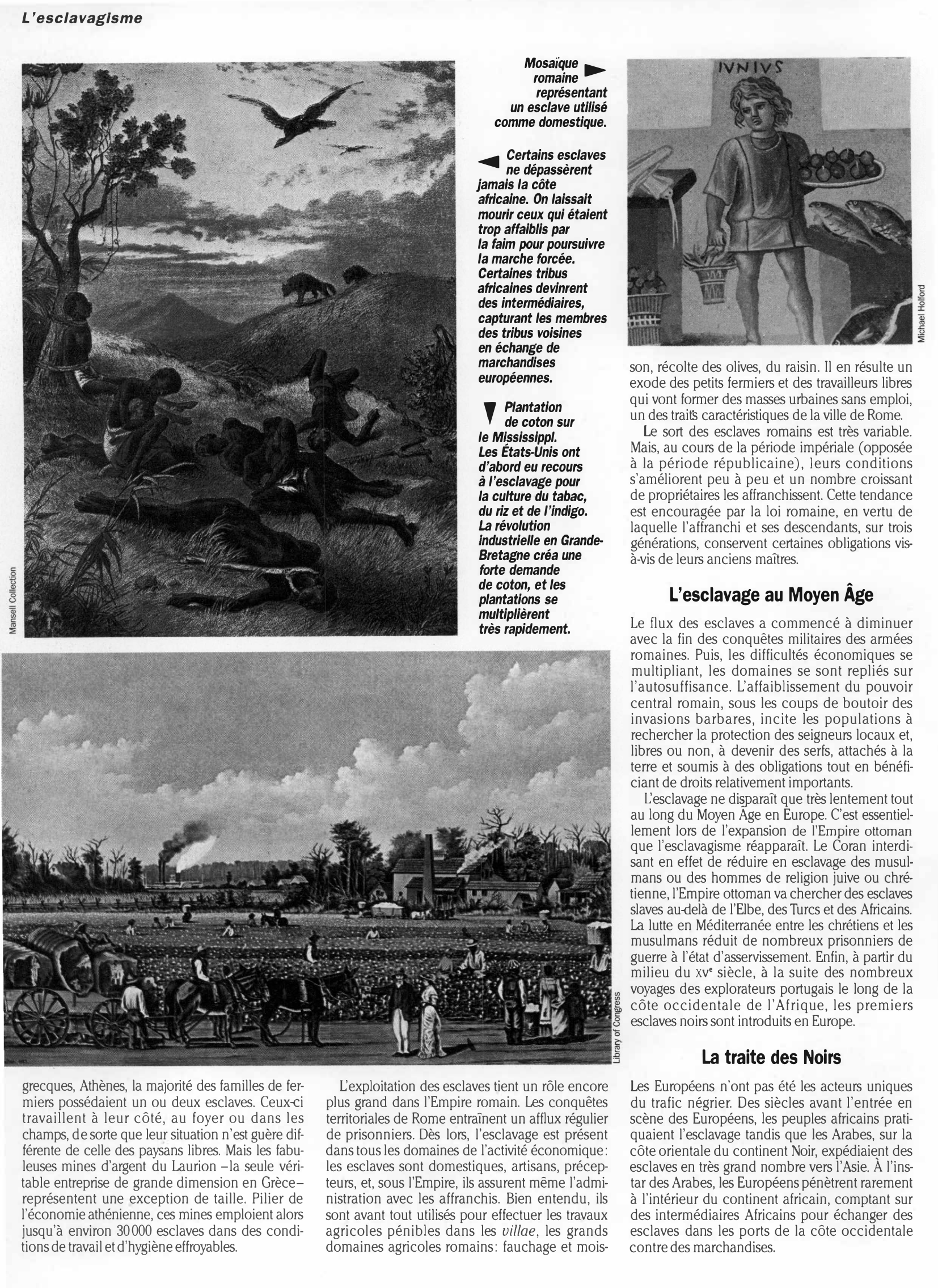Grand oral du bac : L' ESCLAVAGISME
Publié le 01/02/2019

Extrait du document
«
L'esclavagisme
grecques, Athènes, la majorité des familles de fer
miers possédaient un ou deux esclaves.
Ceux-ci
travaillent à leur côté, au foyer ou dans les
champs, de sorte que leur situation n'est guère dif
férente de celle des paysans libres.
Mais les fabu
leuses mines d'argent du Laurion -la seule véri
table entreprise de grande dimension en Grèce
représentent une exception de taille.
Pilier de
l'économie athénienne, ces mines emploient alors
jusqu'à environ 30000 esclaves dans des condi
tions de travail et d'hygiène effroyables.
Mosai
�ue �
roma me
représentant
un esclave utilisé
comme domestique.
� Certains esclaves
ne dépassèrent
jamais la côte
africaine.
On laissait
mourir ceux qui étaient
trop affaiblis par
la faim pour poursuivre
la marche forcée.
Certaines tribus
africaines devinrent
des intermédiaires,
capturant les membres
des tribus voisines
en échange de
marchandises
européennes.
' Plantation
de coton sur
le M�ssissippl.
Les Etats-Unis ont
d'abord eu recours
à l'esclavage pour
la culture du tabac,
du riz et de l'Indigo.
La révolution
Industrielle en Grande
Bretagne créa une
forte demande
de coton, et les
plantations se
multiplièrent
très rapidement.
t..: exploitation des esclaves tient un rôle encore
plus grand dans l'Empire romain.
Les conquêtes
territoriales de Rome entraînent un afflux régulier
de prisonniers.
Dès lors, l'esclavage est présent
dans tous les domaines de l'activité économique:
les esclaves sont domestiques, artisans, précep
teurs, et, sous l'Empire, ils assurent même l'admi
nistration avec les affranchis.
Bien entendu, ils
sont avant tout utilisés pour effectuer les travaux
agricoles pénibles dans les villae, les grands
domaines agricoles romains: fauchage et mois- son,
récolte des olives, du raisin.
Il en résulte un
exode des petits fermiers et des travailleurs libres
qui vont former des masses urbaines sans emploi,
un des traitl> caractéristiques de la ville de Rome.
Le sort des esclaves romains est très variable.
Mais, au cours de la période impériale (opposée
à la période républicaine ), leurs conditions
s'améliorent peu à peu et un nombre croissant
de propriétaires les affranchissent.
Cette tendance
est encouragée par la loi romaine, en vertu de
laquelle l'affranchi et ses descendants, sur trois
générations, conservent certaines obligations vis
à-vis de leurs anciens maîtres.
L'esclavage au Moyen Âge
Le flux des esclaves a commencé à diminuer
avec la fin des conquêtes militaires des armées
romaines.
Puis, les difficultés économiques se
multipliant, les domaines se sont repliés sur
l'autosuffisance.
L'affaiblissement du pouvoir
central romain, sous les coups de boutoir des
invasions barbares, incite les populations à
rechercher la protection des seigneurs locaux et,
libres ou non, à devenir des serfs, attachés à la
terre et soumis à des obligations tout en bénéfi
ciant de droits relativement importants.
t..:esclavage ne di�araît que très lentement tout
au long du Moyen Age en Europe.
C'est essentiel
lement lors de l'expansion de l'Empire ottoman
que l'esclavagisme réapparaît.
Le Coran interdi
sant en effet de réduire en esclavage des musul
mans ou des hommes de religion juive ou chré
tienne, l'Empire ottoman va chercher des esclaves
slaves au-delà de l'Elbe, des Turcs et des Africains.
La lutte en Méditerranée entre les chrétiens et les
musulmans réduit de nombreux prisonniers de
guerre à l'état d'asservissement.
Enfin, à partir du
milieu du xv• siècle, à la suite des nombreux
voyages des explorateurs portugais le long de la
côte occidentale de l'Af rique, les premiers
esclaves noirs sont introduits en Europe.
La traite des Noirs
Les Européens n'ont pas été les acteurs uniques
du trafic négrier.
Des siècles avant l'entrée en
scène des Européens, les peuples africains prati
quaient l'esclavage tandis que les Arabes, sur la
côte orientale du continent Noir, expédiaient des
esclaves en très grand nombre vers l'Asie.
À l'ins
tar des Arabes, les Européens pénètrent rarement
à l'intérieur du continent africain, comptant sur
des intermédiaires Africains pour échanger des
esclaves dans les ports de la côte occidentale
contre des marchandises..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Grand oral du bac : Arts et Culture L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE
- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAUHAUS
- Grand oral du bac : Arts et Culture LE BAROQUE
- Grand oral du bac : WALT DISNEY
- Grand oral du bac : GEORGE ORWELL