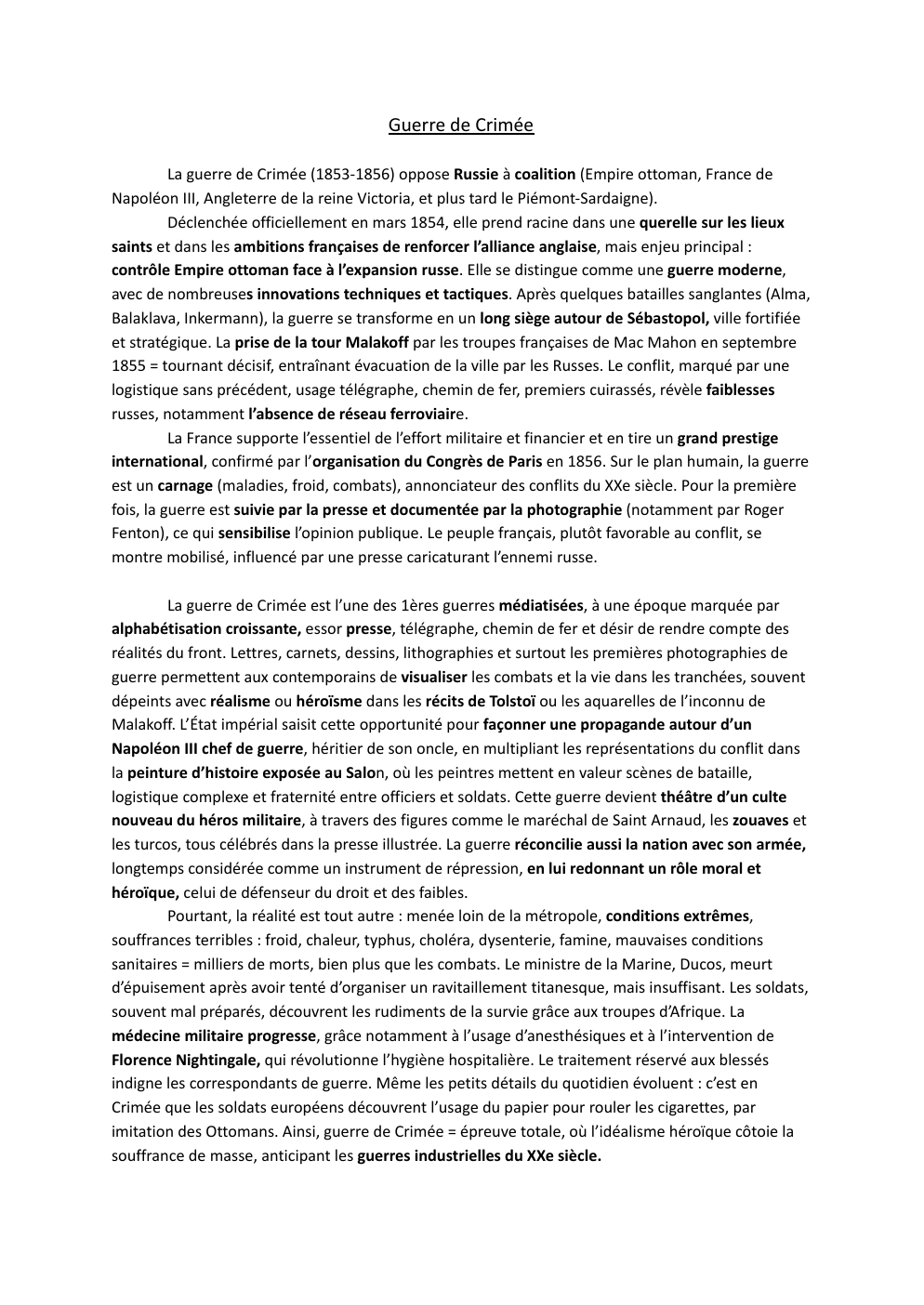Guerre de Crimée
Publié le 27/08/2025
Extrait du document
«
Guerre de Crimée
La guerre de Crimée (1853-1856) oppose Russie à coalition (Empire ottoman, France de
Napoléon III, Angleterre de la reine Victoria, et plus tard le Piémont-Sardaigne).
Déclenchée officiellement en mars 1854, elle prend racine dans une querelle sur les lieux
saints et dans les ambitions françaises de renforcer l’alliance anglaise, mais enjeu principal :
contrôle Empire ottoman face à l’expansion russe.
Elle se distingue comme une guerre moderne,
avec de nombreuses innovations techniques et tactiques.
Après quelques batailles sanglantes (Alma,
Balaklava, Inkermann), la guerre se transforme en un long siège autour de Sébastopol, ville fortifiée
et stratégique.
La prise de la tour Malakoff par les troupes françaises de Mac Mahon en septembre
1855 = tournant décisif, entraînant évacuation de la ville par les Russes.
Le conflit, marqué par une
logistique sans précédent, usage télégraphe, chemin de fer, premiers cuirassés, révèle faiblesses
russes, notamment l’absence de réseau ferroviaire.
La France supporte l’essentiel de l’effort militaire et financier et en tire un grand prestige
international, confirmé par l’organisation du Congrès de Paris en 1856.
Sur le plan humain, la guerre
est un carnage (maladies, froid, combats), annonciateur des conflits du XXe siècle.
Pour la première
fois, la guerre est suivie par la presse et documentée par la photographie (notamment par Roger
Fenton), ce qui sensibilise l’opinion publique.
Le peuple français, plutôt favorable au conflit, se
montre mobilisé, influencé par une presse caricaturant l’ennemi russe.
La guerre de Crimée est l’une des 1ères guerres médiatisées, à une époque marquée par
alphabétisation croissante, essor presse, télégraphe, chemin de fer et désir de rendre compte des
réalités du front.
Lettres, carnets, dessins, lithographies et surtout les premières photographies de
guerre permettent aux contemporains de visualiser les combats et la vie dans les tranchées, souvent
dépeints avec réalisme ou héroïsme dans les récits de Tolstoï ou les aquarelles de l’inconnu de
Malakoff.
L’État impérial saisit cette opportunité pour façonner une propagande autour d’un
Napoléon III chef de guerre, héritier de son oncle, en multipliant les représentations du conflit dans
la peinture d’histoire exposée au Salon, où les peintres mettent en valeur scènes de bataille,
logistique complexe et fraternité entre officiers et soldats.
Cette guerre devient théâtre d’un culte
nouveau du héros militaire, à travers des figures comme le maréchal de Saint Arnaud, les zouaves et
les turcos, tous célébrés dans la presse illustrée.
La guerre réconcilie aussi la nation avec son armée,
longtemps considérée comme un instrument de répression, en lui redonnant un rôle moral et
héroïque, celui de défenseur du droit et des faibles.
Pourtant, la réalité est tout autre : menée loin de la métropole, conditions extrêmes,
souffrances terribles : froid, chaleur, typhus, choléra, dysenterie, famine, mauvaises conditions
sanitaires = milliers de morts, bien plus que les combats.
Le ministre de la Marine, Ducos, meurt
d’épuisement après avoir tenté d’organiser un ravitaillement titanesque, mais insuffisant.
Les soldats,
souvent mal préparés, découvrent les rudiments de la survie grâce aux troupes d’Afrique.
La
médecine militaire progresse, grâce notamment à l’usage d’anesthésiques et à l’intervention de
Florence Nightingale, qui révolutionne l’hygiène hospitalière.
Le traitement réservé aux blessés
indigne les correspondants de guerre.
Même les petits détails du quotidien évoluent : c’est en
Crimée que les soldats....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Guerre de Crimée (1854-1855) En 1854, la France de Napoléon III et l'Angleterre qui ont renoncé à rallier l'Autriche à leur entreprise déclarent la guerre à la Russie.
- La France de 1815 à 1870 par Louis Girard Après une ère de bouleversements politiques et sociaux, de grandes guerres, la France en 1815 entre dans une période de paix qui durera jusqu'à la guerre de Crimée.
- Guerre de Crimée (1854-1855) En 1854, la France de Napoléon III et l'Angleterre qui ont renoncé à rallier l'Autriche à leur entreprise déclarent la guerre à la Russie.
- Conquête de la Crimée (seconde guerre mondiale).
- Histoire de la guerre de Crimée: De l'invasion des principautés danubiennes par les Russes à la conclusion du traité de Paris