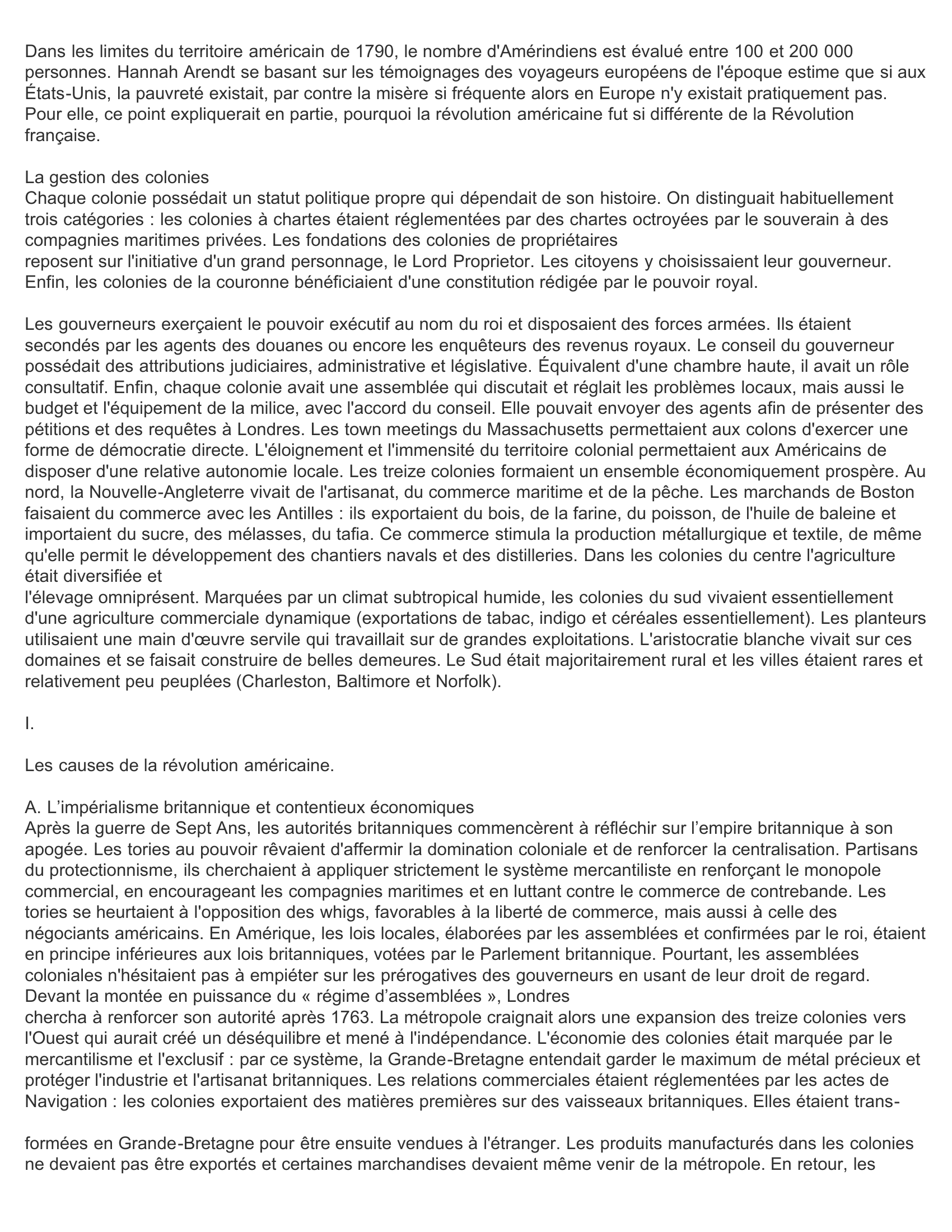L independance des etats unis d'amerique
Publié le 28/10/2019

Extrait du document
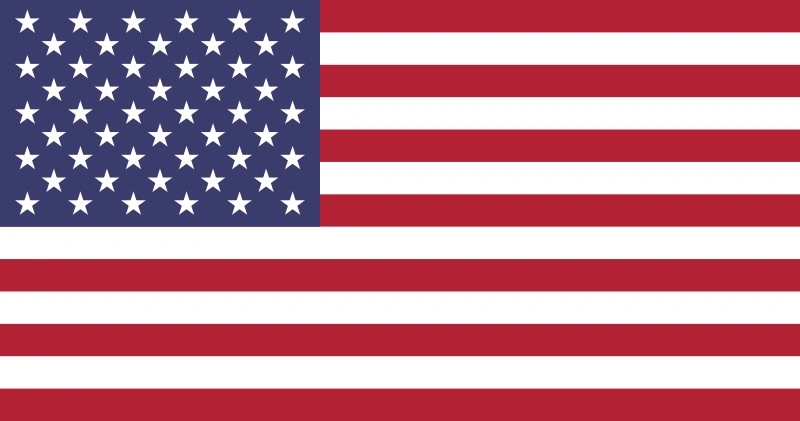
certain manque d’unité entre les Etats. Sur les 2,5 millions d'habitants de colonies, seul un faible pourcentage se porta volontaire pour se battre contre les Anglais. Les États refusèrent de pourvoir au ravitaillement et à l'habillement des troupes de l'Armée continentale. Les soldats souffrirent de la faim et du manque de vêtements. L'élaboration des Articles de la Confédération souleva des oppositions entre les tenants d’un État central relativement fort et les partisans d’une autonomie importante des États fédérés et souverains. Les premiers furent d’abord appelés « nationalistes » puis « fédéralistes ». Les débats portèrent également sur la répartition de la charge fiscale, la manière de voter et l'expansion vers l'Ouest.
B. La période confédérale (1781-1789)
À partir de 1781 siégea un nouveau Congrès, en remplacement du Second Congrès continental. Cependant, les membres de la nouvelle assemblée ne changeaient guère. Les domaines de
compétence du Congrès étaient alors peu étendus : postes, poids et mesures, monnaie, citoyenneté. Une monnaie fut fondée en 1785, le dollar, en remplacement des livres britanniques et des différentes unités monétaires étrangères qui circulaient alors en Amérique du Nord. L'émission de papier monnaie se poursuivit après la guerre. La grande affaire fut la constitution. La Convention de Philadelphie se réunit entre mai et septembre 1787 pour rédiger la Constitution américaine. Les 55 délégués discutèrent de l'esclavage, de l'équilibre entre les pouvoirs et du poids politique des États fédérés. Le projet de constitution fut adopté le17 septembre 1787, et signé par 39 représentants sur 55 et ratifié par les 3/4 des États le 21 juin 1788. Le texte organisait les nouvelles institutions d'un État républicain et fédéral dans lequel les pouvoirs étaient séparés et s'équilibraient. C'était la première fois dans l'Histoire que le fédéralisme était appliqué dans un pays aussi vaste : les États fédérés conservaient leurs pouvoirs politique, juridique, économique, social et fiscal tout en admettant la supériorité de la loi fédérale. Son originalité réside dans la combinaison de la République et de la démocratie ainsi que par un système présidentiel qui n'avait jamais été imaginé jusqu'ici. Par la formule du préambule « Nous le peuple », la constitution entérinait également la naissance d'une nation. Si le texte de la constitution fut le résultat d'un compromis, il fut critiqué par les antifédéralistes, parce qu'il abandonnait le principe d'unanimité des États ; aussi, trois représentants refusèrent de signer la constitution pendant la convention de Philadelphie. La Caroline du Nord refusa de ratifier la constitution le 1er août 1788 parce qu’elle ne comportait pas de Déclaration des droits (elle la ratifia finalement le 21/11/1789). Le Maryland, refusa de signer la constitution de 1787 parce qu’elle ne condamnait pas l’esclavage explicitement. Le Rhode Island fut le dernier État à difficilement ratifier la constitution en 1790. La constitution était prévue pour entrer en vigueur dès ratification par les 3/4 des états, ce qui fut fait en 1788.
C. La période fédéraliste. (1789-1801)
Le premier congrèsfédéral fut élu en janvier 1789 ; en avril, George Washington fut choisi à l'unanimité pour être le premier président des États-Unis qui s'installa à New York, capitale provisoire du pays, où il prêta serment sur la Bible le 30. En septembre, une Déclaration des Droits (Bill of Rights) fut ajoutée à la Constitution par le Congrès ; elle fut ratifiée le 15 décembre 1791. Les débats se poursuivaient au sujet du rôle de l'État fédéral : les fédéralistes se regroupèrent autour d'Alexander Hamilton et réclamaient un État central fort ; ils étaient contre l'égalitarisme. Les « antifédéralistes » ou « républicains » réunirent les partisans de la décentralisation autour de Thomas Jefferson. La Révolution française accentua les différences entre les deux « partis » : alors que les fédéralistes rejetaient la tournure radicale que prenaient les événements en 1793, les Républicains s'enthousiasmaient pour l’égalité et la démocratie française. George Washington préféra rester neutre vis-à-vis de la France et de son ennemie la Grande-Bretagne qui demeurait le principal partenaire commercial des États-Unis. Le traité de Jay en 1794 fut considéré comme une trahison envers la France. La période vit l'affermissement des institutions américaines : dans un contexte difficile d'endettement après la guerre d'indépendance fut fondée une banque des États-Unis en 1791. Le cours de la monnaie remonta. Les inégalités se creusèrent car les terres confisquées pour endettement étaient revendues aux plus riches. Une partie des loyalistes revint après la guerre et récupéra ses terres.
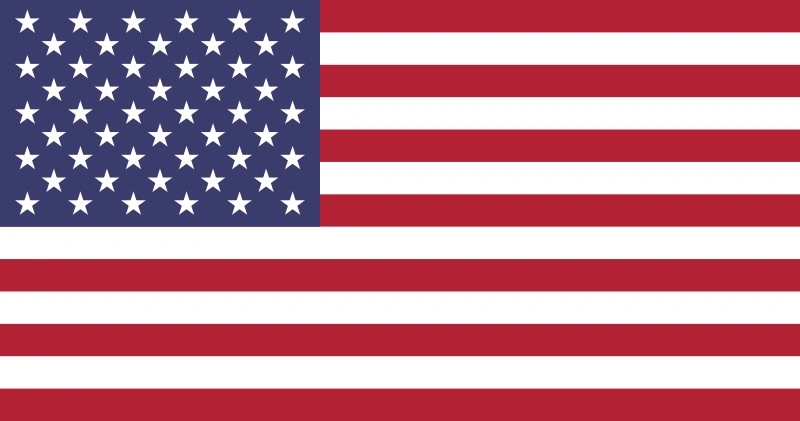
«
Dans les limites du territoire américain de 1790, le nombre d'Amérindiens est évalué entre 100 et 200 000
personnes.
Hannah Arendt se basant sur les témoignages des voyageurs européens de l'époque estime que si aux
États -Unis, la pauvreté existait, par contre la misère si fréquente alors en Europe n'y existait pratiquement pas.
Pour elle, ce point expliquerait en partie, pourquoi la révolution américaine fut si différente de la Révolution
française.
La gestion des colonies
Chaque colonie possédait un statut politique propre qui dépendait de son histoire.
On distinguait habituellement
trois catégories : les colonies à chartes étaient réglementées par des chartes octroyées par le souverain à des
compagnies maritimes privées.
Les fondations des colonies de propriétaires
reposent sur l'initiative d'un grand personnage, le Lord Proprietor.
Les citoyens y choisissaient leur gouverneur.
Enfin, les colonies de la couronne bénéficiaient d'une constitution rédigée par le pouvoir royal.
Les gouverneurs exerçaient le pouvoir exécutif au nom du roi et disposaient des forces armées.
Ils étaient
secondés par les agents des douanes ou encore les enquêteurs des revenus royaux.
Le conseil du gouverneur
possédait des attributions judiciaires, administrative et législative.
Équivalent d'une chambre haute, il avait un rôle
consultatif.
Enfin, chaque colonie avait une assemblée qui discutait et réglait les problèmes locaux, mais aussi le
budget et l'équipement de la milice, avec l'accord du conseil.
Elle pouvait envoyer des agents afin de présenter des
pétitions et des requêtes à Londres.
Les town meetings du Massachusetts permettaient aux colons d'exercer une
forme de démocratie directe.
L'éloignement et l'immensité du territoire colonial permettaient aux Américains de
disposer d'une relative autonomie locale.
Les treize colonies formaient un ensemble économiquement prospère.
Au
nord, la Nouvelle-Angleterre vivait de l'artisanat, du commerce maritime et de la pêche.
Les marchands de Boston
faisaient du commerce avec les Antilles : ils exportaient du bois, de la farine, du poisson, de l'huile de baleine et
importaient du sucre, des mélasses, du tafia.
Ce commerce stimula la production métallurgique et textile, de même
qu'elle permit le développement des chantiers navals et des distilleries.
Dans les colonies du centre l'agriculture
était diversifiée et
l'élevage omniprésent.
Marquées par un climat subtropical humide, les colonies du sud vivaient essentiellement
d'une agriculture commerciale dynamique (exportations de tabac, indigo et céréales essentiellement).
Les planteurs
utilisaient une main d'œuvre servile qui travaillait sur de grandes exploitations.
L'aristocratie blanche vivait sur ces
domaines et se faisait construire de belles demeures.
Le Sud était majoritairement rural et les villes étaient rares et
relativement peu peuplées (Charleston, Baltimore et Norfolk).
I.
Les causes de la révolution américaine.
A.
L’impérialisme britannique et contentieux économiques
Après la guerre de Sept Ans, les autorités britanniques commencèrent à réfléchir sur l’empire britannique à son
apogée.
Les tories au pouvoir rêvaient d'affermir la domination coloniale et de renforcer la centralisation.
Partisans
du protectionnisme, ils cherchaient à appliquer strictement le système mercantiliste en renforçant le monopole
commercial, en encourageant les compagnies maritimes et en luttant contre le commerce de contrebande.
Les
tories se heurtaient à l'opposition des whigs, favorables à la liberté de commerce, mais aussi à celle des
négociants américains.
En Amérique, les lois locales, élaborées par les assemblées et confirmées par le roi, étaient
en principe inférieures aux lois britanniques, votées par le Parlement britannique.
Pourtant, les assemblées
coloniales n'hésitaient pas à empiéter sur les prérogatives des gouverneurs en usant de leur droit de regard.
Devant la montée en puissance du « régime d’assemblées », Londres
chercha à renforcer son autorité après 1763.
La métropole craignait alors une expansion des treize colonies vers
l'Ouest qui aurait créé un déséquilibre et mené à l'indépendance.
L'économie des colonies était marquée par le
mercantilisme et l'exclusif : par ce système, la Grande -Bretagne entendait garder le maximum de métal précieux et
protéger l'industrie et l'artisanat britanniques.
Les relations commerciales étaient réglementées par les actes de
Navigation : les colonies exportaient des matières premières sur des vaisseaux britanniques.
Elles étaient trans-
formées en Grande -Bretagne pour être ensuite vendues à l'étranger.
Les produits manufacturés dans les colonies
ne devaient pas être exportés et certaines marchandises devaient même venir de la métropole.
En retour, les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA PUISSANCE DES ETATS UNIS EN AMERIQUE ET DANS LE MONDE
- Question : Est-ce que la Californie est un modèle pour l’environnement aux Etats-Unis ?
- al quaida et les etats-unis
- Les Etats Unis des années 1960
- Julien Boudon, La séparation des pouvoirs aux Etats-Unis