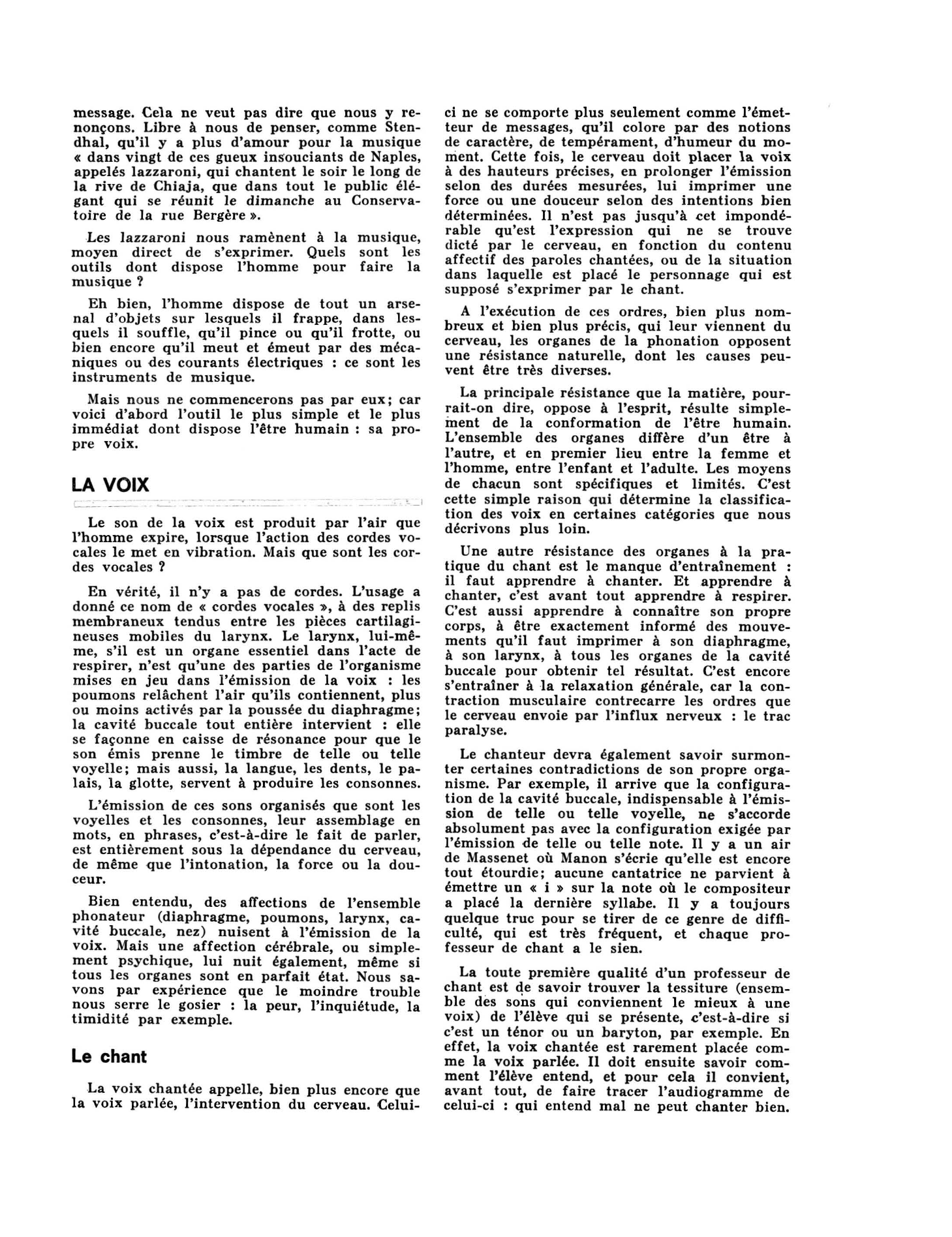LA MUSIQUE LA VOIX - LES INSTRUMENTS: Formes des oeuvres musicales
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
message.
Cela ne veut pas dire que nous y re nonçons.
Libre à nous de penser, comme Sten dhal, qu'il y a plus d'amour pour la mu sique « dans vingt de ces gueux insouciants de Naples, appelés lazzaroni, qui chantent le soir le long de la rive de Chiaja, que dans tout le public élé gant qui se réunit le dimanche au Conserva toire de la rue Bergère ».
-Les lazzaroni nous ramènent à la musique, moyen direct de s'exprimer .
Quels sont les outils dont dispose l'homme pour faire la musique?
Eh bien, l'homme dispose de tout un arse nal d'objets sur lesquels il frappe, dans les quels il souffle, qu'il pince ou qu'il frotte, ou b ien encore qu 'il meut et émeut par des méca niques ou des courants électriques : ce sont les instruments de musique.
Mais nou s ne commencerons pas par eux; car voici d'abord l'outil le plus simple et le plus immédiat dont dispose l'être humain : sa pro pre voix.
LA VOIX • 1
Le son de la voix est produit par l'air que l'homme expire, lorsque l'action des cordes vo cales le met en vibration.
Mais que sont les cor des vocales ?
En vérité, il n'y a pas de cordes.
L'usage a donné ce nom de « cordes vocales >, à des replis membran eux tendus entre les pièces cartilagi neuses mobiles du larynx.
Le larynx , lui-mê me, s'il est un organe essentiel dans l'acte de respirer, n'est qu'une des parties de l'organisme mises en jeu dans l'émission de la voix : les poumons rel âchent l'air qu'ils contiennent, plus ou moin s ac tiv és par la poussée du diaphragme; la cavité buccale tout entière intervient : elle se façonne en caisse de résonance pour que le son émis prenne le timbre de telle ou telle voyelle; mais aussi, la langue , les dents, le pa lais, la glotte, servent à produire les consonnes.
L'émission de ces sons organisés que sont les voyelle s et les consonnes, leur assemblage en mots, en phrases, c'est-à-dire le fait de parler, est entièrement sous la dépendance du cerveau, de même que l'inton ation, la force ou la dou ceur.
Bien entendu, des affections de l'ensemble phonateur (diaphragme, poumons, larynx, ca vité buccale, nez) nuisent à l'émission de la voix .
Mais une affection cérébrale, ou simple ment psychique , lui nuit également , même si tous les organes sont en parfait état.
Nous sa vons par expérience que le moindre trouble nous serre le gosier : la peur, l'inquiétude , la timidité par exemple.
Le chant
La voix chantée appelle, bien plus encore que la voix parlée, l'intervention du cerveau.
Celui-
ci ne se comporte plus seulement comme l'émet teur de messages, qu'il colore par des notions de caract ère, de tempérament , d'humeur du mo nient.
Cette fois, le cerveau doit placer la voix à des hauteurs précises , en prolonger l'émission selon des durées mesurées, lui imprimer une force ou une douceur selon des intentions bien déterminées.
Il n'est pas jusqu'à cet impondé rable qu'est l'expression qui ne se trouve dicté par le cerveau, en fonction du contenu affectif des paroles chantées, ou de la situation dans laquelle est placé le personnage qui est supposé s'exprimer par le chant.
A l ' exécution de ces ordres, bien plus nom breux et bien plus précis, qui leur viennent du cerveau, les organes de la phonation opposent une résistance naturelle, dont les causes peu vent être très diverses.
La principale résistance que la matière, pour rait-on dire, oppose à l'esprit, résulte simple ment de la conformation de l'être humain.
L'ensemble des organes diffère d'un être à l'.autre, et en premier lieu entre la femme et l'homme, entre l'enfant et l'adulte.
Les moyens de chacun sont spécifiques et limités.
C'est cette simple raison qui détermine la classifica tion des voix en certaines catégories que nous décrivons plus loin.
Une autre résistance des organes à la pra tique du chant est le manque d'entraînement : il faut apprendre à chanter.
Et .apprendre à chanter , c'est avant tout apprendre à respirer.
C'est aussi apprendre à connaitre s o n propre corps, à être exactement informé des mouve ments qu'il faut imprimer à son diaphragme, à son larynx, à tous les organes de la cavité buccale pour obtenir tel résultat.
C'est encore s'entraîner à la relaxation générale, car la con traction musculaire contrecarre les ordres que le cerveau envoie par l'influx nerveux : le trac paralyse.
Le chanteur devra également savoir surmon ter certaines contradictions de son propre orga nisme.
Par exemple, il arrive que la configura tion de la cavité buccale, indispensable à l'émis sion de telle ou telle voyelle, ne s'accorde absolument pas avec la configuration exigée par l'émission de telle ou telle note.
Il y a un air de Massenet où Manon s'écrie qu'elle est encore tout étourdie; aucune cantatrice ne parvient à émettre un « i » sur la note où le compositeur a placé la dernière syllabe.
Il y a toujours quelque truc pour se tirer de ce genre de diffi culté, qui est très fréquent, et chaque pro fesseur de chant a le sien.
La toute première qualité d'un professeur de chant est de savoir trouver la tessiture (ensem ble dès sons qui conviennent le mieux à une voix) de l'élève qui se présente, c'est-à-dire si c'est un ténor ou un baryton, par exemple .
En effet, la voix chantée est rarement placée com me la voix parlée.
Il doit ensuite savoir com ment l'élève entend, et pour cela il convient, avant tout, de faire tracer l'audiogramme de celui-ci : qui entend mal ne peut chanter bien..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- musique classique, histoire de la 1 PRÉSENTATION musique classique, histoire de la, ensemble des formes musicales développées en Occident de l'Antiquité à nos jours.
- « Qu'est-ce qu'un arbre sans sa racine ? Qu'est-ce qu'un fleuve sans sa source ? Qu'est-ce qu'un peuple sans son passé ?» s'interrogeait Victor Hugo dans «les Pyrénées ». En vous référant à des oeuvres littéraires que vous connaissez mais également à d'autres formes d'art (architecture, musique, peinture, cinéma, etc.), vous expliquerez pourquoi ce passé des peuples leur est indispensable pour vivre. ?
- MUSIQUE POUR INSTRUMENTS A CORDES, A PERCUSSION ET CELESTA de Béla Bartok
- nature morte nature morte, en peinture, représentation d'objets inanimés (fruits, fleurs, gibier, vaisselle, livres ou instruments de musique).
- CLAESZ : Nature morte aux instruments de musique.