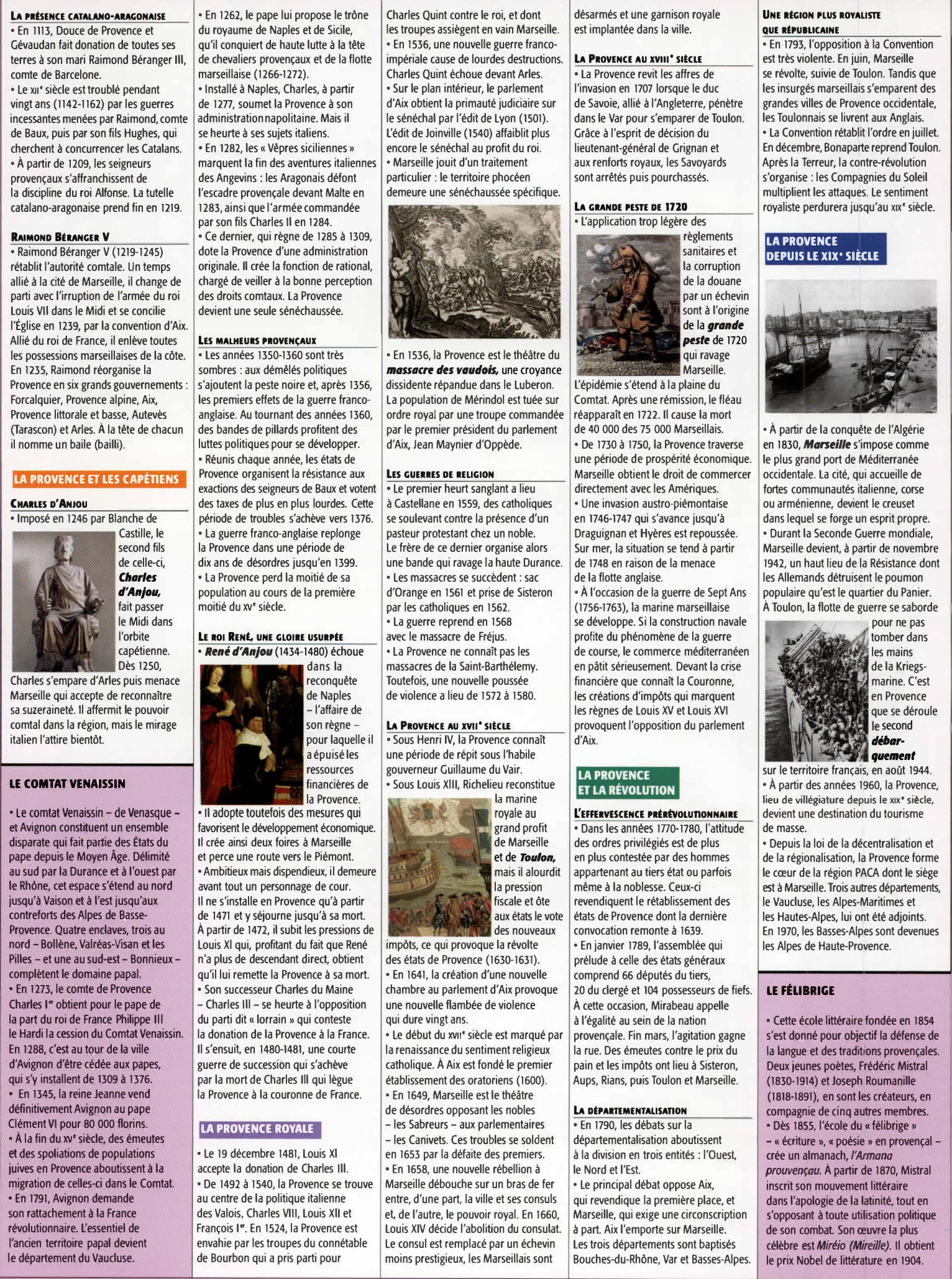La Provence et le Comtat Venaissin: Entre des comtes attirés par l'Italie et l'empreinte papale, deux provinces aux mutiples capitales
Publié le 18/11/2018
Extrait du document
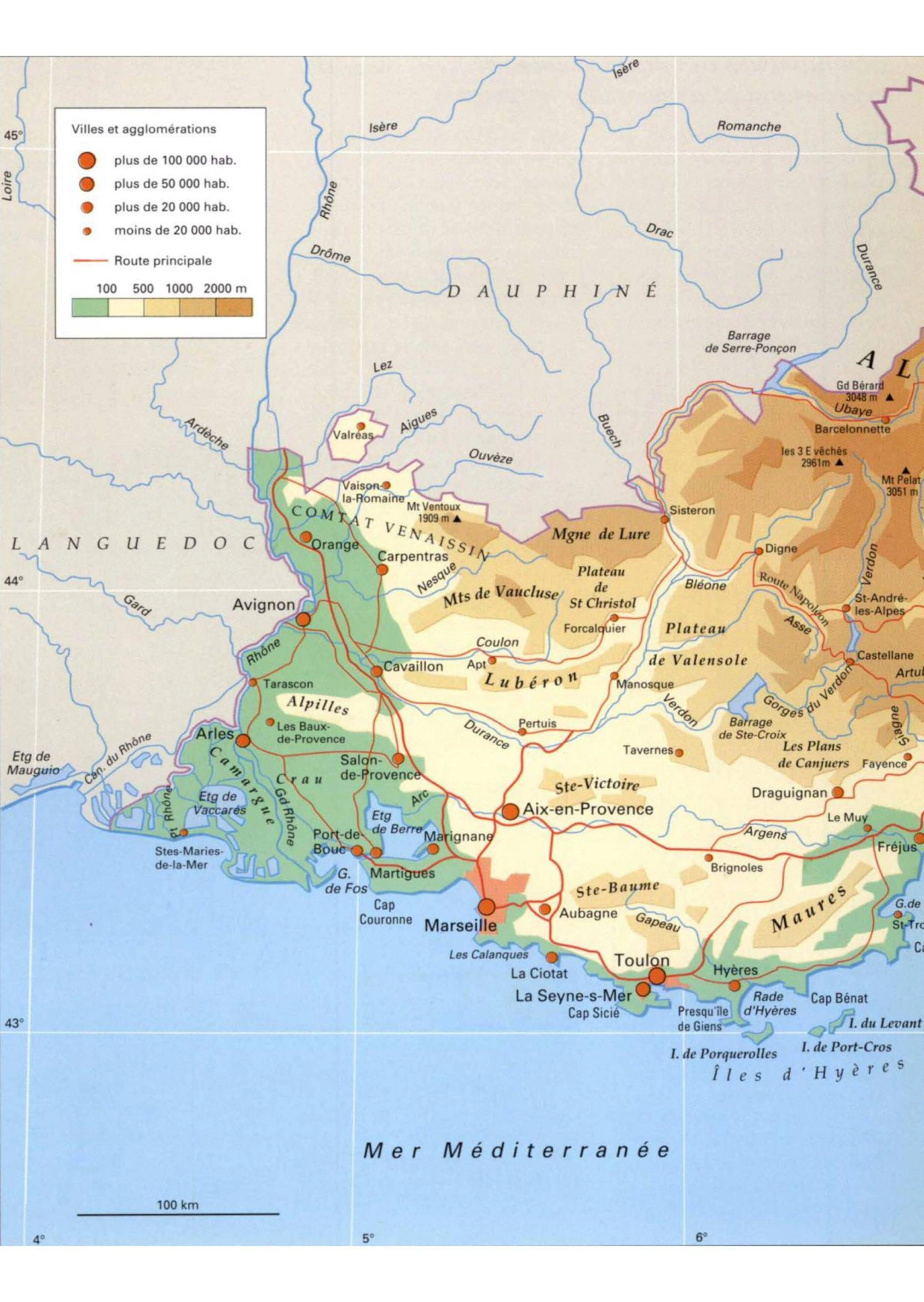
MARSEILLE ET LA PROVENCE
Active dès l'Antiquité, la Provence intègre le domaine royal au xvi' siècle, au terme de l'un de ses siècles d'or. Elle possède plusieurs capitales : au port de Marseille s'ajoutent Arles puis Aix. Sans oublier Avignon, la capitale des papes. Au xixe siècle, la Provence connaît une renaissance identitaire, qui s'illustre en littérature plus qu'en politique : Frédéric Mistral, champion de la langue provençale, obtient le prix Nobel de littérature en 1904. Au xxe siècle, la Provence est une région dynamique, tournée vers le tourisme et les nouvelles technologies.
AVANT L'HISTOIRE
Le premier peuplement
• Les premières traces de peuplement humain se situent sur le littoral.
La grotte Cosquer, au cap Morgiou, découverte en 1991, présente des peintures rupestres qui datent de plus de 20 000 ans.
Les premiers peuples connus
• Les historiens grecs rapportent que la côte qui s'étend de Savone jusqu'au Rhône est habitée par des populations ligures à partir du xe-ixe siècle av. J.-C. À l'intérieur des terres, des Celtes s'installent dans les vallées comme celle de la Durance à partir du vie siècle.
■ Il se constitue une population celto-ligure formant la confédération des Salyens.
LA PROVENCE ANTIQUE
L'apport grec
• En 692, des Grecs originaires de Phocée fondent un comptoir baptisé Massalia, d'où Marseille. C’est la porte d'entrée du commerce grec en Méditerranée occidentale.
• La cité phocéenne crée d’autres comptoirs le long de la côte, à Saint-Tropez et à Fréjus.
La Provence, région
DE LA NARBONNAISE
• En 125-121, une révolte conduit Rome à occuper la région cisalpine et à détruire la capitale des Salyens, l'oppidum d’Entremont (près d'Aix).
• Rome fonde alors la première Provincia romana - qui donnera son nom à la Provence. En 118, celle-ci devient la Narbonnaise (du nom de la capitale fondée par Rome).
Fondation de Marseille Rome fonde la Narbonnaise Raimond Béranger, comte de Provence Comtat Venaissin accordé au pape La Provence entre dans le royaume de France Massacre des vaudois du Luberon Épidémie de peste à Marseille Bonaparte reprend Toulon aux Anglais Débarquement de Provence
La Provence et les Francs
• Après le passage des Wisigoths, en 476, Euric, souverain de l'Auvergne, s'empare d'Arles et de Marseille et règne sur toute la basse Provence.
• À sa mort, les Burgondes sont chassés par Clovis, qui, en 507, défait le Wisigoth Alaric à Vouillé.
• Les Francs sont ensuite menacés par les Ostrogoths de Théodoric qui, entre 523 et 532, occupent la basse Provence puis le reste du pays.
• En 532, la région repasse dans l’orbite franque.
• Alors rattachée à l’Austrasie
- le royaume de l'Est - et gouvernée par un patrice siégeant à Arles, la province revient en 561 au roi de Bourgogne. Comme l’Austrasie exige un accès à la mer, un territoire est dissocié du reste de la région : ce couloir relie l'Auvergne à Marseille en passant par le pays d'Uzès, l'Avignonnais, le passage de Bompas et les pays d'Aix et de Vernègues.
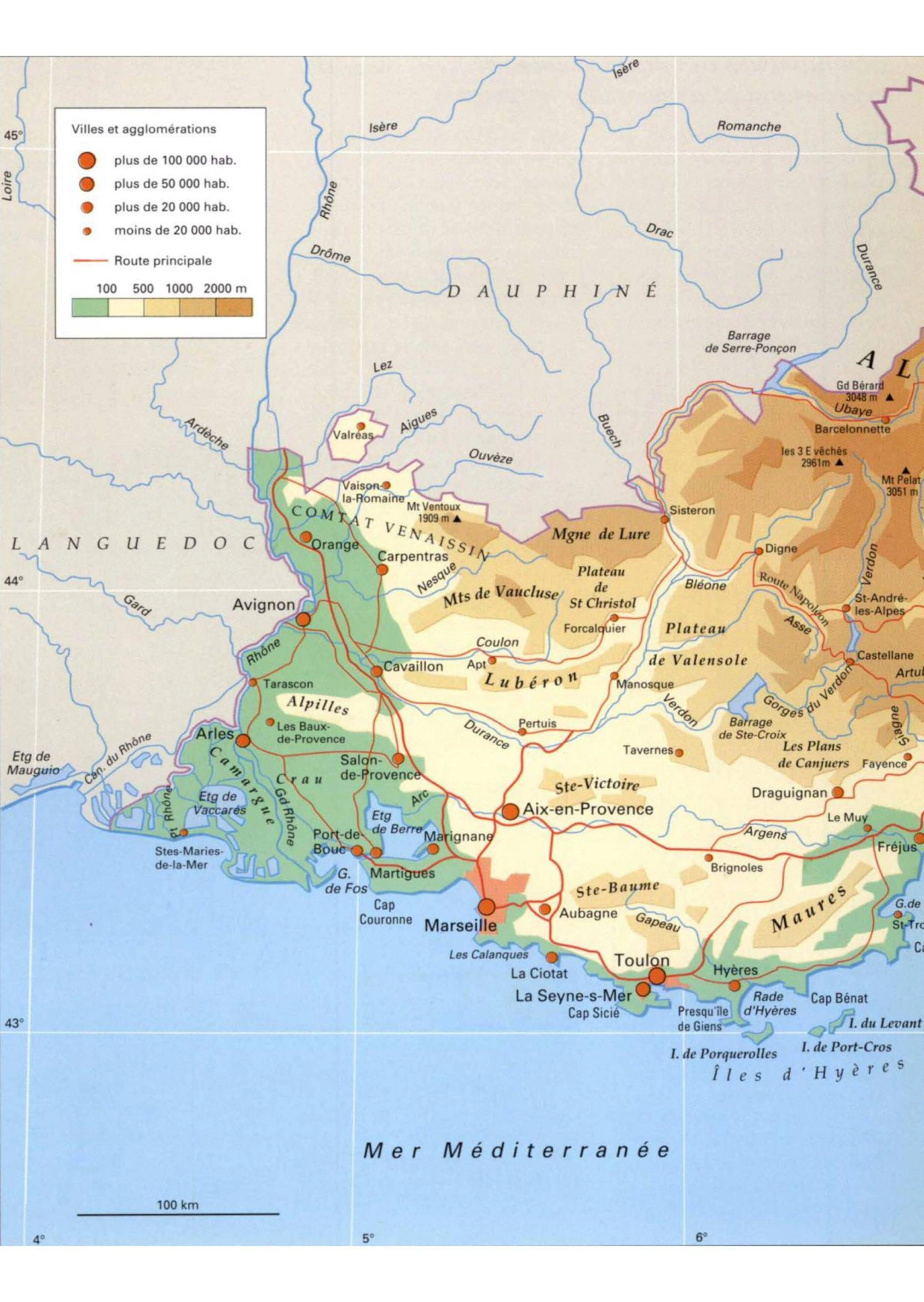
«
LA
PRÉSENCE CATALANG-ARAGONAISE
• En 1113, Douce de Provence et
Gévaudan fait donation de toutes ses
terres à son mari Raimond Béranger Ill,
comte de Barcelone.
• Le Xli' siècle est troublé pendant
vingt ans (1142-1 162) par les guerres
incessantes menées par Raimond, comte
de Baux, puis par son fils Hughes, qui
cherchent à concurrencer les Catalans.
• À partir de 1209, les seigneurs
provençaux s'affranchissent de
la discipline du roi Alfonse.
La tutelle
catalano-aragonaise prend fin en 1219.
RAIMOND BhANGER V
• Raimond Béranger V (1219-1245)
rétablit l'autorité comtale.
Un temps
allié à la cité de Marseille, il change de
parti avec l'irruption de l'armée du roi
Louis Vil dans le Midi et se concilie
l'Église en 1239, par la convention d'Aix.
Allié du roi de France, il enlève toutes
les possessions marseillaises de la côte.
En 1235, Raimond réorganise la
Provence en six grands gouvernements :
Forcalquier, Provence alpine, Aix,
Provence littorale et basse, Autevès
(Tarascon) et Arles.
À la tête de chacun
il nomme un baile (bailli).
LA PROVENCE ET LES CAPÉTIENS
CHAilLES D'ANJOU
• Imposé en 1246 par Blanche de
Castille, le
second fils
de celle-ci,
Ch11rles
d'AnjiiU,
fait passer
le Midi dans
l'orbite
capétienne.
Dès 1250,
Charles s'empare d'Arles puis menace
Marseille qui accepte de reconnaître
sa suzeraineté.
Il affermit le pouvoir
comtal dans la région, mais le mirage
italien l'attire bientôt.
LE COMTAT VENAISSIN
• Le comtat Venaissin -de Venasque -
et Avignon constituent un ensemble
disparate qui fait partie des États du
pape depuis le Moyen Âge.
Délimité
au sud par la Durance et à l'ouest par
le Rhône, cet espace s'étend au nord
jusqu'à Vaison et à l'est jusqu'aux
contreforts des Alpes de Basse
Provence.
Quatre enclaves, trois au
nord -Bollène, Valréas-VISêln et les
Pilles -et une au sud-i!SI -Bonnieux -
complètent le domaine papal.
• En 1273, le comte de Provence
Charles 1" obtient pour le pape de
la part du roi de France Philippe Ill
le Hardi la cession du Comtat Venaissin.
En 12BB, c'est au tour de la ville
d'Avignon d'être cédée aux papes,
qui s'y installent de 1309 à 1376.
• En 1345, la reine Jeanne vend
définitivement Avignon au pape
Clément VI pour 80 000 florins.
• A la fin du xv• siècle, des émeutes
et des spoliations de populations
juives en Provence aboutissent à la
migration de celles-ci dans le Comtat
• En 1791, Avignon demande
son rattachement à la France
révolutionnaire.
l'essentiel de
l'ancien territoire papal devient
le département du Vaucluse.
•
En 1262, le pape lui propose le trône
du royaume de Naples et de Sicile,
qu'il conquiert de haute lutte à la tête
de chevaliers provençaux et de la flotte
marseillaise (1266-1272).
• Installé à Naples, Charles, à partir
de 1277, soumet la Provence à son
administration napolitaine.
Mais il
se heurte à ses sujets italiens.
• En 1282, les " Vêpres siciliennes »
marquent la fin des aventures italiennes
des Angevins : les Arago nais défont
l'escadre provençale devant Malte en
1283, ainsi que l'armée commandée
par son fils Charles Il en 1284.
• Ce dernier, qui règne de 1285 à 1309,
dote la Provence d'une administration
originale.
Il crée la fonction de rational,
chargé de veiller à la bonne perception
des droits comtaux.
La Provence
devient une seule sénéchaussée.
LES MALHEURS PROVENÇAUX
• Les années 1350-1360 sont très
sombres : aux démêlés politiques
s'ajoutent la peste noire et, après 1356,
les premiers effets de la guerre franco
anglaise.
Au tournant des années 1360,
des bandes de pillards profitent des
luttes politiques pour se développer.
• Réunis chaque année, les états de
Provence organisent la résistance aux
exactions des seigneurs de Baux et votent
des taxes de plus en plus lourdes.
Cette
période de troubles s'achève vers 1376.
• La guerre franco-anglaise replonge
la Provence dans une période de
dix ans de désordres jusqu'en 1399.
• La Provence perd la moitié de sa
population au cours de la première
moitié du xv• siècle.
LE ROI RENt, UNE GLOIRE USURPÉE
• René d'Anjou (1434-1480) échoue
dans la
reconquête
de Naples
- l'affaire de
son règne
pour laquelle il
a épuisé les
ressources
financières de
la Provence.
• Il adopte toutefois des mesures qui
favorisent le développement économique.
Il crée ainsi deux foires à Marseille
et perce une route vers le Piémont.
• Ambitieux mais dispendieux.
il demeure
avant tout un personnage de cour.
Il ne s'installe en Provence qu'à partir
de 1471 et y séjourne jusqu'à sa mort.
À partir de 1472, il subit les pressions de
Louis Xl qui, profitant du fait que René
n'a plus de descendant direct, obtient
qu'il lui remette la Provence à sa mort.
• Son successeur Charles du Maine
-Charles Ill- se heurte à l'opposition
du parti dit " lorrain » qui conteste
la donation de la Provence à la France.
Il s'ensui� en 1480-1481, une courte
guerre de succession qui s'achève
par la mort de Charles Ill qui lègue
la Provence à la couronne de France.
LA PROVENCE ROYALE
• Le 19 décembre 1481, Louis Xl
accepte la donation de Charles Ill.
• De 1492 à 1540, la Provence se trouve
au centre de la politique italienne
des Valois, Charles VIII, Louis Xli et
François 1".
En 1524, la Provence est
envahie par les troupes du connétable
de Bourbon qui a pris parti pour Charles
Quint contre le roi, et dont
les troupes assiègent en vain Marseille.
• En 1536, une nouvelle guerre franco
impériale cause de lourdes destructions.
Charles Quint échoue devant Arles.
• Sur le plan intérieur, le parlement
d'Aix obtient la primauté judiciaire sur
le sénéchal par l'édit de Lyon (1501).
l'édit de Joinville (1540) affaiblit plus
encore le sénéchal au profit du roi.
• Marseille jouit d'un traitement
particulier : le territoire phocéen
demeure une sénéchaussée spécifique.
• En 1536, la Provence est le théatre du
m11 SS11ue des vt1udols, une croyance
dissidente répandue dans le Luberon.
La population de Mérindol est tuée sur
ordre royal par une troupe commandée
par le premier président du parlement
d'Aix, Jean Maynier d'Oppède.
LES GUERIES DE RELIGION
• Le premier heurt sanglant a lieu
à Castellane en 1559, des catholiques
se soulevant contre la présence d'un
pasteur protestant chez un noble.
Le frère de ce dernier organise alors
une bande qui ravage la haute Durance.
• Les massacres se succèdent : sac
d'Orange en 1561 et prise de Sisteron
par les catholiques en 1562.
• La guerre reprend en 1568
avec le massacre de Fréjus.
• La Provence ne connaît pas les
massacres de la Saint-Barthélemy.
Toutefois, une nouvelle poussée
de violence a lieu de 1572 à 1580.
LA PROVENCE AU XVII' SllCLE
• Sous Henri IV, la Provence connaît
une période de répit sous l'habile
gouverneur Guillaume du Vair.
· Sous Louis Xlii, Richelieu reconstitue
la marine
royale au
grand profit
de Marseille
et de Toulon,
mais il alourdit
la pression
fiscale et ôte
aux états le vote
des nouveaux
impôts, ce qui provoque la révolte
des états de Provence (163o-1631).
·En 1641, la création d'une nouvelle
chambre au parlement d'Aix provoque
une nouvelle flambée de violence
qui dure vingt ans.
• Le début du XVII' siècle est marqué par
la renaissance du sentiment religieux
catholique.
À Aix est fondé le premier
établissement des oratoriens (1600).
• En 1649, Marseille est le théâtre
de désordres opposant les nobles
- les Sabreurs -aux parlementaires
- les Canivets.
Ces troubles se soldent
en 1653 par la défaite des premiers.
• En 1658, une nouvelle rébellion à
Marseille débouche sur un bras de fer
entre, d'une part.
la ville et ses consuls
et de l'autre, le pouvoir royal.
En 1660,
Louis XIV décide l'abolition du consulat.
Le consul est remplacé par un échevin
moins prestigieux, les Marseillais sont désarmés
et une garnison royale
est implantée dans la ville.
LA PROVENCE AU XVIII' SllCLE
• La Provence revit les affres de
l'invasion en 1707 lorsque le duc
de Savoie, allié à l'Angleterre, pénètre
dans le Var pour s'emparer de Toulon.
Grace à l'esprit de décision du
lieutenant-général de Grignan et
aux renforts royaux, les Savoyards
sont arrêtés puis pourchassés.
LA GRANDE PESTE DE 1720
• t:application trop légère des
règlements
sanitaires et
la corruption
de la douane
par un échevin
sont à l'origine
de la gr11nde
ptste de 1720
qui ravage
Marseille.
t:épidémie s'étend à la plaine du
Comtat.
Après une rémission, le fléau
réapparaît en 1722.
Il cause la mort
de 40 000 des 75 000 Marseillais.
• De 1730 à 1750, la Provence traverse
une période de prospérité économique.
Marseille obtient le droit de commercer
directement avec les Amériques.
• Une invasion austro-piémontaise
en 1746-1747 qui s'avance jusqu'à
Draguignan et Hyères est repoussée.
Sur mer, la situation se tend à partir
de 1748 en raison de la menace
de la flotte anglaise.
• À l'occasion de la guerre de Sept Ans
(1756-1763),1a marine marseillaise
se développe.
Si la construction navale
profite du phénomène de la guerre
de course, le commerce méditerranéen
en pâtit sérieusement.
Devant la crise
financière que connaît la Couronne,
les créations d'impôts qui marquent
les règnes de Louis XV et Louis XVI
provoquent l'opposition du parlement
d'Aix.
L'EFFERVESCENCE PRÉRrJOLUTIONNAIRE
• Dans les années 1770-1780, l'attitude
des ordres privilégiés est de plus
en plus contestée par des hommes
appartenant au tiers état ou parfois
même à la noblesse.
Ceux-ci
revendiquent le rétablissement des
états de Provence dont la dernière
convocation remonte à 1639.
• En janvier 1789, l'assemblée qui
prélude à celle des états généraux
comprend 66 députés du tiers,
20 du clergé et 104 possesseurs de fiefs.
À cette occasion, Mirabeau appelle
à l'égalité au sein de la nation
provençale.
Fin mars, l'agitation gagne
la rue.
Des émeutes contre le prix du
pain et les impôts ont lieu à Sisteron,
Aups, Rians, puis Toulon et Marseille.
LA DÉPARTEMENTALISAnoN
• En 1790, les débats sur la
départementalisation aboutissent
à la division en trois entités : l'Oues t
le Nord et l'Est.
• Le principal débat oppose Aix,
qui revendique la première place, et
Marseille, qui exige une circonscription
à part Aix l'emporte sur Marseille.
Les trois départements sont baptisés
Bouches-du-Rhône, Var et Basses-Alpes.
UNE
lÉGION PLUS IOYALim
QUE RÉPUBLICAINE
• En 1793, l'opposition à la Convention
est très violente.
En juin, Marseille
se révolte, suivie de Toulon.
Tandis que
les insurgés marseillais s'emparent des
grandes villes de Provence occidentale,
les Toulonnais se livrent aux Anglais.
• La Convention rétablit l'ordre en juillet
En décembre, Bonaparte reprend Toulon.
Après la Terreur, la contre-révolution
s'organise : les Compagnies du Soleil
multiplient les attaques.
Le sentiment
royaliste perdurera jusqu'au XIX' siècle.
LA PROVENCE
DEPUIS LE XIX' SIÈCLE
• À partir de la conquête de l'Algérie
en 1830, M11rsellle s'impose comme
le plus grand port de Méditerranée
occidentale.
La cité, qui accueille de
fortes communautés italienne, corse
ou arménienne, devient le creuset
dans lequel se forge un esprit propre.
• Durant la Seconde Guerre mondiale,
Marseille devient, à partir de novembre
1942, un haut lieu de la Résistance dont
les Allemands détruisent le poumon
populaire qu'est le quartier du Panier.
À Toulon, la flotte de guerre se saborde
pour ne pas
tomber dans
les mains
de la Kriegs
marine.
C'est
en Provence
que se déroule
��>.lill- le
second
débtlr
quement
sur le territoire français, en août 1944.
• A partir des années 1960, la Provence,
lieu de villégiature depuis le XIX ' siècle,
devient une destination du tourisme
de masse.
• Depuis la loi de la décentralisation et
de la régionalisation, la Provence forme
le cœur de la région PACA dont le siège
est à Marseille.
Trois autres départements,
le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et
les Hautes-Alpes, lui ont été adjoints.
En 1970, les Basses-Alpes sont devenues
les Alpes de Haute-Provence.
LEFtUBRIGE
• Cette école littéraire fondée en 1854
s'est donné pour objectif la défense de
la langue et des traditions provençales.
Deux jeunes poètes, Frédéric Mistral
(183o-1914) et Joseph Roumanille
(1818-1891), en sont les créateurs, en
compagnie de cinq autres membres.
• Dès 1855, l'école du • félibrige »
- • écriture •.
• poésie • en provençal -
crée un almanach, I'Armana
prouvençau.
À partir de 1870, Mistral
inscrit son mouvement littéraire
dans l'apologie de la latinité, tout en
s'opposant à toute utilisation politique
de son combat Son œUVTe la plus
célèbre est Miréio (Mireille).
Il obtient
le prix Nobel de littérature en 1904..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Provence et le Comtat Venaissin
- Fléchier Esprit, 1632-1710, né à Pernes-les-Fontaines (Comtat Venaissin), prélat et écrivain français.
- Comtat Venaissin.
- Comtat venaissin.
- Lecture Linéaire N°5 capitales, 2013 Sylvie Germain, Petites scènes