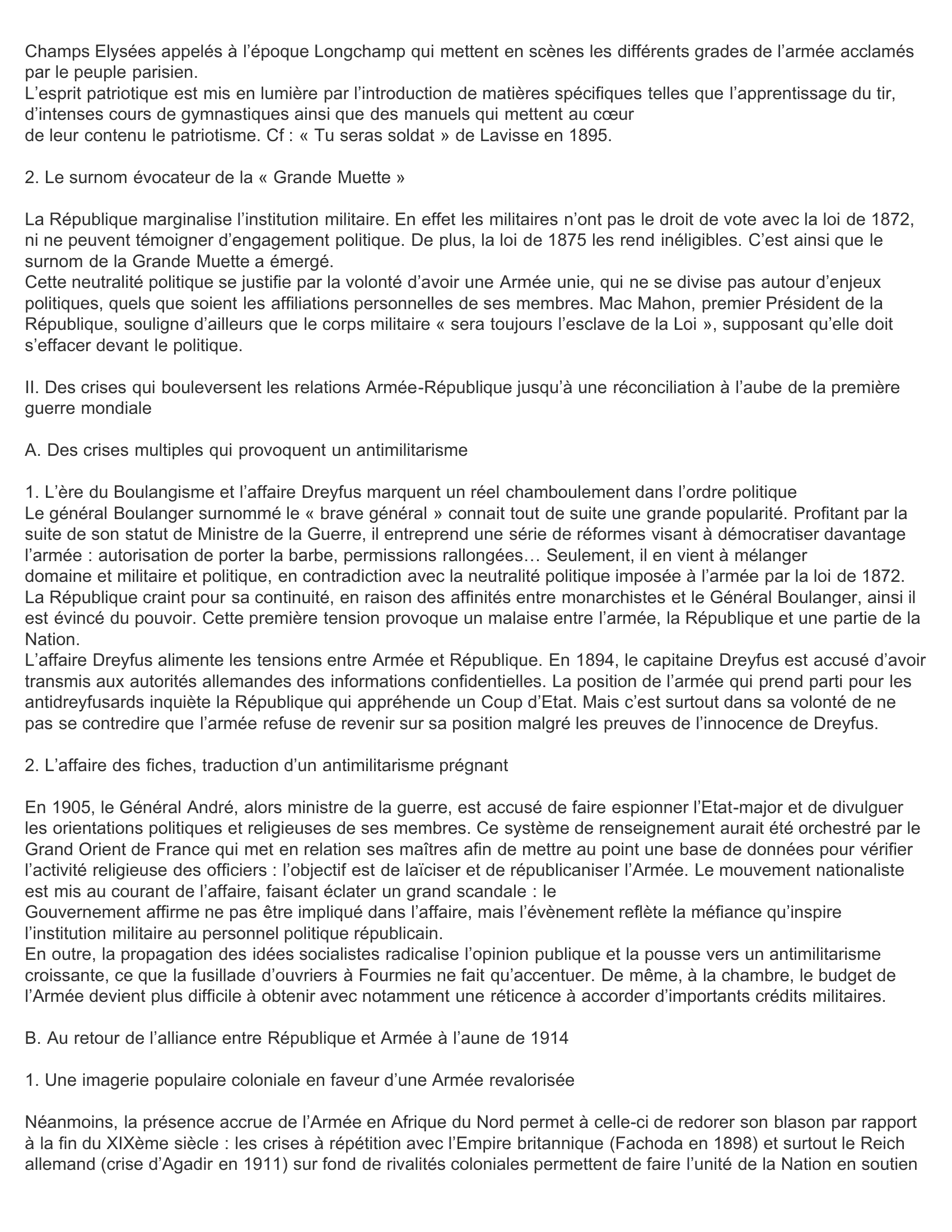LA REPUBLIQUE ET SON ARMEE
Publié le 28/10/2019

Extrait du document
Ce constat est tout de même à relativiser : cette effervescence reste moindre à celle connue dans les années 1880, les scandales ayant tout de même laissé des marques. L’influence socialiste n’est pas négligeable comme le montre le vote laborieux de la loi des trois ans en 1913.2. Un rassemblement national
Le déclenchement de la Première Guerre Mondiale le 4 août 1914 marque le paroxysme de l’alliance entre Armée et République : toutes les principales forces politiques, socialistes compris, participent à l’effort de guerre au sein de la Sainte Alliance, et le taux de réfractaires est négligeable alors qu’on en pronostiquait 15 %.
La République et la population ont fini par accorder leur confiance à l’Armée qui porte les espoirs de revanche contre l’Allemagne, alors même que la fondation de la République s’était faite en conséquence de la défaite de 1870. L’alliance avec les couronnes britannique et russe ainsi que le concours des armées venues des colonies renforce l’optimisme général.
Conclusion :
Force est d’admettre que l’institution militaire, autrefois perçue comme un reliquat conservateur d’un pouvoir autocratique dont on veut refermer la parenthèse, parvient à se démocratiser et se calque sur les ambitions de la République. Néanmoins, malgré la volonté de rendre neutre l’Armée, cette dernière devient un sujet de débat politique, et donc victime principale des crises que connaît le régime.
Le premier conflit mondial voit la victoire de l’Armée républicaine, qui est même érigé en modèle au lendemain de la guerre : les puissances défaites adoptent la République, bien que celle-ci aura toutes les peines du monde à s’imposer. Le modèle français s’est imposé.
«
Champs Elysées appelés à l’époque Longchamp qui mettent en scènes les différents grades de l’armée acclamés
par le peuple parisien.
L’esprit patriotique est mis en lumière par l’introduction de matières spécifiques telles que l’apprentissage du tir,
d’intenses cours de gymnastiques ainsi que des manuels qui mettent au cœur
de leur contenu le patriotisme.
Cf : « Tu seras soldat » de Lavisse en 1895.
2.
Le surnom évocateur de la « Grande Muette »
La République marginalise l’institution militaire.
En effet les militaires n’ont pas le droit de vote avec la loi de 1872,
ni ne peuvent témoigner d’engagement politique.
De plus, la loi de 1875 les rend inéligibles.
C’est ainsi que le
surnom de la Grande Muette a émergé.
Cette neutralité politique se justifie par la volonté d’avoir une Armée unie, qui ne se divise pas autour d’enjeux
politiques, quels que soient les affiliations personnelles de ses membres.
Mac Mahon, premier Président de la
République, souligne d’ailleurs que le corps militaire « sera toujours l’esclave de la Loi », supposant qu’elle doit
s’effacer devant le politique.
II.
Des crises qui bouleversent les relations Armée -République jusqu’à une réconciliation à l’aube de la première
guerre mondiale
A.
Des crises multiples qui provoquent un antimilitarisme
1.
L’ère du Boulangisme et l’affaire Dreyfus marquent un réel chamboulement dans l’ordre politique
Le général Boulanger surnommé le « brave général » connait tout de suite une grande popularité.
Profitant par la
suite de son statut de Ministre de la Guerre, il entreprend une série de réformes visant à démocratiser davantage
l’armée : autorisation de porter la barbe, permissions rallongées… Seulement, il en vient à mélanger
domaine et militaire et politique, en contradiction avec la neutralité politique imposée à l’armée par la loi de 1872.
La République craint pour sa continuité, en raison des affinités entre monarchistes et le Général Boulanger, ainsi il
est évincé du pouvoir.
Cette première tension provoque un malaise entre l’armée, la République et une partie de la
Nation.
L’affaire Dreyfus alimente les tensions entre Armée et République.
En 1894, le capitaine Dreyfus est accusé d’avoir
transmis aux autorités allemandes des informations confidentielles.
La position de l’armée qui prend parti pour les
antidreyfusards inquiète la République qui appréhende un Coup d’Etat.
Mais c’est surtout dans sa volonté de ne
pas se contredire que l’armée refuse de revenir sur sa position malgré les preuves de l’innocence de Dreyfus.
2.
L’affaire des fiches, traduction d’un antimilitarisme prégnant
En 1905, le Général André, alors ministre de la guerre, est accusé de faire espionner l’Etat-major et de divulguer
les orientations politiques et religieuses de ses membres.
Ce système de renseignement aurait été orchestré par le
Grand Orient de France qui met en relation ses maîtres afin de mettre au point une base de données pour vérifier
l’activité religieuse des officiers : l’objectif est de laïciser et de républicaniser l’Armée.
Le mouvement nationaliste
est mis au courant de l’affaire, faisant éclater un grand scandale : le
Gouvernement affirme ne pas être impliqué dans l’affaire, mais l’évènement reflète la méfiance qu’inspire
l’institution militaire au personnel politique républicain.
En outre, la propagation des idées socialistes radicalise l’opinion publique et la pousse vers un antimilitarisme
croissante, ce que la fusillade d’ouvriers à Fourmies ne fait qu’accentuer.
De même, à la chambre, le budget de
l’Armée devient plus difficile à obtenir avec notamment une réticence à accorder d’importants crédits militaires.
B.
Au retour de l’alliance entre République et Armée à l’aune de 1914
1.
Une imagerie populaire coloniale en faveur d’une Armée revalorisée
Néanmoins, la présence accrue de l’Armée en Afrique du Nord permet à celle-ci de redorer son blason par rapport
à la fin du XIXème siècle : les crises à répétition avec l’Empire britannique (Fachoda en 1898) et surtout le Reich
allemand (crise d’Agadir en 1911) sur fond de rivalités coloniales permettent de faire l’unité de la Nation en soutien.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le role du president de la republique
- Republique dominicaine
- La III ème REPUBLIQUE
- la Veme republique
- L'ART ROMAIN SOUS LA REPUBLIQUE