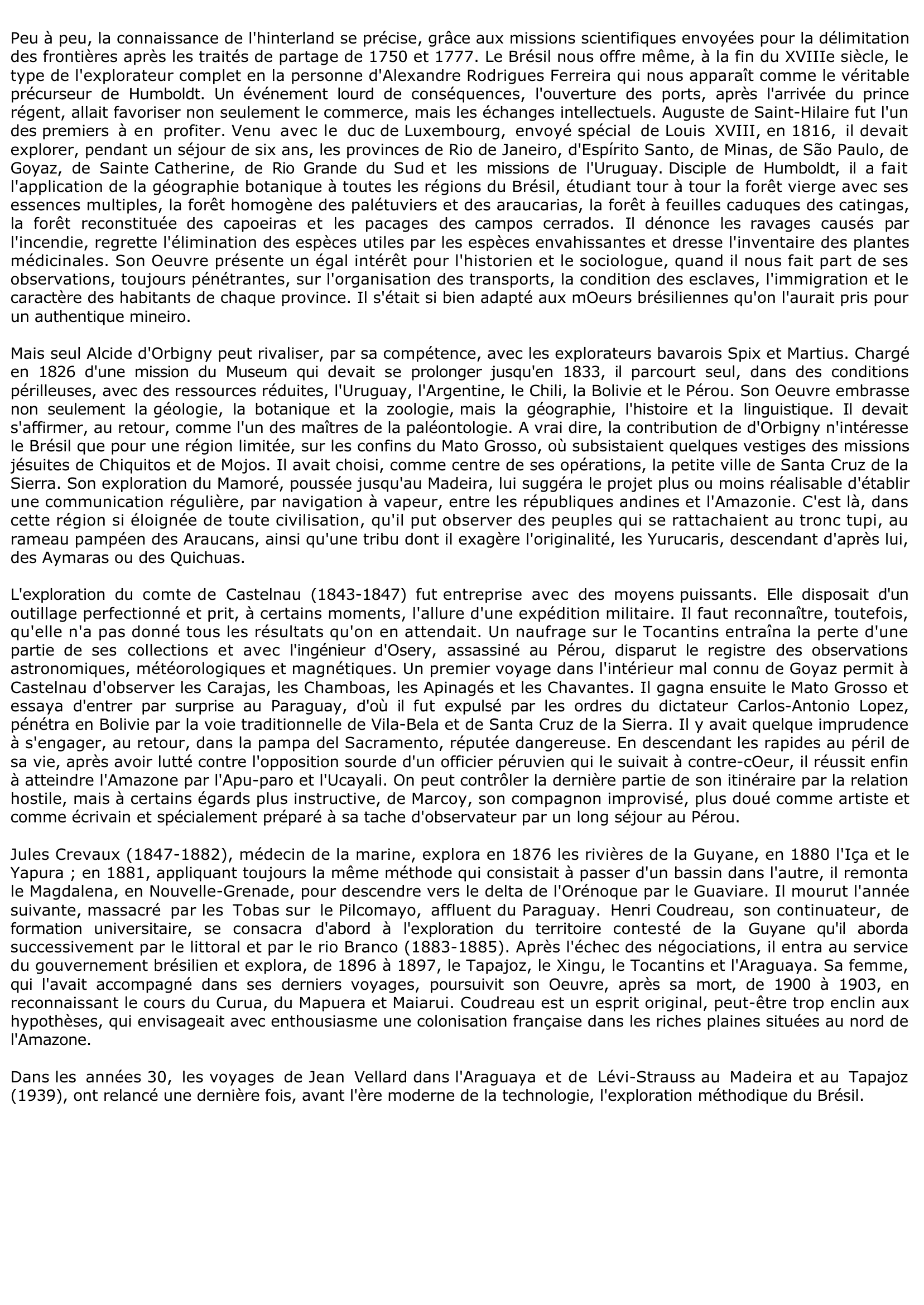L'Amérique du Sud
Publié le 26/02/2010

Extrait du document
Les relations entre le France et le Brésil remontent aux premiers temps de la découverte. Il s'est même trouvé, au XVIIe et au XVIIIe siècles, des auteurs pour affirmer que les Normands avaient précédé les Portugais, non seulement sur la côte d'Afrique, où ils auraient fondé le Petit-Dieppe, mais en Amérique. On ne croit plus depuis longtemps au voyage de Jean Cousin qui, d'après le témoignage suspect de Desmarquetz, aurait atteint l'embouchure de l'Amazone en 1488. Rien n'empêche pourtant de supposer qu'il y eut quelques Français parmi les précurseurs de Cabral. Dans la Relation authentique du Voyage du capitaine de Gonneville ès nouvelles terres des Indes, qui raconte la croisière du navire l'Espoir de Honfleur (1503-1505), il est fait allusion aux Dieppois et aux Malouins qui fréquentent les côtes du Brésil "depuis aucunes années en ça". Toujours est-il que, chez nous, le Brésil était à la mode. On le voit par la fête célébrée à Rouen en 1550, ou des Topinambous, renforcés par une troupe de marins déguisés en Indiens, simulent un combat contre les Tabajares. On nous signale, en 1554 à Troyes, en 1565 à Bordeaux, la présence d'Américains dans un cortège. Ils inspirent les sculpteurs de l'église Saint-Jacques de Dieppe et de l'hôtel de la rue Malpalu à Rouen. C'est précisément l'époque où la colonisation française, repoussée de Pernambouc par la réaction des Portugais, descend vers le sud et cherche à s'implanter dans les parages du Cabo Frio. On se rappelle que Villegagnon s'établit dans la baie de Guanabara, sur l'emplacement de Rio de Janeiro, en 1555, et que nous en serons chassés en 1567. Il avait envoyé en reconnaissance Nicolas Barré, dont nous connaissons le voyage en 1550 par une carte de Le Testu et par la relation manuscrite du cordelier Thevet, qui devait prendre part, comme chapelain, à la seconde expédition. L'ouvrage qu'il publia en 1558, sous le titre prometteur de Singularitez de la France Antarctique, eut une immense répercussion et lui attira les éloges de plus d'un poète de la Pléiade, à commencer par Ronsard. On lui a cependant fait une réputation de menteur que son livre est loin de mériter. On lui doit un aperçu de la faune et de la flore. Enfin, il est le premier à nous renseigner sur le cannibalisme rituel et le mythe du héros civilisateur. Son témoignage n'est pas infirmé par celui de son rival et contradicteur, le protestant Jean de Léry. On reconnaît à ce dernier plus de talent, avec une tendance à faire de son Voyage, édité seulement en 1578, une satire indirecte de l'Europe déchirée par les guerres de religion. Bien qu'il nous transmette une information de première main sur la civilisation matérielle des Indiens, sur leur musique, leurs chants, leurs danses et ces fêtes mystérieuses dont les femmes étaient exclues, on l'apprécie surtout de nos jours en tant que moraliste. C'est chez lui, en effet, qu'apparaît la thèse du "bon sauvage" qui devait exercer une si grande influence sur notre littérature depuis Montaigne jusqu'à Rousseau.
«
Peu à peu, la connaissance de l'hinterland se précise, grâce aux missions scientifiques envoyées pour la délimitationdes frontières après les traités de partage de 1750 et 1777.
Le Brésil nous offre même, à la fin du XVIIIe siècle, letype de l'explorateur complet en la personne d'Alexandre Rodrigues Ferreira qui nous apparaît comme le véritableprécurseur de Humboldt.
Un événement lourd de conséquences, l'ouverture des ports, après l'arrivée du princerégent, allait favoriser non seulement le commerce, mais les échanges intellectuels.
Auguste de Saint-Hilaire fut l'undes premiers à en profiter.
Venu avec le duc de Luxembourg, envoyé spécial de Louis XVIII, en 1816, il devaitexplorer, pendant un séjour de six ans, les provinces de Rio de Janeiro, d'Espírito Santo, de Minas, de São Paulo, deGoyaz, de Sainte Catherine, de Rio Grande du Sud et les missions de l'Uruguay.
Disciple de Humboldt, il a faitl'application de la géographie botanique à toutes les régions du Brésil, étudiant tour à tour la forêt vierge avec sesessences multiples, la forêt homogène des palétuviers et des araucarias, la forêt à feuilles caduques des catingas,la forêt reconstituée des capoeiras et les pacages des campos cerrados.
Il dénonce les ravages causés parl'incendie, regrette l'élimination des espèces utiles par les espèces envahissantes et dresse l'inventaire des plantesmédicinales.
Son Oeuvre présente un égal intérêt pour l'historien et le sociologue, quand il nous fait part de sesobservations, toujours pénétrantes, sur l'organisation des transports, la condition des esclaves, l'immigration et lecaractère des habitants de chaque province.
Il s'était si bien adapté aux mOeurs brésiliennes qu'on l'aurait pris pourun authentique mineiro.
Mais seul Alcide d'Orbigny peut rivaliser, par sa compétence, avec les explorateurs bavarois Spix et Martius.
Chargéen 1826 d'une mission du Museum qui devait se prolonger jusqu'en 1833, il parcourt seul, dans des conditionspérilleuses, avec des ressources réduites, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, la Bolivie et le Pérou.
Son Oeuvre embrassenon seulement la géologie, la botanique et la zoologie, mais la géographie, l'histoire et la linguistique.
Il devaits'affirmer, au retour, comme l'un des maîtres de la paléontologie.
A vrai dire, la contribution de d'Orbigny n'intéressele Brésil que pour une région limitée, sur les confins du Mato Grosso, où subsistaient quelques vestiges des missionsjésuites de Chiquitos et de Mojos.
Il avait choisi, comme centre de ses opérations, la petite ville de Santa Cruz de laSierra.
Son exploration du Mamoré, poussée jusqu'au Madeira, lui suggéra le projet plus ou moins réalisable d'établirune communication régulière, par navigation à vapeur, entre les républiques andines et l'Amazonie.
C'est là, danscette région si éloignée de toute civilisation, qu'il put observer des peuples qui se rattachaient au tronc tupi, aurameau pampéen des Araucans, ainsi qu'une tribu dont il exagère l'originalité, les Yurucaris, descendant d'après lui,des Aymaras ou des Quichuas.
L'exploration du comte de Castelnau (1843-1847) fut entreprise avec des moyens puissants.
Elle disposait d'unoutillage perfectionné et prit, à certains moments, l'allure d'une expédition militaire.
Il faut reconnaître, toutefois,qu'elle n'a pas donné tous les résultats qu'on en attendait.
Un naufrage sur le Tocantins entraîna la perte d'unepartie de ses collections et avec l'ingénieur d'Osery, assassiné au Pérou, disparut le registre des observationsastronomiques, météorologiques et magnétiques.
Un premier voyage dans l'intérieur mal connu de Goyaz permit àCastelnau d'observer les Carajas, les Chamboas, les Apinagés et les Chavantes.
Il gagna ensuite le Mato Grosso etessaya d'entrer par surprise au Paraguay, d'où il fut expulsé par les ordres du dictateur Carlos-Antonio Lopez,pénétra en Bolivie par la voie traditionnelle de Vila-Bela et de Santa Cruz de la Sierra.
Il y avait quelque imprudenceà s'engager, au retour, dans la pampa del Sacramento, réputée dangereuse.
En descendant les rapides au péril desa vie, après avoir lutté contre l'opposition sourde d'un officier péruvien qui le suivait à contre-cOeur, il réussit enfinà atteindre l'Amazone par l'Apu-paro et l'Ucayali.
On peut contrôler la dernière partie de son itinéraire par la relationhostile, mais à certains égards plus instructive, de Marcoy, son compagnon improvisé, plus doué comme artiste etcomme écrivain et spécialement préparé à sa tache d'observateur par un long séjour au Pérou.
Jules Crevaux (1847-1882), médecin de la marine, explora en 1876 les rivières de la Guyane, en 1880 l'Iça et leYapura ; en 1881, appliquant toujours la même méthode qui consistait à passer d'un bassin dans l'autre, il remontale Magdalena, en Nouvelle-Grenade, pour descendre vers le delta de l'Orénoque par le Guaviare.
Il mourut l'annéesuivante, massacré par les Tobas sur le Pilcomayo, affluent du Paraguay.
Henri Coudreau, son continuateur, deformation universitaire, se consacra d'abord à l'exploration du territoire contesté de la Guyane qu'il abordasuccessivement par le littoral et par le rio Branco (1883-1885).
Après l'échec des négociations, il entra au servicedu gouvernement brésilien et explora, de 1896 à 1897, le Tapajoz, le Xingu, le Tocantins et l'Araguaya.
Sa femme,qui l'avait accompagné dans ses derniers voyages, poursuivit son Oeuvre, après sa mort, de 1900 à 1903, enreconnaissant le cours du Curua, du Mapuera et Maiarui.
Coudreau est un esprit original, peut-être trop enclin auxhypothèses, qui envisageait avec enthousiasme une colonisation française dans les riches plaines situées au nord del'Amazone.
Dans les années 30, les voyages de Jean Vellard dans l'Araguaya et de Lévi-Strauss au Madeira et au Tapajoz(1939), ont relancé une dernière fois, avant l'ère moderne de la technologie, l'exploration méthodique du Brésil..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RELIGIONS ET MAGIE INDIENNES D'AMÉRIQUE DU SUD. (résumé)
- CONSTITUTION D'UNE SCIENCE DE L'HOMME - La question «Qu'est-ce que l'homme?» peut-elle recevoir une réponse scientifique? Amérique du Sud, A
- Ancienne colonie espagnole d'Amérique du Sud ayant acquis son indépendance en 1830, de peuplement indien et européen largement métissé, le Venezuela est un pays dont l'histoire fut ponctuée de dictatures militaires et qui est devenu une république parlementaire en 1961.
- Forêts tropicales humides Forêt pluviale amazonienne La forêt ombrophile tropicale la plus vaste au monde est située dans le bassin amazonien, en Amérique du Sud.
- L'Amérique du sud par Pierre et Juliette Monbeig Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine de l'Université de Paris Étrangère au monde depuis des millénaires, l'Amérique va, au début du XVIe siècle, s'y trouver soudainement et brutalement incorporée.