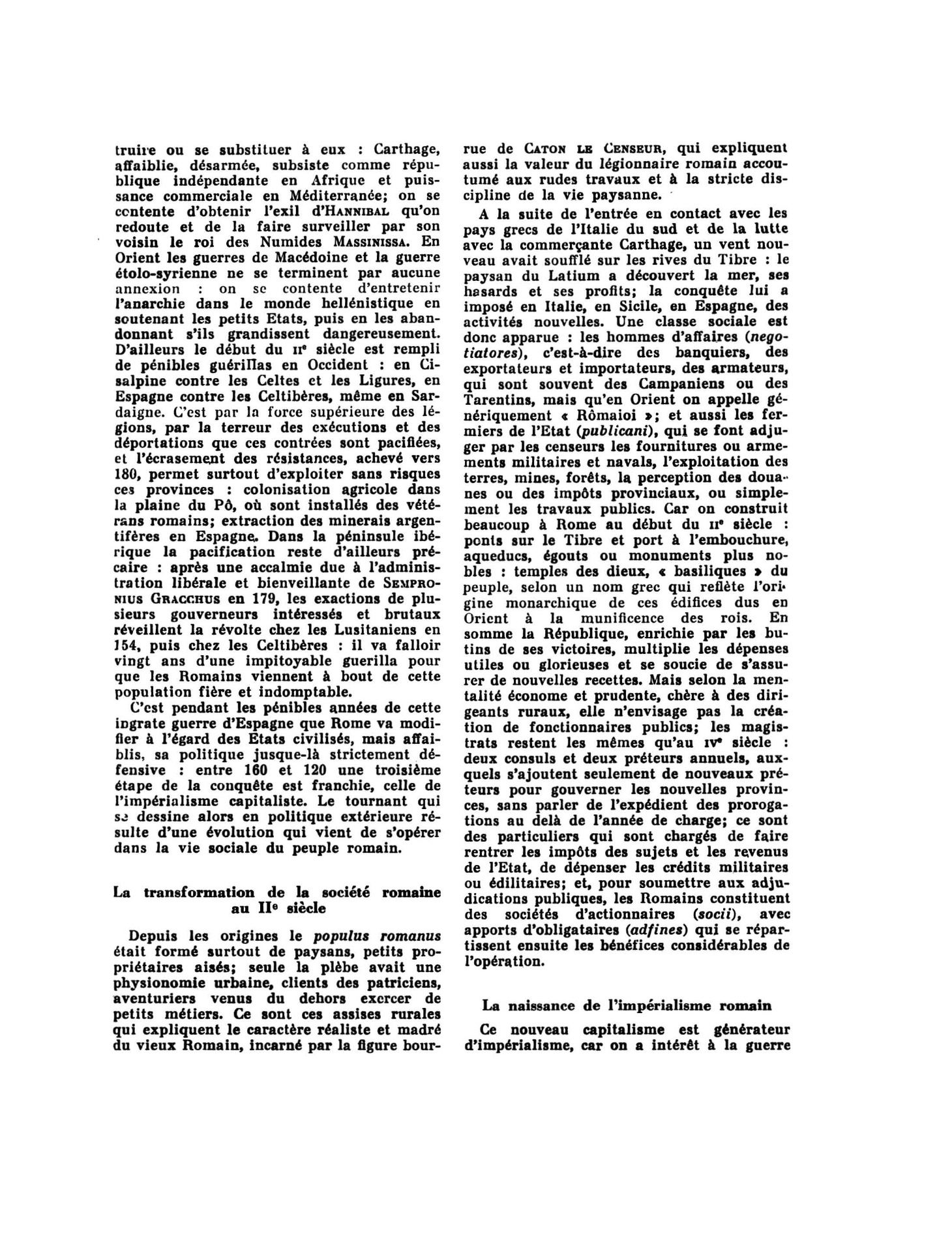L'Empire romain
Publié le 20/10/2011

Extrait du document
Néanmoins, si nous replaçons ces événements tragiques dans la perspective des deux premiers siècles, il est juste de les considérer comme assez exceptionnels. Ainsi que la plupart des guerres extérieures, ils sont avant tout la rançon de la timidité d'Auguste, qui n'a pas osé fonder francbe,ment un régime héréditaire : les usurpateurs avaient beau jeu de se dresser contre une légalité résidant théoriquement dans un Sénat impuissant, qui docilement a toujours investi du pouvoir suprême le candidat des prétoriens, des légions ou du prince luimême. Lorsque le fait crée ainsi le droit, l'Etat est ébranlé et la paix publique menacée.
«
truh ·e ou se aubstiluer à eux : Carthage, ~tffaiblie, désarmée, subsiste comme répu blique indépendante en Afrique et puis sance commerciale en Méditerranée; on se ccntente d'obtenir l'exil d'HANNIBAL qu'on redoute et de la faire surveiller par son
voisin le roi des Numides MASSINISSA.
En Orient les guerres de Macédoine et la guerre
étolo-ayrienne ne se terminent par aucune
annexion : on sc contente d'entretenir l'anarchie dana le monde hellénistique en soutenant les petits Etats, puis en les aban donnant s'ils grandissent dangereusement .
D'ailleurs le début du u• siècle est rempli de pénibles guérillas en Occident : en Ci salpine contre les Celtes et les Ligures, en
Espagne contre les Celtibères, même en Sar daigne.
C'est par ln force supérieure des lé gions, par la terreur des exécutions et des déportations que ces contrées sont pacifiées,
et l'écraseme.nt des résistances, achevé vers
180, permet surtout d'exploiter sans risques ces provinces : colonisation agricole dans la plaine du Pô, où sont installés des vété rans romains; extraction des minerais argen tifères en Espagne..
Dans la péninsule ibé rique la pacification reste d'ailleurs pré caire : après une accalmie due à l'adminis tration libérale et bienveillante de SBMPRO NIUS GRACCHUS en 179, les exactions de plu sieurs gouverneurs intéressés et brutaux réveillent la révolte chez les Lusitaniens en J 54, puis chez les Celtibères : il va falloir vingt ans d'une impitoyable guerilla pour que les Romains viennent à bout de cette population fière et indomptable.
C'est pendant les pénibles années de cette ingrate guerre d'Espagne que Rome va modi fier à l'égard des Etats civilisés, mais affai blis, sa politique jusque-là strictement dé fensive : entre 160 et 120 une troisième étape de la conquête est franchie, celle de l'impérialisme capitaliste.
Le tournant qui s..! dessine alors en politique extérieure ré sulte d'une évolution qui vient de s'opérer dans la vie sociale du peuple romain .
La
transformation de la société romaine au II• siècle
Depuis les
origines le populus romanus était formé surtout de paysans, petits pro priétaires aisés; seule la plèbe avait une physionomie urbaine.
clients des patriciens, ·aventuriers venus du dehors exercer de petits métiers.
Ce sont ces a11isea rurales qui expliquent le caractère réaliste et madré du vieux Romain, incarné par la figure bour- rue
de
CATON LB CBNSBUR, qui expliquent aussi la valeur du légionnaire romain accou tumé aux rudes travaux et à la stricte dis cipline de la vie paysanne.
A
la suite de l'entrée en contact avec les
pays grecs de l'Italie du sud et de la lutte avec la commerçante Carthage, un vent nou veau avait soufflé sur les rives du Tibre : le
paysan du Latium a découvert la mer, ses hssards et ses profits; la conqutHe lui a
imposé en Italie.
en Sicile, en Espagne, des
activités nouvelles.
Une classe sociale est donc apparue : les hommes d'affaires (nego tiatores), c'est-à-dire des banquiers, des exportateurs et importateurs, dea armateurs, qui sont souvent dea Campaniens ou des
Tarentins, mais qu'en Orient on appelle gé nériquement c Rômaioi :t; et aussi les fer miers de l'Etat (publicani), qui se font adju ger par les censeurs les fournitures ou arme ments militaires et navals, l'exploitation des
terres, mines, forêts, la perception dea doua ..
nes ou dea impôts provinciaux, ou simple ment les travaux publics.
Car on construit beaucoup à Rome au début du u• siècle : ponts sur le Tibre et port à l'embouchure,
aqueducs, égouts ou monuments plus no bles : temples des dieux, c basiliques :t du
peuple, selon un nom grec qui reflète l'ori• gine monarchique de ces édifices dus en Orient à la munificence des rois.
En
somme la République, enrichie par les bu tins de ses victoires, multiplie les dépenses
utiles ou glorieuses et se soucie de s'assu rer de nouvelles recettes.
Mais selon la men talité économe et prudente, chère à des diri geants ruraux, elle n'envisage pas la créa tion de fonctionnaires publics; les magis trats restent les mêmes qu'au Iv" siècle :
deux consuls et deux préteurs annuels, aux quels s'ajoutent seulement de nouveaux pré teurs pour gouverner les nouvelles provin ces, sans parler de l'expédient des proroga tions au delà de l'année de charge; ce sont des particuliers qui sont chargés de faire rentrer les impôts des sujets et les r~venus de l'Etat, de dépenser les crédits mUitaires
ou édilitaires; et, pour soumettre aux adju dications publiques, les Romains constituent des sociétés d'actionnaires (socii), avec
apporta d'obligataires (adfïnes) qui se répar tissent ensuite les bénéfices considérables de
l'opération.
La naissance de l'impérialisme romain
Ce nouveau capitalisme est générateur d'impérialisme, car on a intérêt à la guerre.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Antiquité : avant 476 Après 476 : chute de l’Empire romain
- HISTOIRE DU DÉCLIN ET DE LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN (résumé)
- vielle antiquité - l'empire Romain Tardive
- HISTOIRE DU DÉCLIN ET DE LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN
- L'ART DU BAS-EMPIRE ROMAIN : Grandeur et décadence du Bas-Empire (193-395 après J.-C.)