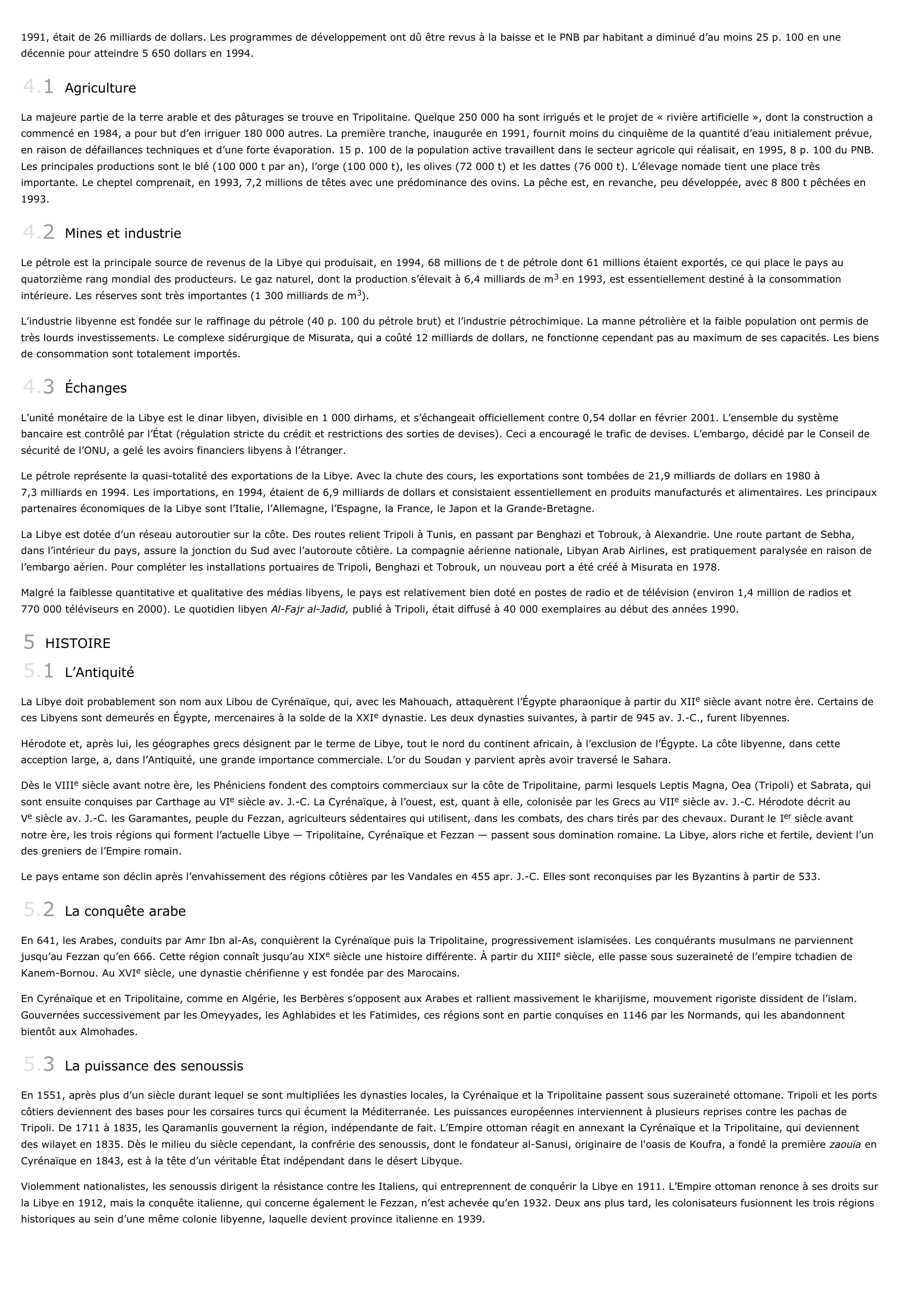Libye.
Publié le 15/04/2013

Extrait du document


«
1991, était de 26 milliards de dollars.
Les programmes de développement ont dû être revus à la baisse et le PNB par habitant a diminué d’au moins 25 p.
100 en unedécennie pour atteindre 5 650 dollars en 1994.
4.1 Agriculture
La majeure partie de la terre arable et des pâturages se trouve en Tripolitaine.
Quelque 250 000 ha sont irrigués et le projet de « rivière artificielle », dont la construction acommencé en 1984, a pour but d’en irriguer 180 000 autres.
La première tranche, inaugurée en 1991, fournit moins du cinquième de la quantité d’eau initialement prévue,en raison de défaillances techniques et d’une forte évaporation.
15 p.
100 de la population active travaillent dans le secteur agricole qui réalisait, en 1995, 8 p.
100 du PNB.Les principales productions sont le blé (100 000 t par an), l’orge (100 000 t), les olives (72 000 t) et les dattes (76 000 t).
L’élevage nomade tient une place trèsimportante.
Le cheptel comprenait, en 1993, 7,2 millions de têtes avec une prédominance des ovins.
La pêche est, en revanche, peu développée, avec 8 800 t pêchées en1993.
4.2 Mines et industrie
Le pétrole est la principale source de revenus de la Libye qui produisait, en 1994, 68 millions de t de pétrole dont 61 millions étaient exportés, ce qui place le pays auquatorzième rang mondial des producteurs.
Le gaz naturel, dont la production s’élevait à 6,4 milliards de m 3 en 1993, est essentiellement destiné à la consommation intérieure.
Les réserves sont très importantes (1 300 milliards de m 3).
L’industrie libyenne est fondée sur le raffinage du pétrole (40 p.
100 du pétrole brut) et l’industrie pétrochimique.
La manne pétrolière et la faible population ont permis detrès lourds investissements.
Le complexe sidérurgique de Misurata, qui a coûté 12 milliards de dollars, ne fonctionne cependant pas au maximum de ses capacités.
Les biensde consommation sont totalement importés.
4.3 Échanges
L’unité monétaire de la Libye est le dinar libyen, divisible en 1 000 dirhams, et s’échangeait officiellement contre 0,54 dollar en février 2001.
L’ensemble du systèmebancaire est contrôlé par l’État (régulation stricte du crédit et restrictions des sorties de devises).
Ceci a encouragé le trafic de devises.
L’embargo, décidé par le Conseil desécurité de l’ONU, a gelé les avoirs financiers libyens à l’étranger.
Le pétrole représente la quasi-totalité des exportations de la Libye.
Avec la chute des cours, les exportations sont tombées de 21,9 milliards de dollars en 1980 à7,3 milliards en 1994.
Les importations, en 1994, étaient de 6,9 milliards de dollars et consistaient essentiellement en produits manufacturés et alimentaires.
Les principauxpartenaires économiques de la Libye sont l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Japon et la Grande-Bretagne.
La Libye est dotée d’un réseau autoroutier sur la côte.
Des routes relient Tripoli à Tunis, en passant par Benghazi et Tobrouk, à Alexandrie.
Une route partant de Sebha,dans l’intérieur du pays, assure la jonction du Sud avec l’autoroute côtière.
La compagnie aérienne nationale, Libyan Arab Airlines, est pratiquement paralysée en raison del’embargo aérien.
Pour compléter les installations portuaires de Tripoli, Benghazi et Tobrouk, un nouveau port a été créé à Misurata en 1978.
Malgré la faiblesse quantitative et qualitative des médias libyens, le pays est relativement bien doté en postes de radio et de télévision (environ 1,4 million de radios et770 000 téléviseurs en 2000).
Le quotidien libyen Al-Fajr al-Jadid, publié à Tripoli, était diffusé à 40 000 exemplaires au début des années 1990.
5 HISTOIRE
5.1 L’Antiquité
La Libye doit probablement son nom aux Libou de Cyrénaïque, qui, avec les Mahouach, attaquèrent l’Égypte pharaonique à partir du XIIe siècle avant notre ère.
Certains de ces Libyens sont demeurés en Égypte, mercenaires à la solde de la XXI e dynastie.
Les deux dynasties suivantes, à partir de 945 av.
J.-C., furent libyennes.
Hérodote et, après lui, les géographes grecs désignent par le terme de Libye, tout le nord du continent africain, à l’exclusion de l’Égypte.
La côte libyenne, dans cetteacception large, a, dans l’Antiquité, une grande importance commerciale.
L’or du Soudan y parvient après avoir traversé le Sahara.
Dès le VIIIe siècle avant notre ère, les Phéniciens fondent des comptoirs commerciaux sur la côte de Tripolitaine, parmi lesquels Leptis Magna, Oea (Tripoli) et Sabrata, qui sont ensuite conquises par Carthage au VIe siècle av.
J.-C.
La Cyrénaïque, à l’ouest, est, quant à elle, colonisée par les Grecs au VIIe siècle av.
J.-C.
Hérodote décrit au Ve siècle av.
J.-C.
les Garamantes, peuple du Fezzan, agriculteurs sédentaires qui utilisent, dans les combats, des chars tirés par des chevaux.
Durant le Ier siècle avant notre ère, les trois régions qui forment l’actuelle Libye — Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan — passent sous domination romaine.
La Libye, alors riche et fertile, devient l’undes greniers de l’Empire romain.
Le pays entame son déclin après l’envahissement des régions côtières par les Vandales en 455 apr.
J.-C.
Elles sont reconquises par les Byzantins à partir de 533.
5.2 La conquête arabe
En 641, les Arabes, conduits par Amr Ibn al-As, conquièrent la Cyrénaïque puis la Tripolitaine, progressivement islamisées.
Les conquérants musulmans ne parviennentjusqu’au Fezzan qu’en 666.
Cette région connaît jusqu’au XIXe siècle une histoire différente.
À partir du XIIIe siècle, elle passe sous suzeraineté de l’empire tchadien de Kanem-Bornou.
Au XVIe siècle, une dynastie chérifienne y est fondée par des Marocains.
En Cyrénaïque et en Tripolitaine, comme en Algérie, les Berbères s’opposent aux Arabes et rallient massivement le kharijisme, mouvement rigoriste dissident de l’islam.Gouvernées successivement par les Omeyyades, les Aghlabides et les Fatimides, ces régions sont en partie conquises en 1146 par les Normands, qui les abandonnentbientôt aux Almohades.
5.3 La puissance des senoussis
En 1551, après plus d’un siècle durant lequel se sont multipliées les dynasties locales, la Cyrénaïque et la Tripolitaine passent sous suzeraineté ottomane.
Tripoli et les portscôtiers deviennent des bases pour les corsaires turcs qui écument la Méditerranée.
Les puissances européennes interviennent à plusieurs reprises contre les pachas deTripoli.
De 1711 à 1835, les Qaramanlis gouvernent la région, indépendante de fait.
L’Empire ottoman réagit en annexant la Cyrénaïque et la Tripolitaine, qui deviennentdes wilayet en 1835.
Dès le milieu du siècle cependant, la confrérie des senoussis, dont le fondateur al-Sanusi, originaire de l'oasis de Koufra, a fondé la première zaouïa en Cyrénaïque en 1843, est à la tête d’un véritable État indépendant dans le désert Libyque.
Violemment nationalistes, les senoussis dirigent la résistance contre les Italiens, qui entreprennent de conquérir la Libye en 1911.
L’Empire ottoman renonce à ses droits surla Libye en 1912, mais la conquête italienne, qui concerne également le Fezzan, n’est achevée qu’en 1932.
Deux ans plus tard, les colonisateurs fusionnent les trois régionshistoriques au sein d’une même colonie libyenne, laquelle devient province italienne en 1939..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Nous avons tous vécu le printemps arabe, ces débuts de révolution dans les pays d’Afrique du Nord tels que la Tunisie, la Libye ou encore l’Egypte.
- Nefousa (djebel), l'un des rares massifs montagneux de la Libye (968 m) avec le djebel Al-Akhdar.
- Libye.
- Idr?ss I er ( Muhammad as-Sanoussi ), 1890-1983, né à Djaraboub (Cyrénaïque), roi de Libye.
- Afrikakorps, troupes allemandes qui combattirent contre les Britanniques, sous le commandement de Rommel, en Libye, en Égypte et en Tunisie de 1941 à 1943.