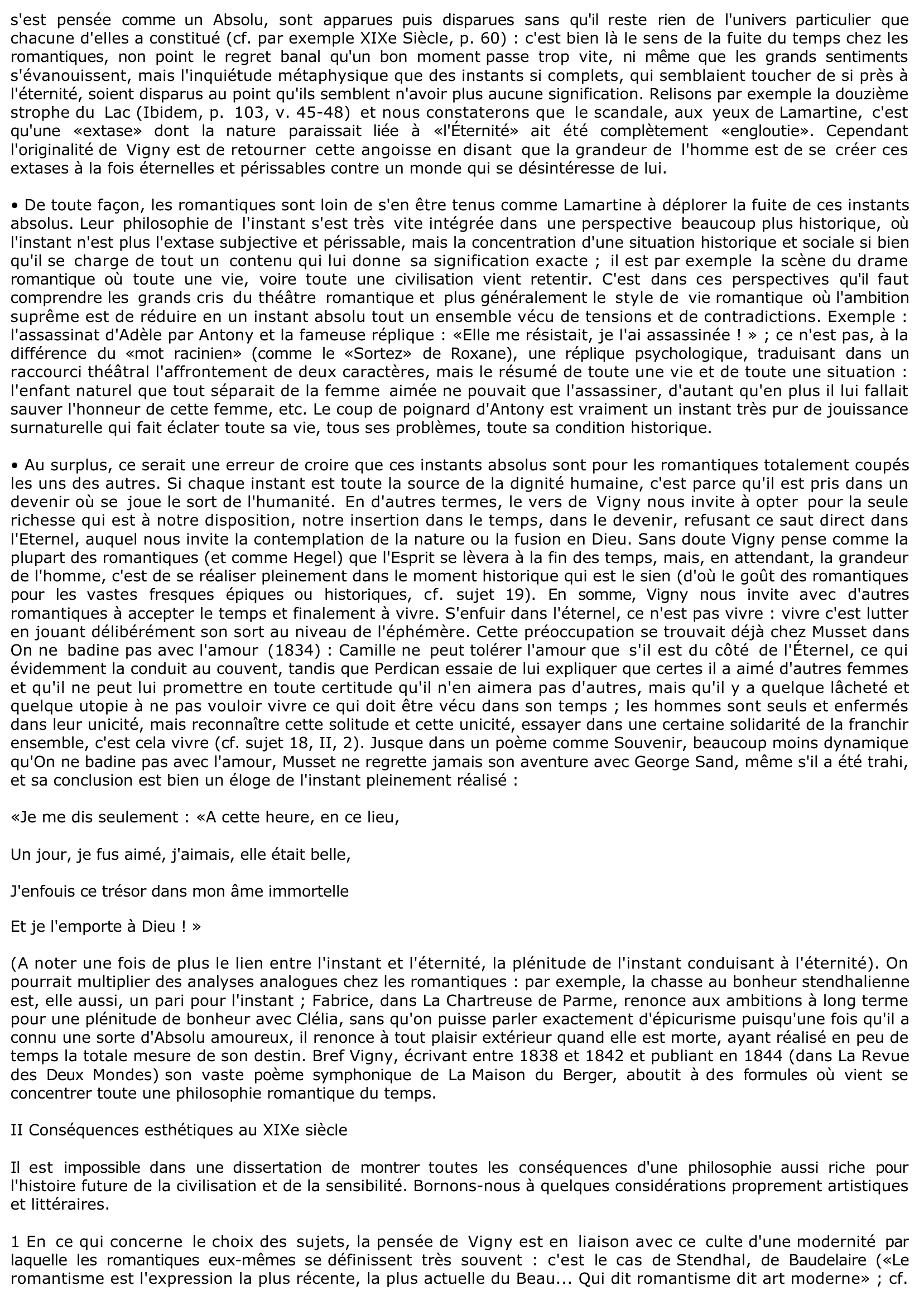«Aimez ce que jamais on ne verra deux fois», tel est le conseil que donne Vigny au vers 308 de La Maison du Berger. En face de la morale et de l'art classiques qui privilégient l'éternel par rapport à l'éphémère, l'universel par rapport au singulier, ne vous semble-t-il pas que Vigny définit ainsi une attitude - éthique et esthétique - nouvelle qui, annoncée par Montaigne et la littérature baroque, s'est surtout développée dans la littérature moderne, à partir du romantisme ? Pour répo
Publié le 08/02/2011

Extrait du document
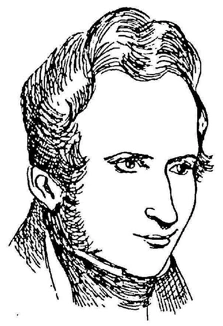
s'est pensée comme un Absolu, sont apparues puis disparues sans qu'il reste rien de l'univers particulier que chacune d'elles a constitué (cf. par exemple XIXe Siècle, p. 60) : c'est bien là le sens de la fuite du temps chez les romantiques, non point le regret banal qu'un bon moment passe trop vite, ni même que les grands sentiments s'évanouissent, mais l'inquiétude métaphysique que des instants si complets, qui semblaient toucher de si près à l'éternité, soient disparus au point qu'ils semblent n'avoir plus aucune signification. Relisons par exemple la douzième strophe du Lac (Ibidem, p. 103, v. 45-48) et nous constaterons que le scandale, aux yeux de Lamartine, c'est qu'une «extase» dont la nature paraissait liée à «l'Éternité» ait été complètement «engloutie». Cependant l'originalité de Vigny est de retourner cette angoisse en disant que la grandeur de l'homme est de se créer ces extases à la fois éternelles et périssables contre un monde qui se désintéresse de lui.
...
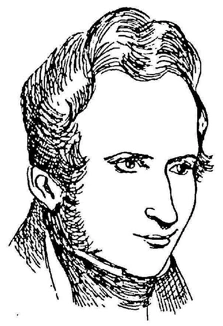
«
s'est pensée comme un Absolu, sont apparues puis disparues sans qu'il reste rien de l'univers particulier quechacune d'elles a constitué (cf.
par exemple XIXe Siècle, p.
60) : c'est bien là le sens de la fuite du temps chez lesromantiques, non point le regret banal qu'un bon moment passe trop vite, ni même que les grands sentimentss'évanouissent, mais l'inquiétude métaphysique que des instants si complets, qui semblaient toucher de si près àl'éternité, soient disparus au point qu'ils semblent n'avoir plus aucune signification.
Relisons par exemple la douzièmestrophe du Lac (Ibidem, p.
103, v.
45-48) et nous constaterons que le scandale, aux yeux de Lamartine, c'estqu'une «extase» dont la nature paraissait liée à «l'Éternité» ait été complètement «engloutie».
Cependantl'originalité de Vigny est de retourner cette angoisse en disant que la grandeur de l'homme est de se créer cesextases à la fois éternelles et périssables contre un monde qui se désintéresse de lui.
• De toute façon, les romantiques sont loin de s'en être tenus comme Lamartine à déplorer la fuite de ces instantsabsolus.
Leur philosophie de l'instant s'est très vite intégrée dans une perspective beaucoup plus historique, oùl'instant n'est plus l'extase subjective et périssable, mais la concentration d'une situation historique et sociale si bienqu'il se charge de tout un contenu qui lui donne sa signification exacte ; il est par exemple la scène du drameromantique où toute une vie, voire toute une civilisation vient retentir.
C'est dans ces perspectives qu'il fautcomprendre les grands cris du théâtre romantique et plus généralement le style de vie romantique où l'ambitionsuprême est de réduire en un instant absolu tout un ensemble vécu de tensions et de contradictions.
Exemple :l'assassinat d'Adèle par Antony et la fameuse réplique : «Elle me résistait, je l'ai assassinée ! » ; ce n'est pas, à ladifférence du «mot racinien» (comme le «Sortez» de Roxane), une réplique psychologique, traduisant dans unraccourci théâtral l'affrontement de deux caractères, mais le résumé de toute une vie et de toute une situation :l'enfant naturel que tout séparait de la femme aimée ne pouvait que l'assassiner, d'autant qu'en plus il lui fallaitsauver l'honneur de cette femme, etc.
Le coup de poignard d'Antony est vraiment un instant très pur de jouissancesurnaturelle qui fait éclater toute sa vie, tous ses problèmes, toute sa condition historique.
• Au surplus, ce serait une erreur de croire que ces instants absolus sont pour les romantiques totalement coupésles uns des autres.
Si chaque instant est toute la source de la dignité humaine, c'est parce qu'il est pris dans undevenir où se joue le sort de l'humanité.
En d'autres termes, le vers de Vigny nous invite à opter pour la seulerichesse qui est à notre disposition, notre insertion dans le temps, dans le devenir, refusant ce saut direct dansl'Eternel, auquel nous invite la contemplation de la nature ou la fusion en Dieu.
Sans doute Vigny pense comme laplupart des romantiques (et comme Hegel) que l'Esprit se lèvera à la fin des temps, mais, en attendant, la grandeurde l'homme, c'est de se réaliser pleinement dans le moment historique qui est le sien (d'où le goût des romantiquespour les vastes fresques épiques ou historiques, cf.
sujet 19).
En somme, Vigny nous invite avec d'autresromantiques à accepter le temps et finalement à vivre.
S'enfuir dans l'éternel, ce n'est pas vivre : vivre c'est lutteren jouant délibérément son sort au niveau de l'éphémère.
Cette préoccupation se trouvait déjà chez Musset dansOn ne badine pas avec l'amour (1834) : Camille ne peut tolérer l'amour que s'il est du côté de l'Éternel, ce quiévidemment la conduit au couvent, tandis que Perdican essaie de lui expliquer que certes il a aimé d'autres femmeset qu'il ne peut lui promettre en toute certitude qu'il n'en aimera pas d'autres, mais qu'il y a quelque lâcheté etquelque utopie à ne pas vouloir vivre ce qui doit être vécu dans son temps ; les hommes sont seuls et enfermésdans leur unicité, mais reconnaître cette solitude et cette unicité, essayer dans une certaine solidarité de la franchirensemble, c'est cela vivre (cf.
sujet 18, II, 2).
Jusque dans un poème comme Souvenir, beaucoup moins dynamiquequ'On ne badine pas avec l'amour, Musset ne regrette jamais son aventure avec George Sand, même s'il a été trahi,et sa conclusion est bien un éloge de l'instant pleinement réalisé :
«Je me dis seulement : «A cette heure, en ce lieu,
Un jour, je fus aimé, j'aimais, elle était belle,
J'enfouis ce trésor dans mon âme immortelle
Et je l'emporte à Dieu ! »
(A noter une fois de plus le lien entre l'instant et l'éternité, la plénitude de l'instant conduisant à l'éternité).
Onpourrait multiplier des analyses analogues chez les romantiques : par exemple, la chasse au bonheur stendhalienneest, elle aussi, un pari pour l'instant ; Fabrice, dans La Chartreuse de Parme, renonce aux ambitions à long termepour une plénitude de bonheur avec Clélia, sans qu'on puisse parler exactement d'épicurisme puisqu'une fois qu'il aconnu une sorte d'Absolu amoureux, il renonce à tout plaisir extérieur quand elle est morte, ayant réalisé en peu detemps la totale mesure de son destin.
Bref Vigny, écrivant entre 1838 et 1842 et publiant en 1844 (dans La Revuedes Deux Mondes) son vaste poème symphonique de La Maison du Berger, aboutit à des formules où vient seconcentrer toute une philosophie romantique du temps.
II Conséquences esthétiques au XIXe siècle
Il est impossible dans une dissertation de montrer toutes les conséquences d'une philosophie aussi riche pourl'histoire future de la civilisation et de la sensibilité.
Bornons-nous à quelques considérations proprement artistiqueset littéraires.
1 En ce qui concerne le choix des sujets, la pensée de Vigny est en liaison avec ce culte d'une modernité parlaquelle les romantiques eux-mêmes se définissent très souvent : c'est le cas de Stendhal, de Baudelaire («Leromantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du Beau...
Qui dit romantisme dit art moderne» ; cf..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Expliquez et, s'il y a lieu, discutez cette analyse de la création littéraire au XVIIe siècle : «Si l'homme du XVIIe siècle sent avec une intensité exceptionnelle son indigence et sa dépendance vis-à-vis de l'acte créateur, c'est qu'en percevant cet acte il ne peut percevoir rien d'autre. Toute sa vie" passée, tout son destin futur se trouvent effacés ou suspendus. Rien ne demeure, sinon le don de l'existence actuelle ; puis, dans un nouvel instant, le même don et la même conscience de
- «Un long avenir se préparait pour (la culture française) du XVIIe (siècle). Même encore au temps du romantisme, les œuvres classiques continuent à bénéficier d'une audience considérable ; l'époque qui les a vu naître bénéficie au premier chef du progrès des études historiques ; l'esprit qui anime ses écrivains, curiosité pour l'homme, goût d'une beauté harmonieuse et rationnelle, continue à inspirer les créatures. Avec cette esthétique une autre ne pourra véritablement entrer en concur
- Paul Valéry, décelant en Baudelaire l'âme d'un classique, écrivait en 1924 (Variété II, Gallimard) : «Classique est l'écrivain qui porte un critique en soi-même et qui l'associe intimement à ses travaux... qu'était-ce après tout que de choisir dans le romantisme et que de discerner en lui un bien et un mal, un faux et un vrai, des faiblesses et des vertus, sinon faire à l'égard des auteurs de la première moitié du XIXe siècle ce que les hommes du temps de Louis XIV ont fait à l'égard d
- Étudiez ce bilan du surréalisme proposé par Gaétan Picon (Panorama de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1960) : «Qu'avons-nous conservé, qu'avons-nous rejeté du Surréalisme ? Dans une large mesure, il est encore et toujours notre poésie : la poésie moderne tout entière prenant conscience d'elle-même, et allant jusqu'au bout. Toute poésie, à l'heure actuelle, veut être autre chose que poème, fabrication rythmique, jeu inoffensif d'images et de mots : confusion ardente avec l
- Diderot reprochait aux moralistes du XVIIe siècle d'être tous «pénétrés du plus profond mépris pour l'espèce humaine». Un critique contemporain précise et nuance cette accusation : «Dans cette peinture de l'homme, peut-être nos écrivains (classiques) ne manifestent-ils pas le même équilibre qu'ailleurs. Entre l'optimisme et le pessimisme, ils penchent fortement du second côté. L'augusti-nisme qui imprègne la culture du temps les a fortement marqués. La dénonciation de l'amour-propre, p