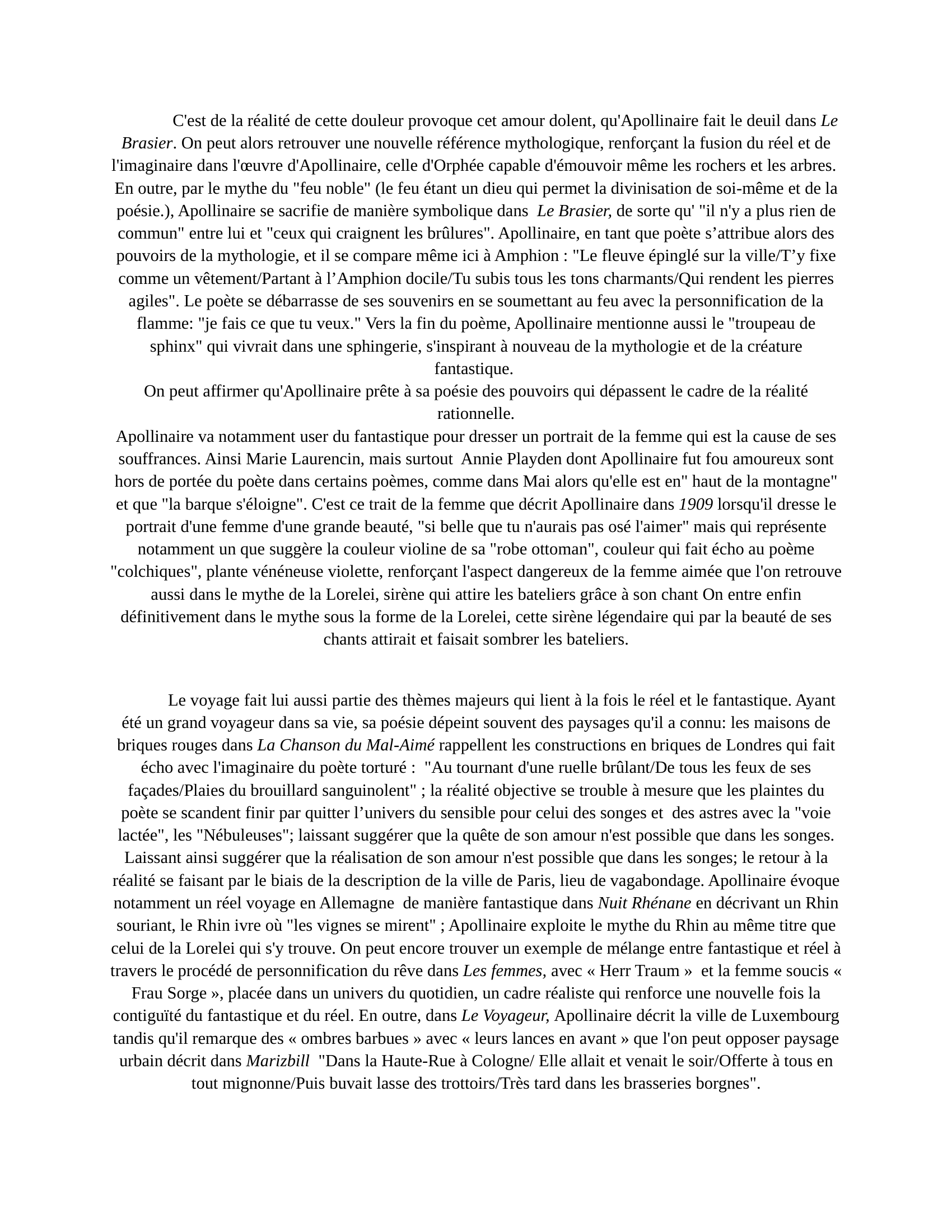Alcools
Publié le 12/02/2013

Extrait du document
«
C'est de la réalité de cette douleur provoque cet amour dolent, qu'Apollinaire fait le deuil dans Le
Brasier .
On peut alors retrouver une nouvelle référence mythologique, renforçant la fusion du réel et de
l'imaginaire dans l'œuvre d'Apollinaire, celle d'Orphée capable d'émouvoir même les rochers et les arbres.
En outre, par le mythe du "feu noble" (le feu étant un dieu qui permet la divinisation de soi-même et de la
poésie.), Apollinaire se sacrifie de manière symbolique dans Le Brasier, de sorte qu' "il n'y a plus rien de
commun" entre lui et "ceux qui craignent les brûlures".
Apollinaire, en tant que poète s’attribue alors des
pouvoirs de la mythologie, et il se compare même ici à Amphion : "Le fleuve épinglé sur la ville/T’y fixe
comme un vêtement/Partant à l’Amphion docile/Tu subis tous les tons charmants/Qui rendent les pierres
agiles".
Le poète se débarrasse de ses souvenirs en se soumettant au feu avec la personnification de la
flamme: "je fais ce que tu veux." Vers la fin du poème, Apollinaire mentionne aussi le "troupeau de
sphinx" qui vivrait dans une sphingerie, s'inspirant à nouveau de la mythologie et de la créature
fantastique.
On peut affirmer qu'Apollinaire prête à sa poésie des pouvoirs qui dépassent le cadre de la réalité
rationnelle.
Apollinaire va notamment user du fantastique pour dresser un portrait de la femme qui est la cause de ses
souffrances.
Ainsi Marie Laurencin, mais surtout Annie Playden dont Apollinaire fut fou amoureux sont
hors de portée du poète dans certains poèmes, comme dans Mai alors qu'elle est en" haut de la montagne"
et que "la barque s'éloigne".
C'est ce trait de la femme que décrit Apollinaire dans 1909 lorsqu'il dresse le
portrait d'une femme d'une grande beauté, "si belle que tu n'aurais pas osé l'aimer" mais qui représente
notamment un que suggère la couleur violine de sa "robe ottoman", couleur qui fait écho au poème
"colchiques", plante vénéneuse violette, renforçant l'aspect dangereux de la femme aimée que l'on retrouve
aussi dans le mythe de la Lorelei, sirène qui attire les bateliers grâce à son chant On entre enfin
définitivement dans le mythe sous la forme de la Lorelei, cette sirène légendaire qui par la beauté de ses
chants attirait et faisait sombrer les bateliers.
Le voyage fait lui aussi partie des thèmes majeurs qui lient à la fois le réel et le fantastique.
Ayant
été un grand voyageur dans sa vie, sa poésie dépeint souvent des paysages qu'il a connu: les maisons de
briques rouges dans La Chanson du Mal-Aimé rappellent les constructions en briques de Londres qui fait
écho avec l'imaginaire du poète torturé : "Au tournant d'une ruelle brûlant/De tous les feux de ses
façades/Plaies du brouillard sanguinolent" ; la réalité objective se trouble à mesure que les plaintes du
poète se scandent finir par quitter l’univers du sensible pour celui des songes et des astres avec la "voie
lactée", les "Nébuleuses"; laissant suggérer que la quête de son amour n'est possible que dans les songes.
Laissant ainsi suggérer que la réalisation de son amour n'est possible que dans les songes; le retour à la
réalité se faisant par le biais de la description de la ville de Paris, lieu de vagabondage.
Apollinaire évoque
notamment un réel voyage en Allemagne de manière fantastique dans Nuit Rhénane en décrivant un Rhin
souriant, le Rhin ivre où "les vignes se mirent" ; Apollinaire exploite le mythe du Rhin au même titre que
celui de la Lorelei qui s'y trouve.
On peut encore trouver un exemple de mélange entre fantastique et réel à
travers le procédé de personnification du rêve dans Les femmes, avec « Herr Traum » et la femme soucis «
Frau Sorge », placée dans un univers du quotidien, un cadre réaliste qui renforce une nouvelle fois la
contiguïté du fantastique et du réel.
En outre, dans Le Voyageur, Apollinaire décrit la ville de Luxembourg
tandis qu'il remarque des « ombres barbues » avec « leurs lances en avant » que l'on peut opposer paysage
urbain décrit dans Marizbill "Dans la Haute-Rue à Cologne/ Elle allait et venait le soir/Offerte à tous en
tout mignonne/Puis buvait lasse des trottoirs/Très tard dans les brasseries borgnes"..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- explication de texte Apollinaire: « Crépuscule », Alcools, APOLLINAIRE
- Comment Apollinaire parvient-il donc à associer tradition et modernité dans Alcools ?
- Zone, poème liminaire du recueil Alcools
- Alcools d'Apollinaire (Article - Fiche de lecture)
- Alcools d'Apollinaire (résumé & analyse)