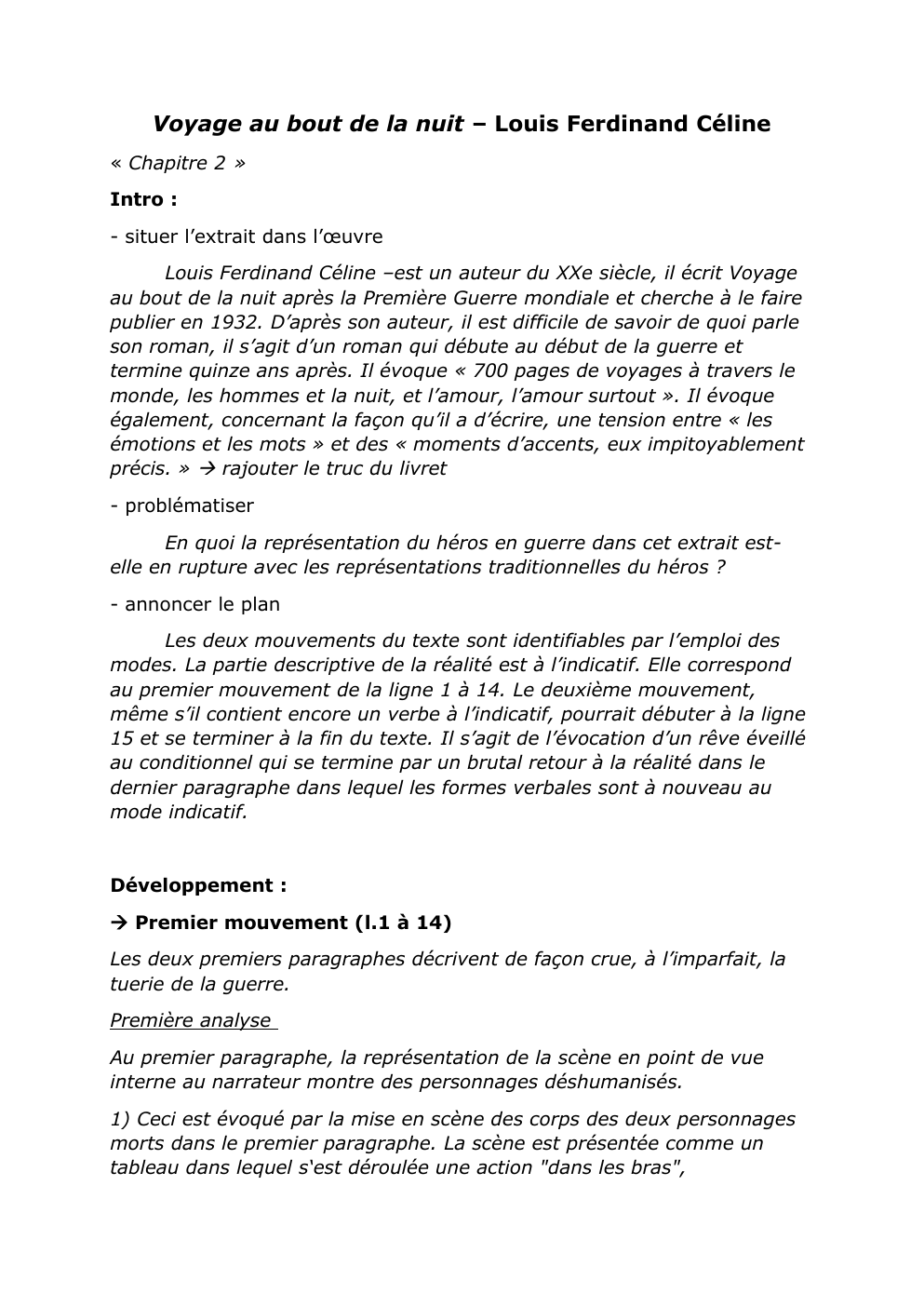Analyse Chapitre 2 Voyage Au Bout de la Nuit Louis-Ferdinand Céline (Français)
Publié le 19/09/2023
Extrait du document
«
Voyage au bout de la nuit – Louis Ferdinand Céline
« Chapitre 2 »
Intro :
- situer l’extrait dans l’œuvre
Louis Ferdinand Céline –est un auteur du XXe siècle, il écrit Voyage
au bout de la nuit après la Première Guerre mondiale et cherche à le faire
publier en 1932.
D’après son auteur, il est difficile de savoir de quoi parle
son roman, il s’agit d’un roman qui débute au début de la guerre et
termine quinze ans après.
Il évoque « 700 pages de voyages à travers le
monde, les hommes et la nuit, et l’amour, l’amour surtout ».
Il évoque
également, concernant la façon qu’il a d’écrire, une tension entre « les
émotions et les mots » et des « moments d’accents, eux impitoyablement
précis.
» rajouter le truc du livret
- problématiser
En quoi la représentation du héros en guerre dans cet extrait estelle en rupture avec les représentations traditionnelles du héros ?
- annoncer le plan
Les deux mouvements du texte sont identifiables par l’emploi des
modes.
La partie descriptive de la réalité est à l’indicatif.
Elle correspond
au premier mouvement de la ligne 1 à 14.
Le deuxième mouvement,
même s’il contient encore un verbe à l’indicatif, pourrait débuter à la ligne
15 et se terminer à la fin du texte.
Il s’agit de l’évocation d’un rêve éveillé
au conditionnel qui se termine par un brutal retour à la réalité dans le
dernier paragraphe dans lequel les formes verbales sont à nouveau au
mode indicatif.
Développement :
Premier mouvement (l.1 à 14)
Les deux premiers paragraphes décrivent de façon crue, à l’imparfait, la
tuerie de la guerre.
Première analyse
Au premier paragraphe, la représentation de la scène en point de vue
interne au narrateur montre des personnages déshumanisés.
1) Ceci est évoqué par la mise en scène des corps des deux personnages
morts dans le premier paragraphe.
La scène est présentée comme un
tableau dans lequel s‘est déroulée une action "dans les bras",
"s'embrassaient", dont les personnages sont réduits à des marionnettes
inanimées comme le soulignent l‘emploi du passif ligne 2 avec "avaient
été déportés" et les participes passés ensuite " allongé“ et "projeté".
2) Par cette description, les soldats sont montrés de façon grotesque* et
obscène, ce qui peut choquer le lecteur.
L'horreur provoquée par la
violence est soulignée par la présence du champ lexical de la guerre,
"explosion", "balles".
Le narrateur fait des remarques inattendues dans
cette situation.
La comparaison prosaïque* " comme de la confiture" de
même que l'observation sarcastique* "il en faisait une sale grimace" sont
en décalage avec la situation de guerre vécue par le narrateur.
3) Le héros observe cyniquement les horreurs en les mettant à distance
par le biais d'images triviales*.
Les descriptions, avec l‘usage constant
d'un niveau de langue orale, créent un effet de réel, comme si les paroles
du personnage étaient entendues directement par le lecteur, sans passer
par l'écrit, on remarque par exemple l'usage du déterminant “son“ dans "il
avait son ventre ouvert" ou encore l‘emploi du pronom “cela“ abrégé
familièrement par “ça“ dans les deux dernières lignes du paragraphe.
La
dernière phrase montre que la solidarité, "tant pis pour lui !", et le
courage qui pourtant sont des valeurs traditionnellement évoquées dans
les combats n'ont pas cours dans l'esprit du narrateur qui encourage la
désertion, "s'il était parti dès les premières balles".
Deuxième analyse
Dans les dernières lignes du premier paragraphe et dans les premières
lignes du second, on peut constater que le personnage de Bardamu, qui
s‘exprime à la première personne, "je", ne respecte pas l'autorité en cours
dans l'armée
1) Il manque de respect à ses deux supérieurs, le "colonel" et "maréchal
des logis", car il se réjouit de leur mort comme en témoigne les
expressions "bonne nouvelle" et 'tant mieux" ainsi que les phrases
exclamatives présentes dans ce paragraphe « C’est une bien grande
charogne en moins dans le régiment ! ».
2) Dans le paragraphe précédent, on avait pu remarquer l'absence de
solidarité et de courage, ici, on peut observer que l'autorité n'est plus
respectée, le maréchal est qualifié de "charogne", de la viande en
décomposition, sa mort est bienvenue car elle permet d‘apaiser le
sentiment de vengeance du narrateur, comme le montre la phrase
explicative au plus que parfait “Il avait voulu me faire passer au Conseil
pour une boîte de conserves.
“
3) Le narrateur va plus loin dans la phrase suivante puisqu’il en vient à
souhaiter la mort de ses compatriotes "j’aurais aidé bien volontiers à
trouver un obus".
L’absence de complément d’objet au verbe « aider »
révèle que sa volonté d’aider l’ennemi dans cette démarche est
accompagnée de scrupules.
C’est pourquoi il ne le désigne pas
explicitement.
4) La dernière phrase fait écho aux expressions présentes dans le premier
paragraphe.
Les êtres humains sont de la "viande" comme précédemment
"charogne".
Le narrateur pose un regard cynique et distancé sur ce qui
l'entoure auquel le lecteur a accès grâce à l'emploi de paroles ou de
pensées rapportées directement, comme le montre l'expression entre
guillemets dans le texte " « Chacun sa guerre » que je me dis.".....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Voyage au bout de la nuit Louis-Ferdinand Céline (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline (résumé et analyse de l'oeuvre)
- Louis ferdinand céline Voyage au bout de la nuit analyse du débarquement au Congo-Bragamante
- COMMENTAIRE DE TEXTE, Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, chapitre 26
- Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline (Analyse)