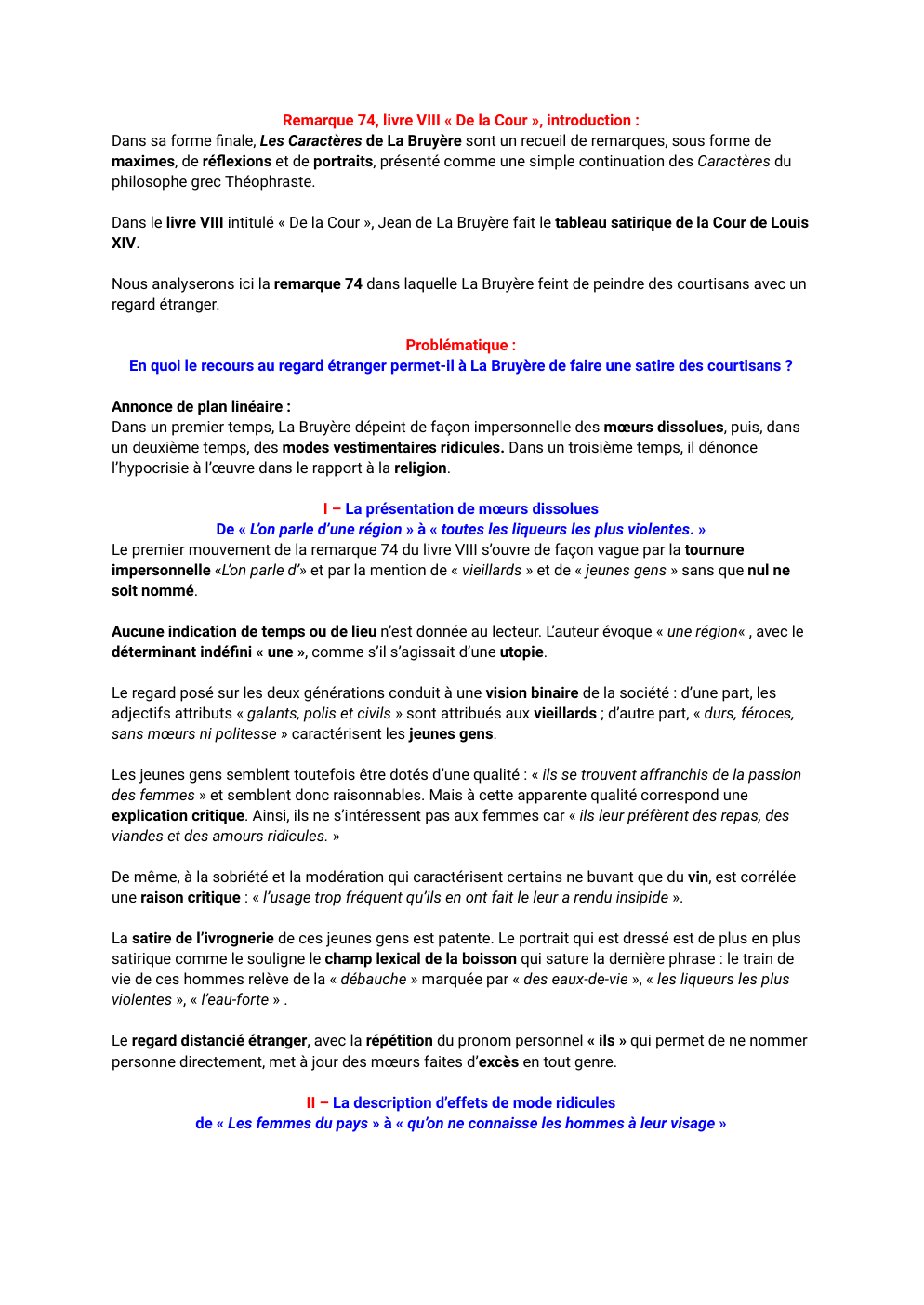Analyse de texte pour le bac de français - Remarque 74, livre VIII « De la Cour »
Publié le 22/05/2023
Extrait du document
«
Remarque 74, livre VIII « De la Cour », introduction :
Dans sa forme finale, Les Caractères de La Bruyère sont un recueil de remarques, sous forme de
maximes, de réflexions et de portraits, présenté comme une simple continuation des Caractères du
philosophe grec Théophraste.
Dans le livre VIII intitulé « De la Cour », Jean de La Bruyère fait le tableau satirique de la Cour de Louis
XIV.
Nous analyserons ici la remarque 74 dans laquelle La Bruyère feint de peindre des courtisans avec un
regard étranger.
Problématique :
En quoi le recours au regard étranger permet-il à La Bruyère de faire une satire des courtisans ?
Annonce de plan linéaire :
Dans un premier temps, La Bruyère dépeint de façon impersonnelle des mœurs dissolues, puis, dans
un deuxième temps, des modes vestimentaires ridicules.
Dans un troisième temps, il dénonce
l’hypocrisie à l’œuvre dans le rapport à la religion.
I – La présentation de mœurs dissolues
De « L’on parle d’une région » à « toutes les liqueurs les plus violentes.
»
Le premier mouvement de la remarque 74 du livre VIII s’ouvre de façon vague par la tournure
impersonnelle «L’on parle d’» et par la mention de « vieillards » et de « jeunes gens » sans que nul ne
soit nommé.
Aucune indication de temps ou de lieu n’est donnée au lecteur.
L’auteur évoque « une région« , avec le
déterminant indéfini « une », comme s’il s’agissait d’une utopie.
Le regard posé sur les deux générations conduit à une vision binaire de la société : d’une part, les
adjectifs attributs « galants, polis et civils » sont attribués aux vieillards ; d’autre part, « durs, féroces,
sans mœurs ni politesse » caractérisent les jeunes gens.
Les jeunes gens semblent toutefois être dotés d’une qualité : « ils se trouvent affranchis de la passion
des femmes » et semblent donc raisonnables.
Mais à cette apparente qualité correspond une
explication critique.
Ainsi, ils ne s’intéressent pas aux femmes car « ils leur préfèrent des repas, des
viandes et des amours ridicules.
»
De même, à la sobriété et la modération qui caractérisent certains ne buvant que du vin, est corrélée
une raison critique : « l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide ».
La satire de l’ivrognerie de ces jeunes gens est patente.
Le portrait qui est dressé est de plus en plus
satirique comme le souligne le champ lexical de la boisson qui sature la dernière phrase : le train de
vie de ces hommes relève de la « débauche » marquée par « des eaux-de-vie », « les liqueurs les plus
violentes », « l’eau-forte » .
Le regard distancié étranger, avec la répétition du pronom personnel « ils » qui permet de ne nommer
personne directement, met à jour des mœurs faites d’excès en tout genre.
II – La description d’effets de mode ridicules
de « Les femmes du pays » à « qu’on ne connaisse les hommes à leur visage »
Le regard de l’auteur se présente bien comme étranger dans la mesure où il s’intéresse aux « femmes
du pays », à « leur coutume », ainsi qu’à « ceux qui habitent cette contrée » ayant des « cheveux
étrangers », comme le ferait un ethnologue étudiant une culture étrangère.
Là encore, le regard distancié et naïf permet de dénoncer le ridicule des faux-semblants et de
l’hypocrisie de la Cour.
Les femmes sont d’abord ciblées : leur âge et leur beauté vont déclinant.
Elles usent alors d’artifices
qu’elles croient servir à les rendre belles».
Le verbe « croire » est chargé d’ironie puisqu’il sous-entend
que la beauté fait défaut à ces femmes, en dépit de ce qu’elles imaginent.
La description physique s’attache aux parties du corps maquillées.
Les énumérations « leurs lèvres,
leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules » et « leur gorge, leurs bras et leurs oreilles » ont un effet
comique et confirment le mauvais goût des femmes qui ne laissent aucune place au naturel.
Ces dernières se déguisent plus qu’elles ne se maquillent et se comportent par minauderies, par
crainte « de cacher » ou «de ne pas se montrer assez».
La naïveté du regard étranger transparaît dans l’emploi des verbes.
Ainsi, le verbe « peindre » est
utilisé au lieu du verbe maquiller : « peindre leurs lèvres » , ce qui fait sourire et permet de dénoncer la
grossièreté de ces femmes.
De plus, le regard étranger observe avec une distance moqueuse la physionomie des habitants.
Il use
de multiples périphrases....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire ou analyse analytique ou préparation du bac oral de français pour le texte Candide chap 3
- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire
- Analyse linéaire "le soleil" de Baudelaire (façon texte du bac)
- ROJET DU LIVRE DE LA PRÉCELLENCE DU LANGAGE FRANÇAIS. (résumé et analyse de l’oeuvre)
- BAC français: Commentaire de texte