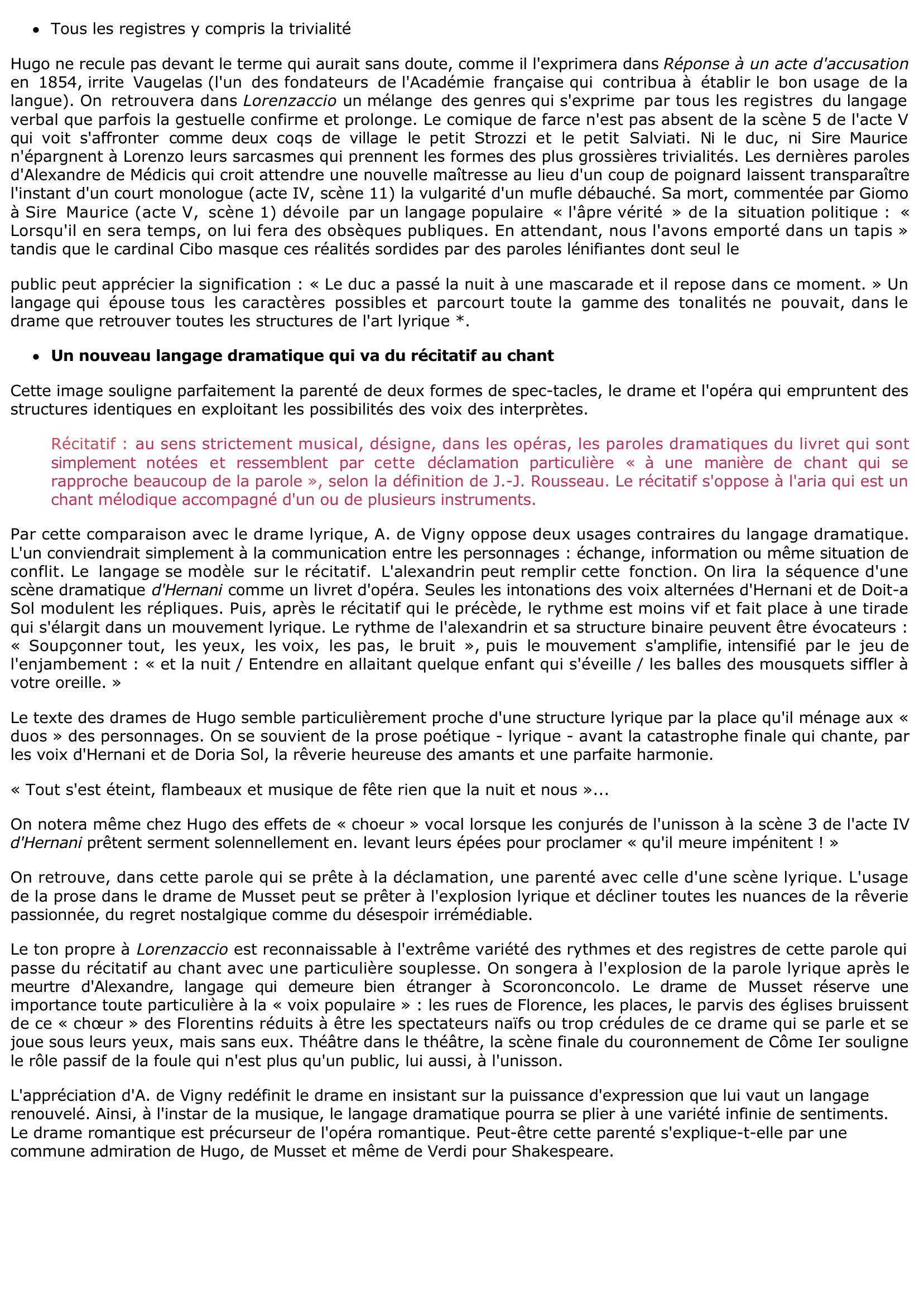Appliquez au drame romantique que vous avez étudié cette appréciation d'A. de Vigny (extrait de la Lettre à Lord***) : « Écoutez ce soir le langage que je pense être celui de la tragédie moderne : dans lequel chaque personnage parlera selon son caractère et, dans l'art comme dans la vie, passera de la simplicité habituelle à l'exaltation passionnée, du récitatif au chant. »
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
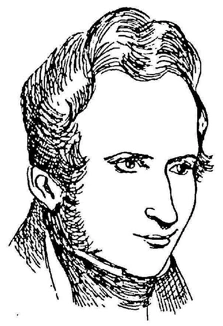
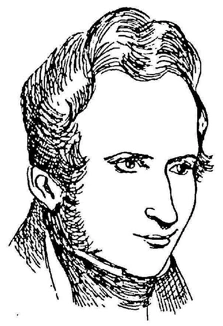
«
Tous les registres y compris la trivialité
Hugo ne recule pas devant le terme qui aurait sans doute, comme il l'exprimera dans Réponse à un acte d'accusation en 1854, irrite Vaugelas (l'un des fondateurs de l'Académie française qui contribua à établir le bon usage de lalangue).
On retrouvera dans Lorenzaccio un mélange des genres qui s'exprime par tous les registres du langage verbal que parfois la gestuelle confirme et prolonge.
Le comique de farce n'est pas absent de la scène 5 de l'acte Vqui voit s'affronter comme deux coqs de village le petit Strozzi et le petit Salviati.
Ni le duc, ni Sire Mauricen'épargnent à Lorenzo leurs sarcasmes qui prennent les formes des plus grossières trivialités.
Les dernières parolesd'Alexandre de Médicis qui croit attendre une nouvelle maîtresse au lieu d'un coup de poignard laissent transparaîtrel'instant d'un court monologue (acte IV, scène 11) la vulgarité d'un mufle débauché.
Sa mort, commentée par Giomoà Sire Maurice (acte V, scène 1) dévoile par un langage populaire « l'âpre vérité » de la situation politique : «Lorsqu'il en sera temps, on lui fera des obsèques publiques.
En attendant, nous l'avons emporté dans un tapis »tandis que le cardinal Cibo masque ces réalités sordides par des paroles lénifiantes dont seul le
public peut apprécier la signification : « Le duc a passé la nuit à une mascarade et il repose dans ce moment.
» Unlangage qui épouse tous les caractères possibles et parcourt toute la gamme des tonalités ne pouvait, dans ledrame que retrouver toutes les structures de l'art lyrique *.
Un nouveau langage dramatique qui va du récitatif au chant
Cette image souligne parfaitement la parenté de deux formes de spec-tacles, le drame et l'opéra qui empruntent desstructures identiques en exploitant les possibilités des voix des interprètes.
Récitatif : au sens strictement musical, désigne, dans les opéras, les paroles dramatiques du livret qui sont simplement notées et ressemblent par cette déclamation particulière « à une manière de chant qui serapproche beaucoup de la parole », selon la définition de J.-J.
Rousseau.
Le récitatif s'oppose à l'aria qui est un chant mélodique accompagné d'un ou de plusieurs instruments.
Par cette comparaison avec le drame lyrique, A.
de Vigny oppose deux usages contraires du langage dramatique.L'un conviendrait simplement à la communication entre les personnages : échange, information ou même situation deconflit.
Le langage se modèle sur le récitatif.
L'alexandrin peut remplir cette fonction.
On lira la séquence d'unescène dramatique d'Hernani comme un livret d'opéra.
Seules les intonations des voix alternées d'Hernani et de Doit-a Sol modulent les répliques.
Puis, après le récitatif qui le précède, le rythme est moins vif et fait place à une tiradequi s'élargit dans un mouvement lyrique.
Le rythme de l'alexandrin et sa structure binaire peuvent être évocateurs :« Soupçonner tout, les yeux, les voix, les pas, le bruit », puis le mouvement s'amplifie, intensifié par le jeu del'enjambement : « et la nuit / Entendre en allaitant quelque enfant qui s'éveille / les balles des mousquets siffler àvotre oreille.
»
Le texte des drames de Hugo semble particulièrement proche d'une structure lyrique par la place qu'il ménage aux «duos » des personnages.
On se souvient de la prose poétique - lyrique - avant la catastrophe finale qui chante, parles voix d'Hernani et de Doria Sol, la rêverie heureuse des amants et une parfaite harmonie.
« Tout s'est éteint, flambeaux et musique de fête rien que la nuit et nous »...
On notera même chez Hugo des effets de « choeur » vocal lorsque les conjurés de l'unisson à la scène 3 de l'acte IVd'Hernani prêtent serment solennellement en.
levant leurs épées pour proclamer « qu'il meure impénitent ! »
On retrouve, dans cette parole qui se prête à la déclamation, une parenté avec celle d'une scène lyrique.
L'usagede la prose dans le drame de Musset peut se prêter à l'explosion lyrique et décliner toutes les nuances de la rêveriepassionnée, du regret nostalgique comme du désespoir irrémédiable.
Le ton propre à Lorenzaccio est reconnaissable à l'extrême variété des rythmes et des registres de cette parole qui passe du récitatif au chant avec une particulière souplesse.
On songera à l'explosion de la parole lyrique après lemeurtre d'Alexandre, langage qui demeure bien étranger à Scoronconcolo.
Le drame de Musset réserve uneimportance toute particulière à la « voix populaire » : les rues de Florence, les places, le parvis des églises bruissentde ce « chœur » des Florentins réduits à être les spectateurs naïfs ou trop crédules de ce drame qui se parle et sejoue sous leurs yeux, mais sans eux.
Théâtre dans le théâtre, la scène finale du couronnement de Côme Ier soulignele rôle passif de la foule qui n'est plus qu'un public, lui aussi, à l'unisson.
L'appréciation d'A.
de Vigny redéfinit le drame en insistant sur la puissance d'expression que lui vaut un langagerenouvelé.
Ainsi, à l'instar de la musique, le langage dramatique pourra se plier à une variété infinie de sentiments.Le drame romantique est précurseur de l'opéra romantique.
Peut-être cette parenté s'explique-t-elle par unecommune admiration de Hugo, de Musset et même de Verdi pour Shakespeare..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- «Aimez ce que jamais on ne verra deux fois», tel est le conseil que donne Vigny au vers 308 de La Maison du Berger. En face de la morale et de l'art classiques qui privilégient l'éternel par rapport à l'éphémère, l'universel par rapport au singulier, ne vous semble-t-il pas que Vigny définit ainsi une attitude - éthique et esthétique - nouvelle qui, annoncée par Montaigne et la littérature baroque, s'est surtout développée dans la littérature moderne, à partir du romantisme ? Pour répo
- Les Goncourt ont écrit dans leur journal : Voltaire est immortel et Diderot n'est que célèbre. Pourquoi ? Voltaire a enterré le poème épique, le conte, le petit vers, la tragédie. Diderot a inauguré le roman moderne, le drame et la critique d'art. L'un est le dernier esprit de l'ancienne France, l'autre est le premier génie de la France nouvelle. Expliquez, discutez, commentez ce jugement. ?
- Étudiez ce bilan du surréalisme proposé par Gaétan Picon (Panorama de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1960) : «Qu'avons-nous conservé, qu'avons-nous rejeté du Surréalisme ? Dans une large mesure, il est encore et toujours notre poésie : la poésie moderne tout entière prenant conscience d'elle-même, et allant jusqu'au bout. Toute poésie, à l'heure actuelle, veut être autre chose que poème, fabrication rythmique, jeu inoffensif d'images et de mots : confusion ardente avec l
- Lorenzaccio, le héros du drame de Musset, déclare à Philippe Strozzi qu'il a vécu, avant même de s'être fait, en apparence, la créature du tyran Alexandre de Médicis, dans une « exaltation fiévreuse ». Ne vous semble-t-il pas qu'il définissait ainsi le caractère essentiel de la plupart des héros du théâtre romantique ?
- Les Concourt ont écrit dans leur Journal (tome I, page 234) : « Voltaire est immortel et Diderot n'est que célèbre. Pourquoi? Voltaire a enterré le poème épique, le conte, le petit vers, la tragédie. Diderot a inauguré le roman moderne, le drame et la critique d'art. L'un est le dernier esprit de l'ancienne France, l'autre est le premier génie de la France nouvelle. » Vous expliquerez ce jugement et vous vous demanderez s'il est entièrement exact et s'il n'est pas incomplet.