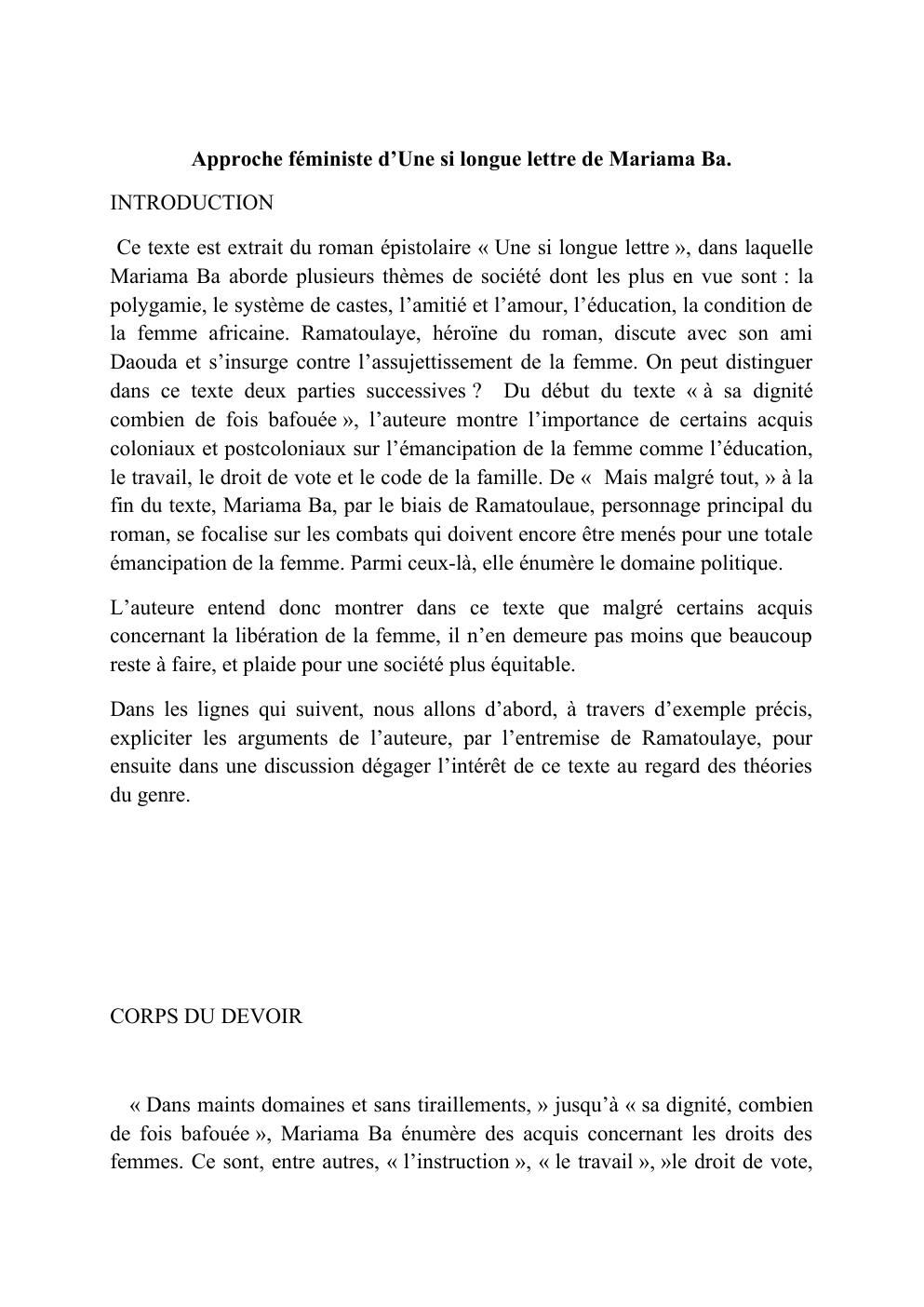Approche féministe d'Une si longue lettre
Publié le 13/11/2023
Extrait du document
«
Approche féministe d’Une si longue lettre de Mariama Ba.
INTRODUCTION
Ce texte est extrait du roman épistolaire « Une si longue lettre », dans laquelle
Mariama Ba aborde plusieurs thèmes de société dont les plus en vue sont : la
polygamie, le système de castes, l’amitié et l’amour, l’éducation, la condition de
la femme africaine.
Ramatoulaye, héroïne du roman, discute avec son ami
Daouda et s’insurge contre l’assujettissement de la femme.
On peut distinguer
dans ce texte deux parties successives ? Du début du texte « à sa dignité
combien de fois bafouée », l’auteure montre l’importance de certains acquis
coloniaux et postcoloniaux sur l’émancipation de la femme comme l’éducation,
le travail, le droit de vote et le code de la famille.
De « Mais malgré tout, » à la
fin du texte, Mariama Ba, par le biais de Ramatoulaue, personnage principal du
roman, se focalise sur les combats qui doivent encore être menés pour une totale
émancipation de la femme.
Parmi ceux-là, elle énumère le domaine politique.
L’auteure entend donc montrer dans ce texte que malgré certains acquis
concernant la libération de la femme, il n’en demeure pas moins que beaucoup
reste à faire, et plaide pour une société plus équitable.
Dans les lignes qui suivent, nous allons d’abord, à travers d’exemple précis,
expliciter les arguments de l’auteure, par l’entremise de Ramatoulaye, pour
ensuite dans une discussion dégager l’intérêt de ce texte au regard des théories
du genre.
CORPS DU DEVOIR
« Dans maints domaines et sans tiraillements, » jusqu’à « sa dignité, combien
de fois bafouée », Mariama Ba énumère des acquis concernant les droits des
femmes.
Ce sont, entre autres, « l’instruction », « le travail », »le droit de vote,
et la promulgation « du code de la famille ».
Mais selon elle, ces acquis ont été
obtenus à la suite d’âpres luttes.
En effet, si nous interrogeons l’histoire, on se
rend compte que la colonisation a voulu transposer un modèle qui consacre
l’exclusion des femmes de l’espace politique avec la loi salique au XIVe siècle,
qui n’avait rien à voir avec les réalités locales.
Mais le substrat culturel qui
demeure en lame de fond dans la société a permis aux Sénégalaises de faire face
à la volonté du pouvoir colonial de les enfermer dans l’espace privé, au même
titre que les Françaises.
Les femmes ont de tout temps été au cœur de la politique dans l’espace social
sénégalais et le fil de la résistance nationale a été tenu d’un bout à l’autre par des
femmes.
La reine du Waalo, Ndaté Yalla Mbodj, a été la première force de
résistance que le colonisateur eut à affronter en 1855.
C’est Aline Sitoë Diatta a
été la dernière résistante nationale déportée en 1943 à Tombouctou, au Mali, par
le pouvoir colonial.
Après avoir conquis le Sénégal, le colonisateur prit un ensemble de mesures
politiques consacrant le recul de la femme.
En stipulant qu’elle devait se
soumettre à l’ordre colonial et à son mari, il lui enlevait tout droit de
représentation mais aussi l’accès à la propriété.
Et s’appuyant sur le code
napoléon , toute propriété fut quasi-automatiquement attribuée au chef de
famille qui est « naturellement » le mari.
La politique coloniale ouvertement
sexiste a limité l’accès des femmes à l’éducation et à la formation.
Si on se
réfère à l’ouvrage « Femmes Sénégalaises à l’horizon 2015 », 1993, P145,
MFEF, on se rend compte qu’en 1906, il y avait 29 écoles dispensant un
enseignement aux garçons et qui comptaient 3 252 élèves, contre quatre écoles
pour les filles (40 élèves).
Au niveau de la formation professionnelle, l’École
Normale William Ponty, pépinière des futurs cadres et chefs d’État africains, fut
ouverte en 1910, et c’est seulement en 1939 que fut fondée une section
féminine, soit 29 ans plus tard.
Elles se sont révoltées contre la France qui, en 1944, avait accordé le droit de
vote aux femmes, mais décidé aux élections législatives de 1945 que seules les
Françaises de souche pouvaient y participer, excluant les femmes des quatre
communes du Sénégal (Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque), qui avaient
pourtant le statut de citoyennes françaises.
Le droit de vote pour les femmes n’a été obtenu qu’en 1945, grâce aux
mobilisations des femmes sous la houlette de Ndaté Yalla Fall et Soukeyna
Konaré, qui, nonobstant leur appartenance à des partis diverses, ont su joindre
leurs efforts pour faire face à l’autorité coloniale.
Cette dernière avait décidé en
1944, que seules les françaises de souches pouvaient participer au vote.
Excluant
les celles qui avaient la citoyenneté.
Les Sénégalaises menaçaient de s’en
prendre à la vie de toute Française de souche qui irait voter et le gouvernement
français finit par reculer
Après les indépendances, vu leur faible représentativité l’espace politique, les
femmes se sont repliées dans l’espace associatif.
Les premières générations de
femmes scolarisées se sont attelées à l’éveil des consciences de leurs sœurs à
travers des associations, lesquelles se coalisent à partir 1977 sous le nom de la
Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS) pour mener des
actions collectives.
C’est également, une histoire racontant ce que vivent les femmes dans la société
africaine, encore aujourd’hui : le mariage forcé, l'absence des droits des femmes,
la polygamie, la violence faite à la femme, la faible représentation des femmes
dans les instances politiques, l’instrumentalisation des femmes.
Mon cœur est en fête chaque fois qu'une....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- émancipation dans « Une si longue lettre »
- l'amour et l'amitié dans une si longue lettre
- Exposé mariage dans Une si longue lettre
- Musset a publié une longue Lettre à Lamartine en vers où il semble considérer Lamartine comme le poète qui l'a le plus profondément ému et le plus directement inspiré. Vous chercherez dans quelle mesure l'œuvre de Lamartine et celle de Musset se ressemblent.
- Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte. Les Provinciales, 16e lettre Pascal, Blaise. Commentez cette citation.