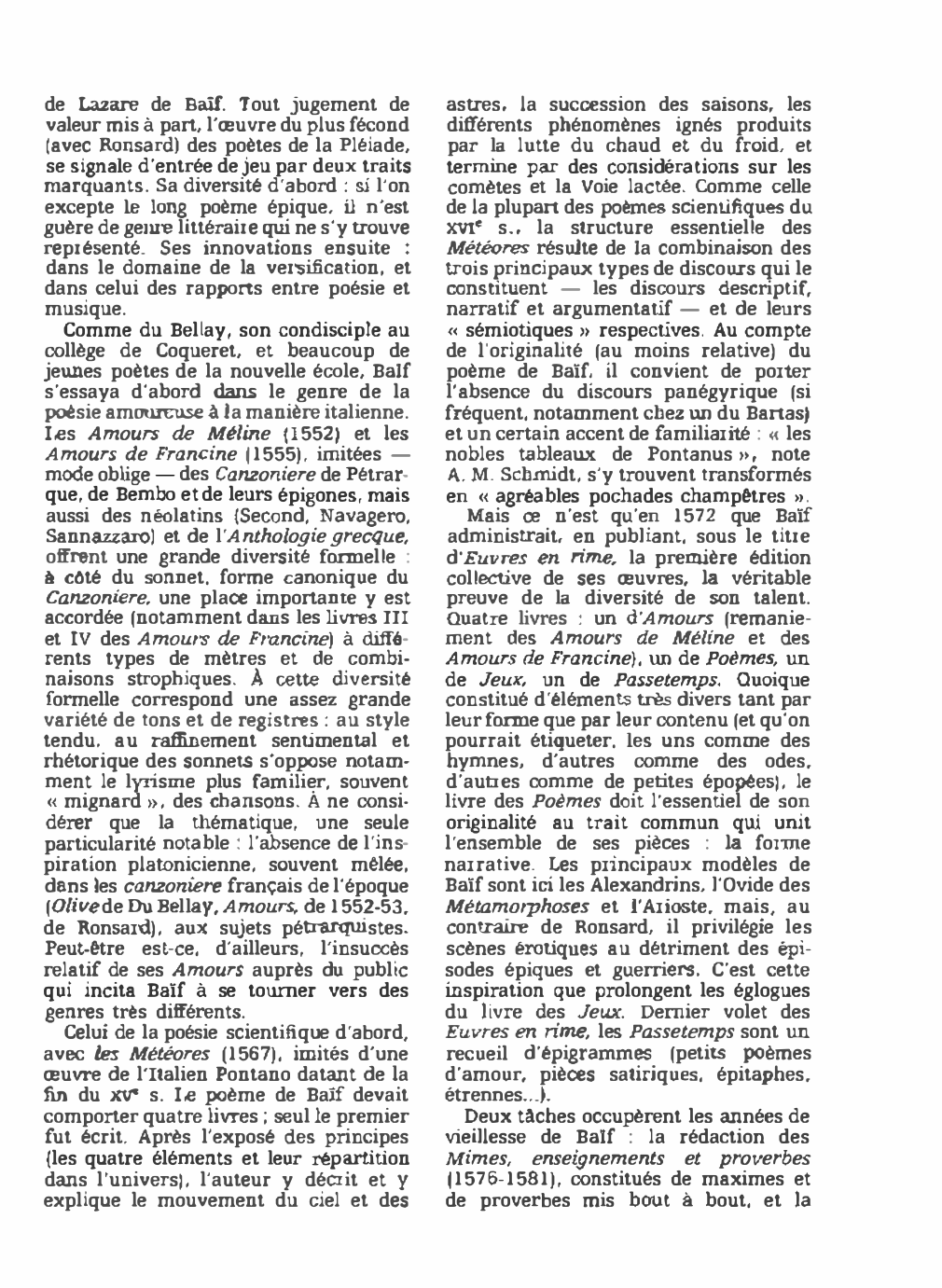BAÏF (Jean-Antoine de)
Publié le 16/02/2019

Extrait du document
BAÏF (Jean-Antoine de), poète français (Venise 1532 - Paris 1589), fils naturel de Lazare de Baïf. Tout jugement de valeur mis à part, l'œuvre du plus fécond (avec Ronsard) des poètes de la Pléiade, se signale d'entrée de jeu par deux traits marquants. Sa diversité d'abord : si l'on excepte le long poème épique, il n'est guère de genre littéraire qui ne s'y trouve représenté. Ses innovations ensuite : dans le domaine de la versification, et dans celui des rapports entre poésie et musique.
Comme du Bellay, son condisciple au collège de Coqueret, et beaucoup de jeunes poètes de la nouvelle école, Baïf s'essaya d'abord dans le genre de la poésie amoureuse à la manière italienne. Les Amours de Méline (1552) et les Amours de Francine (1555), imitées — mode oblige — des Canzoniere de Pétrar que, de Bembo et de leurs épigones, mais aussi des néolatins (Second, Navagero, Sannazzaro) et de {'Anthologie grecque, offrent une grande diversité formelle : à côté du sonnet, forme canonique du Canzoniere, une place importante y est accordée (notamment dans les livres III et IV des Amours de Francine} à différents types de mètres et de combinaisons strophiques. À cette diversité formelle correspond une assez grande variété de tons et de registres : au style tendu, au raffinement sentimental et rhétorique des sonnets s'oppose notamment le lyrisme plus familier, souvent « mignard », des chansons. À ne considérer que la thématique, une seule particularité notable : l'absence de l'inspiration platonicienne, souvent mêlée, dans les canzoniere français de l'époque {Olivede Du Bellay, Amours, de 1552-53, de Ronsard), aux sujets pétrarquistes. Peut-être est-ce, d'ailleurs, l'insuccès relatif de ses Amours auprès du public qui incita Baïf à se tourner vers des genres très différents.
Celui de la poésie scientifique d'abord, avec les Météores (1567), imités d'une œuvre de l'Italien Pontano datant de la fin du XVe s. Le poème de Baïf devait comporter quatre livres ; seul le premier fut écrit. Après l'exposé des principes (les quatre éléments et leur répartition dans l'univers), l'auteur y décrit et y explique le mouvement du ciel et des
astres, la succession des saisons, les différents phénomènes ignés produits par la lutte du chaud et du froid, et termine par des considérations sur les comètes et la Voie lactée. Comme celle de la plupart des poèmes scientifiques du xvie s., la structure essentielle des Météores résulte de la combinaison des trois principaux types de discours qui le constituent — les discours descriptif, narratif et argumentatif — et de leurs « sémiotiques » respectives. Au compte de l'originalité (au moins relative) du poème de Baïf, il convient de porter l'absence du discours panégyrique (si fréquent, notamment chez un du Bartas) et un certain accent de familiarité : « les nobles tableaux de Pontanus », note A. M. Schmidt, s'y trouvent transformés en « agréables pochades champêtres ».
Mais ce n'est qu'en 1572 que Baïf administrait, en publiant, sous le titre à'Euvres en rime, la première édition collective de ses œuvres, la véritable preuve de la diversité de son talent. Quatre livres : un à'Amours (remaniement des Amours de Méline et des Amours de Francine), un de Poèmes, un de Jeux, un de Passetemps. Quoique constitué d'éléments très divers tant par leur forme que par leur contenu (et qu'on pourrait étiqueter, les uns comme des hymnes, d'autres comme des odes, d’autres comme de petites épopées), le livre des Poèmes doit l'essentiel de son originalité au trait commun qui unit l'ensemble de ses pièces : la forme narrative. Les principaux modèles de Baïf sont ici les Alexandrins, l'Ovide des Métamorphoses et l'Arioste, mais, au contraire de Ronsard, il privilégie les scènes érotiques au détriment des épisodes épiques et guerriers. C'est cette inspiration que prolongent les églogues du livre des Jeux. Dernier volet des Euvres en rime, les Passetemps sont un recueil d'épigrammes (petits poèmes d'amour, pièces satiriques, épitaphes, étrennes...).
Deux tâches occupèrent les années de vieillesse de Baïf : la rédaction des Mimes, enseignements et proverbes (1576-1581), constitués de maximes et de proverbes mis bout à bout, et la
«
de
Lazare de Baïf.
Tout jugement de
valeur mis à part, l'œuvre du plus fécond
(avec Ronsard) des poètes de la Pléiade,
se signale d'entrée de jeu par deux traits
marquants.
Sa diversité d'abord: si l" on
excepte le long poème épique, il n ·est
guère de genre littéraire qui ne s'y trouve
représenté.
Ses innovations ensuite :
dans le domaine de la versification, et
dans celui des rapports entre poésie et
musique.
Comme du Bellay, son condisciple au
collège de Coqueret, et beaucoup de
jeunes poètes de la nouvelle école, Balf
s'essaya d'abord dans le genre de la
poésie amoureuse à la manière italienne.
Les Amours de M�line (1552) et tes
Amours de Francine ( 1555), im itée s -
mode oblige -des Canzoniere de Pétrar
que, de Bembo et de leurs épig on es, mais
aussi des néo latin s (Second, Navagero,
Sann azzaro) et de l'Anthologie grecque,
offrent une grande diversité formelle :
à cOté du sonnet, forme canonique du
Canzoniere, une place importante y est
accordée (notamment dan s les livres III
et IV des Amours de Francine) à diffé
rents types de mètres et de combi
naisons strophiques.
A cette diversité
formelle correspond une assez grande
variété de tons et de registres : au style
tendu, au raffinement sentimental et
rhétorique des sonnets s'oppose notam
ment le lyrisme plus familier, souvent
« mignard », des chansons.
À ne consi
dérer que la thématique, une seule
particularité notable : l'absence de l' i n s
piration platonicienne, souvent mêlée,
dans les canzoniere français de l'époque
(Olive de Du Bellay, Amours, de 1552-53,
de Ronsard), aux sujets pétrarquistes.
Peut-être est-ce, d'ailleurs, l'insuccès
relatif de ses Amours auprès du public
qui incita Baïf à se tourner vers des
genres très différents.
Celui de la poésie scientifiqu e d'abord,
avec les Météores (1567), imités d'une
œuvre de l'Italien Pontano datant de ta
fin du XV" s.
Le poème de Baïf devait
comporter quatre livres ; seul le premier
fut écrit.
Après l'exposé des principes
(les quatre éléments et leur réparti tion
dans l'univers), l'auteur y décrit et y
explique le mouvement du ciel et des astres,
la succession des saisons, les
différents phénomènes ignés produits
par la lu tt e du chaud et du froid, et
termine par des considérations sur les
comètes et la Voie lactée.
Comme celle
de la plupart des poèmes sci en tifiq ues du
XVI" s..
la structure essentielle des
Météores résulte de la combinaison des
trois principaux types de discours qui le
constituent -les discours descriptif,
narratif et argumentatif -et de leur s
« sémiotiques » respectives.
Au compte
de J"originalité (au moins relative) du
poème de Baïf, il convient de porter
l'absence du discours panégyrique (si
fréquent, notamment chez un du Bartas)
et un certain accent de familiarité : « les
nobles tableaux de Pontanus », note
A.
M.
Schmidt, s'y trouvent transformés
en « agréables pochades champêtres ».
Mais ce n'est qu'en 1572 que Baïf
administrait, en publiant , sous le titre
d'Euvres en rime, la premi.ère édition
collective de ses œuvres, la véritable
preuve de la diversité de son talent.
Quatre livres : un d'Amours (remanie
ment des Amours de MéUne et des
Amours de Francine), un de Poèmes, un
de Jeux, un de Passetemps.
Quoique
constitué d'él ém en ts trés divers tant par
leur forme que par leur contenu (et qu'on
pourrait étiqueter, les uns comme des
hymne s, d'autres comme des odes,
d'autres comme de petites épopées), le
livre des Poèmes do it l"essentiel de son
originalité au trait commun qui unit
l'ensemble de ses pièces : la forme
narrative.
Les principaux modèles de
Baïf sont ici les Alexandrins, l'Ovide des
Métamorphoses et l'Arioste, mais, au
contraire de Ronsard, il privilégie les
scènes érotiques au détriment des épi
sodes épiques et guerrie.rs.
C'est cette
inspiration que prolongent les églogues
du livre des Jeux.
Dernier volet des
Euvres en rime, les Passetemps sont un
recueil d'épigrammes (peti ts poèmes
d'amour, pièces satiriques, épitaphes,
étrennes ...
).
Deux tâches occupèrent les années de
vieillesse de Baif : la rédaction des
Mimes, enseignements et proverbes
(1576-1581), constitués de maximes et
de proverbes mis bout à bout, et la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MÉTÉORES (Les) de Jean Antoine de Baïf (résumé)
- MIMES, ENSEIGNEMENTS ET PROVERBES de Jean-Antoine de Baïf - résumé, analyse
- Baïf (Jean Antoine de), 1532-1589, né à Venise, poète français de la Renaissance.
- Baïf, Jean Antoine de - littérature.
- BAïF, Jean-Antoine de (1532-1589) Poète, il est l'auteur des Amours de Méline.