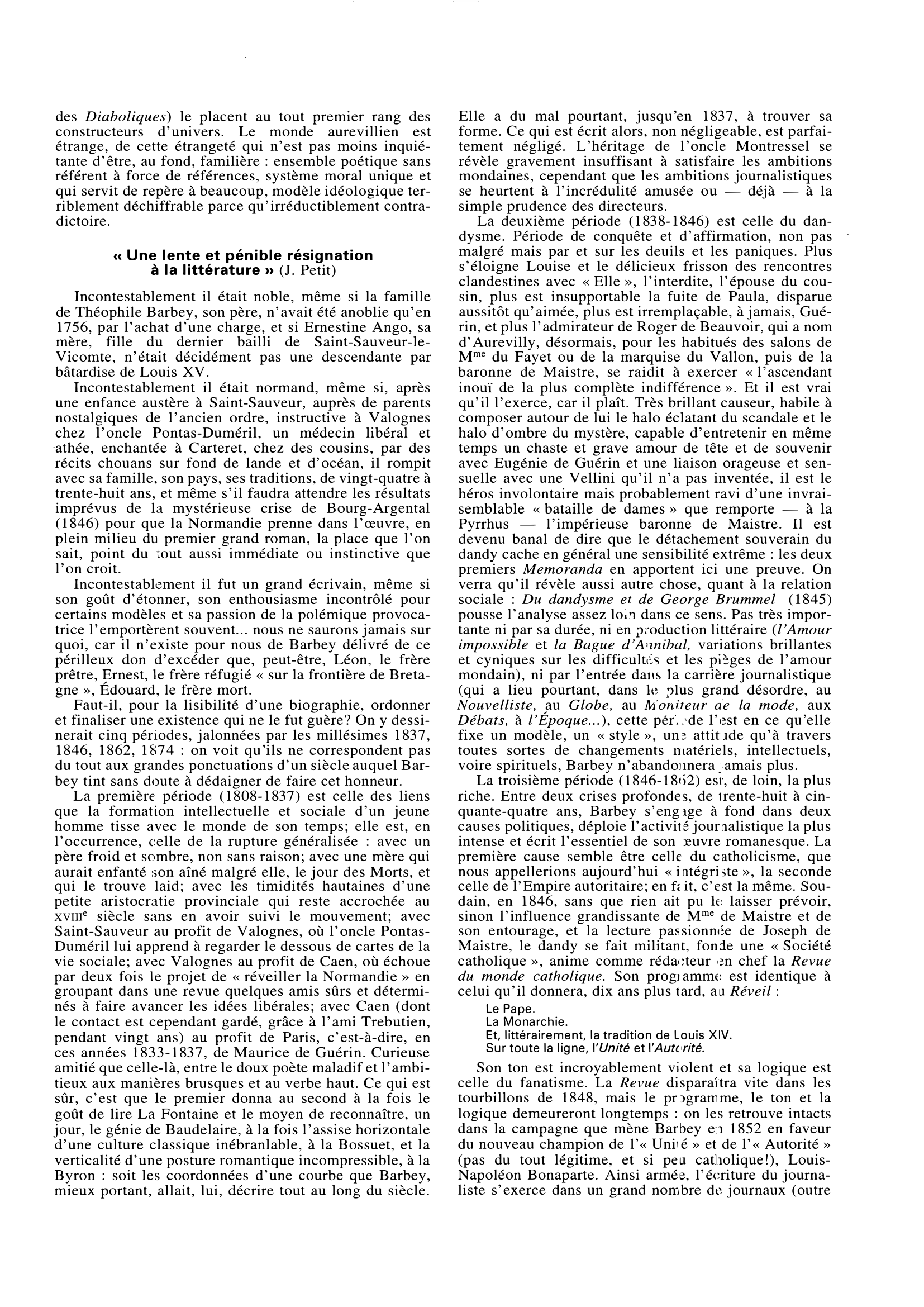BARBEY D’AUREVILLY : sa vie et son oeuvre
Publié le 15/11/2018

Extrait du document

BARBEY D’AUREVILLY
BARBEY, puis BARBEY D'AUREVILLY Jules Amé-dée (1808-1889). Peu d’hommes au xixe siècle ont autant fait parler d’eux, parmi ceux qui ont autant parlé des autres. Et ce fut, décidément, malgré d’autres ambitions, à propos de littérature. Il y consacra près de 1 300 articles, en soixante années d’une vie chaotique au cours de laquelle il fut intensément le contemporain et l’imprécateur des plus grands. Il s’y livra lui-même en une vingtaine de récits, dont les plus puissants (des romans comme Une vieille maîtresse, l'Ensorcelée, le Chevalier Des Touches, Un prêtre marié, Une histoire sans nom, ou des nouvelles comme celles qui composent le recueil des Diaboliques) le placent au tout premier rang des constructeurs d’univers. Le monde aurevillien est étrange, de cette étrangeté qui n’est pas moins inquiétante d’être, au fond, familière : ensemble poétique sans référent à force de références, système moral unique et qui servit de repère à beaucoup, modèle idéologique terriblement déchiffrable parce qu’irréductiblement contradictoire.
« Une lente et pénible résignation à la littérature » (J. Petit)
Incontestablement il était noble, même si la famille de Théophile Barbey, son père, n’avait été anoblie qu’en 1756, par l’achat d’une charge, et si Ernestine Ango, sa mère, fille du dernier bailli de Saint-Sauveur-le-Vicomte, n’était décidément pas une descendante par bâtardise de Louis XV.
Incontestablement il était normand, même si, après une enfance austère à Saint-Sauveur, auprès de parents nostalgiques de l’ancien ordre, instructive à Valognes chez l’oncle Pontas-Duméril, un médecin libéral et athée, enchantée à Carteret, chez des cousins, par des récits chouans sur fond de lande et d’océan, il rompit avec sa famille, son pays, ses traditions, de vingt-quatre à trente-huit ans, et même s’il faudra attendre les résultats imprévus de la mystérieuse crise de Bourg-Argentai (1846) pour que la Normandie prenne dans l’œuvre, en plein milieu du premier grand roman, la place que l’on sait, point du tout aussi immédiate ou instinctive que l’on croit.
Incontestablement il fut un grand écrivain, même si son goût d’étonner, son enthousiasme incontrôlé pour certains modèles et sa passion de la polémique provocatrice l’emportèrent souvent... nous ne saurons jamais sur quoi, car il n’existe pour nous de Barbey délivré de ce périlleux don d’excéder que, peut-être, Léon, le frère prêtre, Ernest, le frère réfugié « sur la frontière de Bretagne », Edouard, le frère mort.
Faut-il, pour la lisibilité d’une biographie, ordonner et finaliser une existence qui ne le fut guère? On y dessinerait cinq périodes, jalonnées par les millésimes 1837, 1846, 1862, 1874 : on voit qu’ils ne correspondent pas du tout aux grandes ponctuations d’un siècle auquel Barbey tint sans doute à dédaigner de faire cet honneur.
La première période (1808-1837) est celle des liens que la formation intellectuelle et sociale d’un jeune homme tisse avec le monde de son temps; elle est, en l’occurrence, celle de la rupture généralisée : avec un père froid et sombre, non sans raison; avec une mère qui aurait enfanté son aîné malgré elle, le jour des Morts, et qui le trouve laid; avec les timidités hautaines d’une petite aristocratie provinciale qui reste accrochée au xviiie siècle sans en avoir suivi le mouvement; avec Saint-Sauveur au profit de Valognes, où l’oncle Pontas-Duméril lui apprend à regarder le dessous de cartes de la vie sociale; avec Valognes au profit de Caen, où échoue par deux fois le projet de « réveiller la Normandie » en groupant dans une revue quelques amis sûrs et déterminés à faire avancer les idées libérales; avec Caen (dont le contact est cependant gardé, grâce à l’ami Trebutien, pendant vingt ans) au profit de Paris, c’est-à-dire, en ces années 1833-1837, de Maurice de Guérin. Curieuse amitié que celle-là, entre le doux poète maladif et l’ambitieux aux manières brusques et au verbe haut. Ce qui est sûr, c’est que le premier donna au second à la fois le goût de lire La Fontaine et le moyen de reconnaître, un jour, le génie de Baudelaire, à la fois l’assise horizontale d’une culture classique inébranlable, à la Bossuet, et la verticalité d’une posture romantique incompressible, à la Byron : soit les coordonnées d’une courbe que Barbey, mieux portant, allait, lui, décrire tout au long du siècle.
Elle a du mal pourtant, jusqu’en 1837, à trouver sa forme. Ce qui est écrit alors, non négligeable, est parfaitement négligé. L’héritage de l’oncle Montressel se révèle gravement insuffisant à satisfaire les ambitions mondaines, cependant que les ambitions journalistiques se heurtent à l’incrédulité amusée ou — déjà — à la simple prudence des directeurs.
La deuxième période (1838-1846) est celle du dandysme. Période de conquête et d’affirmation, non pas malgré mais par et sur les deuils et les paniques. Plus s’éloigne Louise et le délicieux frisson des rencontres clandestines avec « Elle », l’interdite, l’épouse du cousin, plus est insupportable la fuite de Paula, disparue aussitôt qu’aimée, plus est irremplaçable, à jamais, Guérin, et plus l’admirateur de Roger de Beauvoir, qui a nom d’Aurevilly, désormais, pour les habitués des salons de Mme du Fayet ou de la marquise du Vallon, puis de la baronne de Maistre, se raidit à exercer « l’ascendant inouï de la plus complète indifférence ». Et il est vrai qu’il l’exerce, car il plaît. Très brillant causeur, habile à composer autour de lui le halo éclatant du scandale et le halo d’ombre du mystère, capable d’entretenir en même temps un chaste et grave amour de tête et de souvenir avec Eugénie de Guérin et une liaison orageuse et sensuelle avec une Vellini qu’il n’a pas inventée, il est le héros involontaire mais probablement ravi d’une invraisemblable « bataille de dames » que remporte — à la Pyrrhus — l’impérieuse baronne de Maistre. Il est devenu banal de dire que le détachement souverain du dandy cache en général une sensibilité extrême : les deux premiers Memoranda en apportent ici une preuve. On verra qu’il révèle aussi autre chose, quant à la relation sociale : Du dandysme et de George Brummel (1845) pousse l’analyse assez loin dans ce sens. Pas très importante ni par sa durée, ni en production littéraire (l'Amour impossible et la Bague d’Annibal, variations brillantes et cyniques sur les difficultés et les pièges de l’amour mondain), ni par l’entrée dans la carrière journalistique (qui a lieu pourtant, dans le plus grand désordre, au Nouvelliste, au Globe, au Moniteur de la mode, aux Débats, à l'Époque...), cette période l’est en ce qu’elle fixe un modèle, un « style », une attitude qu’à travers toutes sortes de changements matériels, intellectuels, voire spirituels, Barbey n’abandonnera jamais plus.
La troisième période (1846-1862) est, de loin, la plus riche. Entre deux crises profondes, de trente-huit à cinquante-quatre ans, Barbey s’engage à fond dans deux causes politiques, déploie l’activité journalistique la plus intense et écrit l’essentiel de son oeuvre romanesque. La première cause semble être celle du catholicisme, que nous appellerions aujourd’hui «intégriste», la seconde celle de l'Empire autoritaire; en fait, c’est la même. Soudain, en 1846, sans que rien ait pu le laisser prévoir, sinon l’influence grandissante de Mme de Maistre et de son entourage, et la lecture passionnée de Joseph de Maistre, le dandy se fait militant, fonde une « Société catholique », anime comme rédacteur en chef la Revue du monde catholique. Son programme est identique à celui qu’il donnera, dix ans plus tard, au Réveil :
Le Pape.
La Monarchie.
Et, littérairement, la tradition de Louis XIV.
Sur toute la ligne, l'Unité et l'Autorité.
Son ton est incroyablement violent et sa logique est celle du fanatisme. La Revue disparaîtra vite dans les tourbillons de 1848, mais le programme, le ton et la logique demeureront longtemps : on les retrouve intacts dans la campagne que mène Barbey en 1852 en faveur du nouveau champion de l’« Unité » et de l’« Autorité » (pas du tout légitime, et si peu catholique!), Louis-Napoléon Bonaparte. Ainsi armée, l’écriture du journaliste s’exerce dans un grand nombre de journaux (outre la Revue du monde catholique et le Réveil, qu’il contrôle, le Constitutionnel, la Sylphide, la Mode, l'Assemblée nationale, le Public, et surtout, à partir de 1852, le Pays) et dans toutes les directions : politique, selon sa plus grande et durable ambition jamais vraiment satisfaite, littéraire (les grands articles contre Hugo, contre Michelet, contre Sainte-Beuve, sur la mort de Balzac, en faveur des Fleurs du mal et de Madame Bovary, mais aussi sur Banville et sur Leconte de Lisle, sur Poe et sur Gogol, datent de cette période), idéologique surtout, les deux premières instances n’étant apparemment pour lui que des occasions de manifester celle-ci, qu’il illustre en 1851 dans les Prophètes du passé. Car, au milieu de cette agitation, l’écrivain trouve le temps de se révéler aussi : il achève Une vieille maîtresse (1849), conçoit et publie l’Ensorcelée (1849-1855), commence le Chevalier Des Touches (1852) et rédige encore les troisième et quatrième Memoranda. La crise de 1858-1862, qui clôt cette période, semble ne rien changer à toute cette activité; en réalité, elle en inverse radicalement la signification. L’homme qui s’est affilié, pour la croisade, à tel groupe, à tel parti, à telle rédaction, s’en sépare et se drape dans une solitude superbe (rupture avec Sainte-Beuve, avec les catholiques, avec le Pays, avec le régime impérial...); les retrouvailles avec Trebutien aboutissent à une séparation définitive, aggravée d’une trahison (on lui enlève aussi Guérin!); et de même que, tout en jouant à l’espérer encore, il ne croit plus au mariage avec Mme de Bouglon (l’«Ange blanc», qui tente de l’assagir), de même il continue de défendre, désormais sans la moindre illusion, dans un mélange de dérision et de désespoir que seule peut faire « tenir » la raideur étudiée de l’ancien dandysme, les valeurs d’ordre, les dogmatismes répressifs, les réactions de rejet.
C’est ici, au seuil de la quatrième période (1862-1874), que prend tout son sens la formule de J. Petit qui sert de titre à ce synopsis biographique : la littérature n’est plus pour Barbey l’un des instruments de la réussite mondaine, de l’ambition politique, de la persuasion idéologique; elle est devenue le lieu de la résignation ou, plutôt, le seul moyen de construire encore, dans la fiction, la possibilité de ce que le réel a pour jamais répudié. Et c’est tout Barbey qui se met alors à devenir fictif : le personnage excentrique et désuet qui arbore fièrement la cravate sang-de-bœuf et la canne à pomme aventurine et or des années 1830, le sigisbée de la mûrissante baronne de Bouglon, qui écrit pour elle (à sa demande!) le cinquième Mémorandum, l’imprécateur qui s’en prend singulièrement à « cet animal de François Buloz », le tout-puissant directeur de la Revue des Deux Mondes, ou, en bloc, à toute l’Académie française, le collaborateur ricanant du Nain jaune, le « Canard enchaîné » de l’époque (rubrique : « les Ridicules du temps », 1866-1867), l’éditorialiste politique qui se déchaîne contre « les petits hurleurs de liberté » en 1869, dans le Dix-Décembre, et, la même année, dans le Gaulois et le Parlement, prend le parti des républicains contre l’Empire, quitte à relancer, en 1872 dans le Figaro, une violente polémique antirépublicaine..., et surtout, bien sûr, l’auteur des Diaboliques. Autre indice d’une résignation à un nouveau mode d’exister, celui qui, dédaignant les gestes et les mots de l’activité quotidienne dans le monde, choisit d’en organiser les signes et met patiemment en œuvre la technique (re-)constituante du recueil : commencent à paraître chez Amyot les premiers volumes de les Œuvres et les Hommes.
Dans ces conditions, la dernière période (1875-1889) ne fut probablement pas aussi sombre que l’ont voulu certains biographes. Barbey a beau jouer au dandy prolongé, à l’éreinteur inexorable, à l’homme de droite intraitable, au passéiste borné, il ne peut cacher qu’il joue, que le moindre de ses gestes est écriture, et que, si provocation il y a, elle est désormais provocation à lire, à déchiffrer dans l’œuvre d’une vie la destinée d’un siècle. Il ne cherche d’ailleurs guère à le cacher, lui dont la dernière compagne, Louise Read, tient principalement le rôle d’une secrétaire; qui groupe autour de lui tout ce qui se destine à la littérature de l’avenir, et entretient avec chacun des rapports insolites, faits de fascination réciproque et de complicité profonde, malgré la différence des âges, des idées et des goûts; qui, pendant les quinze dernières années, tout en assurant régulièrement la critique dramatique du Triboulet et la critique littéraire du Constitutionnel (« J’ai succédé à Sainte-Beuve! »), multiplie les rééditions de ses romans et de ses essais, reprend des œuvres de jeunesse oubliées depuis longtemps (Germaine, la Bague d’Annibal, Léa, Amaïdée), s’épuise au tri et au regroupement de ses articles pour les Œuvres et les Hommes et trouve dans cette pratique systématique de la relecture et de la réflexion l’inspiration de deux purs chefs-d’œuvre, dont les titres ne se font sans doute pas écho en vain et qui constituent son vrai testament littéraire : Une histoire sans nom et Une page d'histoire. Que l’autre testament ait été âprement disputé entre tous les « héritiers » de Barbey, et qu’on ne sache pas très bien, de ce qui lui appartint en propre, ce qui doit revenir à la secrétaire ou à la baronne, au Mendiant ou au Sâr, à Jean Lorrain, à Paul Bourget ou à Octave Uzanne, voire à Barrés, D’Annunzio, Bernanos ou Mauriac, n’a évidemment ici qu’une portée tout à fait secondaire.
« Incohérent, bizarre et plein de trous » (F. Sarcey)
Pour régner, quand même, sur ce royaume introuvable qu’est le phénomène Barbey — personnage, carrière, œuvre —, on a le plus souvent cherché à le diviser; pour tenter de métriser/maîtriser (selon le joli mot de M. Serres) cette lande, on a bien sûr projeté sur son immensité labyrinthique des repères, des axes, des grilles, des carrefours, tout un système de signalisation sans lequel ne passent ni la syntaxe de la critique littéraire, ni les chariots de la civilisation, ni les armées. On a distingué l’homme public (théâtral, masqué) de l’homme privé (simple, sensible), le critique (outrancier, maladroit) de l’écrivain (maître de lui et de ses effets), l’idéologue (fanatique, totalitaire) du penseur (lucide, ouvert), voire le narrateur (citoyen, officiant) du héros (joueur, transgresseur). Il faut au contraire probablement, pour avoir quelque chance de traverser la lande, la reconnaître pour ce qu’elle est, « lacune de culture », « soudaine interruption de mélancolie », « lambeaux, laissés sur le sol, d’une poésie primitive et sauvage », où il arrive que le cavalier et le cheval ne fassent plus « qu’un seul être, bizarre et monstrueux » (FEnsorcelée, début).
Ce qui fait l’unité du monstre, en cela parfaitement romantique, c’est la passion. Non l’aptitude générale à se passionner, comme il arrivait alors beaucoup, mais telle passion bien précise, et qui chevauche si bien son objet qu’elle finit par faire corps avec lui. Barbey fut l’homme d’une passion. Et il serait vain d’évoquer ici, malgré l’émotion bouleversante de l’adolescent, Louise du Méril, ou, malgré l’attachement mystique du « chevalier de Malte », l’Ange blanc, voire encore la fugitive Paula, la douce Eugénie, l’énigmatique Vellini, l’imposante marquise du Vallon ou l’exigeante baronne de Maistre; tout aussi vain de songer à Maurice de Guérin, le délicat ami de collège et l’initiateur en poésie, ou à Trebutien le fidèle, car avec eux et avec quelques autres (Brucker, Baudelaire, Saint-Maur, Bloy) Barbey pratiqua l’amitié la plus vraie, celle précisément qui n’est pas une passion; vain — et sot — de nommer l’Art, le Beau, l’Utile, ou la Mission du poète, qu’il laissa à d’autres et ne leur pardonna guère; vain encore d’en appeler à l’Ancien Régime, aux formes, aux gestes, au langage d’une société respectueuse des valeurs de la vieille chevalerie, de la monarchie légitime, de la foi révélée; ou même à la Normandie, pays de l’enfance, terre chouane, cadre idéal pour le bonheur, le souvenir et le rêve : lieux et temps favoris, en effet, encres hautes en couleur, où la plume se trempe, où le cœur se retrempe, mais si peu irremplaçables que c’est à l’autre bout de la jeunesse et de la France que se produit le choc révélateur, la vision soudaine, totale et définitive de l’objet, sous la forme d’un « cône renversé », d’un « profond et sombre entonnoir fermé par des montagnes », d’où l’on ne peut apercevoir le jour qu’« en regardant la lucarne bleue (...) à mille pieds au-dessus (des) têtes ». Cette image qui détermine le cadre du dernier roman est, à la position de l’observateur près, étrangement proche de celle qui servit à définir la première « diabolique » écrite : « L’Enfer vu par un soupirail ». L’instrument de la passion, c’est le regard; l’axe qui détermine son champ, celui qui relie le regardant indifféremment au ciel ou à l’enfer, « ciel en creux »; son objet, le désespoir. Toutes les poses que prit Barbey n’étaient que des adaptations de cette position fondamentale : contempler et décrire, passionnément, l’absolu désespoir d’un monde impuissant à être le ciel, incapable d’être l’enfer, mais ne pouvant détacher son regard ni de l’un ni de l’autre, comme d’un rideau cramoisi; désespoir d’une distance désormais irréductible et douloureuse, mais qui seule permet, précisément, le regard... et la passion. D’où la fougue, d’où l’éclat, d’où l’incroyable élan de l’ironie, de l’indignation, de l’invective, de l’amour. Tout était possible, pour Barbey, parce que tout était déjà radicalement perdu.
C’est là probablement ce que les spécialistes de la pensée religieuse appellent son jansénisme. C’est là que les experts sourciers reconnaissent son byronisme. C’est le lieu de son accord profond avec Joseph de Maistre, avec la différence majeure que ce dernier annonçait et prêchait, à travers l’expiation, une renaissance du christianisme triomphant, à laquelle il est clair que Barbey ne croit pas. C’est aussi le ressort psychologique de son dandysme, fort révélateur en cela de la signification générale du phénomène : l’étonnant détour qu’entre George Brummel et Oscar Wilde ce comportement typiquement britannique fit sur le continent et l’acclimatation qu’il y réussit pendant tout le xixe siècle manifestent, entre l’âge immémorial des certitudes chrétiennes et celui des perspectives positivistes, entre ce passé et cet avenir tous deux amplement pourvus de prophètes, un présent terriblement vide d’espoir.
Si c’est là ce qu’on appelle le romantisme, Barbey y occupe une place centrale, par la reconnaissance implacable de ce vide, par l’élégance raffinée dans la manière de l’affronter, par le refus hautain de tous les placebo (les « prophètes du passé », Chateaubriand, Bonald, Maistre, Lamennais, ne sont pas des voix pour nous, non plus que les prophètes de l’avenir, Hugo, Michelet, Renan... « L’avenir a ses spectres comme le passé a les siens »), enfin et surtout par la provocation. Car c’est la spécialité qu’il a choisie entre toutes, sans doute pour des raisons que la psychanalyse éclairerait : abandon de la mère, complexe de laideur, goût voyeuriste, besoin d’étonner... La provocation s’adresse essentiellement aux valeurs bourgeoises — qu’il ne fustige pas moins qu’un Flaubert, un Rimbaud ou un Villiers — mais elle traque systématiquement tout ce qui peut, de près ou de. loin, être considéré comme solidaire de ces valeurs ou découlant de leur triomphe : démocratie, réalisme, scientisme, humanitarisme, socialisme, matérialisme... Ce faisant, elle oblige le siècle à se poser sur lui-même toutes les questions qu’il préférait éviter, à nommer son histoire, à en lire toutes les pages : forme de réalisme qui ne doit rien à Champfleury, mais qui révèle dans l’auteur de Du dandysme... et des Prophètes... le contraire du réactionnaire attardé ou du rêveur idéaliste qu’en ont volontiers fait les manuels.
Une « relation de la décadence » (J. Petit)
La carrière du journalisme était bien la plus apte à l’exercice inlassable et fracassant d’une telle provocation. Aussi Barbey la poursuit-il avec la plus durable obstination, fondant ou animant lui-même des revues (Revue de Caen, 1831; Revue critique..., 1834; Revue du monde catholique, 1847; le Réveil, 1858), collaborant aux journaux existants, et autant que possible aux plus importants. C’est une activité qu’il n’interrompt à peu près jamais, de l’âge de trente ans jusqu’à sa mort.
Avec chacun des quelque quarante journaux ou revues auxquels il a affaire, le schéma est à peu près le même : jeu d’intrigues et d’influences pour y entrer; succès immédiat dû à l’originalité et à l’absence de précautions qui tranchent sur les habitudes; excès qui indisposent les lecteurs et mettent la direction dans l’embarras; censure; mise à l’écart temporaire; exclusion définitive. Ce schéma s’applique entièrement à son aventure avec le Pays entre 1852 et 1865 (350 articles). Au Globe, au Figaro et au Journal des débats, la collaboration, conquise de haute lutte, tourna court beaucoup plus vite. Avec le Pays, c’est finalement le Nouvelliste (environ 100 articles, en 1838-1839), le Nain jaune (130 articles, 1863-1869), le Constitutionnel (250 articles, en 1845-1846, puis de 1869 à 1884) et le Triboulet (70 articles, en 1880-1882) qui le publièrent le plus longtemps. Or si le Pays et le Constitutionnel étaient des organes gouvernementaux, dévoués aux valeurs d’ordre et d’autorité qu’assumait F Empire, le Nouvelliste passait pour un peu «jacobin », et le Nain jaune était une virulente feuille d’opposition politique, institutionnelle, morale.
A cet éclectisme dans le choix des journaux, Barbey joignit la plus grande diversité dans les rubriques qu’il y assurait : éditorial politique, critique littéraire, revue théâtrale, critique d’art, voire chronique mondaine de la mode ou feuilleton satirique. C’est qu’il ne s’agissait pas pour lui de se spécialiser dans tel domaine, d’y acquérir des connaissances organisées et de les défendre méthodiquement; il ne s’agissait que de saisir toutes les occasions de faire entendre sa voix. On l’entend en effet, on la reconnaît entre mille, mais on ne reconnaît rien de la chose dont elle s’est emparée; elle semble à dessein empêcher qu’on la reconnaisse, pour la donner à connaître. Syntaxe de l’effet, esthétique de l’étonnement, goût du paradoxe, sens immédiat de la caricature, haine instinctive du troupeau, du chemin tracé, du sentiment obligé, du mot attendu sont les caractéristiques de celui qui, en lançant le Réveil, prétendait tenir en respect la littérature avec « un caporal et quatre hommes ».
La contradiction est patente, ostensible, provocatrice encore, entre ces déclarations de principes qui lui font attribuer au discours du critique des fonctions dogmatiques, autoritaires, policières, et l’assimiler lui-même au soldat qui maintient l’ordre ou au bourreau qui en punit la transgression, et sa pratique journalistique, dépourvue de toute réelle rigueur. Ni sur les questions politiques ni sur les questions religieuses, malgré la netteté des positions qu’il a défendues (un exemple suffira : « Nos pères ont été sages d’égorger les huguenots et bien imprudents de ne pas brûler Luther. Si, au lieu de brûler les écrits de Luther, dont les cendres retombèrent sur le monde comme une semence, on avait brûlé Luther lui-même, le monde était sauvé, au moins pour un siècle »), il n’a pu être considéré par personne comme un chef de file, un axe de ralliement. Tour à tour, les royalistes, les catholiques, les bonapartistes ont éprouvé les torts que leur causait ce tonitruant héraut de leur cause.

«
des
Diaboliques) le placent au tout premier rang des
constructeurs d'univers.
Le monde aurevillien est
étrange, de cette étrangeté qui n'est pas moins inquié
tante d'être, au fond, familière : ensemble poétique sans
référent à force de références, système moral unique et
qui servit de repère à beaucoup, modèle idéologique ter
riblement déchiffrable parce qu'irréductiblement contra
dictoire.
u Une lente et pénible résignation
à la littérature n (J.
Petit)
Incontestablement il était noble, même si la famille
de Théophile Barbey, son père, n'avait été anoblie qu'en
1756, par l'achat d'une charge, et si Ernestine Ango, sa
mère, fille du dernier bailli de Saint-Sauveur-le
Vicomte, n'était décidément pas une descendante par
bâtardise de Louis XV.
Incontestablement il était normand, même si, après
une enfance austère à Saint-Sauveur, auprès de parents
nostalgiques de l'ancien ordre, instructive à Valognes
chez l'oncle Pontas-Duméril, un médecin libéral et
-athée, enchantée à Carteret, chez des cousins, par des
récits chouans sur fond de lande et d'océan, il rompit
avec sa famille, son pays, ses traditions, de vingt-quatre à
trente-huit ans, et même s'il faudra attendre les résultats
imprévus de la mystérieuse crise de Bourg-Argental
(1846) pour que la Normandie prenne dans l'œuvre, en
plein milieu du premier grand roman, la place que l'on
sait, point du tout aussi immédiate ou instinctive que
l' on croit.
Incontestablement il fut un grand écrivain, même si
son goût d'étonner, son enthousiasme incontrôlé pour
certains modèles et sa passion de la polémique provoca
trice l'emportèrent souvent ...
nous ne saurons jamais sur
quoi, car il n'existe pour nous de Barbey délivré de ce
périlleux don d'excéder que, peut-être, Léon, le frère
prêtre, Ernest, le frère réfugié « sur la frontière de Breta
gne », Édouard, le frère mort.
Faut-il, pour la lisibilité d'une biographie, ordonner
et finaliser une existence qui ne le fut guère? On y dessi
nerait cinq périodes, jalonnées par les millésimes 1837,
1846, 1862, 1874 : on voit qu'ils ne correspondent pas
du tout aux grandes ponctuations d'un siècle auquel Bar
bey tint sans doute à dédaigner de faire cet honneur.
La première période (1808-1837) est celle des liens
que la formation intellectuelle et sociale d'un jeune
homme tisse avec le monde de son temps; elle est, en
l' occurrence, celle de la rupture généralisée : avec un
père froid et sombre, non sans raison; avec une mère qui
aurait enfanté son aîné malgré elle, le jour des Morts, et
qui le trouve laid; avec les timidités hautaines d'une
petite aristocratie provinciale qui reste accrochée au
xvm e siècle sans en avoir suivi le mouvement; avec
Saint-Sauveur au profit de Valognes, où l'oncle Pontas
Duméril lui apprend à regarder le dessous de cartes de la
vie sociale; avec Valognes au profit de Caen, où échoue
par deux fois le projet de «réveiller la Normandie» en
groupant dans une revue quelques amis sûrs et détermi
nés à faire avancer les idées libérales; avec Caen (dont
le contact est cependant gardé, grâce à 1' ami Trebutien,
pendant vingt ans) au profit de Paris, c'est-à-dire, en
ces années 1833-1837, de Maurice de Guérin.
Curieuse
amitié que celle-là, entre le doux poète maladif et 1' am bi
tieux aux manières brusques et au verbe haut.
Ce qui est
sûr, c'est que le premier donna au second à la fois le
goût de lire La Fontaine et le moyen de reconnaître, un
jour, le génie de Baudelaire, à la fois l'assise horizontale
d' une culture classique inébranlable, à la Bossuet, et la
verticalité d'une posture romantique incompressible, à la
Byron : soit les coordonnées d'une courbe que Barbey,
mieux portant, allait, lui, décrire tout au long du siècle.
Elle
a du mal pourtant, jusqu'en 1837, à trouver sa
forme.
Ce qui est écrit alors, non négligeable, est parfai
tement négligé.
L'héritage de l'oncle Montressel se
révèle gravement insuffisant à satisfaire les ambitions
mondaines, cependant que les ambitions journalistiques
se heurtent à l'incrédulité amusée ou -déjà - à la
simple prudence des directeurs.
La deuxième période (1838-1846) est celle du dan
dysme.
Période de conquête et d'affirmation, non pas
malgré mais par et sur les deuils et les paniques.
Plus
s' éloigne Louise et le délicieux frisson des rencontres
clandestines avec «Elle», l'interdite, l'épouse du cou
sin, plus est insupportable la fuite de Paula, disparue
aussitôt qu'aimée, plus est irremplaçable, à jamais, Gué
rin, et plus l'admirateur de Roger de Beauvoir, qui a nom
d' Aure villy, désormais, pour les habitués des salons de
Mme du Fayet ou de la marquise du Vallon, puis de la
baronne de Maistre, se raidit à exercer « 1' ascendant
inouï de la plus complète indifférence ».
Et il est vrai
qu' il 1' exerce, car il plaît.
Très brillant causeur, habile à
composer autour de lui le halo éclatant du scandale et le
halo d'ombre du mystère, capable d'en tretenir en même
temps un chaste et grave amour de tête et de souvenir
avec Eugénie de Guérin et une liaison orageuse et sen
suelle avec une Vellini qu'il n'a pas inventée, il est le
héros involontaire mais probablement ravi d'une invrai
semblable « bataille de dames » que remporte - à la
Pyrrhus -l'impérieuse baronne de Maistre.
Il est
devenu banal de dire que le détachement souverain du
dandy cache en général une sensibilité extrême : les deux
premiers Memoranda en apportent ici une preuve.
On
verra qu'il révèle aussi autre chose, quant à la relation
sociale : Du dandysme et de George Brummel (1845)
pousse l'analyse assez lo�!l dans ce sens.
Pas très impor
tante ni par sa durée, ni en tJ:Oduction littéraire (l'Amour
im possible et la Bague d'A,mibal, variations brillantes
et cyniques sur les difficulttS et les pièges de l'amour
mondain), ni par l'entrée dan& la carrière journalistique
(qui a lieu pourtant, dans h� �lus grand désordre, au
Nouvelliste, au Globe, au Moniteur ae la mode, aux
Débats, à l'Époque ...
), cette pér.,'de l',!st en ce qu'elle
fixe un modèle, un «style», un:: attit1de qu'à travers
toutes sortes de changements matériels, intellectuels,
voire spirituels, Barbey n'abandonnera �-amais plus.
La troisième période (1846-1862) est, de loin, la plus
riche.
Entre deux crises profondes, de trente-huit à cin
quante-quatre ans, Barbey s' eng 1ge à fond dans deux
causes politiques, déploie l'activité journalistique la plus
intense et écrit l'essentiel de son 1:uvre romanesque.
La
première cause semble être celle du catholicisme, que
nous appellerions aujourd'hui « iatégri;;te », la seconde
celle de l'Empire autoritaire; en fdt, c'est la même.
Sou
dain, en 1846, sans que rien ait pu k laisser prévoir,
sinon 1' influence grandissante de Mme de Maistre et de
son entourage, et la lecture passionnée de Joseph de
Maistre, le dandy se fait militant, fonie une « Société
catholique», anime comme rédacteur '!n chef la Revue
du monde catholique.
Son programme est identique à
celui qu'il donnera, dix ans plus tard, al! Réveil :
Le Pape.
La Monarchie.
Et, littérairement, la tradition de Louis XIV.
Sur toute la ligne, l'Unité et I'Autc•rité.
Son ton est incroyablement violent et sa logique est
celle du fanatisme.
La Revue disparaltra vite dans les
tourbillons de 1848, mais le pr )gram me, le ton et la
logique demeureront longtemps : on les retrouve intacts
dans la campagne que mène Barbey e1 1852 en faveur
du nouveau champion de l'« Unit.é » et de l'« Autorité »
(pas du tout légitime, et si pel! catholique!), Louis
Napoléon Bonaparte.
Ainsi armée, l'écriture du journa
liste s'exerce dans un grand nombre de journaux (outre.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PRÊTRE MARIÉ (Un) de Jules Barbey d’Aurevilly (résumé et analyse de l’oeuvre)
- Ensorcelée (L'). Roman de Jules Barbey d'Aurevilly (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Diaboliques (les). Recueil de nouvelles de Jules Barbey d'Aurevilly (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Chevalier des Touches (le). Roman de Jules Barbey d'Aurevilly (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- En 1865, dans la préface à son roman Une vieille maîtresse, Barbey d'Aurevilly écrit : « La moralité de l'artiste est dans la force et dans la vérité de sa peinture. En peignant la réalité, en lui infiltrant, en lui insufflant la vie, il a été assez moral : il a été vrai. Vérité ne peut jamais être péché ou crime ». En appuyant votre argumentation sur des exemples précis empruntés notamment à la littérature, vous analyserez et apprécierez ce point de vue. ?