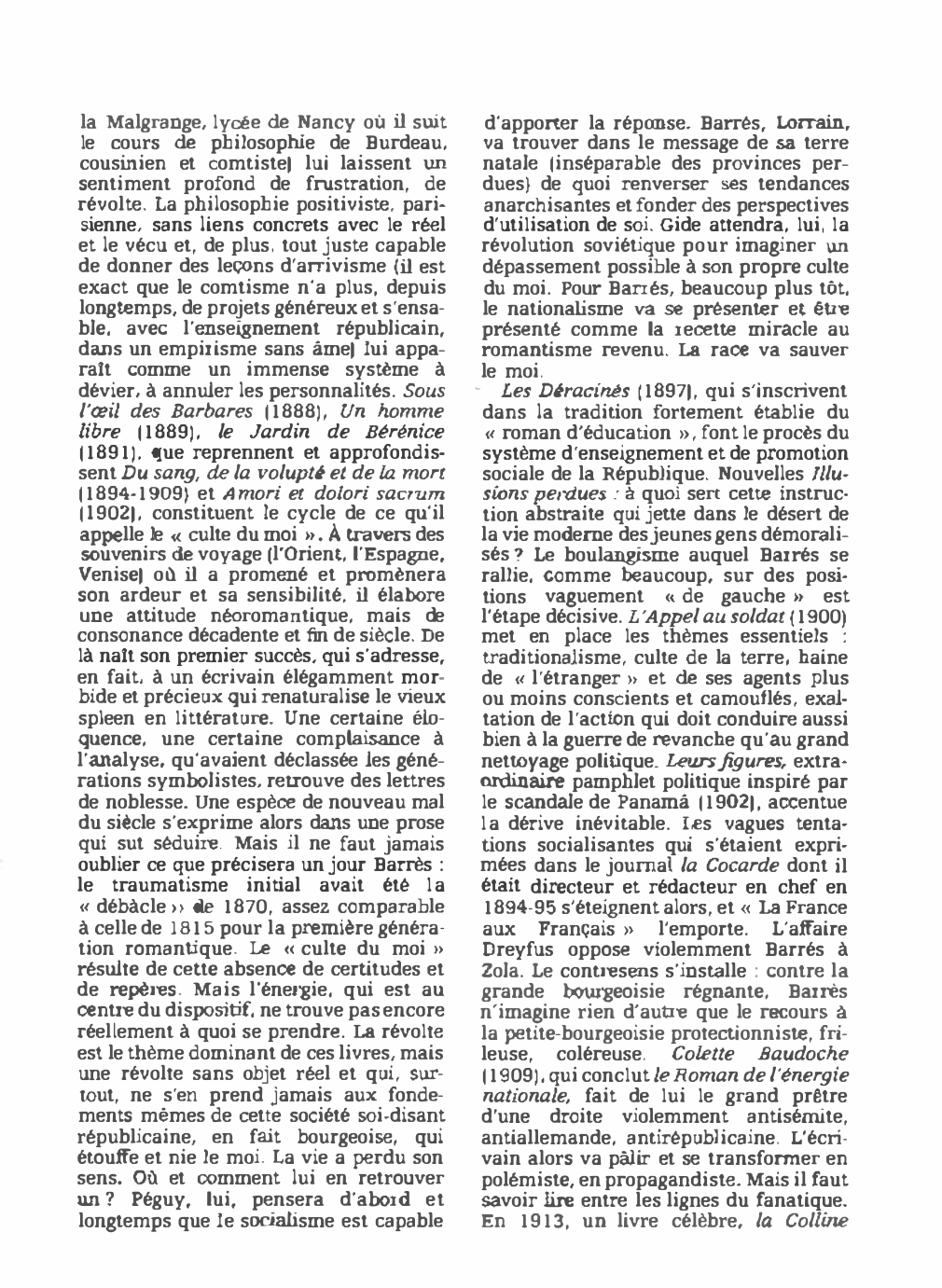BARRÉS (Maurice)
Publié le 16/02/2019

Extrait du document
BARRÉS (Maurice), écrivain et homme politique (Charmes, Vosges, 1862-
Neuilly-sur-Seine 1923). Sa gloire et son influence, qui furent considérables, peuvent paraître aujourd'hui surprenantes si on les juge à l'« actualité » de son écriture et de son entreprise romanesque. Grande figure du nationalisme, « écrivain patriote », disait la presse de droite (impliquant par là que les « autres » écrivains étaient tous plus ou moins traîtres et décadents), académicien donneur de leçons, mais aussi initiateur du jeune Mauriac à l'univers des lettres, théoricien de l'enracinement qui scandalisait André Gide (d'origine à la fois normande et nîmoise, « comment voulez-vous, monsieur Barrés, que je m'enracine? »), cible favorite du jeune Canard enchaîné, il fut au centre de toute une agitation intellectuelle, littéraire et politique aujourd'hui assez oubliée. Dès 1925, Montherlant, pourtant si proche de lui sur bien des points, publiait un livre significatif : Barrés s'éloigne. Il a fallu qu'Aragon, dans les Lettres françaises, en 1948, se proclame à sa manière barrésien (il l'avait d'ailleurs déjà fait lors du procès Barrés mis en scène par Dada ; v. procès Barrés) pour que la question soit à nouveau posée de sa valeur et de sa place.
Barrés est comme l'un des derniers romantiques qui se seraient convertis à une doctrine d’action fortement positive. En ce sens, comme Péguy, par exemple, il témoigne de la renaissance, à la fin du siècle, des valeurs et des pratiques d'engagement, d'investissement de soi dans l'entreprise notamment politique. Après le grand vide qui commence en 1848-1851 (les journées de Juin, le coup d'État), la double montée du socialisme et du nationalisme semble mettre un terme à des décennies de sécession des intellectuels. Barrés, rêveur et mélancolique, introverti, prenant sans trop de mal des poses à la Chateaubriand, a commencé par la mise en cause esthétique et sentimentale de l’héritage positiviste. Il devait finir dans la peau d'un « professeur d’énergie ». Comme Claudel se convertissant au catholicisme, c'est contre Taine (et contre Renan) qu'il a commencé à s'éprouver et à s’exprimer. Ses études secondaires (collège de la Malgrange, lycée de Nancy où il suit le cours de philosophie de Burdeau, cousinien et comtiste) lui laissent un sentiment profond de frustration, de révolte. La philosophie positiviste, parisienne, sans liens concrets avec le réel et le vécu et, de plus, tout juste capable de donner des leçons d'arrivisme (il est exact que le comtisme n’a plus, depuis longtemps, de projets généreux et s'ensable, avec l'enseignement républicain, dans un empirisme sans âme) lui apparaît comme un immense système à dévier, à annuler les personnalités. Sous l'œil des Barbares (1888), Un homme libre (1889), le Jardin de Bérénice (1891), que reprennent et approfondissent Du sang, de la volupté et de la mort (1894-1909) et Amori et dolori sacrum (1902), constituent le cycle de ce qu'il appelle le « culte du moi ». À travers des souvenirs de voyage (l'Orient, l'Espagne, Venise) où il a promené et promènera son ardeur et sa sensibilité, il élabore une attitude néoromantique, mais de consonance décadente et fin de siècle. De là naît son premier succès, qui s'adresse, en fait, à un écrivain élégamment morbide et précieux qui renaturalise le vieux spleen en littérature. Une certaine éloquence, une certaine complaisance à l'analyse, qu'avaient déclassée les générations symbolistes, retrouve des lettres de noblesse. Une espèce de nouveau mal du siècle s'exprime alors dans une prose qui sut séduire. Mais il ne faut jamais oublier ce que précisera un jour Barrés : le traumatisme initial avait été la « débâcle » de 1870, assez comparable à celle de 1815 pour la première génération romantique. Le « culte du moi » résulte de cette absence de certitudes et de repères. Mais l'énergie, qui est au centre du dispositif, ne trouve pas encore réellement à quoi se prendre. La révolte est le thème dominant de ces livres, mais une révolte sans objet réel et qui, surtout, ne s'en prend jamais aux fondements mêmes de cette société soi-disant républicaine, en fait bourgeoise, qui étouffe et nie le moi. La vie a perdu son sens. Où et comment lui en retrouver un ? Péguy, lui, pensera d'abord et longtemps que le socialisme est capable
«
la
Malgrange, lycée de Nancy où il suit
le cours de philosophie de Burdeau.
cousinien et comtiste) lui laissent un
sentiment profond de frustration, de
révolte.
La philosophie positiviste, pari·
sienne, sans liens concrets avec le réel
et le vécu et, de plus, tout juste capable
de donner des leçons d'arrivisme (il est
exact que le comtisme n'a plus, depuis
longtemps, de projets généreux et s'ensa
ble, avec l'enseignement républicain,
dans un empirisme sans âme) lui appa
ralt comme un immense système à
dévier, à annuler les personnalités.
Sous
l'œil des Barbares ( 1888), Un homme
libre (1889), le Jardin de B�r�nice
(1891), que reprennent et approfondis·
sent Du sang, de la volupté et de la mort
(1894-1909) et Amori et do/ori sacrum
(1902), constituent le cycle de ce qu'il
appelle le « culte du moi ».
A travers des
souvenirs de voyage (l'Orient, l'Espagne.
Venise) où il a promené et promènera
son ardeur et sa sensibilité, il élabore
une attitude néoromantique, mais de
consonance décadente et fin de siècle.
De
là nalt son premier succès, qui s'adresse,
en fait, à un écrivain élégamment mor
bide et précieux qui renaturalise le vieux
spleen en littérature.
Une certaine élo·
quence, une certaine complaisance à
l'analyse, qu'avaient déclassée les géné
rations symbolistes.
retrouve des lettres
de noblesse.
Une espèce de nouveau mal
du siècle s'exprime alors dans une prose
qui sut séduire.
Mais il ne faut jamais
oublier ce que précisera un jour Barrès :
le traumatisme initial avait été la
« débàcle >> de 1870, assez comparable
à celle de 1 B 15 pour la première généra·
tion romantique.
Le « culte du moi >>
résulte de cette absence de certitudes et
de repères.
Mais l'énergie.
qui est au
centre du dispositif, ne trouve pas encore
réellement à quoi se prendre.
La révolte
est le thème dominant de ces livres.
mais
une révolte sans objet réel et qui, Sur·
tout, ne s'en prend jamais aux fonde
ments mêmes de cette société soi-disant
républicaine, en fait bourgeoise, qui
étouffe et nie le moi.
La vie a perdu son
sens.
Où et comment lui en retrouver
un? Péguy, lui, pensera d'abord et
longtemps que le socialisme est capable d'apporter
la réponse.
Barrés, Lorrain,
va trouver dans le message de sa terre
natale (inséparable des provinces per
dues) de quoi renverser ses tendances
anarchisantes et fonder des perspectives
d'utilisation de soi.
Gide attendra, lui, la
révolution soviétique pour imaginer un
dépassement possible à son propre culte
du moi.
Pour Barrés, beaucoup plus tOt,
le nationalisme va se présenter et être
présenté comme la recette miracle au
romantisme revenu.
La race va sauver
le moi.
· Les DéraciMs (1897), qui s'inscrivent
dans la tradition fortement établie du
« roman d'éducation », font le procès du
système d'enseignement et de promotion
sociale de la République.
Nouvelles Jllu.
sions perdues : à quoi sert cette instruc·
tion abstraite qui jette dans le désert de
la vie moderne des jeunes gens démorali·
sés ? Le boulangisme auquel Barrés se
rallie, comme beaucoup, sur des posi
tions vaguement « de gauche » est
l'étape décisive.
L'Appel au soldat (1900)
met en place les thèmes essentiels :
traditionalisme, culte de la terre, haine
de « l'étranger» et de ses agents plus
ou moins conscients et camouflés, exal·
talion de l'action qui doit conduire aussi
bien à la guerre de revanche qu'au grand
nettoyage politique.
Leurs figures, extra·
ordinaire pamphlet politique inspiré par
le scandale de Panamâ (1902), accentue
la dérive inévitable.
Les vagues tenta·
tions socialisantes qui s'étaient expri·
mées dans le journal la Cocarde dont il
était directeur et rédacteur en chef en
1894-95 s'éteignent alors, et « La France
aux Français » l'emporte.
L'affaire
Dreyfus oppose violemment Barrés à
Zola.
Le contresens s'installe : contre la
grande bourgeoisie régnante, Barrés
n'imagine rien d'autre que le recours à
la petite-bourgeoisie protectionniste, fri
leuse, coléreuse.
Colette Baudoche
( 1 909), qui conclut le Roman de l'�nergie
nationale, fait de lui le grand prêtre
d'une droite violemment antisémite,
antiallemande, antirépublicaine.
L'écri
vain alors va pâlir et se transfonner en
polémiste, en propagandiste.
Mais il faut
savoir lire entre les lignes du fanatique.
En 1913, un livre célèbre, la Colline.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- COLLINE INSPIRÉE (la), de Maurice Barrés
- MES CAHIERS, de Maurice Barrés
- DÉRACINÉS (les) Roman de Maurice Barrés (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- ENQUÊTE AUX PAYS DU LEVANT (Une) de Maurice Barrés (résumé)
- ENNEMI DES LOIS (L’). de Maurice Barrés (1862-1923) (résumé)