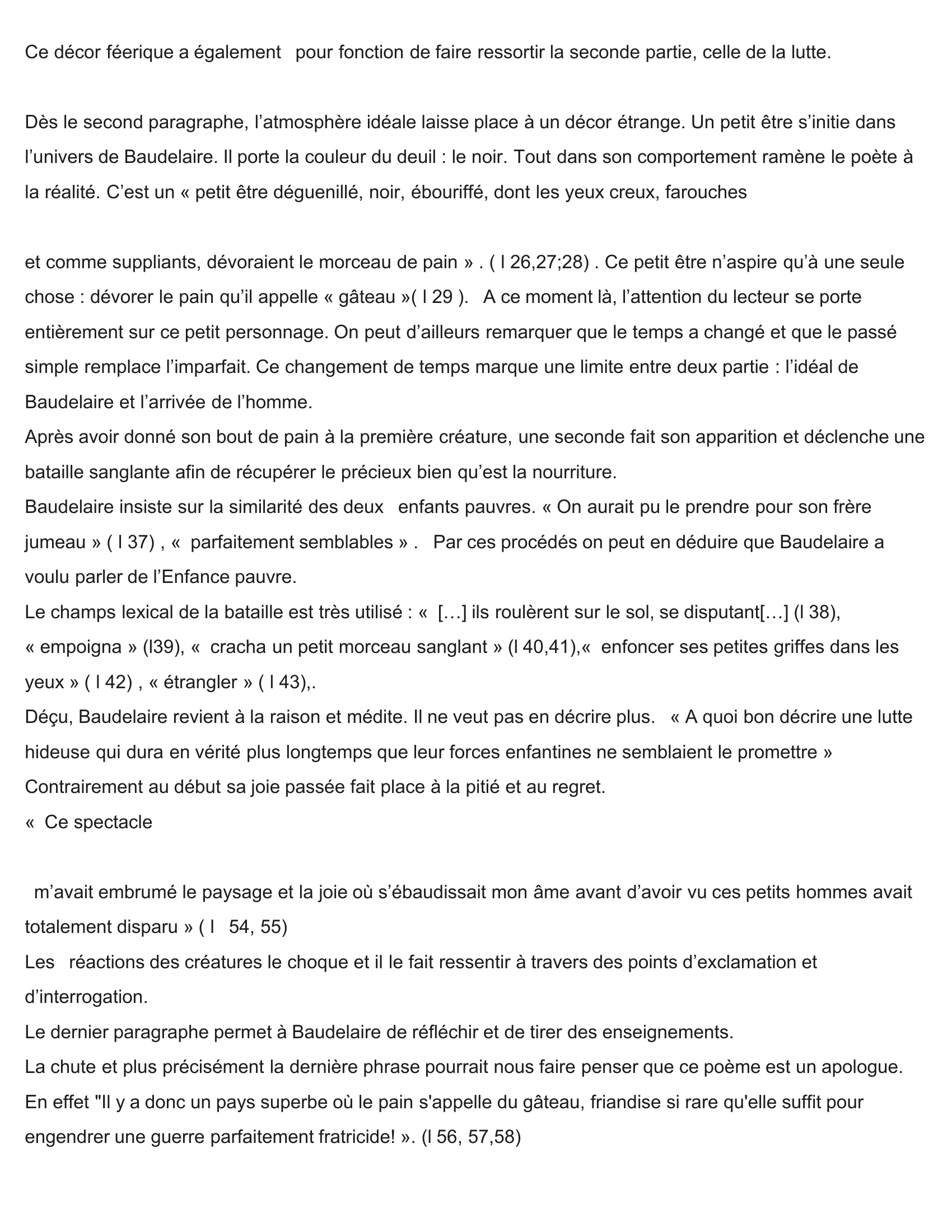Baudelaire Le gâteau - commentaire
Publié le 04/11/2012

Extrait du document

Baudelaire s’inspire d’un fait réel pour ensuite le transformer en un apologue. Cette scène fait partie intégrante de son quotidien et par ces poèmes il cherche à dénoncer les vices et les injustices humaines. Cette foi, le poète a choisi l’enfance comme sujet d’écriture. Dans son recueil « Petits poèmes en prose « , il propose un regard sombre sur la vie des enfants pauvres de son époque. Dans le « joujou du pauvre « il décrit les différences de conditions de vie entre deux enfants. A la chut on se rend compte que le jouet du pauvre enfant n’était en réalité qu’un rat vivant ! En déstabilisant le lecteur, Baudelaire souhaite lui montrer l’image pessimiste qu’il se fait de la vie humaine.

«
Ce décor féerique a également pour fonction de faire ressortir la seconde partie, celle de la lutte.
Dès le second paragraphe, l’atmosphère idéale laisse place à un décor étrange.
Un petit être s’initie dans
l’univers de Baudelaire.
Il porte la couleur du deuil : le noir.
Tout dans son comportement ramène le poète à
la réalité.
C’est un « petit être déguenillé, noir, ébouriffé, dont les yeux creux, farouches
et comme suppliants, dévoraient le morceau de pain » .
( l 26,27;28) .
Ce petit être n’aspire qu’à une seule
chose : dévorer le pain qu’il appelle « gâteau »( l 29 ).
A ce moment là, l’attention du lecteur se porte
entièrement sur ce petit personnage.
On peut d’ailleurs remarquer que le temps a changé et que le passé
simple remplace l’imparfait.
Ce changement de temps marque une limite entre deux partie : l’idéal de
Baudelaire et l’arrivée de l’homme.
Après avoir donné son bout de pain à la première créature, une seconde fait son apparition et déclenche une
bataille sanglante afin de récupérer le précieux bien qu’est la nourriture.
Baudelaire insiste sur la similarité des deux enfants pauvres.
« On aurait pu le prendre pour son frère
jumeau » ( l 37) , « parfaitement semblables » .
Par ces procédés on peut en déduire que Baudelaire a
voulu parler de l’Enfance pauvre.
Le champs lexical de la bataille est très utilisé : « […] ils roulèrent sur le sol, se disputant[…] (l 38),
« empoigna » (l39), « cracha un petit morceau sanglant » (l 40,41),« enfoncer ses petites griffes dans les
yeux » ( l 42) , « étrangler » ( l 43),.
Déçu, Baudelaire revient à la raison et médite.
Il ne veut pas en décrire plus.
« A quoi bon décrire une lutte
hideuse qui dura en vérité plus longtemps que leur forces enfantines ne semblaient le promettre »
Contrairement au début sa joie passée fait place à la pitié et au regret.
« Ce spectacle
m’avait embrumé le paysage et la joie où s’ébaudissait mon âme avant d’avoir vu ces petits hommes avait
totalement disparu » ( l 54, 55)
Les réactions des créatures le choque et il le fait ressentir à travers des points d’exclamation et
d’interrogation.
Le dernier paragraphe permet à Baudelaire de réfléchir et de tirer des enseignements.
La chute et plus précisément la dernière phrase pourrait nous faire penser que ce poème est un apologue.
En effet "Il y a donc un pays superbe où le pain s'appelle du gâteau, friandise si rare qu'elle suffit pour
engendrer une guerre parfaitement fratricide! ».
(l 56, 57,58).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire rédigé Les fenêtres Baudelaire
- La musique de Baudelaire (commentaire et analyse)
- Commentaire : « Sed non Satiata » de Charles Baudelaire
- Commentaire composé : Baudelaire : Le chat
- Commentaire du poème « L'Horloge » de Charles Baudelaire