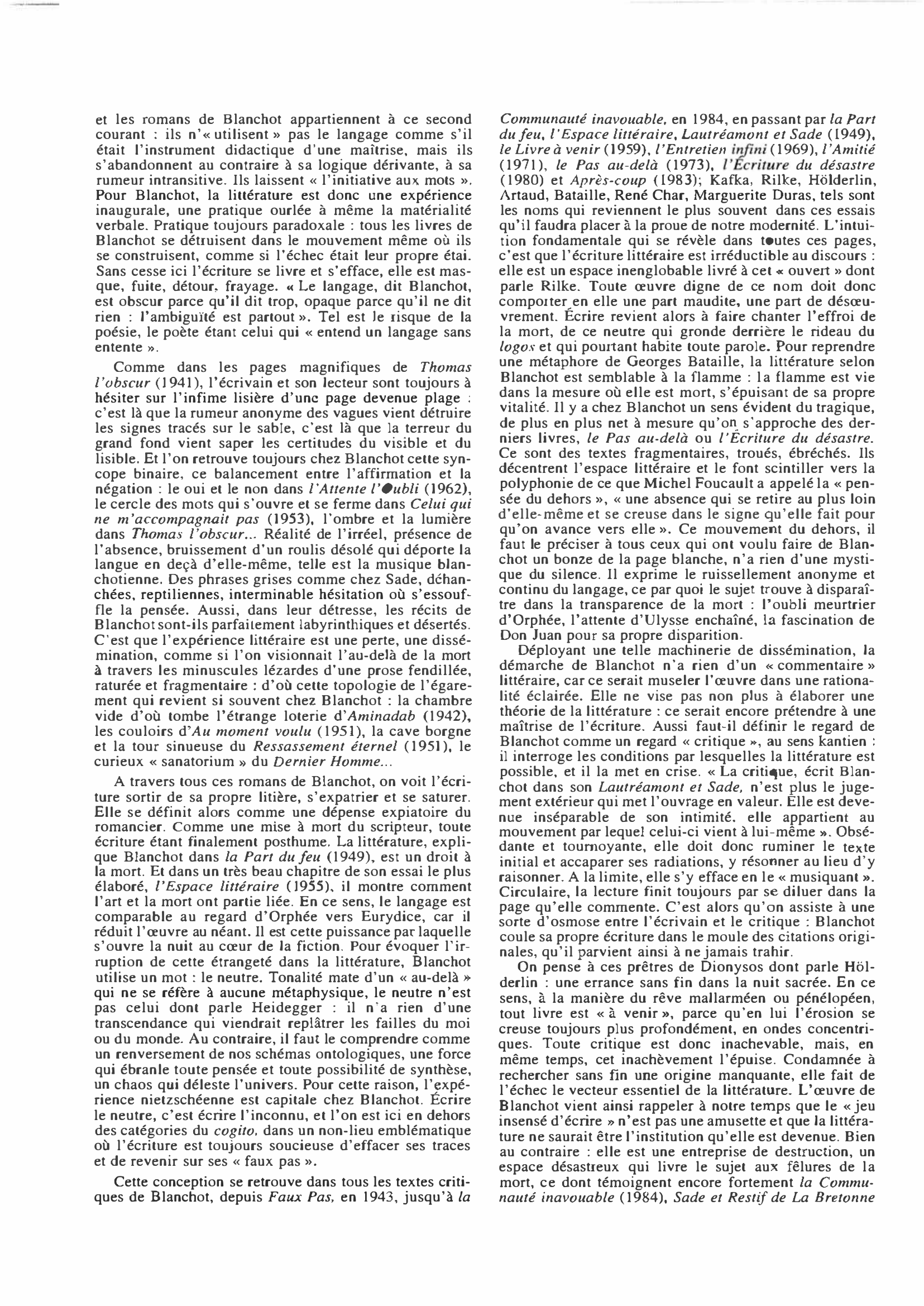BLANCHOT Maurice : sa vie et son oeuvre
Publié le 18/11/2018

Extrait du document

BLANCHOT Maurice (né en 1907). Solitaire et souterraine jusqu’à l’obstination, l’œuvre de Maurice Blanchot est une des plus fascinantes de l'après-guerre. Par l’exigence de sa recherche, elle fait autorité auprès des théoriciens de la littérature, mais également auprès des écrivains qui sont soucieux d’interroger leur propre pratique, à savoir l’espace littéraire. Lancinante, ressassante, sans cesse remodelée et répétée, c’est toujours la même question qui semble rebondir à travers près de quarante années de réflexion : qu’en est-il de l’écriture? Une question que Blanchot, lecteur inégalé, a posée comme critique, d’abord, puis comme romancier : ses récits sont autant de tests où la fabrique textuelle se met à l'épreuve pour interroger son propre fondement.
Aussi, entre la vague phénoménologique des années 1945-1950 et les recherches structurales des années 1970, l'œuvre de Blanchot a-t-elle été une des principales références pour tous ceux qu’a concerné la réflexion sur le langage et sur l’écriture, de Sartre à René Char et de Barthes à Foucault. Influence qui n’a pas manqué de porter la crise dans les discours : après des auteurs comme Valéry ou Bataille, Blanchot a mis enjeu l'existence même de la littérature, sa fonction esthétique, philosophique, idéologique et sociale. Il a mis le feu dans les bibliothèques, illustrant ainsi cette parole de Hôl-derlin que commente Heidegger : « Le langage est le plus dangereux de tous les biens ».
Il y a deux types d'écrivains. Ceux dont les mots servent à colmater les angoisses de l’être et les obscurités du réel : ceux-là rabattent sur le chaos la chape d’une écriture qui se protège derrière les garde-fous de l’ordre et de la représentation, du réalisme et du vraisemblable. Et puis il y a les écrivains dont les mots sont autant de scalpels pour fracturer les choses et les pensées. Du Très-Haut (1948) au Dernier Homme (1957), les récits

«
et
les romans de Blanchot appartiennent à ce second
courant : ils n'« utilisent » pas le langage comme s'il
était l'instrument didactique d'une maîtrise, mais ils
s'abandonnent au contraire à sa logique dérivante, à sa
rumeur intransitive.
Ils laissent « l'initiative aux mots ».
Pour Blanchot, la littérature est donc une expérience
inaugurale, une pratique ourlée à même la matérialité
verbale.
Pratique toujours paradoxale : tous les livres de
Blanchot se détruisent dans le mouvement même où ils
se construisent, comme si l'échec était leur propre étai.
Sans cesse ici l'écriture se livre et s'efface, elle est mas
que, fuite, détour, frayage.
« Le langage, dit Blanchot,
est obscur parce qu'il dit trop, opaque parce qu'il ne dit
rien : l'ambiguïté est partout».
Tel est Je risque de la
poésie, le poète étant celui qui «entend un langage sans
entente».
Comme dans les pages magnifiques de Thomas
l'obscur (1 94 1), l'écrivain et son lecteur sont toujours à
hésiter sur l'infime lisière d'une page devenue plage :
c'est là que la rumeur anonyme des vagues vient détruire
les signes tracés sur le sable, c'est là que la terreur du
grand fond vient saper les certitudes du visible et du
lisible.
Et l'on retrouve toujours chez Blanchot cette syn
cope binaire, ce balancement entre l'affirmation et la
négation : le oui et le non dans l'Attente l'Oubli (1962),
le cercle des mots qui s'ouvre et se ferme dans Celui qui
ne m'accompagnait pas (1953), l'ombre et la lumière
dans Thomas l'obscur ...
Réalité de l'irréel, présence de
l'absence, bruissement d'un roulis désolé qui déporte la
langue en deçà d'elle-même, telle est la musique blan
chotienne.
Des phrases grises comme chez Sade, déhan
chées, reptiliennes, interminable hésitation où s'essouf
fle la pensée.
Aussi, dans leur détresse, les récits de
Blanchot sont-ils parfaitement labyrinthiques et désertés.
C'est que l'expérience littéraire est une perte, une dissé
mination, comme si l'on visionnait l'au-delà de la mort
à travers les minuscules lézardes d'une prose fendillée,
raturée et fragmentaire : d'où cette topologie de l'égare
ment qui revient si souvent chez Blanchot : la chambre
vide d'où tombe l'étrange loterie d'Aminadab (1942),
les couloirs d'Au moment voulu ( 1951 ), la cave borgne
et la tour sinueuse du Ressassement éternel (1951), le
curieux «sanatorium )) du Dernier Homme ...
A travers tous ces romans de Blanchot, on voit l'écri
ture sortir de sa propre litière, s'expatrier et se saturer.
Elle se définit alors comme une dépense expiatoire du
romancier.
Comme une mise à mort du scripteur, toute
écriture étant finalement posthume.
La littérature, expli
que Blanchot dans la Part dufeu (1949), est un droit à
la mort.
Et dans un très beau chapitre de son essai le plus
élaboré, L'Espace littéraire (1 955), il montre comment
l'art et la mort ont partie liée.
En ce sens, le langage est
comparable au regard d'Orphée vers Eurydice, car il
réduit l'œuvre au néant.
Il est cette puissance par laquelle
s'ouvre la nuit au cœur de la fiction.
Pour évoquer l'ir
ruption de cette étrangeté dans la littérature, Blanchot
utilise un mot : le neutre.
Tonalité mate d'un «au-delà»
qui ne se réfère à aucune métaphysique, le neutre n'est
pas celui dont parle Heidegger : il n'a rien d'une
transcendance qui viendrait replâtrer les failles du moi
ou du monde.
Au contraire, il faut le comprendre comme
un renversement de nos schémas ontologiques, une force
qui ébranle toute pensée et toute possibilité de synthèse,
un chaos qui déleste l'univers.
Pour cette raison, l'�xpé
rience nietzschéenne est capitale chez Blanchot.
Ecrire
le neutre, c'est écrire l'inconnu, et l'on est ici en dehors
des catégories du cogito, dans un non-lieu emblématique
où l'écriture est toujours soucieuse d'effacer ses traces
et de revenir sur ses «faux pas ».
Cette conception se retrouve dans tous les textes criti
ques de Blanchot, depuis Faux Pas, en 1943, jusqu'à la Communauté
inavouable, en 1984, en passant par La Part
du feu, L'Espace littéraire, Lautréamont et Sade (1949),
Le Livre à venir (1959), l'Entretien.
infi ni
(1969), l'Amitié
(197 1 ), le Pas au-delà (1973), l' Écri
ture du désastre
( 198 0 ) et Après-coup (19 83); Kafka, Rilke, H.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Denis, Maurice - vie et oeuvre du peintre.
- Utrillo, Maurice - vie et oeuvre du peintre.
- Estève, Maurice - vie et oeuvre du peintre.
- Vlaminck, Maurice de - vie et oeuvre du peintre.
- Cullen, Maurice - vie et oeuvre du peintre.