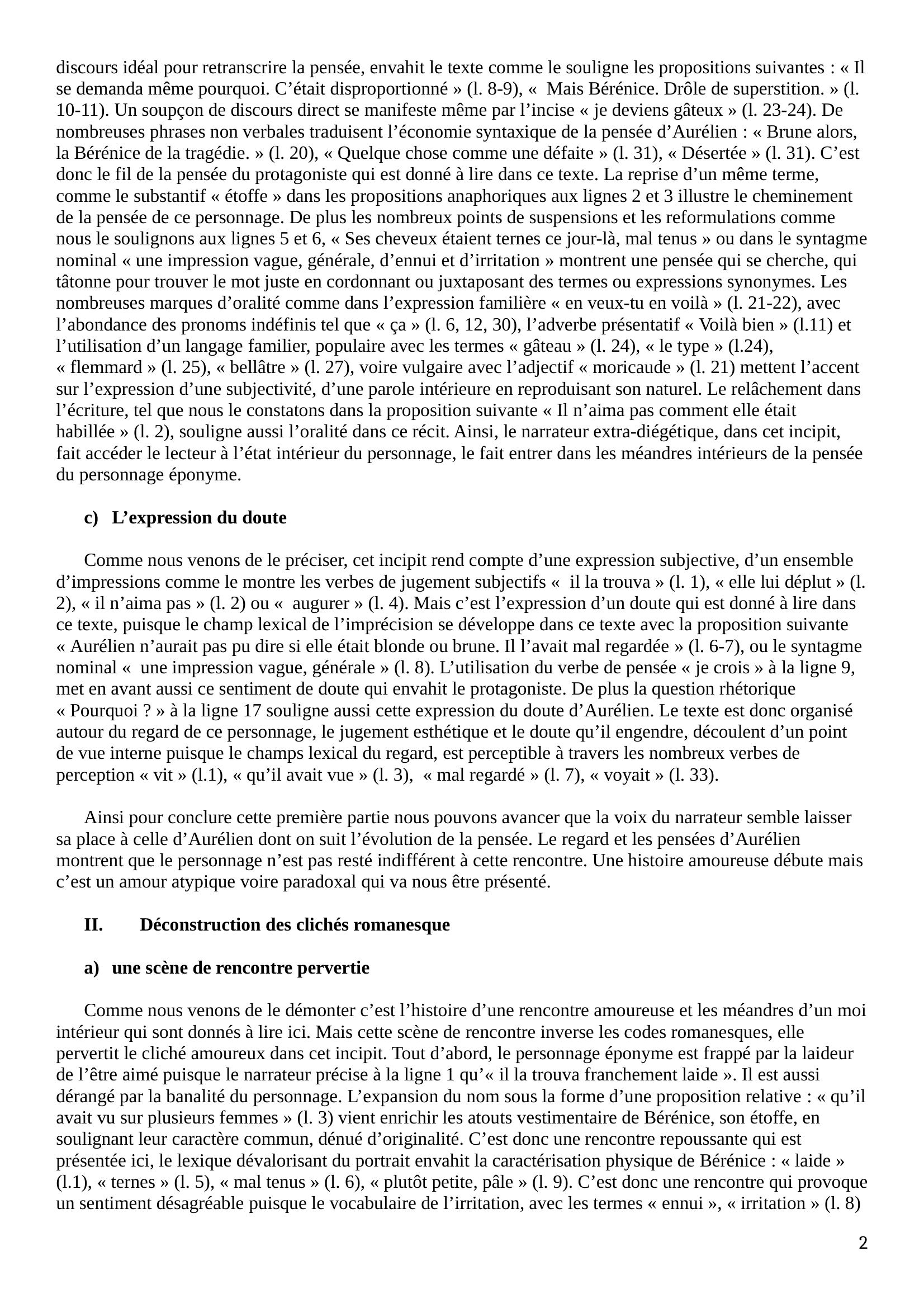CARRASCO Aurélie, M1 master MEEF Étude stylistique Aurélien de
Publié le 30/11/2015

Extrait du document
«
discours idéal pour retranscrire la pensée, envahit le texte comme le souligne les propositions suivantes : « Il
se demanda même pourquoi.
C’était disproportionné » (l.
8-9), « Mais Bérénice.
Drôle de superstition.
» (l.
10-11).
Un soupçon de discours direct se manifeste même par l’incise « je deviens gâteux » (l.
23-24).
De
nombreuses phrases non verbales traduisent l’économie syntaxique de la pensée d’Aurélien : « Brune alors,
la Bérénice de la tragédie.
» (l.
20), « Quelque chose comme une défaite » (l.
31), « Désertée » (l.
31).
C’est
donc le fil de la pensée du protagoniste qui est donné à lire dans ce texte.
La reprise d’un même terme,
comme le substantif « étoffe » dans les propositions anaphoriques aux lignes 2 et 3 illustre le cheminement
de la pensée de ce personnage.
De plus les nombreux points de suspensions et les reformulations comme
nous le soulignons aux lignes 5 et 6, « Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus » ou dans le syntagme
nominal « une impression vague, générale, d’ennui et d’irritation » montrent une pensée qui se cherche, qui
tâtonne pour trouver le mot juste en cordonnant ou juxtaposant des termes ou expressions synonymes.
Les
nombreuses marques d’oralité comme dans l’expression familière « en veux-tu en voilà » (l.
21-22), avec
l’abondance des pronoms indéfinis tel que « ça » (l.
6, 12, 30), l’adverbe présentatif « Voilà bien » (l.11) et
l’utilisation d’un langage familier, populaire avec les termes « gâteau » (l.
24), « le type » (l.24),
« flemmard » (l.
25), « bellâtre » (l.
27), voire vulgaire avec l’adjectif « moricaude » (l.
21) mettent l’accent
sur l’expression d’une subjectivité, d’une parole intérieure en reproduisant son naturel.
Le relâchement dans
l’écriture, tel que nous le constatons dans la proposition suivante « Il n’aima pas comment elle était
habillée » (l.
2), souligne aussi l’oralité dans ce récit.
Ainsi, le narrateur extra-diégétique, dans cet incipit,
fait accéder le lecteur à l’état intérieur du personnage, le fait entrer dans les méandres intérieurs de la pensée
du personnage éponyme.
c) L’expression du doute
Comme nous venons de le préciser, cet incipit rend compte d’une expression subjective, d’un ensemble
d’impressions comme le montre les verbes de jugement subjectifs « il la trouva » (l.
1), « elle lui déplut » (l.
2), « il n’aima pas » (l.
2) ou « augurer » (l.
4).
Mais c’est l’expression d’un doute qui est donné à lire dans
ce texte, puisque le champ lexical de l’imprécision se développe dans ce texte avec la proposition suivante
« Aurélien n’aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune.
Il l’avait mal regardée » (l.
6-7), ou le syntagme
nominal « une impression vague, générale » (l.
8).
L’utilisation du verbe de pensée « je crois » à la ligne 9,
met en avant aussi ce sentiment de doute qui envahit le protagoniste.
De plus la question rhétorique
« Pourquoi ? » à la ligne 17 souligne aussi cette expression du doute d’Aurélien.
Le texte est donc organisé
autour du regard de ce personnage, le jugement esthétique et le doute qu’il engendre, découlent d’un point
de vue interne puisque le champs lexical du regard, est perceptible à travers les nombreux verbes de
perception « vit » (l.1), « qu’il avait vue » (l.
3), « mal regardé » (l.
7), « voyait » (l.
33).
Ainsi pour conclure cette première partie nous pouvons avancer que la voix du narrateur semble laisser
sa place à celle d’Aurélien dont on suit l’évolution de la pensée.
Le regard et les pensées d’Aurélien
montrent que le personnage n’est pas resté indifférent à cette rencontre.
Une histoire amoureuse débute mais
c’est un amour atypique voire paradoxal qui va nous être présenté.
II.
Déconstruction des clichés romanesque
a) une scène de rencontre pervertie
Comme nous venons de le démonter c’est l’histoire d’une rencontre amoureuse et les méandres d’un moi
intérieur qui sont donnés à lire ici.
Mais cette scène de rencontre inverse les codes romanesques, elle
pervertit le cliché amoureux dans cet incipit.
Tout d’abord, le personnage éponyme est frappé par la laideur
de l’être aimé puisque le narrateur précise à la ligne 1 qu’« il la trouva franchement laide ».
Il est aussi
dérangé par la banalité du personnage.
L’expansion du nom sous la forme d’une proposition relative : « qu’il
avait vu sur plusieurs femmes » (l.
3) vient enrichir les atouts vestimentaire de Bérénice, son étoffe, en
soulignant leur caractère commun, dénué d’originalité.
C’est donc une rencontre repoussante qui est
présentée ici, le lexique dévalorisant du portrait envahit la caractérisation physique de Bérénice : « laide »
(l.1), « ternes » (l.
5), « mal tenus » (l.
6), « plutôt petite, pâle » (l.
9).
C’est donc une rencontre qui provoque
un sentiment désagréable puisque le vocabulaire de l’irritation, avec les termes « ennui », « irritation » (l.
8)
2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- étude linéaire poème 4 livre 4 les contemplations: Pauca Mea
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Claude Bernard : Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (fiche de lecture)
- Une étude de la poésie à la lumière de l'esthétique phénoménologique : l'exemple de Francis Ponge
- HdA au Brevet 3e1 Objet d’étude : Arts et progrès techniques Thématique Domaine Période Arts, rupture et continuité Art du langage XXe siècle